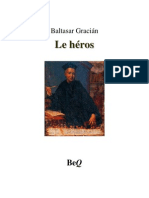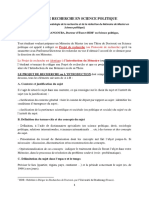Professional Documents
Culture Documents
Morale Et Science Des Moeurs
Uploaded by
Isa LemmypOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Morale Et Science Des Moeurs
Uploaded by
Isa LemmypCopyright:
Available Formats
Lucien Lvy-Bruhl (1903)
LA MORALE
ET LA SCIENCE
DES MURS
Un document produit en version numrique par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi
Courriel: jmt_sociologue@videotron.ca
Site web: http://pages.infinit.net/sociojmt
Dans le cadre de la collection: "Les classiques des sciences sociales"
Site web: http://www.uqac.uquebec.ca/zone30/Classiques_des_sciences_sociales/index.html
Une collection dveloppe en collaboration avec la Bibliothque
Paul-mile-Boulet de l'Universit du Qubec Chicoutimi
Site web: http://bibliotheque.uqac.uquebec.ca/index.htm
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
Cette dition lectronique a t ralise par Jean-Marie Tremblay,
professeur de sociologie au Cgep de Chicoutimi partir de :
Lucien Lvy-Bruhl (1903),
La morale et la science des murs.
Une dition lectronique ralise partir de la 3e dition du livre de
Lucien Lvy-Bruhl publie en 1927.
Polices de caractres utilise :
Pour le texte: Times, 12 points.
Pour les citations : Times 10 points.
Pour les notes de bas de page : Times, 10 points.
dition lectronique ralise avec le traitement de textes Microsoft Word
2001 pour Macintosh.
Mise en page sur papier format
LETTRE (US letter), 8.5 x 11)
dition complte le 22 fvrier 2002 Chicoutimi, Qubec.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
Table des matires
PRFACE DE LA TROISIME DITION (1927)
CHAPITRE PREMIER. - Il n'y a pas et il ne peut pas y avoir de morale thorique
I.
Conditions gnrales de la distinction du point de vue thorique et du point de vue
pratique. - Cette distinction se fait d'autant plus tardivement et difficilement que les
questions considres touchent davantage nos sentiments, nos croyances et nos intrts.
- Exemples pris des sciences de la nature et en particulier des sciences mdicales
Il.
Application au cas de la morale. - Sens particulier que les philosophes ont donn ici
aux mots de thorie et de pratique . - La morale serait une science normative, ou
lgislatrice en tant que thorique. - Critique de cette ide. - En fait, les morales thoriques sont normatives, mais non pas thoriques
III.
L'antithse morale entre ce qui est et ce qui doit tre. - Diffrents sens de ce qui doit
tre dans les morales inductives et dans les morales intuitives. Impossibilit d'une
morale dductive a priori. - Raisons sentimentales et forces sociales qui se sont opposes jusqu' prsent des recherches proprement scientifiques sur les choses morales
IV.
Ide d'une ralit morale qui serait objet de science comme la ralit physique. Analyse de l'ide positive de nature . - Comment les limites de la nature varient
en fonction des progrs du savoir scientifique. - Quand et sous quelles conditions un
ordre donn de faits devient partie de la nature . - Caractres propres de la ralit
morale
CHAPITRE Il. Que sont les morales thoriques actuellement existantes
I.
Les doctrines morales divergent par leur partie thorique et s'accordent par les
prceptes pratiques qu'elles enseignent. - Explication de ce fait : les morales pratiques
ne peuvent pas s'carter de la conscience morale commune de leur temps. - La pratique
ne se dduit donc pas ici de la thorie; mais la thorie, au contraire, est assujettie
rationaliser la pratique existante
II.
De l vient que : 1 la spculation morale des philosophes a rarement inquit la
conscience ; -2 il n'y a gure eu de conflits entre elle et les dogmes religieux ; - 3 elle
se donne pour entirement satisfaisante et possde des solutions pour tous les
problmes, ce qui n'est le cas d'aucune autre science. - En fait, c'est l'volution de la
pratique qui fait apparatre peu peu des lments nouveaux dans la thorie
III.
La pratique aurait ses principes propres indpendamment de la thorie. - Carnade. - La
philosophie morale du christianisme. - Kant et la Critique de la Raison pratique. Effort pour tablir la conformit de la raison et de la foi morale. - Causes de l'insuccs
de cet effort
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
IV.
Pourquoi les rapports rationnels de la thorie et de la pratique ne se sont pas encore
tablis dans la morale. - Les autres sciences de la nature ont travers elles aussi une
priode analogue. - Comparaison de la morale thorique des Modernes avec la
physique des Anciens. - Tant que la mthode dialectique est employe, la mtamorale
subsiste
CHAPITRE III. - Les postulats de la morale thorique
I.
Premier postulat : la nature humaine est toujours identique elle-mme, en tout temps
et en tout lieu. - Ce postulat permet de spculer abstraitement sur le concept de
l'homme . - Examen du contenu de ce concept dans la philosophie grecque, dans la
philosophie moderne et chrtienne. - largissement de l'ide concrte d'humanit au
XIXe sicle, d au progrs des sciences historiques, anthropologiques, gographiques,
etc. - Insuffisance de la mthode d'analyse psychologique, ncessit de la mthode
sociologique pour l'tude de la ralit morale
II.
Second postulat : le contenu de la conscience morale forme un ensemble harmonieux et
organique. - Critique de ce postulat. - Les conflits de devoirs. - L'volution historique
du contenu de la conscience morale. - Stratifications irrgulires; obligations et
interdictions d'origine et de date diverses
III.
Utilit des morales thoriques dans le pass, malgr l'inexactitude de leurs postulats. Fonction qu'elles ont remplie. - La morale antique plus libre et plus affranchie d'arrirepenses religieuses que les morales philosophiques des Modernes jusqu'au XIXe sicle.
- Ici la Renaissance n'a pas eu son plein effet. - Raction la fin du XVIIIe sicle. Succs apparent et impuissance finale de cette raction
CHAPITRE IV. - De quelles sciences thoriques la pratique morale dpend-elle ?
I.
L'objet de la science n'est pas de construire ou de dduire une morale, mais d'tudier la
ralit morale donne. - Nous ne sommes pas rduits constater simplement cet ordre
de faits ; nous pouvons y intervenir efficacement si nous en connaissons les lois
II.
Trois acceptions distinctes du mot morale . Comment s'tabliront les applications de
la science des murs la pratique morale. - Difficult d'anticiper sur les progrs et sur
les applications possibles de cette science. - Sa diffrenciation et ramification
progressives
III.
On peut se reprsenter cette marche d'aprs l'volution de la science de la nature
physique, plus avance. - Causes qui ont arrt le dveloppement de cette science chez
les Anciens. - La physique d'Aristote se propose de comprendre plutt que de
connatre , et descend des problmes les plus gnraux aux questions particulires. Les sciences morales ont encore plus d'un caractre commun avec cette physique. Comment elles prennent une forme plus voisine de celle des sciences modernes de la
nature
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
IV.
Rle considrable des mathmatiques dans le dveloppement des sciences de la nature.
- Jusqu' quel point les sciences historiques peuvent jouer un rle analogue dans le
dveloppement des sciences de la ralit sociale
CHAPITRE V. - Rponse quelques objections
I.
Comment rester sans rgles d'action, en attendant que la science soit faite ? Rponse :
la conception mme de la science des murs suppose des rgles prexistantes
Il.
N'est-ce pas dtruire la conscience morale que de la prsenter comme une ralit
relative ? - Rponse : ce n'est pas parce que nous le connaissons comme absolu que le
devoir nous apparat comme impratif; c'est parce qu'il nous apparat comme impratif
que nous le croyons absolu. -Si les philosophes ne font pas la morale, ils ne la dfont
pas non plus. - Force du misonisme moral. - L'autorit d'une rgle morale est toujours
assure, tant que cette rgle existe rellement
III.
Mais il y a pourtant des questions de conscience : au nom de quel principe les rsoudre
? - Rponse : notre embarras est souvent la consquence invitable de l'volution
relativement rapide de notre socit, et du dveloppement de l'esprit scientifique et
critique. - Se dcider pour le parti qui, dans l'tat actuel de nos connaissances, parat le
plus raisonnable. - Se contenter de solutions approximatives et provisoires, dfaut
d'autres
IV.
Qu'importe que l'autorit de la conscience morale subsiste en fait, si elle disparat en
droit ? Que devient l'idal moral ? - Rponse : analyse du concept d'idal moral. - Part
de l'imagination, de la tradition et de l'observation de la ralit prsente dans le contenu
de ce concept. - Rle conservateur, au point de vue social, d'une certaine sorte d'idalisme moral. - La recherche scientifique, hritire vritable de l'idalisme philosophique
d'autrefois
CHAPITRE VI. - Antcdents historiques de la science des murs
I.
tat prsent de la science des murs. - Principales influences qui tendent maintenir
les anciennes sciences morales : traditions religieuses ; prdominance de la culture
littraire. - Les moralistes ; caractres gnraux de leurs descriptions et de leurs
analyses. - Plus prs de l'artiste que du savant, proccups de peindre ou de corriger, ils
ont peu de got pour la recherche spculative
II.
Les philologues et les linguistes, vritables prcurseurs d'une science positive des
murs. - Leur mthode rigoureuse et scrupuleuse. - Rle analogue des sciences conomiques et de la psychologie exprimentale. - Influence des thories transformistes. Rle capital des sciences historiques. - Conflit apparent et connexion vritable de
l'esprit historique avec la mthode d'analyse gntique du XVIIIe sicle
III.
Lenteur invitable des changements de mthode. - Exemple pris de la physique du
XVIe sicle. - Causes qui retardent la transformation des sciences morales . - Formes de transition o les anciennes mthodes sont encore mles aux nouvelles. -
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
Ncessit d'un clivage nouveau des faits. - Raisons d'esprer que la transformation
s'achvera
CHAPITRE VII. - La morale naturelle
I.
La recherche scientifique consiste, non fonder la morale, mais analyser la ralit
morale donne. - Sa premire dmarche est de reconnatre que cette ralit, quoique
familire, n'en est pas moins ignore
II.
La morale d'une socit donne, une poque donne, est dtermine par l'ensemble de
ses conditions, au point de vue statique et dynamique. - Postulats finalistes sous-jacents
aux conceptions courantes sur le consensus social. - Critique de l'ide philosophique de
morale naturelle . - Toutes les morales existantes sont naturelles. - Comparaison de
la morale naturelle avec la religion naturelle. - L'anthropocentrisme moral, dernire
forme de l'anthropocentrisme physique et mental
III.
Ncessit d'tudier dsormais les morales, passes ou existantes, au moyen de la
mthode comparative. - Impossibilit de les ramener notre propre conscience prise
pour type
IV.
Objection : les vrits morales ont t connues de tout temps. - Rponse : cette conception est inconciliable avec la solidarit relle des diffrentes sries des phnomnes
sociaux qui voluent ensemble. - En fait, la ressemblance des formules n'empche pas
une trs grande diversit de leur contenu. - La justice sociale est un devenir, sinon un
progrs continu. -Influence des grands changements conomiques
CHAPITRE VIII. - Le sentiment moral
I.
Les sentiments et les reprsentations sont insparables les uns des autres. - L'intensit
des sentiments n'est pas toujours proportionnelle la clart des reprsentations. - En
quel sens on peut faire une tude part des sentiments. - Difficults spciales de cette
tude. - Mthode employe par la sociologie contemporaine. - Rsultats obtenus
II.
Analyse sociologique du sentiment d'obligation dans son rapport avec les reprsentations collectives. - Critique de l'ide de sentiment moral naturel. Exemple de
la pit filiale chez les Chinois. - Comment des sentiments contradictoires peuvent
coexister indfiniment dans une mme conscience. - La force de persistance des sentiments est plus grande que celle des reprsentations. - Exemples pris de notre socit
III.
nergie des ractions que les sentiments moraux dterminent. - Rien de plus difficile
modifier que les sentiments collectifs. - Sentiments religieux se portant chez les
Anciens sur toute la nature, chez les Modernes sur la nature morale seulement. Signification, ce point de vue, de la religion de l'Humanit. Comment nous pouvons
restituer la conception sentimentale, aujourd'hui disparue, de la nature physique
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
CHAPITRE IX. - Consquences pratiques
I.
Ide d'un art rationnel fond sur la science des murs. - En quoi il diffrera de la
pratique morale qu'il se propose de modifier. - Le progrs moral n'est plus conu comme dpendant uniquement de la bonne volont. - Il portera sur des points particuliers et
dpendra lui-mme du progrs des sciences. - Tentatives faites jusqu' prsent pour
rformer systmatiquement la ralit sociale. Pourquoi elles ont t prmatures
Il.
Objection : n'est-ce pas aboutir au scepticisme moral ? - Rponse : rien n'est plus loign du scepticisme que la conception d'une ralit soumise des lois, et d'une action
rationnelle fonde sur la connaissance de ces lois. - Sens de cette action. Amlioration
possible d'un tat social donn, sous quelles conditions
III.
Les prescriptions de l'art rationnel ne valent que pour une socit et dans des conditions
donnes. - Ncessit d'une critique des obligations dictes par notre propre morale. Impossibilit de leur reconnatre une valeur immuable et universelle. - Hypocrisie
sociale naissant de l'enseignement moral actuel. Comment la morale existante peut
tre un obstacle au progrs moral
IV.
Conclusion. Schme gnral provisoire de l'volution des rapports de la pratique et de
la thorie en morale. Trois grandes priodes. Disparition, dans la troisime, des
postulats religieux, finalistes, anthropocentriques. - tude de la ralit sociale par une
mthode scientifique. - Applications possibles de cette science dans l'avenir
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
Prface
DE LA TROISIME DITION
(1927)
Retour la table des matires
Il est gnralement admis qu'en matire de morale les changements se font avec
une extrme lenteur. C'est une observation qui ne vaut pas seulement pour les rgles
morales elles-mmes, mais aussi polir la spculation philosophique sur la morale.
Cette spculation n'entre pas volontiers dans de nouvelles voies. Elle s'en tient de
prfrence ses problmes traditionnels. Elle ne les croit bien poss que sous leur
forme habituelle. Essaye-t-on de montrer que cette forme est suranne et que ces problmes, ou du moins certains d'entre eux, ne doivent plus tre poss, aussitt des
malentendus et des conflits se produisent.
La morale et la science des murs devait en faire l'exprience. A peine ce livre
avait-il paru, que l'on pouvait lire dans un compte rendu sommaire 1 : L'auteur...
nous apporte un trait de morale... Avoir mis tous ses soins faire voir qu'aux traits de morale construits par les philosophes, il faut substituer dsormais une science
des murs, qui ne prtendra nullement tre normative, et un art moral rationnel,
fond sur cette science ; - et s'entendre rpondre aussitt, sans ironie, que l'on apporte
un trait de morale ! Je n'en croyais pas mes yeux, je l'avoue. Depuis lors, je suis
revenu de ce grand tonnement. Le mot qui m'avait d'abord si vivement surpris est
devenu pour moi une indication prcieuse. Il m'a clair sur les dispositions d'esprit
de la plupart de mes critiques. Il m'a donn par avance la clef d'un grand nombre
d'objections qui me furent faites. Celles-ci aussi supposent, implicitement, que La
morale et la science des murs est, ou doit tre, un trait de morale. Mon dessein
avait t tout autre, et je l'avais expliqu de mon mieux. Pourquoi, malgr les prcautions prises, le malentendu s'est-il produit cependant ? Peut-tre, en cherchant les
1
Revue de Mtaphysique et de Morale, juillet 1903.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
raisons de ce fait, pourrons-nous la fois rpondre quelques-uns de nos critiques, et
mettre mieux en lumire ce que nous nous sommes propos d'tablir.
La science des murs se substituera-t-elle la morale ? demande M. Fouille 1. Non, rpond-il. On ne dtruit que ce qu'on remplace. La science des murs, qui prtend dtruire la morale, ne saurait la remplacer. Par consquent la morale subsistera.
En quel sens, demanderons-nous notre tour, le mot morale est-il pris ici ?
S'agit-il de la morale en tant qu'elle essaie de se constituer comme science, ou de la
morale en tant qu'elle formule les devoirs de l'homme, et qu'elle donne une expression
abstraite aux injonctions de la conscience ? La science des murs, recherche de
caractre thorique comme la physique ou toute autre science, ne saurait videmment
viser dtruire la morale prise au second sens. Elle ne peut avoir affaire qu' la
morale dite thorique. La question souleve est d'ordre purement spculatif, et elle ne
porte que sur l'objet et la mthode d'une science. Quel que soit le parti qui triomphera,
la moralit n'est pas intresse dans ce dbat. L'emploi du mot morale ne doit pas
laisser subsister d'quivoque sur ce point.
Nous ne croyons pas non plus que la science des MURS ait dtruire la
morale thorique. Elle n'y prtend pas, et elle n'en a pas besoin. A quoi bon s'engager
dans une lutte qui prendrait ncessairement la forme d'une rfutation dialectique des
systmes de morale, et qui impliquerait l'acceptation de principes communs avec
eux ? Il suffit la science des murs de faire voir ce que sont historiquement ces
systmes, comment ils expriment un effort, qui a d ncessairement se produire, pour
rationaliser la pratique morale existante, et de reconnatre le rle parfois considrable
que ces systmes ont jou dans l'volution morale des socits civilises. Mais, si elle
ne les dtruit pas, on peut dire bon droit qu'elle les remplace. Car elle est vraiment
ce que ces systmes n'taient qu'en apparence : une science objective et dsintresse
de la ralit morale.
Pourquoi donc M. Fouille, et plusieurs autres critiques comme lui, soutiennentils que la science des murs dtruit la morale et ne la remplace pas, alors que nous
croyions avoir montr qu'elle la remplace, au contraire, sans avoir la dtruire ? C'est que l'on a peine accepter l'ide d'une science touchant la ralit morale, qui ne
soit pas une morale analogue celles qui ont t proposes jusqu' prsent, c'est-dire la fois thorique et normative. Vous voulez que la science des murs se substitue la morale thorique ? Il faudra donc qu'elle procure le mme genre de satisfaction rationnelle, et qu'elle rsolve les problmes essentiels poss par cette morale. Et comme la science des murs ne contente nullement ces exigences, les critiques
trouvent l ample matire objections. Il est certain que, comme trait de morale ,
la science des murs laisse fort dsirer. Mais si elle tait ce que l'on rclame d'elle,
c'est alors qu'elle ne remplacerait pas la morale thorique : elle ne ferait que la prolonger, sous une forme nouvelle. Elle la remplacera, au contraire, parce qu'elle refuse de
continuer poser en termes abstraits les problmes traditionnels sur le devoir, l'utile,
le bien, etc., parce qu'elle ne spcule plus sur des concepts, comme faisaient Socrate,
Platon et Aristote, parce qu'elle abandonne les discussions dialectiques pour s'attacher
des problmes particuliers et prcis, qui admettent des solutions vrifiables.
Ce dplacement de l'effort spculatif provoque naturellement des rsistances. Dconcerts, et parfois mme inquiets de ne pas retrouver dans la science des murs ce
1
Revue des Deux Mondes, 1er octobre 1905.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
10
qu'ils sont habitus voir dans les traits de morale, les critiques protestent. Il n'y a
rien l que de conforme aux prcdents. L'histoire des sciences de la nature nous
enseigne qu'elles aussi ont d lutter longtemps pour se rendre matresses de leur objet
et de leur mthode. Il leur fallut de longs efforts pour s'affranchir d'une spculation
dialectique et verbale, qui leur dniait la qualit de sciences parce qu'elles ne tenaient
compte que des expriences, et ne se proposaient que des questions particulires bien
dfinies.
La rsistance nous parat - sans doute tort - plus vive encore dans le cas prsent,
o il s'agit de la morale, et peut-tre pourrions-nous, sans trop de peine, dmler les
principales causes qui tendent la prolonger. Sans reprendre ici cette tude, signalons
du moins un prjug qui se retrouve sous beaucoup d'objections qui nous sont faites,
et dont presque aucun critique n'est tout fait exempt. On veut que la spculation sur
la morale soit morale elle-mme, et, comme la science des murs est aussi dpourvue
de ce caractre que peut l'tre la physique ou la mcanique, on lui en fait grief.
Cependant, quelle raison y a-t-il, a priori, pour qu'une science participe aux aspects
moraux ou esthtiques de son objet ? Attend-on d'un trait de physiologie qu'il soit
vivant , d'un ouvrage d'acoustique qu'il soit harmonieux ? Considrez les figures d'un livre de biologie : quelle distance n'y a-t-il pas de ces dessins aux fonctions
vitales dont ils reprsentent l'analyse ! Pareillement, on s'habituera peu peu trouver, dans les ouvrages qui traitent de la science des murs, non pas des dductions
abstraites ou des rflexions de moralistes, mais des observations ethnographiques, des
rponses des questionnaires, des courbes statistiques, des colonnes de chiffres,
toutes choses qui sont en effet, pour l'apprhension immdiate, extrmement loin de
ce que nous appelons morale . Le seul intrt dont la science, en tant que science,
ait se proccuper, n'est-il pas d'objectiver le plus parfaitement possible la ralit
qu'elle tudie ? Ensuite, mais ensuite seulement, on pourra se placer au point de vue
de la pratique, et les applications seront en gnral d'autant plus fcondes que la
recherche scientifique aura t plus dsintresse.
Cette conception pouvait difficilement trouver grce aux yeux de critiques qui,
loin de distinguer ainsi le point de vue de la spculation de celui de la pratique, se
reprsentent au contraire la morale comme la fois thorique et normative, et plus
normative encore que thorique. Certains d'entre eux vont mme jusqu' lui demander
uniquement de systmatiser ce que la conscience commune ordonne. Toute autre recherche leur parat superflue, pour ne pas dire nuisible. Comme les savants, crit M.
Cantecor, ne se croient pas obligs de tenir compte, pour dcider du vrai, des opinions des Patagons ou des Esquimaux, il serait peut-tre temps d'en finir aussi, en
morale, avec les histoires de sauvages 1. L'intrt thorique disparat ici entirement
devant l'intrt pratique. La morale a pour unique objet de dcider du bien , de
ramener leur principe les devoirs que notre conscience nous dicte. Ds lors, puisque
nous ne voulons pas pratiquer la mme morale que les Patagons et les Esquimaux,
quoi l'tude de leurs murs nous servirait-elle ? Nous n'avons que faire d'une science
des murs, tandis que nous ne pouvons nous passer d'une morale thorique normative : comment consentirions-nous la substitution qu'on nous propose ?
Le dissentiment entre notre critique et nous est donc tel qu'il ne s'agit plus ici,
proprement parler, d'une objection, mais plutt d'une divergence totale de principes.
Et cette divergence devient encore plus clatante quand M. CANTECOR demande si
la science des MURS rpond bien nos besoins pratiques . videmment non,
1
CANTECOR, Revue philosophique, avril 1904, p. 390.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
11
elle n'y rpond pas. Mais, selon nous, elle n'a pas y rpondre. Une science, quelle
qu'elle soit, si c'est vraiment une science, rpond notre besoin de connatre, ce qui
est tout diffrent. La science des murs a prcisment pour objet d'tudier la ralit
morale, qui, malgr le prjug contraire, ne nous est pas plus connue, avant l'analyse
scientifique, que ne l'est la ralit physique. Pour y parvenir, elle n'a pas de meilleur
instrument que la mthode comparative, et les histoires de sauvages sont aussi
indispensables pour la constitution des divers types sociaux que l'tude des organismes infrieurs pour la physiologie humaine. Quant nos besoins pratiques , il est
juste sans doute qu'ils trouvent satisfaction. Mais ce n'est pas de la science qu'ils
peuvent immdiatement l'obtenir.
*
**
Une autre difficult, non moins grave que la prcdente, a t souleve. La science des murs ne pourrait prtendre remplacer la morale thorique, non plus parce
qu'elle ne nous donnerait pas l'quivalent de cette morale - raison qui, nous l'avons
vu, revient simplement une fin de non-recevoir -, mais parce que l'ide mme de
cette science serait irralisable. L'analogie tablie entre la nature physique et la
nature morale serait fausse. Objection dcisive, si elle est juste.
M. Fouille l'exprime ainsi : La nature physique est fonde indpendamment
des individus humains, tandis que c'est nous qui, individuellement ou collectivement,
admettons et tablissons un ordre moral quelconque, lequel n'existerait pas sans nos
consciences et nos volonts 1. Cette dernire formule est ambigu. Selon le sens
qu'elle prendra en se prcisant, nous l'accepterons ou nous la rejetterons. M. Fouille
veut-il dire que les faits sociaux se manifestent par le moyen de consciences individuelles, et ne se manifestent que dans ces consciences ? Nous en tomberons d'accord.
Une reprsentation collective est une reprsentation qui occupe simultanment les
esprits d'un mme groupe. Une langue n'existe que dans la pense des individus plus
ou moins nombreux qui la parlent. Une croyance religieuse n'a pas d'autre lieu
que la conscience de chacun de ceux qui la professent. Jamais la sociologie scientifique n'a song nier ces vrits plus qu'videntes. Il lui suffit que les reprsentations
collectives, les langues, les croyances religieuses, et, en gnral, les faits sociaux
soient rgis par un ordre de lois spcifiques, distinctes des autres ordres de lois. - M.
Fouille entend-il que l'ordre moral, dont il parle, c'est--dire ce que nous appelons la
nature morale par analogie avec la nature physique, dpend, pour exister, du
consentement exprs des individus, soit isols, soit runis ? Il nierait alors l'vidence.
Personne aujourd'hui ne conteste plus gure que les institutions sociales, telles que la
religion et le droit, par exemple, constituent pour les individus d'une socit donne
une ralit vritablement objective. Sans doute, elle n'existerait pas sans eux, mais
elle ne dpend pas de leur bon vouloir pour exister. Elle s'impose eux, elle existait
avant eux, et elle leur survivra. C'est l un ordre qui, pour n'tre pas physique,
mais moral , c'est--dire pour avoir lieu dans des consciences, n'en prsente pas
moins les caractres essentiels d'une nature dont les faits peuvent tre analyss et
ramens leurs lois. La sociologie est possible, puisqu'elle existe : quel intrt y
aurait-il revenir, propos de la science des murs, sur ce dbat qui parat puis ?
Mais, cela dit, nous n'avons garde de mconnatre les diffrences trs marques
qui distinguent la nature morale de la nature physique. Nous ne cherchons pas con1
Revue des Deux Mondes, 1er oct. 1905, p. 528.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
12
fondre et encore moins identifier ces deux natures. Nous avons voulu seulement, en
les dsignant du mme nom de nature , appeler l'attention sur un caractre trs
gnral qui leur appartient toutes deux : savoir que les faits, ici et l, sont rgis par
des lois que nous ignorons d'abord, et que la recherche scientifique peut seule dcouvrir. Mais il est trop clair que ce caractre, lui seul, ne suffirait les dfinir ni l'une
ni l'autre : il n'exprime que ce qu'elles ont de commun. De mme, rien n'est plus loin
de notre pense que de rduire tous les faits de la nature morale , quels qu'ils
soient, un mme type, qui serait ncessairement vague. L'analogie que nous nous
sommes efforc d'tablir, loin d'impliquer cet excs de simplification abstraite, nous
met au contraire en garde contre lui. Dire que tous les phnomnes de la nature
physique sont rgis par des lois, est-ce mconnatre ce qu'a de spcifique chaque
catgorie de phnomnes, est-ce confondre, par exemple, les faits physiques avec les
biologiques ? Pareillement, on peut affirmer que tous les phnomnes de la nature
morale sont, eux aussi, soumis des lois constantes, sans effacer les diffrences qui
caractrisent les diverses catgories de ces phnomnes, et qui correspondent aux
grandes divisions de la sociologie. Nous ne nierons donc point que les faits proprement moraux aient leurs caractres spcifiques, qui les distinguent des faits sociaux
les plus voisins (faits juridiques, faits religieux), et davantage encore des faits conomiques, linguistiques et autres.
Ces caractres sont si marqus, si importants aux yeux de la conscience individuelle, qu'elle se sent invinciblement porte y voir l'essence mme du fait moral.
Elle rpugne d'abord admettre qu'il puisse se dsubjectiver , et prendre place
dans l'ensemble des faits sociaux. Il lui parat qu'en l'assimilant eux on le dnature.
On ne la tranquillise pas en spcifiant que, lorsque la science traite le fait moral
comme un fait social, elle n'a pas la prtention d'en saisir ni d'en exprimer l'essence
tout entire, et qu'elle se contente de l'apprhender par ceux de ses caractres qui
permettent l'emploi de la mthode comparative. Elle maintient au contraire que le fait
moral cesse d'exister aussitt que l'on cesse de considrer la relation intime de l'agent
responsable aux actes qu'il a librement voulus : un fait social, observable du dehors,
peut-il avoir rien de commun avec cette relation ?
Cette protestation est assez vive, et assez spontane, pour qu'on soit tent de lui
donner gain de cause. Et, en effet, tant que nous observons les faits moraux dans notre
propre conscience, ou chez ceux qui nous entourent, nous en sentons si profondment
le caractre original et irrductible, que nous ne pouvons presque pas croire qu'objectivs, ce soient encore les mmes faits. Il nous semble qu' tre considrs du dehors,
ils perdent ce qui en fait la ralit et l'essence. Mais transportons-nous par la pense
dans une socit autre que la ntre, bien que dj trs complexe, telle que la socit
grecque ancienne, par exemple, ou les socits actuelles de lExtrme-Orient. Nous
ne sentons plus aussi vivement les faits qui, pour ces consciences exotiques, sont des
faits moraux, et nous concevons sans peine que ce soient des faits sociaux, dont les
conditions peuvent tre dtermines par une recherche scientifique. Nous admettons
qu'un Japonais ou un Annamite ait comme nous une vie morale intrieure, et que
nanmoins les faits de cette vie morale puissent tre considrs d'un point de vue
objectif. Il faut donc l'admettre aussi quand il s'agit de nous, et ne pas tre dupe d'une
illusion d'optique mentale. Les mmes considrations qui valent pour une socit,
valent aussi pour les autres. S'il est vrai, ce qu'on ne peut gure contester, que les
diffrentes sries de faits qui composent la vie d'une socit sont solidaires les unes
des autres, comment les faits moraux feraient-ils seuls exception ? Ne voyons-nous
pas, dans l'histoire, qu'ils varient toujours en fonction des faits religieux, juridiques,
conomiques, etc., qui sont videmment rgis par des lois ? Nous avouerons donc,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
13
tout en respectant le caractre propre des faits moraux, que la science a le droit de les
dsubjectiver en tant que faits sociaux, et de les incorporer comme tels la
nature morale dont elle a pour objet de rechercher les lois.
Il subsiste cependant, selon certains critiques, entre la nature physique et la nature
morale une diffrence telle qu'on ne peut pas conclure de ce qui a t possible pour
l'une ce qui sera possible pour l'autre. La nature physique est fixe. Que nous la
connaissions ou que nous l'ignorions, les phnomnes y ont lieu de la mme manire,
conformment des lois immuables. Les mares montent et descendent, sur les ctes
de l'Ocan, qu'un astronome les ait calcules ou non, exactement la mme hauteur.
Notre science demeure, l'gard des faits de cet ordre, une dnomination extrinsque.
Nous pouvons mesurer d'avance, au moins dans certains cas, avec toute la prcision
dsirable, l'effet que notre intervention produira dans les phnomnes. Cette sret
fait notre scurit, et nous permet nombre d'applications heureuses. Une science et
une technique physiques sont possibles, crit M. Belot, parce que la nature nous est
trangre. C'est parce qu'elle nous ignore que nous pouvons la connatre 1.
En est-il de mme de la nature morale ? - Non, rpond M. Belot, et, semble-t-il,
aussi M. Fouille. Selon eux, la connaissance que nous acqurons de la ralit morale
fait varier cette ralit mme. La rflexion ne peut se porter sur elle sans la modifier.
En connaissant ce que nous sommes, nous devenons autres. Nous ne sommes plus ce
que nous tions tout l'heure, quand nous nous ignorions encore. C'est comme si un
astronome, en dterminant l'attraction solaire et lunaire, en modifiait la force ; comme
si un ingnieur, en calculant l'intensit de la pesanteur en un point donn, l'augmentait
ou la diminuait. S'il en est ainsi, on ne peut plus, videmment, parler de nature
morale . L'analogie sur laquelle nous nous fondions s'vanouit.
Mais cette objection prouve trop. Pour montrer l'impossibilit de la science des
murs, et dans l'intrt de la morale traditionnelle, elle irait jusqu' soutenir qu'une
partie importante des phnomnes de la nature chappe au principe des lois. Cependant, M. Fouille lui-mme, et nos critiques en gnral, se contentent d'ordinaire d'affirmer qu'il n'est pas impossible de concilier ce principe, considr comme s'appliquant l'universalit des phnomnes, avec les exigences de la morale, ou, en d'autres
termes, que les lois de la nature n'excluent pas la contingence. Nous n'avons pas
discuter cette thse mtaphysique : il nous suffit de remarquer que, si ses partisans ne
l'abandonnent pas, l'objection prcdente perd presque toute sa porte. Elle ne prouvera plus que la science des MURS ou de la nature morale est impossible. Elle fera
seulement ressortir une difficult spciale, et trs grave, particulire cette science et
aux applications qu'on en voudrait tirer. Si vraiment la connaissance ici modifie
l'objet mme sur lequel elle porte, c'est une complication de plus dont il faut tenir
compte, dans une recherche dj trs malaise : ce n'est pas une raison de renoncer
cette recherche. Une difficult analogue semblait s'opposer l'emploi de l'exprimentation en physiologie. Vous voulez, disait-on, obtenir une observation plus
rigoureuse des phnomnes biologiques, et votre intervention, si limite qu'elle soit, a
pour effet immdiat de faire varier ces phnomnes et leurs rapports : ce que vous
vouliez observer a disparu. En vertu du consensus vital, ds le moment o l'exprimentateur opre, une infinit de modifications se produisent dans l'organisme. L'tat
chimique du sang, des humeurs, les scrtions, etc., tout a chang. - Les physiologistes ne se sont pas laiss dcourager par ces objections prjudicielles. Ils ont expriment, et bien leur en a pris. Pareillement, les sciences de la nature morale tra1
Revue de Mtaphysique et de Morale, septembre 1905, pp. 748-749.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
14
vaillent la recherche des lois des faits sociaux, et elles parviennent dj des
rsultats satisfaisants, sans se laisser arrter par les difficults inhrentes la nature
de leur objet, en particulier par l'extrme variabilit que signalent M. Belot et M.
Fouille, et que d'ailleurs les faits sociaux ne manifestent pas tous au mme degr.
La forme que leur objection a prise vrifie une fois de plus une rflexion profonde
d'Auguste Comte au sujet du principe des lois. Ce principe, disait-il, n'est solidement
tabli que pour les ordres de phnomnes naturels o des lois invariables ont t en
effet dcouvertes. On l'tend, par analogie, aux ordres de phnomnes plus complexes, dont on ne connat pas encore de lois proprement dites, et on lui donne une
valeur universelle. Mais cette vague anticipation logique demeure sans valeur
comme sans fcondit. Rien ne sert de concevoir, abstraitement, qu'un certain ordre
de phnomnes doit tre soumis des lois. Cette conception vide ne peut contrebalancer les croyances thologiques et mtaphysiques relatives ces phnomnes, qui
ont pour elle la force de la tradition. Celles-ci ne cdent la place que lorsque quelques
lois ont t en effet trouves et dmontres. Il ne faut donc pas s'tonner si ceux
mmes qui admettent, en principe, la possibilit d'une science naissante, contestent en
fait cette possibilit quelques pages plus loin.
Enfin, il est tmraire d'affirmer que les faits d'un certain ordre ne peuvent pas,
qu'ils ne pourront jamais tre pris d'un biais tel qu'ils deviennent objets d'une science
positive et qu'ils prtent des applications fondes sur cette science. On risque d'tre
dmenti par des dcouvertes imprvues. Comme celles-ci dpendent, en gnral, de
progrs de mthode, de procds nouveaux d'analyse et de classification, tant que ces
procds n'ont point paru, on a beau jeu pour proclamer qu'ils ne se produiront pas.
Mais cette position n'est pas sre. On peut en tre dlog demain, par l'extension
inattendue d'un artifice de mthode, dont souvent celui mme qui l'a invent, tout
entier son travail de recherche positive, n'avait pas pressenti la porte. Ou bien une
dcouverte se trouve avoir des consquences inattendues pour des sciences qui n'y
paraissaient pas du tout intresses. Comment les inventeurs de la photographie, par
exemple, auraient-ils devin que leur dcouverte serait d'un grand prix pour l'astronomie, et qu'elle permettrait la connaissance de corps clestes jusque-l invisibles ?
De nos adversaires et de nous, c'est donc nous qui sommes le plus rservs dans
nos affirmations. Selon eux, une science des murs et une technique fonde sur cette
science sont impossibles, cause des caractres des faits moraux. - Impossibles sans
doute, si l'on considre ces faits du point de vue o la conscience individuelle les
aperoit et les sent, mais non pas si on les soumet un clivage qui les rende propres
une laboration scientifique. Nos critiques affirment de la sociologie ce qui est vrai
des sciences morales auxquelles justement la sociologie se substitue. C'est le propre
du progrs scientifique de faire apparatre la ralit donne sous un aspect qui ne
pouvait tre prvu. Une grande dcouverte, comme celles de Newton ou de Pasteur,
par exemple, oblige leurs contemporains soit abandonner, soit radapter, tout un
ensemble d'ides et de croyances : ce ne sont pas des changements sur lesquels on
puisse anticiper. - Mais, dira-t-on, vous prjugez bien vous-mme des rsultats qu'obtiendra la science des murs! - Non pas ; je prjuge seulement qu'elle en obtiendra, et
de quelle sorte, en me fondant sur les analogies que permet l'histoire des sciences.
Mais je ne prjuge pas quels ils seront, prcisment parce que je sais qu'ils sont
imprvisibles quant leur contenu. Nos adversaires soutiennent que cette science
n'existera pas, ou, s'ils en admettent l'existence, ils raisonnent comme si elle ne devait
rien apporter de vraiment nouveau, rien qui oblige quitter, ou du moins modifier,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
15
leur attitude mentale actuelle. C'est par l qu'ils sont imprudents, et sourds la leon
que proclame le pass de l'esprit humain.
*
**
Soit, disent les critiques. Supposons cette science faite, ou du moins suffisamment
avance. Mme dans cette hypothse (que rien n'oblige accepter ds prsent), elle
ne permet pas de constituer une morale. Il est sophistique, crit l'un d'eux 1, de
constituer une morale sans finalit... L'auteur de La morale et la science des murs
n'a pas russi viter les jugements de valeur et les prfrences sentimentales... La
connaissance des lois est la condition ncessaire et non suffisante de notre intervention raisonne dans les phnomnes moraux.
En premier lieu, l'objection implique que la science des murs devra remplir le
double office auquel la morale thorique a suffi jusqu' prsent, c'est--dire qu'elle
devra tre la fois thorique et normative. Mais faut-il rpter qu'elle n'a rien de
commun avec un trait de morale ? Nous avons essay de montrer, au contraire,
qu'ici comme ailleurs le point de vue thorique, ou l'tude scientifique de la ralit
donne, devait tre soigneusement spar du point de vue pratique, c'est--dire de la
dtermination des fins et des moyens dans l'action ; que, jusqu' prsent, cette distinction, pour des raisons fortes et nombreuses, d'ailleurs faciles expliquer, n'avait pas
t rellement faite en morale ; mais que le temps paraissait venu de l'tablir, dans
l'intrt commun de notre savoir et de notre pouvoir. Accordons que l'auteur de l'objection ait raison, et qu'il soit impossible de constituer une morale sans faire appel
des jugements de valeur. Cela ne touche que celui qui veut constituer une morale.
Nous n'ambitionnons rien de tel. Le but o nous tendons est autre. Nous cherchons
fonder une science qui ait la nature morale pour objet, et, s'il se peut, un art moral
rationnel, qui tire des applications de cette science.
Mais, insiste-t-on, c'est ici prcisment que des considrations de finalit, que des
jugements de valeur devront intervenir. Comment chercher des applications, sans
avoir rflchi sur les fins et choisi celles que l'on voudra poursuivre ? Pour les sciences de la nature physique, le problme est aussitt rsolu que pos. Aucune hsitation
n'est possible. Les sciences mdicales servent combattre la maladie et protger la
sant. Les sciences physiques et mcaniques servent domestiquer les forces
naturelles et conomiser le travail humain. Mais les sciences de la ralit morale,
quoi les appliquerons-nous ? Une spculation d'un autre ordre sera videmment
ncessaire pour dmontrer que telle fin est prfrable telle autre, au point de vue de
l'individu ou au point de vue de la socit. Il faudra tablir une chelle de valeurs. La
science des murs, par dfinition, est hors d'tat de le faire. Sa fonction unique est
d'analyser la ralit donne. En sorte que, en l'absence de la morale thorique qu'elle
prtendait remplacer, cette science des murs restera inutilisable. La morale thorique actuelle essaie au moins de dterminer le fondement de l'obligation morale,
l'objet suprme de notre activit, les rapports des tendances gostes et des sentiments
altruistes. La science des murs n'en fait rien. Supposons-la acheve : elle ne nous est
d'aucun secours en prsence de ces problmes. Mais si elle ne nous sert pas les
1
Revue de Mtaphysique et de Morale, juillet 1903.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
16
rsoudre, nous ne pouvons pas non plus nous servir d'elle : car, pour l'employer, nous
devrions d'abord savoir quoi.
L'objection est spcieuse. Elle exprime, sous un aspect nouveau et saisissant, le
trouble que produit la substitution de la science des murs la morale thorique, et
les difficults d'une transition qui n'est pourtant pas aussi brusque qu'elle peut le
paratre.
Ici encore, l'histoire de la philosophie et des sciences nous fournira une analogie
prcieuse. Quand les sciences Positives de la nature physique se sont dfinitivement
substitues la spculation dialectique qui les avait prcdes, en ont-elles accept
l'hritage entier ? Ont-elles repris leur compte, sous une forme nouvelle, tous les
problmes auparavant agits ? Certes non. De ces problmes, elles ont retenu seulement ceux qui relevaient de la mthode exprimentale et du calcul. Quant aux autres,
aux problmes transcendants, elles les ont considrs comme hors de porte, et elles
se sont abstenues d'y toucher. Mais elles n'ont pas ni pour cela qu'ils existassent, ni
interdit une autre sorte de spculation de les aborder. De quel droit, au nom de quels
principes l'auraient-elles fait ? Le physicien ne spcule pas sur l'essence de la matire
ou de la force, ni le biologiste sur l'essence de la vie : mais tous deux reconnaissent
qu'il est loisible au mtaphysicien de s'y risquer. Un processus semblable de diffrenciation se produit lorsque les sciences de la nature morale remplacent la spculation
dialectique. Ces sciences, positives par la conception de leur objet et par la pratique
de leur mthode, ne retiennent pas non plus tous les problmes traits par cette
spculation. Mais elles ne prononcent pas une sorte d'interdit sur ceux qu'elles abandonnent. Pourquoi se donneraient-elles l'air de mriter le reproche que fait J. S. Mill
Auguste Comte, de ne pas vouloir laisser de questions ouvertes ? Libre la mtaphysique, ou, si l'on nous permet le mot, la mtamorale, de s'attacher aux problmes de
la destine de l'homme, du souverain bien, etc., et de continuer y appliquer sa
mthode traditionnelle.
Quant prtendre qu'ils doivent tre rsolus d'abord, pour que la science positive
puisse recevoir des applications, c'est ne tenir aucun compte de la diffrenciation que
nous venons de rappeler. C'est admettre implicitement que, si la science des murs
tait faite, nous nous poserions encore, et dans les mmes termes, les problmes
btards, la fois thoriques et pratiques, sur lesquels spculent les traits de morale.
Je m'y refuse pour ma part. Le concept de cette science, qui est vide pour vous, est
plein pour moi. La ralit morale qui en fait l'objet, je la considre vraiment comme
une nature , qui m'est familire sans doute, mais qui ne m'en est pas moins inconnue, et dont j'ignore les lois. Par suite, les questions que la spculation morale a
poses jusqu' prsent au sujet de cette ralit portent ncessairement la marque de
notre ignorance : j'ai les plus fortes raisons de douter qu'elles se posent encore de la
mme faon, quand celle-ci aura disparu, ou sensiblement diminu. A l'heure actuelle,
la morale traite surtout des questions relatives aux fins les plus hautes, et rien n'est
plus naturel. La tradition, les exigences du sentiment, les besoins logiques de l'entendement, tout conspire mettre au premier plan ce genre de questions. Faut-il
poursuivre le bonheur, individuel ou social ? Quel idal moral faut-il se proposer ?
Quel est le but suprme de l'activit humaine, etc. ? Tout serait gagn, pense-t-on, si
l'on trouvait une rponse dfinitive ces problmes, et aujourd'hui encore des philosophes se flattent d'y apporter de vritables dmonstrations.
Mais cette confiance en la mthode dialectique, peu justifie d'ailleurs jusqu' prsent par le succs, prouve seulement combien certaines habitudes d'esprit sont diffici-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
17
les draciner. Elle mconnat qu'il existe une ralit morale extrmement complexe,
dont nous ne pouvons pas esprer dcouvrir les lois par une analyse abstraite, et par
une simple manipulation de concepts. Si elle fait une place la science positive de
cette ralit, c'est une place subordonne. Elle lui assigne pour rle d'indiquer les
moyens les plus propres atteindre les fins qui auront t dtermines par la spculation morale. Mais cette conception, pour employer une expression anglaise, est tout
fait preposterous. C'est la science, au contraire, qui, en nous apprenant peu peu
discerner ce qui est possible pour nous de ce qui ne l'est pas, fera apparatre en mme
temps quelles fins il est raisonnable de poursuivre.
Rserve est faite, bien entendu, des fins qui sont tellement universelles et instinctives, que sans elles il ne pourrait tre question ni d'une ralit morale, ni d'une
science de cette ralit, ni d'applications de cette science. On prend pour accord que
les individus et les socits veulent vivre, et vivre le mieux possible, au sens le plus
gnral du mot. Il n'est pas absurde, sans doute, de soutenir que les socits et les
individus feraient mieux de ne pas le vouloir, et Schopenhauer a employ un admirable talent dfendre cette thse ; mais c'est l une question mtaphysique au premier
chef. La science a le droit de postuler ce genre de fins universelles, et c'est de son
progrs que dpendra ensuite la dtermination de fins plus prcises.
Faut-il montrer que ces fins varient ncessairement avec l'tat de nos connaissances ? Tant que celles-ci consistent en un mlange d'observations plus ou moins rigoureuses et de conceptions d'origine subjective, les fins gardent un caractre abstrait et
chimrique. Avant que les sciences de la nature fussent dfinitivement constitues, et
en tat de porter des fruits, pouvait-on avoir seulement l'ide des fins positives
qu'elles permettent aujourd'hui de poursuivre et d'atteindre ? Une de ces fins qui nous
paraissent aujourd'hui le plus naturelles, tellement nous y sommes habitus par le
spectacle de ce qui nous entoure, c'est la substitution de la machine l'homme. La
pesanteur, la vapeur, l'lectricit, doivent travailler pour nous. Pourtant, c'est une fin
dont les socits antiques se sont peu proccupes. Elles se contentaient, pour presque
tous les travaux, de la main-duvre fournie par les esclaves et par les petits artisans.
Qui a suggr aux socits modernes de l'Occident la poursuite de cette fin nouvelle,
dont les consquences sociales porteront si loin ? Elle provient d'un ensemble de
causes complexes, mais avant tout du dveloppement des sciences mathmatiques et
physiques, qui a permis la construction de machines dont l'Antiquit ne pouvait avoir
ni l'ide ni le dsir. Est-il tmraire d'augurer qu'un processus analogue se produira au
sujet de la nature morale ? Aujourd'hui, la morale thorique spcule encore en vue
d'tablir une chelle des fins qui nous apparaissent comme dsirables, belles ou
rationnelles, indpendamment de toute connaissance positive autre que l'analyse de la
nature humaine en gnral. Mais que la science de la ralit morale se dveloppe
comme ont fait les sciences physiques depuis le XVIe sicle : elle fournira sur cette
ralit des prises dont nous n'avons pas, dont nous ne pouvons pas avoir actuellement
l'ide, et ces prises leur tour suggreront des fins poursuivre qu'aujourd'hui nous
ne pouvons pas non plus concevoir. Compares celles dont traitent les morales
thoriques, ces fins seront sans doute plus spciales et plus modestes ; mais ce
qu'elles perdront en gnralit elles le gagneront en efficacit. Au lieu de s'imposer
tout tre libre et raisonnable , elles prsenteront probablement la mme varit que
les types sociaux. Disons seulement, sans nous hasarder des prvisions trop aventureuses, que les fins qui seront alors conues et poursuivies ne dpendront plus, pour
tre dtermines, de la spculation mtaphysique.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
18
L'objection principale carte, les difficults secondaires du mme ordre s'effacent en mme temps. Nous avons fait voir que nous n'essayons point de constituer
une morale sans finalit . Peu importe, aprs cela, que nous n'ayons pas russi
viter les jugements de valeur et les prfrences sentimentales . Pourquoi d'ailleurs nous interdirions-nous les considrations de finalit, si l'objet de notre science
les comporte ? Elles peuvent tre un auxiliaire trs utile de la recherche. Les sciences
biologiques ne se font pas faute de l'employer. Les socits diffrent sans doute des
organismes vivants, mais elles prsentent du moins ce caractre commun avec eux
qu'en vertu d'un consensus intime, les parties et le tout s'y commandent rciproquement. Rien n'empche donc que les sciences de la ralit morale ne se servent aussi
des considrations de finalit comme d'un procd heuristique. Quant aux jugements
de valeur, il faut distinguer s'ils sont relatifs ou absolus. La science positive doit s'abstenir de ceux qui prtendraient tre absolus et assigner des valeurs d'ordre transcendant. Mais peut-on lui dnier le droit de formuler des jugements de valeur relatifs ?
Quand la science biologique remarque que dans le corps humain actuel il y a un grand
nombre d'organes inutiles, dont quelques-uns deviennent souvent dangereux, elle
prononce un jugement de valeur, qui est parfaitement lgitime. De mme, la science
des MURS pourra observer que telle rgle actuellement en vigueur, et obligatoire,
dans une socit donne, y est nuisible : elle formulera ainsi un jugement de valeur,
sans excder ce qui lui est permis. Il n'est que trop vrai que toutes les socits
existantes ont besoin d'tre amliores . La science a le droit d'en constater les imperfections : trop heureuse si elle permettait aussi de prescrire un moyen sr d'y
remdier.
II
L'ide d'une science des MURS substitue la morale thorique ne heurte pas
seulement d'antiques habitudes d'esprit. Elle veille aussi des inquitudes au point de
vue social. A entendre dire que les faits moraux sont des faits sociaux, que toutes les
morales sont naturelles, que chacune d'elles est fonction des autres sries de faits dans
la socit o on l'observe, plus d'un critique se demande si la doctrine nouvelle, dj
peu rassurante au point de vue thorique, ne met pas en pril la moralit elle-mme.
Elle ne serait pas seulement aventureuse et inexacte, elle serait en outre dangereuse et
subversive. Tous, il est vrai, n'expriment pas ces craintes : on les rencontre nanmoins
souvent. M. Fouille les a dveloppes longuement, en s'appuyant sur la loi nonce
par Guyau : La rflexion dissout l'instinct. Il estime que cette doctrine conduit au
scepticisme moral . Il proclame que l'humanit ne se contentera jamais d'une
morale par provision 1. Selon M. Cantecor, nous voil dmunis de toute rgle 2.
M. Belot n'est pas moins affirmatif. Il est contradictoire de vouloir instruire une
socit du caractre provisoire de sa morale, et d'esprer en mme temps qu'elle ne
s'en apercevra pas... C'est la pioche du dmolisseur... C'est pour la socit une
euthanasie morale 3.
1
2
3
Revue des Deux Mondes, octobre 1905, pp. 539, 541, 543.
Revue philosophique, mars 1904, p. 236.
Revue de Mtaphysique et de Morale, juillet 1905, p. 582.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
19
Ce genre d'argument fait beaucoup d'impression. On peut considrer comme de
bonne guerre d'y avoir recours. Mais il est moins sr qu'il ne parat d'abord, et il
relve plutt de la polmique que de la discussion scientifique. Il a le dfaut d'tre
indirect. Pour rfuter une doctrine qui prtend dmontrer qu'elle est vraie, il faudrait
prouver qu'elle est fausse. On lui objecte que, si elle tait vraie, les consquences en
seraient fcheuses, et qu'il vaut donc mieux qu'elle ne le soit pas. Mais cette prfrence sentimentale ne change rien la ralit des choses. Si la doctrine est vraie, il
sera bien difficile, la longue, de l'empcher d'vincer les autres. Le meilleur parti
prendre, dans ce cas, serait de l'accepter, et de parer de son mieux aux consquences
que l'on redoute. Au reste, l'exprience a montr qu'une rfutation par les consquences peut tout au plus arrter la diffusion d'une doctrine vraie, et jeter la dfaveur sur
les premiers qui la soutiennent. Elle ne fait que retarder ainsi une victoire qu'elle
n'empche pas.
Mais laissons ce point prliminaire. A ces apprhensions, dans la mesure o elles
sont sincres, on rpondra qu'elles proviennent d'une illusion o les philosophes se
sont complu, sans grand dommage d'ailleurs, except pour leurs systmes. Ils croient
fonder la morale, au sens plein du mot, ils croient aussi que si ce fondement vient
manquer, la moralit va disparatre. En vain nous avons essay de montrer que la
morale, en ce sens, n'a pas plus besoin d'tre fonde que la nature, et que si les
philosophes ne font pas la morale, ils ne la dfont pas non plus. Les critiques rpliquent que des rgles morales dont les hommes connatraient la nature relative et
provisoire perdraient ncessairement leur autorit et ne sauraient plus imposer le respect. La science des murs serait mortelle la conscience morale.
Appelons-en aux faits, et prenons pour exemple des obligations auxquelles nous
nous conformons tous ou presque tous avec une grande rgularit : les obligations de
politesse et les gards pour autrui qui sont de rgle dans le groupe social o nous
vivons. Nous les observons parce que nous y avons t plis ds l'enfance, parce que
nous sentons qu' les violer nous prouverions une sorte de disgrce, et que nous nous
exposerions des ennuis fort dsagrables. Supposons maintenant que la science nous
rvle l'origine de ces obligations, leur rapport avec les conditions gnrales de notre
socit, et mme le caractre fortuit de la plupart d'entre elles, qui auraient pu ne pas
exister, ou tre diffrentes, et qui sont autres en effet chez d'autres peuples. Quel effet
cette connaissance aura-t-elle sur notre conduite ? Cesserons-nous d'observer ces
rgles ? En perdrons-nous le respect ? videmment non. Et l o le respect des rgles
mondaines prend la forme du snobisme, cette connaissance pourra-t-elle rien contre
lui ? Il est donc certain que les forces qui assurent l'obissance volontaire ces
prescriptions ne dpendent point de l'ignorance o nous sommes de leur origine, et ne
sont pas paralyses, ni mme affaiblies, quand cette ignorance se dissipe.
Mais, dira-t-on, ce ne sont l que des convenances et des usages, c'est--dire quelque chose d'extrieur, o la conscience morale n'est pas intresse, et o notre avantage personnel pousse presque toujours l'observation des rgles. Il en va autrement
des vrais devoirs. - Se pourrait-il donc que les simples formalits de la vie sociale
eussent une assiette plus solide que les obligations morales qui en assurent la dure ?
Il n'en est rien, et l'exprience tmoigne pour celles-ci exactement comme pour les
autres. Soit, par exemple, le devoir de sacrifier la justice l'intrt personnel, de
rendre la vrit un tmoignage qui dplaira ceux dont on dpend. Un homme
honnte et courageux parlera. Un homme faible ou malhonnte se taira. Qu'il prenne
l'un ou l'autre parti, c'est une question d'espce : il aura toujours senti l'obligation.
Croit-on que la connaissance scientifique des lois qui rgissent les faits moraux, et du
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
20
caractre relatif de toute morale, fasse qu'il ne la sente Plus, ou qu'il la considre
comme ngligeable ? On imagine aisment des influences qui, dans des circonstances
donnes, touffent la voix de la conscience : la contagion du. mauvais exemple, l'esprit de corps, la pression de l'opinion publique, la crainte de se compromettre, d'autres
encore. Mais on ne voit pas comment une connaissance purement thorique pourrait
contrebalancer la force du sentiment moral. Il faudrait, pour cela, que cette force ft
simplement apparente et la merci d'un changement d'opinion. Et c'est bien ce qu'implique l'objection qui nous est faite. Comme la moralit s'exprime dans les consciences par des impratifs, on soutient qu'elle appartient la catgorie du devoir-tre,
et non celle de l'tre. On en mconnat la ralit sociale, en mme temps que l'on
accuse ceux qui veulent la faire considrer comme existante en fait, de la dnaturer ou
mme de la dtruire.
Ainsi la moralit, et par consquent la persistance d'une socit compose d'tres
moraux, seraient suspendues l'ignorance o chacun d'eux doit rester des conditions
d'existence objectives de cette moralit! L'homme peut connatre la nature inorganique, il peut connatre la nature vivante, il peut mme connatre la nature sociale tant
qu'il n'y considre que des faits comme les faits conomiques, juridiques, linguistiques, etc. Ces sciences lui sont profitables. Indpendamment des applications qu'il en
peut tirer, elles constituent le dveloppement mme de sa raison. Il n'y a que la ralit
morale proprement dite qu'il ne doit pas connatre scientifiquement, sous peine de la
faire vanouir! Pourquoi cette exception, si ce n'est parce que justement elle n'est pas
conue comme une ralit ?
Comme la reprsentation des faits moraux que suppose cette conception est
incomplte et tronque! Elle ne veut considrer que le caractre d'obligation sous lequel ils se prsentent la conscience individuelle. Mais ce caractre, qui les fait
admirablement discerner du point de vue de l'action, ne suffit pas les dfinir d'un
point de vue objectif, et ne nous rvle pas leurs conditions relles d'existence. Pour
prendre une comparaison, d'ailleurs fort grossire, quand nous prouvons une douleur
physique, nous savons, n'en pas douter, que nous l'prouvons, et que quelque chose
n'est pas en ordre dans notre corps. Mais, pour le mdecin qui nous examine, cette
douleur, si vive qu'elle soit, n'est qu'un symptme. Elle est moins importante que tel
ou tel signe objectif, qui le renseigne sur la nature du mal, dont le symptme douleur
ne donne aucune ide. De mme, le symptme conscience est le signe infaillible, pour
chacun de nous, qu'une question de nature morale s'est prsente lui. Mais c'est une
illusion de croire que ce symptme exprime le fait moral dans son entier, et qu'il en
constitue l'essence. C'est oublier tout ce que ce fait implique ncessairement de social,
comme le praticien qui ne s'arrterait qu'au symptme douleur, mconnatrait les
causes de ce symptme mme, et se mettrait hors d'tat de diagnostiquer et de traiter
le mal.
Ceux qui prtendent que nous tendons dtruire la moralit sont donc justement
ceux qui n'admettent point qu'elle soit une ralit. Ils nous reprochent d'en faire
quelque chose qui ne se dfinisse pas uniquement par l'acte volontaire de l'individu
obissant sa conscience. Ils ne voient pas que cette conscience, que l'idal moral
d'un homme, si haut qu'il soit, ne sont pas son oeuvre lui seul, ne sont pour ainsi
dire jamais son oeuvre que pour une part infinitsimale. Comme la langue qu'il parle,
comme la religion qu'il professe, comme la science qu'il possde, ils sont le rsultat
d'une participation constante une ralit sociale qui le dpasse infiniment, qui
existait avant lui, et qui lui survivra. Nous serions donc en droit de soutenir que, c'est
nous, et non pas nos adversaires, qui considrons la moralit comme indestructible,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
21
puisque selon nous elle repose sur une base sociale qui ne peut jamais lui manquer,
bien qu'elle varie, trs lentement d'ailleurs, en fonction des autres sries de faits
sociaux. Selon eux, elle n'a qu'une existence prcaire, et les plus grands dangers la
menacent, si les hommes se persuadent jamais qu'elle a une origine sociale. Selon
nous, elle fait partie d'une nature comparable, sous certaines rserves, la nature
physique, et, comme telle, elle n'a rien redouter de la connaissance scientifique que
nous pouvons en acqurir. Nous ne contestons pas l'action rcurrente de cette
connaissance sur la ralit qu'elle tudie, mais nous savons que cette ralit est assez
solide pour subir cette action sans y succomber.
*
**
Peut-tre cependant y a-t-il des raisons plus profondes au malaise que traduisent
les critiques, quand ils assurent que, dfinir les faits moraux comme des faits sociaux,
concevoir une nature morale analogue la nature physique , tudier l'une comme l'autre d'un point de vue objectif, tout cela dissimule mal la pioche du dmolisseur . Il ne suffit pas de montrer que ces craintes sont vaines, et que les consquences redoutes ne se produiront pas. Il faut, en outre, faire voir pourquoi ces craintes
sont si vives et si persistantes. Une premire explication se prsente tout de suite
l'esprit : l'extrme sensibilit de la conscience commune ds que la morale est en jeu.
La conception traditionnelle de la morale participe du caractre sacr de son objet.
Qu'une doctrine nouvelle heurte cette conception, la conscience commune ragit
aussitt avec force. Tant que les sentiments ainsi provoqus demeurent intenses, les
arguments les plus dcisifs parviennent difficilement se faire couter.
En second lieu, la morale, dans notre socit, est troitement lie la religion.
Elles semblent se prter un mutuel appui, et lutter parfois toutes deux contre les mmes ennemis. Nous voyons la morale enseigne souvent au nom du dogme religieux,
et le dogme dfendu contre les impies dans l'intrt de la morale. L'volution des
doctrines religieuses touche donc de trs prs la morale. Or rien n'est plus intolrable,
pour une religion rvle, que d'tre replace par l'histoire, par l'exgse, par la sociologie, dans le cours des vnements humains. Il semble qu'en perdant son caractre
surnaturel, elle perde tout, et jusqu' sa raison d'tre : c'est du moins ce que croient la
plupart de ses adversaires, et beaucoup de ses dfenseurs. Que maintenant la morale
soit conue comme une sorte de religion laque, o le Devoir, mystre auguste et
incomprhensible, tient la place de Dieu, combien l'exprience douloureuse faite
depuis deux sicles par la religion positive ne devra-t-elle pas exciter les craintes et
exasprer les rsistances des thoriciens de la morale ainsi comprise ? Quand ils
entendent parler de science des MURS , de mthode comparative applique la
ralit morale, ils pressentent que le mme procs va se drouler, et qu'ici encore la
thologie ptira du dveloppement du savoir rationnel. C'est pourquoi ils ne veulent
pas tre rassurs. Rien ne leur tera de l'esprit que, constituer une science objective
des murs, c'est agir en ennemi, dclar ou masqu, de la morale. Mais il n'y a de
menac, en fait, que la conception mystique et thologique de la morale, non la
morale elle-mme. Nous avons vu tout l'heure que la science ne pouvait avoir pour
effet de faire vanouir la ralit ni les caractres propres des faits moraux. Elle
s'efforce, au contraire, d'en dgager les conditions d'existence sans les dnaturer. Pour
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
22
en chercher les lois, et pour en dterminer les rapports avec les autres sries de faits
de la nature morale , il faut bien sans doute qu'elle les dsubjective . Mais cette
objectivation serait sans valeur, si elle mutilait la ralit qu'il s'agit de connatre, et si,
pour nous procurer la science des faits moraux, elle commenait par les dpouiller de
ce qu'il y a en eux de proprement moral.
Il est vrai que certaines doctrines philosophiques ont tent de rendre compte de ce
caractre spcifique au moyen de l'association des ides, de l'ducation, de la tradition, de l'habitude acquise, comme elles essayaient, par une sorte de chimie mentale,
d'engendrer l'espace en partant d'lments intendus. C'tait, en un sens, faire disparatre la moralit en l'expliquant. Ces tentatives n'ont pas russi, et elles paraissent
assez abandonnes aujourd'hui. Elles auraient pu, la rigueur, justifier en quelque
mesure les craintes exprimes par leurs adversaires. C'est elles surtout que s'adressait la critique de Guyau. Pourtant, mme au moment o elles trouvaient faveur,
aucune consquence fcheuse pour la morale existante tait-elle vraiment redouter ?
Il n'y a gure eu d'hommes plus scrupuleux, plus respectueux du devoir tel qu'ils le
comprenaient, ou plutt, tel que leur conscience le leur dictait, que les deux reprsentants les plus convaincus de cette doctrine, James et John Stuart Mill ; et l'on ne
saurait dire que le cercle de ceux qui ont subi leur influence y ait perdu de sa valeur
morale. Le contraire serait plutt vrai. - Inconsquence, dira-t-on, et qui ne prouve
rien : les hommes valaient mieux que leur doctrine. - Mais il n'est pas besoin
d'invoquer ici une inconsquence. Leur effort, d'ailleurs malheureux, pour expliquer le sentiment de l'obligation morale par une thorie associationniste, provenait
lui-mme du sentiment trs vif de leur devoir social. Ils se considraient comme
obligs de promouvoir la vrit philosophique de toutes leurs forces, et de substituer
des jugements rationnels aux croyances mystiques qui ne se justifient pas logiquement. Et pour expliquer son tour cette obligation, il suffirait d'analyser, outre le
caractre individuel des deux Mill - lment qu'on ne peut ngliger dans l'examen de
cas particuliers -, la ralit morale de leur temps, et surtout l'idal social qui leur
tait commun avec l'cole de Bentham.
Ces doctrines n'ont donc pas, en fait, des consquences aussi fcheuses que leurs
adversaires l'ont dit. A plus forte raison ne devrait-on rien craindre de la recherche
scientifique qui, procdant par une tout autre mthode, ne risque pas de mconnatre
ce qui est spcifiquement moral en l'expliquant. - Mais, dit M. Fouille, avec Guyau,
il n'en reste pas moins que la rflexion dissout l'instinct. - Il n'est pas sr que ce soit
vrai de tous les instincts. Et le sentiment du devoir ne saurait tre assimil l'instinct.
Il en a sans doute l'imprativit et la spontanit apparente. Mais, par ailleurs, il
implique souvent une rflexion, une possession de soi, un effort conscient, qui en font
l'expression la plus parfaite, la plus sublime parfois de la personnalit, c'est--dire
juste l'oppos d'un instinct.
Sous cette ide, que la conscience morale participe de la nature de l'instinct, et
qu'elle peut tre dissoute comme lui par la rflexion, ne reconnat-on pas une conception assez analogue la clbre thorie de l'amour chez Schopenhauer ? L'amour
serait, comme on sait, une duperie savamment organise par le gnie de l'espce, qui
parvient ses fins aux dpens de l'individu, au moment mme o celui-ci croit
toucher son propre bonheur. De mme, la moralit dissimulerait une ruse providentiellement amnage pour maintenir l'ordre social. Cette ruse dvoile, tout serait
perdu. L'individu ne prfrerait plus la sublimit du sacrifice moral la satisfaction de
ses penchants gostes. Dtromp, il se refuserait tre dupe plus longtemps :
c'est le mot de Renan. Mais cette mtaphysique schopenhauerienne est moins con-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
23
vaincante qu'ingnieuse. Le fondement de la moralit est heureusement plus solide. Il
est insparable de la structure mme de chaque socit. La morale d'un groupe social,
comme sa langue et ses institutions, nat avec lui, se dveloppe et volue avec lui, et
ne disparat qu'avec lui.
*
**
Cependant, si la morale est fonction de la socit o elle apparat, elle varie
ncessairement avec cette socit. Elle est autre dans une socit d'un autre type. Elle
est diffrente mme dans une socit donne des poques diffrentes, ou, une
mme poque, pour des classes diffrentes. Comment, dans une conception de ce
genre, le devoir peut-il conserver son autorit ? Comment lui sacrifier sa vie, en se
disant que quelques sicles plus tt ou plus tard, ce sacrifice n'aurait pas t exig,
n'aurait peut-tre pas eu de sens ? On respectera encore l'ordre de la conscience, par la
force de l'habitude acquise, quand il n'en cotera pas beaucoup. Mais si l'effort
demand est trop pnible, le devoir aura le dessous. Et ainsi, malgr les explications
que nous avons donnes, la tentative d'une science naturelle des faits moraux reste un
danger mortel pour la moralit.
A quoi l'on peut rpondre :
1 La variabilit des devoirs dans le temps, la diversit des morales dans les
diverses socits humaines est un fait, dont il faut bien s'accommoder. Personne aujourd'hui ne le conteste plus. Ceux mmes qui admettent une morale naturelle, identique pour tous les hommes, avouent qu'elle n'est universelle qu'en puissance, et qu'en
fait, les civilisations tant diffrentes, leurs morales le sont aussi. Cette constatation
nous suffit. Nous n'avons mme aucune raison de mettre en doute que, si toutes les
socits taient semblables, elles pratiqueraient la mme morale. Rien ne s'accorde
mieux avec notre conception qui voit dans la morale une fonction de l'ensemble
des autres institutions sociales. Seulement, nos critiques s'attachent presque exclusivement cette morale universelle hypothtique, accoutums qu'ils sont spculer sur
l'homme en gnral, tandis qu' nos yeux l'important est d'tudier d'abord la ralit
morale dans sa diversit donne, c'est--dire les divers types sociaux qui existent ou
ont exist. Toujours est-il que, d'un commun accord, il est reconnu que les rgles
morales sont relatives et provisoires, si l'on prend un champ de comparaison assez
tendu. Pourquoi soutenir alors que la relativit de ces rgles est incompatible avec le
respect qu'elles exigent ?
Sans revenir aux arguments dj produits, l'exprience prouve, au contraire, que le
caractre local et temporaire d'un devoir peut tre connu, sans que ce devoir cesse
d'tre senti comme obligatoire. Par exemple, il y a seulement quelques Sicles, quand
une pidmie clatait dans une ville, les mdecins s'enfuyaient comme les autres, s'ils
craignaient d'y succomber. Tout le monde le trouvait naturel, personne n'aurait song
leur en faire un crime, et leur conscience ne leur reprochait rien. Aujourd'hui, un
mdecin qui se sauverait quand la peste ou le cholra se dclare, manquerait un de
ses devoirs les plus imprieux. Il serait svrement condamn par l'opinion publique,
par la conscience de ses confrres et par la sienne propre. Supposez qu'il sache qu'
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
24
l'poque de la grande peste de Londres les mdecins ont pu s'enfuir en toute conscience, et qu'il prvoie un temps o ce devoir ne s'imposera plus : en quoi cette connaissance affaiblira-t-elle l'obligation professionnelle qui s'impose lui ? Il se dira, certainement, que s'il avait vcu au temps de la peste de Londres, sa conscience n'aurait pas
t plus exigeante que celle de ses confrres ; mais que, vivant au XXe sicle, il ne
peut se drober aux devoirs qui lui sont dicts par sa conscience actuelle. Voil ce que
nous entendons par la ralit objective de la morale, ralit qui n'a rien craindre
des recherches des savants non plus que des thories des philosophes, prcisment
parce que sa nature sociale en fonde l'objectivit.
Il semblerait, entendre nos critiques, qu'une rgle morale dt perdre toute chance
d'tre observe, du jour o ceux qui s'y conforment s'apercevraient qu'elle n'est pas
une injonction formule de toute ternit par un pouvoir qui exige d'eux une
obissance passive. Mais il n'en est rien. On pourrait, sans paradoxe, soutenir la thse
contraire. Dans toute socit humaine, dans la ntre en particulier, si avance qu'elle
se croie, il subsiste nombre de rgles dont on a beau savoir qu'elles sont aujourd'hui
sans raison et sans utilit : elles n'en continuent pas moins d'tre observes, et par
ceux qui en souffrent autant que par ceux qui en profitent. Qui sait si l'une des formes
du progrs qu'on peut esprer de la science ne sera pas la disparition de ces impratifs
prims et nanmoins respects ?
2 On oppose l'un l'autre le devoir senti comme absolu, catgorique, et, comme
tel, imposant le respect la conscience individuelle - et le devoir connu comme relatif, provisoire, et perdant comme tel son droit ce respect, mme si en fait il l'obtient
pendant quelque temps encore. Mais l'antithse est factice. Elle ne rpond pas la
ralit des faits. Non seulement le devoir, mme connu comme relatif, peut continuer
tre respect et obi ; mais, entre les termes extrmes, un trs grand nombre de
termes moyens peuvent s'insrer. Entre les prescriptions de la mode, qui durent une
anne ou changent avec les saisons, et les devoirs relatifs la famille, qui mettent des
sicles varier, il y a place pour des obligations qui prsentent tous les degrs possibles de stabilit. La qualification de provisoire ne convient pas toutes exactement dans le mme sens. Sans doute, la morale d'une socit est relative sa structure, au type auquel elle appartient, au stade actuel de son dveloppement, etc. Elle
est donc destine varier, et, en ce sens, elle est provisoire : mais provisoire comme
son droit, comme sa religion, comme la langue qu'elle parle. Un provisoire qui s'tend
ainsi sur une longue suite de gnrations quivaut, pour la courte vie d'un individu,
du dfinitif. Il s'impose lui, comme l'exprience le prouve, sous la forme d'obligations nettement impratives. Et si l'on ne voit pas bien comment il dpendrait de
l'individu de changer tout d'un coup la langue qu'il a apprise sur les lvres de sa mre,
on ne conoit pas davantage qu'il puisse vivre moralement d'aprs des rgles tout
autres que celles qui sont obligatoires dans la socit o il est devenu homme. Les
consciences les plus promptes s'alarmer peuvent donc se tranquilliser. Le caractre
relatif et provisoire de toute morale, ainsi entendu - et c'est en ce sens seulement que
la science des murs l'implique -, ne compromet pas la stabilit de la moralit
existante.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
25
III
Aprs s'tre dfendue d'tre subversive au point de vue social, et de porter sur la
morale la pioche du dmolisseur , il est assez trange que la conception d'une
science des murs et d'un art moral rationnel doive rpondre une objection contraire. On lui reproche cependant de conduire l'impossibilit de procurer ou mme de
concevoir un progrs social , une attitude purement passive et expectante qui
laisserait tout au plus subsister la vis medicatrix nalurae , bref, un Conservatisme
absolu 1. L'une de ces objections, semble-t-il, devrait exclure l'autre. Si la doctrine
tend au maintien indfini de l'tat actuel de la socit, comment peut-elle en mme
temps agir la faon d'un ferment nergique ou d'un dissolvant ?
Toutefois, en un sens, les deux objections ne sont pas inconciliables. L'affaiblissement de la moralit est une consquence de la doctrine, qui, selon les critiques, en
rsultera en fait; le conservatisme absolu est une attitude que le partisan de la doctrine
devrait observer, s'il tait fidle ses principes. La premire objection considre la
conscience morale individuelle ; la seconde se rapporte l'action sociale. Et pourquoi
la science des murs aboutit-elle ici une attitude purement passive et expectante
? C'est qu'elle subordonne notre intervention dans les faits sociaux la science de ces
faits. Or nous sommes loin d'avoir port cette science au point qu'il faudrait pour que
des applications fussent possibles. Donc, dans l'ignorance o nous sommes encore, et
qui peut durer des sicles, la prudence conseille de s'abstenir. Notre intervention courrait risque de produire des effets tout autres que ceux que nous attendons. Puisque
l'tat de chaque socit est, chaque moment, aussi bon et aussi mauvais qu'il peut
tre , le plus sage est de ne rien faire. La doctrine serait ainsi, de ce point de vue,
ultra-conservatrice, et, pourrait-on dire, quitiste.
Les auteurs de l'objection oublient, ici encore, que nous nous sommes efforc,
avant tout, de distinguer le plus parfaitement possible le point de vue de la connaissance et le point de vue de la pratique. A leurs yeux, l'urgence de certains problmes
sociaux exige que la science, si elle existe, en fournisse ds aujourd'hui une solution
satisfaisante. Si la science s'en avoue incapable, quoi sert-elle ? On ne lui fait pas
crdit. Il faut, comme dit M. Cantecor, qu'elle rponde nos besoins pratiques. Aussi
bien n'y a-t-il gure eu, jusqu' prsent, de spculation en cette matire qui n'ait t je ne dis pas anime par des motifs pratiques, ce qui est trs lgitime -, mais dirige
par eux, ce qui ne l'est point. Mais si l'on concevait vraiment la nature morale , de
mme que la nature physique , comme une ralit objective tudier, si l'on
comprenait qu'elle ne nous est pas plus connue d'emble que le monde de la matire
ou de la vie, on n'exigerait plus de la science des murs une rponse immdiate des
questions d'ordre pratique. Comme elle n'est pas un trait de morale, ni, plus forte
raison, de politique, ses recherches ne portent jamais que sur des problmes thoriques. Par suite, elle n'est pas moins indiffrente que les autres sciences aux questions
politiques du jour. Lui demander s'il faut tre conservateur, libral, ou rvolutionnaire, c'est lui poser une question laquelle, en tant que science, elle n'a pas plus de
rponse que la mcanique cleste ou la botanique. Sa fonction se limite connatre
des faits avec le plus de prcision possible, et en chercher les lois. Des travailleurs
runis dans un laboratoire de physique ou de physiologie peuvent professer des
opinions politiques trs diffrentes : de mme, on conoit que dans une quipe de sa1
BELOT, Revue de Mtaphysique et de Morale, juillet 1905, p. 586.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
26
vants s'occupant ensemble de la science des murs, les tendances sociales les plus
opposes se rencontrent.
Il est vrai que si la science des murs, comme telle, est indiffrente la politique,
la politique ne se dsintresse peut-tre pas de la science des murs. Les partis sont
toujours l'afft de ce qui peut leur servir dans l'opinion publique. Ils n'hsitent pas
s'approprier, sans grande crmonie, telle ou telle doctrine scientifique, s'ils pensent y
trouver un avantage, quitte n'en plus parler ou mme la combattre quelques annes
plus tard, quand les circonstances auront chang. Qui ne se rappelle comme les
thories transformistes ont servi ce jeu, dans la seconde moiti du XIXe sicle ? A
peine L'origine des espces avait-elle paru, qu'on en tira les consquences touchant
l'origine de l'homme, et, par suite, touchant les dogmes religieux qui sont intresss
ce problme. Inquitante pour les dogmes, l'hypothse darwiniste eut aussitt une
foule de partisans qui ne s'taient jamais occups d'histoire naturelle. L'origine des
espces et La descendance de l'homme, suspectes l'orthodoxie religieuse, devinrent
les livres de chevet des rvolutionnaires. Mais voici qu'un peu plus tard, la lutte pour
la vie, la slection naturelle, l'hrdit des caractres acquis, ont l'air de s'accorder
bien mieux avec les tendances aristocratiques qu'avec les ides galitaires, tandis que
des vques anglicans ne voient plus rien dans le transformisme qui soit inconciliable
avec la foi chrtienne. Qu' cela ne tienne : ce sont les conservateurs, maintenant, qui
utilisent le darwinisme, et leurs adversaires qui le regardent de mauvais oeil. Enfin le moment vient o les partis portent ailleurs leur humeur batailleuse, et
abandonnent aux naturalistes un problme qui leur appartient. La science des murs
ne peut empcher que de semblables controverses ne se produisent son sujet. Rvolutionnaires et conservateurs tour tour, sinon en mme temps, prtendront peut-tre
y trouver la justification de leur attitude, ou se donneront devant l'opinion le mrite de
la combattre. C'est l un inconvnient auquel, par la nature de son objet, elle est plus
expose que toute autre science. Mais il ne serait pas juste de l'en rendre responsable.
L'objection, qui ne porte point contre la science des murs a-t-elle plus de force
contre l'art rationnel que nous concevons comme fond sur cette science ? Il le semble
d'abord : car, si cet art ne peut se constituer que dans un avenir lointain, ne sommesnous pas engags demeurer immobiles dans l'intervalle ? Ne devons-nous pas viter
de prendre parti, puisque nous n'avons pas le moyen de le faire rationnellement,
mme dans les questions qui exigeraient une solution immdiate ? Ne sommes-nous
pas condamns l'abstention pour un temps indfini ? - Nullement. L o la science
ne peut pas encore diriger notre action, et o cependant la ncessit d'agir s'impose, il
faut s'arrter la dcision qui parat aujourd'hui la plus raisonnable, d'aprs l'exprience passe et l'ensemble de ce que nous savons. Le bon sens nous le conseille, et la
force des choses nous y contraint. Ne devons-nous pas dj nous y rsoudre en mille
circonstances ? La mdecine, par exemple, intervient encore souvent sur de simples
prsomptions, ou sur la foi d'expriences antrieures, qui ont donn de bons rsultats
dans des cas peu prs pareils celui qu'il faut traiter. De mme, une socit qui
prend conscience d'un mal dont elle souffre, essaiera d'y porter remde de son mieux,
avec les moyens dont elle dispose, mme si la science, et l'art rationnel par consquent, lui font encore dfaut. Elle pourra se tromper, et, faute d'avoir aperu les
consquences un peu loignes de ses rsolutions, de ce mal tomber dans un pire.
Mais il se peut aussi qu'elle russisse, et la possibilit d'un chec n'est pas une raison
de ne rien tenter. Pourquoi telle intervention sera-t-elle heureuse, telle autre non ? Les
conditions du succs sont si complexes que nous ne saurions, dans l'tat actuel de nos
connaissances, en donner une analyse satisfaisante. Nous savons du moins que l'habilet, la dcision, le tact politique, le gnie de l'homme d'tat, quand ils se rencontrent,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
27
peuvent exercer l une influence dcisive. Vrits presque trop videntes, que notre
doctrine ne songe pas nier. Elle ne dit pas et n'a pas dire : Abstenez-vous, tant
que la science ne sera pas faite. Elle dit, au contraire : Le mieux serait, ici comme
ailleurs, de possder la science de la nature, pour intervenir dans les phnomnes
coup sr, quand il le faut, et dans la mesure o il faut. Mais, jusqu' ce que cet idal
soit atteint, - si jamais il doit l'tre -, que chacun agisse selon des rgles provisoires,
les plus raisonnables possible , ce qui ne veut pas toujours dire des rgles conservatrices.
Ainsi, lorsqu'un critique estime que nous aboutissons des consquences extrmement conservatrices... prserver la socit, telle qu'elle est constitue, des accidents qui peuvent l'branler 1, il tire de la doctrine des consquences qui n'en
dcoulent point naturellement. Sans doute, l'art moral rationnel ne peut exister encore,
puisqu'il suppose une connaissance scientifique des institutions sociales, et que, cette
connaissance, nous commenons peine l'acqurir. Mais notre ignorance confre-telle ces institutions, quelles qu'elles soient, un caractre intangible et sacr, jusqu'
ce que la science soit faite ? C'est bien une affirmation de ce genre qu'on nous prte :
nous nous refusons l'accepter. Nous dirions bien plutt, au contraire : tant que la
science n'est pas faite, nulle institution n'a de caractre intangible et sacr. Comment
l'attitude scientifique ne serait-elle pas en mme temps une attitude critique ? Sans
doute, de notre point de vue, toutes les institutions, comme toutes les morales, sont
naturelles . Mais naturel ne veut pas dire, comme certains semblent l'avoir cru,
lgitime , et qui doit a priori tre conserv. Pour le savant, la maladie est aussi
naturelle que la sant. Il ne s'ensuit pas qu'un membre gangren doive tre trait
comme un membre sain. De ce que la science constate tout, tudie tout avec une
impartiale srnit, il ne faut pas conclure qu'elle conseille de tout conserver avec une
gale indiffrence.
Aprs cela, est-il ncessaire de montrer que notre doctrine n'a pas pour consquence un esclavage, o nul ne peut tre admis, titre individuel, juger la volont
sociale 2 ? Consquence effroyable en effet, si elle tait ncessaire. Mais la science
des murs n'implique rien de tel. Elle reconnat, au contraire, qu' un moment donn
l'harmonie des forces dans une socit n'est jamais parfaite. C'est toujours une
concordia discors. On y constate la lutte de tendances diverses, des efforts pour conserver l'quilibre actuel, contrebalancs par d'autres efforts pour en tablir un diffrent, l'apparition d'ides et de sentiments nouveaux en correspondance avec les
changements qui se produisent dans les phnomnes conomiques, religieux,
juridiques, dans les rapports avec les socits voisines, dans la densit croissante ou
dcroissante de la population, etc. Et quant refuser l'individu le droit de juger la
volont sociale, comment la science y songerait-elle, puisque n'tant pas normative,
elle n'est pas non plus prohibitive, et qu'elle ne dfend rien personne ? Est-ce de l'art
moral rationnel que l'on redoute cette tyrannie ? Mais, par dfinition, il ne servira qu'
amliorer les institutions sociales. Il n'est pas vraisemblable que cette amlioration consiste jamais briser ce qui a t jusqu' prsent un des ressorts les plus
nergiques du progrs social. Il faut attendre de lui, au contraire, qu'il procure une
indpendance toujours plus grande des individus en mme temps qu'il assurera une
solidarit sociale toujours plus troite. Si ces deux termes semblent aujourd'hui
s'exclure, la faute en est sans doute notre ignorance, et la duret des charges
qu'elle fait peser sur les individus dans la socit prsente.
1
2
Revue de Mtaphysique et de Morale, juillet 1903.
CANTECOR, Revue philosophique, mars 1904, p. 240.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
28
Pour conclure, les quelques objections que nous avons examines, comme les
craintes plus ou moins vives que l'on exprime, soit au nom de la conscience morale,
soit du point de vue de l'action politique et sociale, se ramnent sans trop de peine
une origine commune. Elles procdent d'une rpugnance, dont les raisons sont
multiples et fortes, accepter jusqu'au bout l'ide d'une nature morale et d'une
science applique connatre cette nature. Nous en trouvons l'aveu pour ainsi dire
ingnu chez un critique. Aprs une longue discussion qui aboutit un expos de ses
propres ides, il crit cette phrase significative : Nous ne connatrons jamais bien la
socit que dans la mesure o nous l'aurons faite 1. Tant qu'une croyance de ce
genre persiste, tant que l'on s'imagine que des actes de volont, mme collectifs, suffiront pour dterminer dans la ralit objective les transformations que l'on souhaite,
quoi bon en effet se contraindre au long et pnible dtour qui passe par la science ? Il
est beaucoup plus simple et plus conomique de s'en dispenser, et d'aller droit au
rsultat, qui seul importe. Le malheur est qu'on a peu de chances de transformer
systmatiquement une nature qu'on ne connat pas.
En fait, si l'on affirme avec tant de confiance que la volont humaine superpose
un monde nouveau la nature brute , c'est qu'on n'est pas persuad que ce soit l une
nature au sens plein du mot, une ralit objective, qui ne dpend pas de nous pour
exister, rgie par des lois que nous ignorons et qui ne seront mises au jour que par une
recherche mthodique et persvrante. On pense plutt que cette nature sociale, qui
ne se manifeste aprs tout que dans des consciences humaines, ne peut pas leur tre
obscure. Pour la pntrer, il doit suffire de savoir ce que c'est que l'homme , et de
continuer le travail entrepris, de temps immmorial, par les philosophes et par les
moralistes. Et l'on rejette enfin une analogie trop troite entre la nature physique et la
nature morale, comme un paradoxe la fois invraisemblable et dangereux. Mais on
oublie que pendant de longs sicles, qui se comptent par centaines et peut-tre par
milliers, nos anctres ont senti, ont vcu la nature physique comme nous sentons,
comme nous vivons aujourd'hui la nature morale, et peut-tre plus intimement encore
: je veux dire qu'elle leur tait la fois plus familire et plus inconnue que la nature
morale ne l'est pour nous. Les croyances et les pratiques des primitifs en fournissent
des preuves sans nombre. Ce n'est donc pas la nature physique, telle que nous la concevons aujourd'hui, objective dans ses lois, qu'il faut comparer la nature morale,
qui ne nous est connue encore que par des reprsentations presque exclusivement
subjectives et sentimentales. Il faut rapprocher de cette nature morale la nature
physique des primitifs, ou de la nature physique objective d'aujourd'hui, la nature
morale telle que la science commence la dgager avec ses lois. Alors l'analogie se
justifie, et elle apparat profonde.
On voit aussi ce qu'elle nous permet d'attendre de l'avenir. Non pas sans doute la
transformation systmatique qu'on nous promettait tout l'heure, sans avoir
prendre la peine de connatre la nature sociale, par la seule vertu des volonts convergentes ; - mais une libration progressive qui nous tirera peu peu de quelques-unes
des servitudes auxquelles cette nature nous a assujettis, et dont nous ne nous affranchirions jamais sans la science. La bonne volont n'y suffit pas. Si la prdication
morale avait pu transformer la nature morale, les leons les plus sublimes, les
exemples les plus beaux et les plus touchants ont-ils fait dfaut depuis de longs
sicles ? Que d'efforts se sont perdus, que de sacrifices se sont accomplis pour des
causes que l'ignorance seule pouvait croire saintes ou utiles! De mme que le progrs
1
BELOT, Revue de Mtaphysique et de Morale, septembre 1905, p. 761.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
29
de l'intelligence a peu peu conduit dominer et utiliser, dans une certaine mesure,
les forces de la nature physique, dont les hommes furent longtemps les esclaves et les
victimes, de mme la science de la nature morale permettra sans doute d'allger le
poids des ncessits de la vie sociale, si cruellement lourdes pour ceux qui ne sont pas
privilgis. Cette analogie n'a rien de tmraire : mais elle reste, jusqu' prsent,
presque purement idale. Il dpend des progrs de la science qu'elle devienne une
ralit 1.
On n'a voulu considrer dans cette prface - et sans prtendre tre complet -, que les objections des
critiques qui contestent le fond mme de notre thse, et qui dfendent contre nous la forme
traditionnelle de la spculation morale. On n'a donc pas cru devoir discuter ici les thories propres
d'autres critiques, qui, comme M. Rauh, par exemple, se dclarent d'accord avec nous sur un
certain nombre de points essentiels, et qui acceptent, du moins en gros, notre mthode, tout en
croyant indispensable de la complter par des recherches d'un caractre diffrent (l'exprience
morale). C'est l une conception fort intressante en soi, mais dont nous ne pouvions entreprendre
ici l'examen.
Nous ne pouvons non plus discuter ici les applications morales des sciences sociologiques
proposes par M. Albert Bayet dans sa Morale scientifique. L'auteur y accepte, en principe, la
distinction de la science des MURS et de l'art moral rationnel, mais les applications qu'il en
tire ne sauraient d'aucune manire tre considres comme une interprtation de notre doctrine. En
fait, la mthode qu'il emploie est, sans confusion possible, trs diffrente de la ntre, et, par suite,
entre les ides dveloppes dans notre ouvrage et les conclusions auxquelles aboutit M. Albert
Bayet, les divergences sont videntes.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
30
CHAPITRE I
IL N'Y A PAS
ET IL NE PEUT PAS Y AVOIR
DE MORALE THORIQUE
I
Conditions gnrales de la distinction du point de vue thorique et du point de
vue pratique. - Cette distinction se fait d'autant plus tardivement et difficilement que les questions considres touchent davantage nos sentiments, nos
croyances et nos intrts. - Exemples pris des sciences de la nature et en particulier des sciences mdicales.
Retour la table des matires
La distinction de la science et de l'art, ou, plus prcisment, du point de vue thorique et du point de vue pratique, est, dans certains cas, trs simple, dans certains
autres, plus dlicate. Nous la faisons sans peine, comme on sait, quand l'objet dont il
s'agit intresse presque exclusivement l'esprit, et trs peu, ou d'une faon trs indirecte, les sentiments et les passions. Nous concevons trs aisment les mathmatiques
pures, la physique pure, d'une part, les mathmatiques appliques, la physique applique, d'autre part. Il se peut que toute science soit ne d'un art correspondant, comme
le dit Comte, et peut-tre les mathmatiques elles-mmes ont-elles travers, leur
origine, une priode o les vrits acquises n'taient considres que comme des
connaissances utiles. Du moins, depuis de longs sicles, le gomtre s'est accoutum
sparer l'tude spculative des mathmatiques d'avec leurs applications.
Cet exemple, donn d'abord par les mathmatiques, a t extrmement prcieux
pour les autres sciences. Car, quels que soient les phnomnes naturels tudis, plus
la recherche thorique a t dgage de toute proccupation pratique, plus les appli-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
31
cations ont chance d'tre, dans la suite, sres et fcondes. Non que la recherche ne
puisse porter, dans certains cas, sur des problmes spciaux poss par des besoins
urgents de la pratique : quelques-unes des grandes dcouvertes de Pasteur, par exemple, ont cette origine. Mais la poursuite scientifique de rsultats utilisables sur-lechamp n'est possible, comme le prouvent les travaux mmes de Pasteur, que grce
des recherches antrieures, de caractre purement spculatif, o le savant ne se proposait que la dcouverte des lois des phnomnes.
Or, en fait, mesure que l'on monte l'chelle des sciences dans l'ordre de complexit croissante de leur objet, la distinction du point de vue thorique et du point de
vue pratique parat moins srement tablie et moins nette. Le changement est surtout
sensible lorsque l'on arrive la nature vivante. Claude Bernard n'aurait sans doute pas
expliqu avec tant d'insistance que la mdecine doit tre exprimentale, c'est--dire
que l'art mdical doit se fonder sur une recherche scientifique dont il est distinct, si
cette vrit avait t universellement admise de son temps. La physiologie ne s'est
constitue comme science indpendante qu' la fin du XVIIIe sicle ; la biologie
gnrale est encore plus rcente, ainsi que la plupart des sciences qui s'y rattachent.
Un grand nombre de causes, il est vrai, et, avant toute autre, l'extrme complexit des
phnomnes biologiques ont contribu retarder la formation dfinitive de ces
sciences. Mais, parmi ces causes, l'exigence immdiate de la pratique n'a pas t la
moins dcisive. L'intrt en jeu - sant ou maladie, vie ou mort - est trop pressant,
trop imprieux. Pendant de longs sicles, et jusqu' une poque toute rcente, il n'a pu
consentir se subordonner avec patience l'tude purement spculative et dsintresse des faits.
Quand la gomtrie rationnelle s'est substitue la gomtrie empirique, cette
rvolution, grosse de consquences presque infinies pour l'humanit, put passer inaperue, except dans les corps de mtier qu'elle intressait. Encore rien ne fut-il chang d'abord dans l'arpentage des champs ni dans le bornage des proprits. Une
substitution analogue, pour la mdecine, a demand des sicles,. Elle n'est pas encore
tout fait acheve. C'est que la pratique, dans ce dernier cas, pour devenir rationnelle,
devait se dgager d'un ensemble trs complexe de croyances, de coutumes, et par
consquent aussi de sentiments et de passions que leur antiquit rendait singulirement tenaces. La sociologie a tabli que partout le mdecin a commenc par ne faire
qu'un avec le sorcier, le magicien, le prtre. A eux revenait la tche de combattre les
maladies, dont beaucoup, par leur caractre pidmique, ou soudain, ou horrible
voir, suggraient invinciblement l'ide d'un ou de plusieurs principes malfaisants qui
se seraient introduits dans le corps. Et comment agir sur ces principes, sinon par les
moyens appropris, coercition, exorcisme, persuasion, prire ? Peu peu, la division
du travail social et le progrs de la connaissance de la nature ont spar le sorcier du
prtre, et le mdecin de l'un et de l'autre. Mais la distinction n'est pas si bien tablie
qu'il ne se trouve encore des sorciers et des rebouteux, en nombre non ngligeable,
dans nos campagnes, et mme dans nos villes. Il est bien peu de personnes, parmi
celles que l'on dit instruites, qui ne prtent une oreille complaisante des histoires de
cures merveilleuses et inexplicables. Combien d'autres acceptent, plus ou moins
franchement, l'hypothse d'une intervention miraculeuse de la Vierge, ou d'un saint,
au cours d'une maladie! Elles repoussent l'ide que les lois de la mcanique ou de la
physique puissent comporter actuellement aucune exception. Mais elles s'accommodent fort bien d'une exception clatante aux lois biologiques ; - sans s'apercevoir,
d'ailleurs, que le miracle qu'elles admettent implique ncessairement plusieurs de
ceux qu'elles n'admettent pas.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
32
Que des croyances qui proviennent d'une poque extrmement recule persistent
ainsi, cte cte avec une conception gnrale de la nature qui les exclut ; que tant
d'esprits s'accommodent encore aujourd'hui d'une contradiction si grossire, cela
s'explique, notamment, par le dsir ardent d'chapper la souffrance et la mort.
Faut-il s'tonner, si ce mme dsir a rendu la distinction de la thorie et de la pratique
fort lente et fort pnible, quand l'art de gurir est intress ? Non que l'Antiquit n'ait
connu des mdecins dous d'un esprit scientifique remarquable. Les auteurs des crits
hippocratiques, pour ne citer que ceux-l, savaient dj fort bien observer, et mme,
dans certains cas, exprimenter. Non que des cliniciens excellents ne se soient produits, jusque dans les sicles obscurs du Moyen ge, en Europe comme chez les
Arabes, et que, depuis le XVIe sicle, les sciences mdicales n'aient fait de continuels
progrs. Mais on n'en tait pas encore instituer des recherches biologiques pures, en
dehors de toute application mdicale ou chirurgicale immdiate. L'ide en est rcente,
et elle ne se serait peut-tre pas fait accepter avant le XIXe sicle. Trop d'obstacles s'y
opposaient. On sentait surtout la ncessit de plus en plus pressante de substituer une
pratique plus rationnelle aux procds et aux recettes empiriques de la tradition, et
l'on voulait, par consquent, que toute acquisition nouvelle de la science ft aussitt
utilisable.
Les progrs des sciences biologiques et naturelles au XIXe sicle, et, en particulier, ceux de l'anatomie compare et de la physiologie gnrale modifirent peu peu
ces dispositions. Un effet encore plus considrable fut produit, en ce sens, par les
dcouvertes de Pasteur, qui n'tait pas mdecin, et par celles de ses successeurs, qui le
sont pour la plupart. Elles ont prouv par le fait, de la faon la plus dcisive et la plus
clatante, que, dans ce domaine comme dans les autres, les recherches les plus
dsintresses, et les plus trangres, en apparence, la pratique, peuvent se trouver
un jour extraordinairement fcondes en applications. Aprs Pasteur, Lister. Elles ont
fait comprendre que la microbiologie et la chimie biologique n'taient pas moins indispensables au progrs de l'art de gurir que la pathologie et la physiologie. Par
suite, le savoir scientifique sur lequel la mdecine et la chirurgie se fondent n'est plus
rduit, par l'intrt immdiat et mal compris de la pratique, un segment arbitrairement dcoup dans l'ensemble de la biologie. Leur base thorique va, au contraire,
s'largissant de plus en plus, sans prjudice de la prparation pratique et technique qui
demeure indispensable au mdecin. Mais ce rsultat n'est obtenu que d'hier, ou mme, plus exactement, d'aujourd'hui ; et, bien qu'assur dsormais, il n'est pas encore
incontest.
Sans vouloir esquisser, mme grands traits, l'histoire des rapports de la mdecine avec les sciences dont elle relve, nous voyons donc comment la recherche
thorique s'est peu peu spare du point de vue de la pratique. Nous pouvons mme
marquer les tapes principales de cette marche. La distinction s'est tablie, et ensuite
prcise, dans la mesure o la science proprement dite se dsubjectivait , c'est-dire dans la mesure o la dissociation s'oprait entre les phnomnes et les lois tudier, d'une part, et, de l'autre, les croyances, les sentiments, les exigences pratiques
qui en taient primitivement insparables. Ainsi il a fallu : 1 Que la conception de
ces phnomnes cesst d'tre mystique (disparition de la croyance des esprits ou
des divinits qui les produisent ou les arrtent, par leur seule prsence, ou selon
qu'elles sont bien ou mal disposes l'gard de telle ou telle personne, ou de tel ou tel
groupe) ; 2 Qu'elle cesst d'tre mtaphysique (fin du principe vital , d'une chimie
spciale aux tres vivants, d'une vis medicatrix naturae) ; 3 Que ces phnomnes
enfin perdissent leur caractre spcifiquement humain, pour tre rintgrs dans
l'ensemble des faits biologiques. Alors seulement, les sciences thoriques de la vie
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
33
ont t nettement spares des arts qui reoivent d'elles leurs moyens d'action. Alors
seulement, les exigences et les besoins immdiats de la pratique ont cess de
s'imposer comme principes directeurs la recherche scientifique. Alors seulement, en
un mot, les phnomnes biologiques ont commenc d'tre tudis avec la mme
objectivit et dans le mme esprit o les phnomnes du monde inorganique le sont
depuis longtemps. L'exprience a prouv trs vite, cette fois encore, que la distinction
nette et mthodique de la science et de la pratique, et l'tablissement de rapports rationnels entre elles, ne sont pas moins profitables l'une qu'. l'autre. Mais l'histoire
fait voir aussi combien il tait difficile de gagner ce point.
II
Application au cas de la morale. - Sens particulier que les philosophes ont donn
ici aux mots de thorie et de pratique . - La morale serait une science
normative, ou lgislatrice en tant que thorique. - Critique de cette ide. - En
fait, les morales thoriques sont normatives, mais non pas thoriques.
Retour la table des matires
La difficult sera-t-elle moindre si, laissant le domaine des faits biologiques, on
passe celui des faits sociaux, dont les faits proprement moraux sont une partie ? Il
serait tmraire de l'esprer. Les faits sociaux, de l'aveu gnral, prsentent une
complexit plus grande encore que les faits biologiques : ils sont donc encore plus
malaiss tudier scientifiquement. Les raisons en ont t donnes bien des fois en
dtail, depuis Auguste Comte ; il n'est pas ncessaire de les rappeler ici. Il suffit de
retenir le fait, que personne ne conteste gure : la science positive des phnomnes
sociaux n'est pas encore sortie de la priode inchoative. En ces matires, la pratique a
paru le plus souvent ne relever que l'exprience acquise, et prter fort peu d'attention
aux travaux des thoriciens, au moins jusqu' une date tout fait rcente. Mais
surtout, les faits moraux proprement dits sont ceux qui touchent, de la faon la plus
constante et la plus intime, a nos sentiments, nos croyances, nos passions, nos
craintes et nos esprances individuelles et collectives. C'est de ce point de vue
seulement qu'on les regarde d'ordinaire.
Sans doute, si l'on considre les faits moraux du dehors, objectivement, et dans
leurs rapports avec les autres faits sociaux, ils semblent appartenir la mme catgorie qu'eux, et par consquent tre comme eux objets de science. Mais, en tant qu'ils
se manifestent subjectivement, dans la conscience, sous la forme de devoirs, de remords, de sentiments de mrite, de dmrite, de blme, d'loge, etc., ils apparaissent
avec de tout autres caractres. Ils semblent alors avoir rapport exclusivement l'action, et ne relever que des principes de la pratique. De ces deux conceptions, la premire est insolite, la seconde, universellement reue. Celle-ci n'est pas moins familire aux philosophes qu'au sens commun, et n'a jamais choqu personne. L'autre est
propre la sociologie scientifique, qui pose en principe que les faits moraux sont des
faits-sociaux, et qui en conclut que la mme mthode s'applique aux uns et aux autres.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
34
Elle veille presque toujours un sentiment de dfiance instinctive chez ceux qui ne
sont point accoutums regarder les choses de ce biais.
Loin donc que la distinction entre la thorie et la pratique, en morale, soit nettement tablie, on commence peine la formuler, et elle devra, pour s'imposer, triompher d'une rsistance trs vive. Ce fait n'a rien qui doive surprendre. C'est peine si
cette distinction est dfinitivement accepte lorsqu'il s'agit de phnomnes biologiques, qui sont donns dans l'espace, et rgis videmment par des lois indpendantes
de notre volont ; ne serait-il pas invraisemblable qu'elle ft admise dj dans le cas
des faits moraux, qui ne se rvlent, semble-t-il, qu' la conscience, et qui paraissent
avoir leur origine dans la volont libre de l'homme ? Partout ailleurs, nous sparons
sans trop de peine, au moins par la pense, notre science qui s'efforce de connatre les
phnomnes naturels, et les procds de notre art pour les modifier. Nous concevons
l'une sans l'autre. Le constructeur de machines se sert de formules que l'analyse pure a
tablies ; l'anatomiste, le physiologiste ne cherchent qu' connatre les faits et les lois,
laissant d'autres les applications thrapeutiques possibles. Mais, ds qu'il s'agit de
morale, la subordination de la pratique une thorie distincte d'elle semble s'effacer
tout coup. La pratique n'est plus comprise comme la modification, par l'intervention
rationnelle de l'homme, d'une ralit objective donne. La conscience parat tmoigner qu'elle tient ses principes d'elle-mme. Aussi faut-il un long exercice de la
rflexion pour s'habituer concevoir que c'est notre pratique mme (c'est--dire ce
qui nous apparat subjectivement dans la conscience comme loi obligatoire, sentiment
de respect pour cette loi, pour les droits d'autrui, etc.), qui, considre objectivement,
constitue (sous forme de murs, coutumes, lois), la ralit tudier par une mthode
scientifique en mme temps que le reste des faits sociaux.
Il y a donc, en ralit, deux sens nettement distincts du mot pratique . En un
premier sens, la pratique dsigne les rgles de la conduite individuelle et collective, le systme des devoirs et des droits, en un mot, les rapports moraux des hommes
entre eux. En un second sens, qui n'est plus particulier la morale, la pratique
s'oppose d'une manire gnrale la thorie. Par exemple, la physique pure est une
recherche thorique, et la physique applique se rapporte la pratique. Ce second
sens peut et doit s'tendre aux faits moraux. Il suffit que l'ensemble de ces faits,
savoir, la pratique , au premier sens du mot, devienne lui-mme l'objet d'une tude.
vraiment spculative, c'est--dire dsintresse et toute thorique. Et lorsque cette
pratique sera suffisamment connue, c'est--dire lorsqu'on sera en possession d'un
certain nombre de lois rgissant ces faits, on pourra esprer la modifier, par une
application rationnelle du savoir scientifique. Alors, mais alors seulement, les rapports de la thorie et de la pratique, en morale, seront normalement organiss.
Mais, pourra-t-on dire, la distinction de la morale thorique et de la morale pratique n'exige pas tant d'efforts. N'est-elle pas d'usage courant, et d'une clart parfaite ?
La premire fonde spculativement les principes de la conduite ; la seconde tire les
applications de ces principes. La pratique est donc ici, comme partout, rgle par la
connaissance thorique, pralablement tablie. Les considrations invoques tout
l'heure ne peuvent rien contre ce fait. Loin que la distinction entre la thorie et la
pratique soit particulirement difficile et peine bauche en morale, nulle part elle
n'est plus nette ni plus familire aux esprits cultivs.
- La distinction est courante en effet ; mais est-il certain qu'elle soit fonde ? De
quelle nature est la thorie , dans les morales thoriques ? Quel genre de questions
se proposent-elles de rsoudre ? Qu'elles soient intuitives et procdent a priori, ou
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
35
qu'elles soient inductives et emploient une mthode empirique, elles ne traitent que
des problmes ayant directement rapport l'action : dterminer, par exemple, quelles
fins l'homme doit poursuivre, trouver l'ordre dans lequel ces fins se subordonnent les
unes aux autres, et s'il en est une suprme ; tablir une chelle des biens ; fixer les
principes directeurs des relations des hommes entre eux. Il s'agit toujours d'obtenir un
ordre de prfrence, et de fonder, selon l'expression favorite de Lotze, des jugements
de valeur. Mais est-ce bien l l'office de la science, de la recherche proprement thorique ? La science, par dfinition, n'a d'autre fonction que de connatre ce qui est. Elle
n'est, et ne peut tre, que le rsultat de l'application mthodique de l'esprit humain
une portion ou un aspect de la ralit donne. Elle tend, et elle aboutit, la dcouverte des lois qui rgissent les phnomnes. Telles sont les mathmatiques, l'astronomie, la physique, la biologie, la philologie, etc. La morale thorique se propose un
objet essentiellement diffrent. Elle est, par essence, lgislatrice. Elle n'a pas pour
fonction de connatre, mais de prescrire. Du moins, connatre et prescrire pour elle ne
font qu'un. Son but est de ramener un principe unique, s'il est possible, les rgles
directrices de l'action. Sans doute, une systmatisation de ce genre peut encore s'appeler, si l'on veut, une thorie . Mais c'est la condition de prendre ce mot dans le
sens troit et spcial o il dsigne la formulation abstraite des rgles d'un art - thorie
de la construction navale, thorie de l'utilisation des chutes d'eau -, et non plus dans le
sens plein o thorie signifie tude spculative d'un objet propos l'investigation
scientifique et dsintresse. Les morales thoriques ne rpondent pas cette dernire
dfinition. Elles se dfendraient mme d'y rpondre.
Aussi quelques philosophes, et en particulier M. Wundt, ont-ils propos de mettre
la morale au nombre des sciences normatives . Mais la question est de savoir si ces
deux termes sont compatibles entre eux, et s'il existe rellement des sciences normatives. Toute norme est relative l'action, c'est--dire la pratique. Elle ne relve du
savoir que d'une faon indirecte, titre de consquence. Empirique, elle procde de
traditions, de croyances et de reprsentations dont le rapport avec la ralit objective
peut tre plus ou moins lointain. Rationnelle, elle se fonde sur la connaissance exacte
de cette ralit, c'est--dire sur la science : mais il ne suit pas de l que cette science,
considre en elle-mme, soit normative .
La science fournit simplement une base solide aux applications. Autrement, il faudrait admettre que toutes les sciences qui donnent lieu des applications sont normatives, commencer par les mathmatiques. Mais celles ci sont justement le type de la
science spculative et thorique par excellence.
Prtendre qu'une science est normative en tant que science, c'est--dire en tant que
thorique, c'est confondre en un seul deux moments qui ne peuvent tre que successifs. Toutes les sciences actuellement existantes sont thoriques d'abord ; elles
deviennent normatives ensuite, si leur objet le comporte, ou si elles sont assez avances pour permettre des applications.
Il peut arriver, sans doute, que la distinction du point de vue spculatif et du point
de vue de l'application soit lente s'tablir, surtout quand l'intrt imprieux de la
pratique ne souffre pas que les rgles dont l'usage parait indispensable soient spares
de l'ensemble des connaissances, plus ou moins scientifiques, acquises jusqu' ce
moment. Le savoir peut paratre alors ne pas se distinguer de la rgle d'action. En ce
sens, la mdecine, nous l'avons vu tout l'heure, a t une sorte de science normative
jusqu' une poque assez rcente.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
36
Mais ce n'est pas ainsi que l'on reprsente la morale. Celle-ci serait une science
normative prcisment par sa partie thorique, serait lgislatrice en tant que science . Or, c'est l confondre l'effort pour connatre avec l'effort pour rgler l'action :
c'est une prtention irralisable. En fait, les systmes de morale thorique ne la ralisent point. Jamais, aucun moment, ils ne sont proprement spculatifs. Jamais ils ne
perdent de vue l'intrt pratique pour rechercher, d'une faon dsintresse, les lois
d'une ralit (empirique ou intelligible) prise pour objet de connaissance. Bref, une
morale, mme quand elle veut tre thorique, est toujours normative ; et, prcisment
parce qu'elle est toujours normative, elle n'est jamais vraiment thorique.
Ainsi, la morale thorique et la morale pratique ne diffrent pas entre elles comme
les mathmatiques pures, par exemple, et les mathmatiques appliques. En ralit,
toutes deux, morale thorique et morale pratique, ont pour objet de rgler l'action.
Seulement, tandis que la morale pratique descend dans le dtail concret des devoirs
particuliers, la morale thorique cherche s'lever la formule la plus haute de
l'obligation, du bien et de la justice. Elle prsente un degr suprieur d'abstraction, de
gnralit et de systmatisation.
En outre, les morales pratiques sont, en gnral, homognes ; les morales thoriques ne le sont pas. Les premires se bornent exclusivement l'examen des questions
concrtes de morale ; et, si le nombre de ces questions est illimit, elles n'en sont pas
moins toutes situes dans un mme champ bien dfini. Dans les morales thoriques,
au contraire, se rencontrent presque toujours des lments de provenance diverse, et
plus ou moins amalgams avec ce qui est proprement moral. Tantt ce sont des
croyances religieuses, ou des considrations mtaphysiques sur l'origine et la destine
de l'homme, et sur sa place dans l'univers ; tantt des recherches psychologiques sur
la nature et la force relative des inclinations naturelles ; tantt des conceptions et des
analyses juridiques touchant les droits relatifs aux personnes et aux choses. Ces
lments prtent une apparence thorique aux spculations philosophiques sur la
morale. Mais ce n'est qu'une apparence. En fait, comme on le verra plus loin, ces
considrations de nature thorique ne fondent pas rellement les rgles d'action auxquelles elles se trouvent jointes. Il n'y a pas l un rapport de principe consquence,
mais un genre de relation trs complexe, trs obscur, et qui ne peut le plus souvent
tre clairci sans le secours de l'analyse sociologique. Mais il reste vrai que le
mlange de propositions de caractre spculatif avec des prceptes gnraux de
morale qui paraissent y tre troitement lis, ou mme en tre dduits, ne contribue
pas peu entretenir l'illusion qui fait prendre la morale pour une science la fois
thorique et normative .
Il n'y a donc pas de science thorique de la morale, au sens traditionnel du mot, et
il ne saurait y en avoir, puisqu'une science ne peut tre normative en tant que
thorique. Est-ce dire qu'une recherche scientifique touchant la morale ne soit pas
possible ? Au contraire, la distinction rationnelle du point de vue thorique et du point
de vue pratique nous permettra de dfinir l'objet de cette recherche. Tandis que la
conception confuse d'une morale thorique est destine disparatre, une autre
conception, claire et positive, commence se former. Elle consiste considrer les
rgles morales, obligations, droits, et en gnral le contenu de la conscience morale,
comme une ralit donne, comme un ensemble de faits, en un mot, comme un objet
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
37
de science, qu'il faut tudier dans le mme esprit et par la mme mthode que le reste
des faits sociaux 1.
III
L'antithse morale entre ce qui est et ce qui doit tre. - Diffrents sens de ce
qui doit tre dans les morales inductives et dans les morales intuitives. - Impossibilit d'une morale dductive a priori. - Raisons sentimentales et forces
sociales qui se sont opposes jusqu' prsent des recherches proprement
scientifiques sur les choses morales.
Retour la table des matires
On objectera peut-tre que la dfinition gnrale des rapports de la thorie et de la
pratique, donne plus haut, ne s'applique pas la morale. Tant qu'il s'agit de la nature
physique , notre intervention rationnelle, en effet, dpend presque exclusivement
de la connaissance des faits et de leurs lois. Mais la pratique morale ne ressemble en
rien cette intervention. Elle a rapport au bien et au mal, qui dpendent de nous. Le
problme n'est pas, pour elle, de modifier une ralit donne : elle ne dpend donc pas
de la connaissance scientifique de cette ralit. Par suite, la morale thorique prsente
un caractre qui n'appartient qu' elle. Elle a pour objet, non de connatre ce qui est,
mais de dterminer ce qui doit tre. Ds lors, les infrences fondes sur une analogie
prsume entre cette science et les sciences de la nature n'ont point de valeur. Tout ce
qui a t dmontr plus haut se rduit dire qu'il ne peut exister de morale thorique
qui emploie la mme mthode que les sciences physiques et naturelles. Mais cette
dmonstration tait inutile. Il est vident que la morale thorique, ayant un objet tout
diffrent, doit tre elle-mme trs diffrente de ces sciences. Normative, elle est
ncessairement aussi constructive. Elle n'a pas analyser une ralit donne, mais
difier, conformment ses principes, l'ordre qui doit exister dans l'me de l'individu,
puis entre les individus, et enfin entre les groupes et les groupes de groupes d'individus.
- On pourrait carter cette objection, en remarquant qu'elle ne fait que dvelopper,
sous une autre forme, la dfinition de la morale thorique qui vient d'tre critique.
Science de ce qui doit tre , quivaut en effet science la fois thorique et
normative. Mais laissons la forme, et considrons le fond mme de l'objection.
Ce qui doit tre, par opposition ce qui est, peut s'entendre en deux sens principaux. Dans les deux cas, un ordre moral - soit dans l'me individuelle, soit dans la
socit - est conu comme suprieur l'ordre naturel, est reprsent comme un idal,
est senti comme l'objet obligatoire de nos efforts. Mais tantt cet ordre moral a ses
1
Voyez mile DURKHEIM, Les Rgles de la mthode sociologique, 2e d., Paris, F. Alcan, 1901.
Pleinement d'accord avec l'esprit de cet ouvrage, nous sommes heureux de reconnatre ici ce que
nous devons son auteur.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
38
conditions ncessaires, sinon suffisantes, dans l'ordre naturel dont il prtend se
distinguer ; tantt, au contraire, il en diffre toto genere, et d'une manire absolue. Il
introduit alors l'tre libre et raisonnable dans un monde qui n'a plus rien de commun
avec celui de l'exprience. Toute morale thorique, en tant que science de ce qui doit
tre, est un effort pour dvelopper logiquement l'une ou l'autre de ces conceptions.
Or les morales thoriques de la premire catgorie sont insuffisamment dfinies,
semble-t-il, par l'expression science de ce qui doit tre . Car, ce qui doit tre tant
conu dans un rapport constant avec ce qui est, cette science en suppose une autre
avant elle, o entrent, en proportion varie selon les doctrines, la connaissance de la
nature humaine, la science de certaines lois du monde physique, et la science sociale
en gnral. En un mot, la science de ce qui doit tre, qui prtend tablir comment il
faut modifier la ralit psychologique et sociale, dpend de la connaissance scientifique de cette ralit. Bien mieux, l'histoire montre que l'ide mme de ce qui doit
tre , considre dans son contenu, varie en fonction de cette connaissance. Quand
celle-ci est encore maigre et rudimentaire, l'imagination ne se sent pas retenue, et il
lui est trs facile de construire un ordre idal qu'elle se plait opposer l'ordre - ou au
dsordre - rel que semble prsenter l'exprience. Inversement, mesure que la ralit
sociale est mieux connue, mesure que les lois qui en rgissent les phnomnes sont
plus familires aux esprits, il devient impossible de se reprsenter comme souhaitable
ou comme obligatoire ce que l'on sait tre impraticable. L'ide de ce qui doit tre est
ainsi conditionne et comme resserre de plus en plus troitement par la connaissance
de ce qui est. A la limite, la science de ce qui doit tre aurait fait place des applications raisonnables de la science de ce qui est, pour le grand bien de tous. Qu'est-ce
dire, sinon que le thorique et le normatif de la prtendue science morale se
seraient dissocis ?
En fait, les morales thoriques de ce type sont normatives par essence, et thoriques par accident. Elle sont normatives par essence, car elles prtendent, comme les
autres, tablir un principe directeur de l'action, dterminer la hirarchie des devoirs et
des droits, et fonder la justice : y renoncer serait, de leur propre aveu, renoncer tre
des morales. Mais elles ne sont thoriques que par accident. Car la connaissance du
monde, de la nature humaine et de l'organisation sociale, sur laquelle elles s'appuient,
n'est pas le produit de leurs propres recherches, et leur est apporte d'ailleurs. Elle
leur est fournie, des degrs divers, par la mtaphysique et par les sciences positives.
Ainsi, dans les systmes de Spinoza et de Leibniz, par exemple, la morale consiste,
proprement parler, en des conclusions pratiques tires de la connaissance de certaines
vrits mtaphysiques. Cette connaissance est sans doute tout fait thorique, mais
elle n'appartient nullement la morale comme telle. N'a-t-on pas cru longtemps que
l'thique de Spinoza, en dpit de son titre, exposait plutt une mtaphysique qu'une
morale ?
La mme observation s'applique aux morales inductives et empiriques, qui empruntent aux sciences historiques, psychologiques et sociologiques la connaissance
des faits dont elles ont besoin. Elles font profession de se fonder sur l'exprience, et
de ne pas introduire un sens mystique dans l'expression ce qui doit tre . Elles devraient donc reconnatre qu'elles sont en effet normatives, mais non pas thoriques, et
subordonner expressment leurs prescriptions la connaissance scientifique qui leur
vient d'ailleurs. Mais elles n'en sont pas encore l. Elles persistent se prsenter comme proprement spculatives, et tenter de lgitimer par leurs dmonstrations les rgles qu'elles formulent. Malgr la place considrable qu'elles font la connaissance
du rel, il leur manque l'ide essentielle sans laquelle la distinction du thorique et du
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
39
pratique, en morale, reste confuse : savoir, que les faits moraux sont des faits sociaux, variant en fonction des autres faits sociaux, et soumis comme eux des lois ;
bref, que l'objet du savoir thorique, en morale, c'est la pratique elle-mme, tudie
objectivement, du point de vue sociologique.
Dans les morales thoriques du second type, ce qui doit tre n'est plus considr
dans son rapport avec ce qui est. C'est un ordre de ralit tout fait distinct. Il a son
existence propre et il se suffit lui-mme. Seule, la vertu de l'intention morale y donne accs. Telle est la conception de Pascal, disant que tous les univers et toutes les
intelligences mis ensemble ne valent pas un mouvement de charit, car cela est d'un
autre ordre . Telle, la doctrine de Kant, selon qui le bien et le mal moral diffrent absolument, par essence, du bien et du mal naturel : la bonne volont est la seule chose,
dans l'univers, qui ait une valeur absolue ; la loi morale commande uniquement par sa
forme, abstraction faite de sa matire ; la volont raisonnable est autonome, et lgislatrice a priori ; par elle, l'homme sait qu'il appartient au monde des noumnes, et il
chappe au dterminisme du monde des phnomnes. Ainsi entendue, la morale thorique, science de ce qui doit tre au sens plein de ce mot, se constitue toute a
priori. Elle tablit des principes universels et ncessaires, sans rien emprunter
l'exprience.
Mais non pas sans rien lui devoir. On l'accordera peut tre sans que nous reprenions ici, une fois de plus, la critique de la morale de Kant. Il est gnralement reconnu aujourd'hui que Kant, quoi qu'il en pense, ne construit pas sa morale en s'en tenant
la seule considration de l'autonomie de la volont. Il tient compte, non seulement
de la forme, mais aussi de la matire de la loi. Mme, avec les postulats de la Raison
pratique, il rintroduit toute une mtaphysique. D'autre part, il est permis de regarder
cette preuve comme dcisive. Il est peu vraisemblable que l'entreprise de construire
une morale thorique , toute a priori, soit jamais pousse avec plus de vigueur et
de rsolution qu'elle ne l'a t par Kant. Enfin, il est visible chez Pascal, et peut-tre
aussi chez Kant, qu'elle est inspire au fond par des raisons religieuses autant que
philosophiques.
Reste, il est vrai, une dernire conception, qui se rencontre la fois chez Locke et
chez Leibniz, malgr l'opposition ordinaire de leurs doctrines. La science de la
morale prendrait une forme analogue celle des mathmatiques. Il suffirait qu'elle
comment par poser un certain nombre, le plus petit possible, dit Leibniz, de dfinitions, d'axiomes, et de postulats, tels que personne ne pt les lui refuser. Elle se
constituerait ensuite par une succession de thormes, sans avoir jamais besoin de
recourir l'exprience. Leibniz avait t conduit cette conception en rflchissant
sur les dmonstrations juridiques. Il les trouvait logiquement irrprochables, et tout
fait comparables celles des mathmatiques ; il ne voyait pas pourquoi ce qui russit
dans la science du droit ne russirait pas aussi dans la science de la morale. De son
ct, Locke ne considrait comme certaines que les vrits immdiates ou dmontrables sans le secours de l'exprience ; les vrits de fait, selon lui, ne pouvant jamais
tre que probables. Comme les vrits de la morale, sans tre toutes immdiates, ne
comportent cependant ses yeux aucun lment de doute, il devait donc admettre la
possibilit d'une science dmonstrative de la morale.
Mais, d'abord, aucune tentative de ce genre n'a jamais russi, mme pour un
temps. Aucune mme n'a jamais t srieusement entreprise. Puis, les dmonstrations
en usage dans le droit romain, dont Leibniz invoque l'exemple, sont sans doute trs
rigoureuses. Mais les propositions qu'elles tablissent ne valent que dans un systme
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
40
social o les ides constitutives de la socit romaine ont gard leur autorit. Elles
participent donc au caractre local et historique de ces ides. Elles ne sauraient prtendre l'universalit que les philosophes rclament pour les vrits de la morale.
Enfin, ce qui rend tout fait illusoire l'analogie entre les mathmatiques et une science morale dductive, c'est la diffrence que prsentent leurs notions fondamentales.
En mathmatiques, les axiomes et les dfinitions n'impliquent que des ides parfaitement simples et claires, du moins pour l'usage qu'on en fait. En morale, les notions de
bien, d'obligation, de mrite, de justice, de proprit, de responsabilit, etc., sont des
concepts d'une complexit extrme, impliquant un grand nombre d'autres concepts,
imprgns de sentiments et de croyances plus ou moins perceptibles la conscience
et la rflexion, chargs, en un mot, de tout un pass d'expriences sociales. Clairs
pour l'action, qui la tradition en enseigne l'usage, ils sont trangement obscurs pour
l'analyse scientifique. Loin qu'on puisse fonder sur eux une srie de thormes analogues ceux des mathmatiques, une dialectique tant soit peu habile en tire ce
qu'elle veut, comme M. Simmel l'a fort bien montr dans son Introduction la
science morale.
Ainsi, de quelque faon qu'elle s'y prenne, la spculation philosophique choue
ncessairement dans son effort, si souvent renouvel, pour constituer une science
thorique de la morale. Cette science devrait tre la fois thorique et normative,
c'est--dire satisfaire en mme temps deux exigences incompatibles, si elles sont
simultanes. Et, comme de ces deux exigences la seconde est la plus imprieuse,
comme il faut avant tout que la morale formule les rgles fondamentales de la conduite, c'est la premire qui est sacrifie. La prtendue science morale n'est thorique
que de nom, ou par emprunt.
- Mais comment une illusion si grave a-t-elle pu chapper pendant si longtemps,
et aujourd'hui encore, l'attention des philosophes ? - Nous en serions plus tonns, si
nous ne savions combien de confusions, mme grossires, passent inaperues lorsqu'aucun intrt pratique ne sollicite distinguer, et surtout lorsqu'il y a un intrt
pratique ne pas distinguer. C'est ainsi que, dans l'usage de nos sens, nous tendons
percevoir, non pas de la faon la plus exacte, mais de la faon la plus conomique la
fois et la plus avantageuse pour nous. Or, en fait, aucun intrt pratique ne demandait
une dissociation relle de la thorie et de la pratique en morale, tandis que des intrts
trs pressants s'y opposaient.
Il suffira, pour s'en convaincre, de revenir la comparaison entre l'volution de la
mdecine et celle de la morale. L'art mdical, son origine, ne se sparait pas des
croyances et des traditions qui l'inspiraient. Peu peu est apparue une thorie distincte de la pratique, et aujourd'hui la pratique tend de plus en plus se subordonner la
science. Le schme trs sommaire de cette volution pourrait se rsumer ainsi : dans
une premire priode, l'art a t irrationnel, purement empirique ; dans une seconde,
qui dure encore, et qui durera probablement longtemps, il est rationnel pour une part,
traditionnel et empirique pour le reste ; dans une troisime enfin, il approchera d'une
limite qui ne sera sans doute jamais atteinte, et il tendra devenir tout fait rationnel.
La pratique morale ne passe-t-elle point par une succession de phases analogues ? Non, car, sans parler des difficults propres la science sociale, un intrt puissant y
met obstacle. Dans toute socit, quelle qu'elle soit, une tendance conservatrice
nergique arrte, ou du moins ralentit le plus possible, la dissociation des pratiques
morales et des croyances. Elle s'efforce de conserver indfiniment aux rgles morales
un caractre religieux ou mystique. Elle s'oppose donc de toute sa force ce qui pourrait les en dpouiller - ce qu'elles soient soumises, par exemple, au contrle d'une
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
41
science indpendante d'elles et purement humaine. Mais surtout, elle carte jusqu'
l'ide d'une priode de transition videmment trs longue, o certaines de ces rgles
continueraient tre valables, tandis que d'autres seraient peu peu modifies par une
connaissance scientifique de la ralit sociale. Ne paratrait-il pas sacrilge la fois et
impraticable de proclamer en principe la caducit plus ou moins prochaine de rgles
dont l'observation s'impose aujourd'hui comme un devoir ?
Nous nous rsignons n'avoir qu'une mdecine mi-empirique, mi-rationnelle.
Nous nous consolons de ce qu'elle ignore encore, en frmissant l'ide de ce qu'elle
croyait savoir autrefois. Nous comprenons qu'elle s'abstienne devant certaines maladies o elle ne peut rien ; nous esprons seulement qu'un jour viendra o elle saura y
appliquer un traitement rationnel et efficace. Mais qui approuverait une semblable
attitude en prsence des problmes de la morale, individuelle ou sociale ? L'intrt
social la condamnerait comme coupable et extravagante la fois. Un sentiment trs
nergique nous verrons plus tard s'il est bien fond -, empche d'admettre que nous
ne sachions pas que faire dans un cas donn, et que nous arguions de notre ignorance pour nous abstenir. Le manque de savoir thorique n'est jamais invoqu comme
une excuse. Au contraire, ne voit-on pas les plus grands thoriciens de la morale,
Kant par exemple, se demander srieusement si ce qu'ils font est bien utile, et si la
conscience morale des humbles et des ignorants, laisse elle-mme, n'en sait pas
aussi long que le plus profond philosophe ? Scrupule significatif, et qui jette une vive
lumire sur ce qu'est vraiment la science thorique de la morale .
Si la pratique morale devait se subordonner une thorie, il fallait que ce ft sans
y rien compromettre de son autorit, sans y rien perdre de son caractre impratif. Il
ne pouvait tre question d'une volution progressive, de dure indfinie, o la science
sociale se constituerait peu peu, et rendrait enfin possible une pratique plus rationnelle. L'intrt social ne tolre pas que les rgles de l'action soient la fois provisoires
et obligatoires. Mais, d'autre part, l'esprit humain, parvenu un certain degr de
dveloppement scientifique, prouve le besoin de retrouver partout l'ordre et l'intelligibilit dont il porte en lui-mme le principe. Il a cherch organiser, systmatiser,
lgitimer logiquement les rgles qui, en fait, s'imposaient la conscience et
dirigeaient les actions. A dfaut d'une pratique rationnelle, il a rationalis la pratique. De l, la morale thorique des philosophes.
Il tait donc invitable que les rapports de la thorie et de la pratique ne fussent
pas, en morale, semblables ce qu'ils sont ailleurs. Mais, si la pratique morale ne s'est
Pas subordonne, jusqu' prsent, une connaissance thorique nettement distincte
d'elle, c'est--dire une science positive des faits sociaux, ce n'est pas l un privilge
de la morale, seul domaine o l'activit de l'homme trouverait sa rgle sans le long
apprentissage de la science. C'est une preuve, au contraire, que, dans la morale, la
critique et la science ont encore faire leur oeuvre presque entire.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
42
IV
Ide d'une ralit morale qui serait objet de science comme la ralit physique. Analyse de l'ide positive de nature . - Comment les limites de la nature
varient en fonction des progrs du savoir scientifique. - Quand et sous quelles
conditions un ordre donn de faits devient partie de la nature . - Caractres
propres de la ralit morale.
Retour la table des matires
La conception nouvelle des rapports de la pratique et de la thorie en morale
implique qu'il y a une ralit sociale objective, comme il y a une ralit physique
objective, et que l'homme, s'il est raisonnable, doit se comporter l'gard de la premire comme de l'autre, c'est--dire s'efforcer d'en connatre les lois pour s'en rendre
matre autant qu'il lui sera possible. Tout le monde n'accorde pas cette conception ni
cette consquence. Souvent encore, l'ordre de la nature physique, invariable et indpendant de nous, on oppose l'ordre moral, qui a son origine et son dveloppement
dans la conscience, et o intervient la libert de l'homme. C'est un des points essentiels de la grande querelle entre les sociologues de l'cole de M. Durkheim et les
reprsentants des anciennes sciences morales . Les faits moraux sont-ils des faits
sociaux, et les faits sociaux en gnral peuvent-ils faire l'objet d'une science proprement dite, ou un lment de contingence toujours renouvele et irrductible s'opposet-il la constitution d'une telle science ?
Nous ne songeons nullement augmenter le nombre des travaux o la dfinition,
les caractres, la possibilit, la lgitimit de la sociologie ont t examins tant de
fois. Les essais de ce genre n'ont qu'un temps, et le temps en est pass. A quoi bon
prouver abstraitement qu'une science est possible, quand le seul argument dcisif, en
pareille matire, est de produire des travaux qui aient un caractre scientifique ? Une
science dmontre sa lgitimit par le simple fait de son existence et de ses progrs. Et
de mme, quoi sert de contester dialectiquement la possibilit d'une science qui
donne des tmoignages positifs et rpts de son existence ?
Les reprsentants de la sociologie scientifique ont pris le bon parti de soutenir leur
doctrine par des travaux effectifs plutt que par des raisonnements abstraits. Ils sont
encore loin, il est vrai, de l'avoir fait accepter universellement. Mais leur tentative est
toute rcente, et elle se heurte des opinions traditionnelles trs fortes, des prjugs
enracins, des sentiments vivaces. En outre, nous avons d'autant plus de peine
concevoir des phnomnes comme rgis par des lois invariables, que nous pouvons
plus facilement les modifier par notre intervention volontaire. L'ide philosophique de
la ncessit nous vient, ce qu'il semble, des mathmatiques, de la logique, de l'astronomie, par l'exprience que nous faisons l du ne pas pouvoir tre autrement . Inversement, l'ide philosophique de la contingence ou de l'imprvisibilit tire sans
doute son origine de l'observation des phnomnes biologiques, et surtout des phnomnes moraux. Dans ce domaine, il dpend de nous, semble-t-il souvent, qu'une chose soit ou ne soit pas. Quoi de plus ais, en gnral, que de dtruire la vie des plantes
ou des animaux ? Quoi de plus notre discrtion, en apparence, que notre propre
conduite ? D'o nous infrons aussitt, bien qu' tort, que ces phnomnes ne sont pas
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
43
soumis des lois comme les premiers. Pourtant, que nous touffions un animal ou
que nous le laissions respirer, c'est en vertu des lois invariables qu'il vit ou qu'il
meurt. Que nous fassions ou que nous ne fassions pas notre devoir en une circonstance donne, il ne dpend pas de nous que ce devoir ne nous apparaisse comme obligatoire, ni que notre action, dans un cas comme dans l'autre, n'entrane des consquences qui peuvent tre connues l'avance. Par exemple, si j'ai manqu sciemment
mon devoir, des sanctions de diffrentes sortes se produiront (remords, raction
sociale sous forme de dsapprobation publique et de chtiment), et les forces ainsi mises en jeu agissaient dj auparavant sous forme de reprsentations et de sentiments.
A ne considrer que nous-mmes, et la socit o nous vivons, nous pouvons
croire que nos jugements et nos sentiments moraux prennent naissance dans notre
conscience, et qu'il n'y a pas en chercher l'origine au-del, ni en dehors d'elle. Cette
origine parat suffisamment prouve par le caractre impratif des devoirs que la
conscience nous dicte. Mais examinons les jugements et les sentiments moraux d'un
homme non civilis, ou appartenant une civilisation autre que celle de notre socit:
d'un Fugien, d'un Grec de l'poque homrique, d'un Hindou, d'un Chinois. A cette
conscience, diffrente de la ntre, certaines actions apparaissent obligatoires, certaines autres, interdites. Que ces obligations et ces dfenses soient, nos yeux, raisonnables ou absurdes, humaines ou horribles, nous n'hsitons pas en rendre compte par
les croyances religieuses, par l'tat intellectuel, par l'organisation politique et conomique, bref par l'ensemble des institutions de la socit o ces hommes vivent. Et
quand ils seraient persuads de n'obir qu' leur seule conscience en accomplissant tel
ou tel acte, nous, qui voyons la fois et l'acte et les conditions sociales qui le dterminent, nous en jugeons mieux. Nous savons quel rapport unit les consciences individuelles la conscience sociale qu'elles expriment. Nous comprenons leur conviction, et
pourquoi elle a d se produire.
Mais, si ces considrations sont exactes, elles valent pour notre cas comme pour
les autres. On ne voit pas pourquoi l'investigation scientifique pourrait s'appliquer
toutes les morales humaines, except la ntre. Sur quoi se fonderait une pareille
prtention ? Mtato nomine, de le... Pour les peuples civiliss de l'Extrme-Orient, les
Occidentaux sont des barbares. Aux yeux de nos descendants du Le sicle, notre
civilisation paratra sans doute, sous certains aspects, aussi repoussante que celle des
Dahomens l'est pour nous. Cette humanit plus savante et, vraisemblablement, plus
douce aussi que celle d'aujourd'hui, saura comprendre non seulement nos murs, qui
ne seront plus les siennes, mais encore le fait que nous les ayons expliques tout
autrement qu'elle le fera.
En dpit de ces raisons, l'tude objective et scientifique de la nature sociale ,
semblable l'tude objective et scientifique de la nature physique , reste une conception d'apparence paradoxale. L'assimilation de ces deux natures l'une l'autre
semble force et fausse. Elle choque la reprsentation traditionnelle, et encore universellement accepte, qui place l'homme au point de contact de deux mondes distincts
et htrognes : l'un physique, o les phnomnes sont rgis par des lois constantes,
l'autre moral, qui lui est rvl par la conscience. De ces deux mondes, le premier
seul, croit-on, peut tre conquis par la science positive. Le second lui chappe, et ne
prte qu' des spculations d'un ordre diffrent. Au premier seulement convient le
nom de nature .
- Cette distinction est lie par notre mtaphysique l'immortalit de l'me et au
libre arbitre de l'homme, croyances qui sont d'un intrt capital dans notre civilisa-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
44
tion. Elle est donc dfendue, comme ces croyances, avec une tnacit passionne.
Mais, d'un point de vue purement rationnel, et tout sentiment mis part, elle se justifie mal. Si par nature on n'entend pas la totalit de la ralit donne, si l'on restreint la signification de ce terme la partie de cette ralit que nous concevons
comme soumise des lois constantes, il y a quelque tmrit prtendre fixer le point
o cette nature finit. Car la limite s'en est plusieurs fois dplace. Ce que l'on
appelle nature s'est constitu peu peu pour notre entendement. Il n'est pas
impossible de retrouver les phases successives que cette nature a traverses pour
s'tendre. M. Lasswitz, dans sa belle Histoire de l'Atomisme, a mis en pleine lumire
quelques moments de cette volution. Il montre comment des parties de la ralit
extrieure, dont l'homme a toujours eu connaissance par la sensation, n'ont t
incorpores la nature (au sens strict du mot), que depuis le jour o les phnomnes
sont reprsents d'une faon proprement intellectuelle, objective, c'est--dire conus
comme soumis des lois. Par exemple, les Anciens avaient comme nous la perception sensible de la lumire et des couleurs. Pourtant, lumire et couleurs ne sont
rellement entres dans notre conception de la nature qu'aprs l'analyse du spectre et
les dcouvertes ultrieures de l'optique. Car, alors seulement, nous avons eu de ces
phnomnes une reprsentation objective, conceptuelle, et faisant corps pour notre
entendement avec le reste des lois de la nature.
Ce que Newton a dcouvert pour la lumire et les couleurs, les Grecs l'avaient
dj trouv pour les sons. Un physicien de gnie le fera peut-tre quelque jour pour
les odeurs. Ce jour-l, la somme des perceptions possibles pour nos sens n'aura pas
vari et, nanmoins, du seul fait de l'objectivation de perceptions qui auparavant
taient purement sensibles, quelque chose sera chang dans la conception de la nature. L'exemple de l'optique montre quelle vaste tendue de dcouvertes peut s'ouvrir,
une fois l'objectivation commence, dcouvertes dont on ne pouvait jusque-l avoir
mme le pressentiment, et qui enrichissent singulirement notre ide de la nature
(double rfraction, diffraction, polarisation, analyse spectrale, rayons infrarouges et
ultraviolets, action chimique de la lumire, rayons X, thorie lectromagntique de la
lumire, etc.).
D'une faon gnrale, notre conception de la nature s'agrandit et s'enrichit chaque
fois qu'une portion de la ralit qui nous est donne dans l'exprience se dsubjective pour s'objectiver. Cette conception n'est donc pas toujours semblable ellemme, ni de contenu constant. Au contraire, elle n'a gure cess de varier depuis
l'poque trs recule o elle est ne. Car elle a d natre. Il a exist un temps o aucune squence presque de phnomnes n'apparaissait comme infailliblement rgulire :
les esprits et les dieux pouvaient, par leur action arbitraire, peu prs tout produire et
tout empcher. A ce moment, le domaine de la nature, si tant est que la nature soit
conue, mme d'une faon vague, est presque infiniment petit. Il est alors minimum.
Peu peu il s'est form, il s'est accru, et il comprend aujourd'hui la plus grande partie
de ce qui nous est donn dans l'espace. Mais de quel droit, au nom de quel principe,
fixerions-nous ds prsent le maximum qu'il ne dpassera pas ? Pourquoi
exclurions-nous a priori de la nature ainsi conue telle portion du rel, les phnomnes sociaux par exemple ? Parce que nous n'prouvons pas aujourd'hui le besoin de
les y faire entrer, parce qu'un sentiment spontan s'y oppose ? Pauvres raisons : car,
sans critiquer le rle que l'on fait jouer ici au sentiment, nous voyons, par l'histoire
des sciences, que l'esprit humain se trouve toujours satisfait de la conception intellectuelle du monde, quelle qu'elle soit, qui lui est transmise. Il suit la ligne de moindre
effort, et il tend conserver tel quel l'hritage intellectuel qu'il a reu. Loin de dsirer
ou de rclamer un enrichissement pour la conception traditionnelle de la nature, il
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
45
n'accepte presque jamais sans rsistance celui qu'on lui offre, et seulement aprs un
temps plus ou moins long.
Rien ne s'oppose donc, a priori, ce que le processus d'objectivation se poursuive,
ce que de nouvelles portions de la ralit donne entrent dans la reprsentation
intellectuelle de la nature, et soient dsormais conues comme rgies par des lois
constantes. C'est une conqute de ce genre que la sociologie scientifique ralise. La
rsistance qu'elle rencontre est un fait normal, et qui pouvait tre prvu. La distinction
rigide entre le monde de la nature physique et le monde moral n'est qu'un aspect
de cette rsistance.
Mais encore, comment parler de lois, quand il s'agit de faits qui, pour la plupart,
ne nous sont fournis que par l'histoire, c'est--dire connus par des tmoignages, avec
l'lment d'incertitude, avec la part d'interprtation que tout tmoignage comporte, et
qui ne sont donns qu'une seule fois, les faits de l'histoire ne se rptant jamais d'une
faon identique ? - Sur le premier point, la rponse est fournie par l'existence de
sciences dj sculaires, des sciences philologiques, par exemple, qui, sans autre
matire que des tmoignages, tablissent des lois incontestes. Quant la seconde
objection, elle prouve trop. Leibniz a dit dj qu'il n'y a pas deux tres identiques dans
la nature. Ce qu'il y a d'irrductiblement individuel dans chaque arbre, chaque animal,
chaque tre humain, intresse surtout l'artiste : le savant cherche dgager, sous les
diffrences individuelles, les lments constants qui sont les lois. Il y parvient ds
prsent en biologie, malgr les difficults extrmes que prsentent l les recherches
scientifiques. Affirmer qu'il n'y russira jamais dans l'tude des faits sociaux serait
pour le moins tmraire.
De mme que nous avons de presque toute la ralit donne dans l'espace deux
reprsentations parfaitement distinctes, l'une sensible et subjective, l'autre conceptuelle et objective; de mme que le monde des sons et des couleurs est aussi l'objet de
la science physique ; de mme enfin que nous sommes accoutums nous reprsenter
objectivement comme des ondes de l'ther ce que nous prouvons subjectivement
comme chaleur et comme lumire, sans que l'une de ces reprsentations exclue l'autre
ni mme s'y oppose; de mme, nous pouvons possder en mme temps deux reprsentations de la ralit morale, l'une subjective, l'autre objective. Nous pouvons, d'une
part, subir l'action de la ralit sociale o nous sommes plongs, la sentir se raliser
dans notre propre conscience, et de l'autre, saisir dans cette ralit objectivement
conue les relations constantes qui en sont les lois. La coexistence en nous de ces
deux reprsentations nous deviendra familire. Elle ne soulvera pas plus de difficults que lorsqu'il s'agit du monde extrieur. Les progrs de l'acoustique ont-ils rien
enlev la puissance motionnelle des sons, et quand Helmholtz a eu dcouvert la
thorie physique du timbre, les richesses de l'orchestration d'un Beethoven ou d'un
Wagner ont-elles cess de faire les dlices de nos oreilles ? Nous ne sommes pas
moins sensibles la dlicatesse et l'clat des couleurs, depuis que l'optique sait les
dcomposer. Pareillement, quand la science des faits moraux nous en aura donn une
reprsentation objective, quand elle les aura incorpors la nature , la vie intrieure de la conscience morale n'aura rien perdu de son intensit, ni de son irrductible originalit.
Une diffrence cependant subsiste. La nature physique s'impose pour ainsi dire du
dehors l'homme, toujours semblable elle-mme, et indiffrente sa prsence. Les
phnomnes se produisent conformment aux lois l'intrieur de la terre, qui nous est
inaccessible, comme sa surface. Mais les murs, les langues, les religions, les arts,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
46
en un mot les institutions sont luvre de l'homme, le produit et le tmoignage de son
activit, transmis de gnration en gnration, bref, la matire mme de son histoire.
Ils sont autres l o cette histoire est autre. Comment concilier cette diversit selon
les temps et les lieux avec le caractre essentiel de la nature, qui consiste en une
constante et parfaite uniformit ?
Cette difficult ne fait qu'exprimer sous une forme nouvelle une objection que
nous avons examine plus haut. Elle revient douter a priori que des phnomnes
donns, dans une apprhension primitive, comme infiniment divers, et comme incommensurables les uns avec les autres, puissent jamais faire l'objet d'une reprsentation
intellectuelle et d'une science proprement dite. Il est vrai qu'ils ne le peuvent pas,
dans cet tat. Mais il suffit, pour qu'ils le puissent, qu'ils aient subi une laboration
permettant de les concevoir comme objectifs, et d'en dcouvrir les lois constantes.
Ceci n'est pas une hypothse : non seulement la mcanique, la physique, et les autres
sciences de la nature physique se sont constitues ainsi, mais on en peut dire autant de
la linguistique, de la science des religions, et d'autres sciences du mme genre. Il reste
que, pour la plupart des catgories de faits sociaux, les moyens actuels d'objectivation
sont encore trs insuffisants, ou mme font dfaut. Mais, si l'on veut dire seulement
que la sociologie en est encore la priode de formation, personne ne le conteste,
except ceux qui tendent prouver, par leurs ouvrages, qu'elle n'est pas une science.
Le point capital est que la ralit morale soit dsormais incorpore la nature, c'est-dire que les faits moraux soient rangs parmi les faits sociaux, et que les faits sociaux
en gnral soient conus comme un objet de recherche scientifique, au mme titre et
par la mme mthode que les autres phnomnes naturels.
De cette faon, les rapports de la thorie et de la pratique en morale redeviennent
normaux et intelligibles. Dans ce cas, comme dans les autres, la pratique rationnelle,
qui doit venir tt ou tard modifier la pratique spontane issue des besoins immdiats
de l'action, dpend dsormais du progrs dans la connaissance scientifique de la
nature. Nous sortons de la confusion inextricable o nous entranait l'ide d'une
science de la morale , d'une morale pure , d'une morale thorique , qui devait
tre tout ensemble normative et spculative, sans pouvoir satisfaire la fois ces
deux exigences. L'une se spare de l'autre, conformment la nature des choses. Dsormais l'effort spculatif ne consiste plus dterminer ce qui doit tre , c'est-dire, en ralit, prescrire. Il porte, comme en toute science, sur une ralit objective
donne, c'est--dire sur les faits moraux et sur les autres faits sociaux insparables de
ceux-ci. Comme en toute science encore, il n'a d'autre fin directe et immdiate que
l'acquisition du savoir. Parvenu un certain degr de dveloppement, ce savoir permettra d'agir, d'une faon mthodique et rationnelle, sur les phnomnes dont il aura
dcouvert les lois. Ainsi la prtendue morale thorique disparat. La morale
pratique subsiste en fait. Elle devient l'objet de l'investigation scientifique qui, sous
le nom de sociologie, entreprend l'tude thorique de la ralit morale. Et cette tude
thorique prtera plus tard des applications, c'est--dire des modifications de la
pratique existante. Transformation des sciences morales grosse de consquences,
dans le domaine de la pense comme dans le domaine de l'action, et dont nous ne
pouvons apercevoir encore que la priode prliminaire.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
47
CHAPITRE II
QUE SONT
LES MORALES THORIQUES
ACTUELLEMENT EXISTANTES?
I
Les doctrines morales divergent par leur partie thorique et s'accordent par les
prceptes pratiques qu'elles enseignent. - Explication de ce fait : les morales
pratiques ne peuvent pas s'carter de la conscience morale commune de leur
temps. - La pratique ne se dduit donc pas ici de la thorie ; mais la thorie, au
contraire, est assujettie rationaliser la pratique existante.
Retour la table des matires
Paul Janet avait coutume de dire que l'on a tort, dans l'enseignement de la morale,
de commencer par la morale thorique pour descendre la morale applique. C'est de
celle-ci, selon lui, qu'il faudrait partir, pour remonter ensuite la thorie. Outre des
raisons d'ordre pdagogique, que l'on peut deviner, Paul Janet faisait valoir, l'appui
de son opinion, cette rflexion d'ordre philosophique : les morales thoriques divergent, tandis que les morales pratiques concident. Les divers systmes sont inconciliables, et se rfutent les uns les autres sur les questions de principes ; ils sont d'accord
sur les devoirs remplir.
Le fait signal par P. Janet est exact. On ne peut nier que, une mme poque et
dans une mme civilisation, les diffrentes doctrines morales n'aboutissent, en gnral, des prceptes aussi semblables entre eux que les thories le sont peu. Sans
doute, il y a des exceptions. Telles sont les morales que l'on peut appeler paradoxales
ou excentriques (la morale cynique dans l'Antiquit, ou la morale de Nietzsche
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
48
aujourd'hui). Mais elles sont rares, et elles n'agissent que sur une portion restreinte du
public, d'esprit raffin, et capable de prter l'oreille des conseils pratiques qui piquent sa curiosit, sans y conformer aussitt sa conduite. Le plus souvent, ce sont
moins des thories morales proprement dites, c'est--dire des tentatives de construction systmatique, que des protestations contre la routine ou l'hypocrisie morales.
Parfois, c'est un effort pour secouer les consciences qui s'endorment sur les formules
toutes faites d'une philosophie attarde et complaisante. Si l'on met part ces doctrines rvolutionnaires, dont le rle est souvent fort utile, les autres, si diffrentes
qu'elles soient par ailleurs, se trouvent d'accord sur le terrain de la pratique. Cette
concidence se remarquait dj dans les coles morales les plus clbres de
l'Antiquit. ternels adversaires dans la rgion des principes, les stociens et les
picuriens fondent leurs doctrines sur des conceptions de la nature rigoureusement
opposes ; mais ils finissent par prescrire la mme conduite dans la plupart des cas.
Snque, comme on sait, se plat emprunter indiffremment ses formules tantt
picure et tantt Znon.
Chez les modernes, mmes rencontres. Ds qu'il s'agit de la pratique, l'extrme
diversit des doctrines fait place une quasi-uniformit. Considrons la srie des
doctrines examines par M. Fouille dans sa Critique des systmes de morale contemporains. N'est-il pas dj significatif que cette critique porte peu prs sans exception
sur la partie thorique de ces systmes ? C'est apparemment que M. Fouille pense
qu'ils diffrent entre eux par cette partie-l seulement. Kantienne ou criticiste, utilitaire, pessimiste, positive, volutionniste, spiritualiste, thologique, chaque doctrine
morale dfend jalousement l'originalit de son principe thorique contre les objections des autres : mais elle n'hsite pas formuler dans les mmes termes que ses
rivales les rgles directrices de la conduite, les prceptes concrets de la justice et de la
charit. Dj Schopenhauer avait attir l'attention sur cet accord invitable. Il est
difficile, disait-il, de fonder la morale : il est ais de la prcher. Car il n'y a pas deux
faons de le faire. Ses rgles gnrales : Suum cuique tribue. Neminem laede. Imo
omnes, quantum potes, juva, n'ont rien de mystrieux. Elles sont assures d'un
assentiment unanime. Schopenhauer ne s'arrte pas un instant l'ide que des morales
pratiques diffrentes puissent s'opposer les unes aux autres. Il lui parat vident que
les mmes maximes se retrouvent partout. John Stuart Mill, de son ct, remarque
que la rgle suprme de son utilitarisme se confond avec le prcepte de l'vangile :
Aime ton prochain comme toi-mme. Et Leibniz, deux sicles auparavant, montrait
l'accord, au point de vue pratique, entre sa morale rationnelle et la morale religieuse,
en disant : Qui Deum amat, amat omnes. Il serait facile de multiplier les exemples.
Sans doute, le fond commun prend des teintes varies, selon le systme o il
entre. Mme ici, l'originalit et le temprament de chaque philosophe impriment leur
marque, et des divergences apparaissent sur des points spciaux de morale pratique.
Par exemple, le mensonge est, aux yeux de Kant, la faute morale par excellence. Rien
ne peut l'excuser. Au contraire, selon Schopenhauer, d'accord en ce point avec plusieurs moralistes anglais, le mensonge est indiffrent, et par consquent licite, dans un
certain nombre de cas. M. Spencer soutient que la charit, telle qu'elle est enseigne
par la morale chrtienne, est anti-sociale et impraticable. Mais ces divergences
n'infirment pas l'accord des diverses doctrines sur les points essentiels. Ce n'est
jamais les rgles gnrales Neminem laede, imo omnes.... qui sont mises en question,
mais simplement l'application qu'il faut en faire dans une conjoncture donne. Tel est
aussi le sentiment de M. Sidgwick. Il a fait voir en dtail, dans ses Methods of Ethics,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
49
comment les morales intuitionnistes et les morales empiriques, malgr l'opposition de
leurs principes, finissent par concider peu prs si l'on considre la pratique.
Assurment, cette convergence n'est pas fortuite. Elle doit avoir sa raison dans
certaines conditions auxquelles les morales pratiques doivent toutes satisfaire, et qui
leur imposent cette quasi-uniformit. C'est en effet ce qui a lieu. Les philosophes ne
se soucient peut-tre pas beaucoup de s'accorder entre eux, au point de vue thorique :
mais, en tant qu'ils enseignent une morale pratique, ils tiennent fort ne pas tre
dsavous par la conscience morale commune. Dj, dans la spculation pure, ils
prennent soin, pour la plupart, de ne pas se mettre ouvertement en contradiction avec
le sens commun . Plus un systme est paradoxal d'apparence, plus il s'efforce de
montrer que, au fond, le sens commun dit comme lui, en son langage : s'il savait s'expliquer, c'est--dire dvelopper ce qu'il contient implicitement, le sens commun
aboutirait ce systme. Ce souci d'avoir le sens commun pour soi ne provient pas
seulement du dsir de n'effaroucher personne, et de se concilier des partisans. Il rpond au besoin que la pense de l'individu ressent de se persuader elle-mme qu'elle
exprime des vrits valables pour la raison de tous. A fortiori, s'il s'agit de morale
pratique. Quelles que soient ses prtentions l'originalit, l'auteur ne se sent
tranquille que si les principes gnraux formuls par lui sont, pour ainsi dire, accepts
d'avance par la conscience commune. Et, tandis qu'il se trouve des systmes de
philosophie spculative pour se passer de l'acquiescement, mme apparent, du sens
commun, et pour en appeler des juges plus comptents, il ne se rencontre gure de
doctrine morale qui ose se dclarer ouvertement en dsaccord, sur les questions de
pratique, avec la conscience morale de son temps. Quand Fourier ou les Saint-Simoniens veulent modifier les rgles de la morale sexuelle, leur drogation la pratique
courante prtend encore se justifier par les principes mmes sur lesquels cette
pratique repose. Elle en appelle de la conscience commune la conscience mieux
claire. Elle invoque le droit des deux sexes l'galit dans les MURS comme
devant la loi. La rhabilitation de la chair tait, du moins pour une part, une faon
de protester contre la subordination morale et lgale d'un sexe l'autre. Elle pouvait
donc en ce sens, comme tout l'effort socialiste de cette priode, se rclamer de la
conscience morale mme, qui n'est jamais lasse de demander plus de justice dans les
relations humaines.
Pour conclure, les morales pratiques d'un temps donn, devant s'accorder avec la
conscience commune de ce temps, s'accordent donc aussi entre elles. Les morales
thoriques, de caractre plus abstrait, n'intressent pas aussi directement cette conscience, et peuvent diverger sans l'inquiter.
S'il en est ainsi, le rapport de la thorie la pratique morale devient tout fait
singulier. Partout ailleurs, il faut que le savoir thorique soit obtenu d'abord ; les
applications ne sauraient venir qu'ensuite, par une srie de dductions plus ou moins
compliques. Dans le cas de la morale, la pratique parat au contraire indpendante de
la thorie ; rien ne prouve que celle-ci lait Prcd celle-l, et nous avons toute raison
de penser le contraire. Il ne saurait tre question non plus d'une dduction allant des
principes thoriques aux consquences pratiques. Car comment cette dduction
aboutirait-elle des applications identiques, si elle partait vraiment de principes
opposs ? Si elle tait relle dans un des systmes entre lesquels les philosophes se
partagent, celui-l aurait sans doute la force d'liminer les autres. Or ce rsultat ne
s'est jamais produit. Il faut donc avouer qu'en morale ce ne sont pas les applications
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
50
qui se tirent de la thorie. Elles prexistent, au contraire : ce sont les thories qui se
rglent sur elles.
Je comparerais volontiers les morales thoriques des courbes assujetties passer
par un certain nombre de points. Ces points reprsentent les grandes rgles de la
pratique, les faons d'agir qui sont obligatoires pour la conscience morale commune
d'un mme temps. Ces faons sont d'ailleurs dtermines, dans une certaine mesure,
les unes par les autres. Par exemple, une structure donne de la famille entrane ncessairement certaines consquences dans la lgislation et dans les murs. D'autre
part, les caractres les plus gnraux de la nature humaine, physique et morale, et les
conditions constantes de la vie en socit sont comme le plan commun o ces courbes
seraient traces. Il est vident que plusieurs courbes pourront satisfaire aux conditions
proposes, c'est--dire tre sur le plan et passer par les points donns. Pareillement,
plusieurs systmes de morale peuvent jouer le rle de thorie l'gard de la pratique
prexistante. Pourvu qu'une dduction apparente s'tablisse, ils seront tous des interprtations acceptables, sinon galement satisfaisantes, de rgles qui ne leur doivent
point leur autorit.
De cette faon seule peut s'expliquer le paradoxe d'une pratique dont on ne doute
pas, dduite d'une thorie encore incertaine. Si nous ne perdions la facult de nous
tonner de ce qui nous est familier, nous ne pourrions assez admirer ce prodige.
Quoi ! nous ne savons pas quel est le fondement de l'obligation morale, ou, si l'on
aime mieux poser le problme la faon des anciens, nous ignorons quel bien nous
devrions poursuivre de prfrence ; et si les uns disent le bonheur, d'autres, avec non
moins de vraisemblance et d'autorit, recommandent l'obissance Dieu, la recherche
de la perfection, l'intrt particulier ou gnral, etc. Et cette incertitude si grave
n'entrane, ne permet aucune hsitation dans la pratique! Que je sois kantien, spiritualiste, ou utilitaire, il n'en rsulte aucune diffrence, ni pour les autres, ni pour moimme, quant au jugement porter sur mes actes. Si ma conduite est gnralement
blme comme immorale, j'aurais beau faire voir qu'elle est d'accord avec ma thorie,
que je considre comme dmontre : le seul rsultat que je saurais obtenir sera de
passer probablement pour un hypocrite, qui colore ses mfaits de raisons honntes, et
de faire tendre ma doctrine la rprobation qui frappe mes actes.
Il suffit qu'une thorie soit en dsaccord avec ce qu'exige la conscience morale
commune pour que nous la condamnions comme mauvaise ; et nous n'hsitons pas
en conclure aussitt qu'elle est fausse. La condamnation peut se trouver lgitime ; il
se pourrait aussi qu'elle ne le ft pas. Du moins, cette juridiction exerce sur les thories au nom de la pratique quivaut, au fond, la reconnaissance d'un droit suprieur
chez celle-ci. Si nous ne savons pas encore ce que sont rellement les morales thoriques, nous savons dj ce qu'elles ne sont pas. Qu'elles y prtendent ou non, ce n'est
pas elles qui fondent les principes directeurs de la pratique.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
51
II
De l vient que : 1 La spculation morale des philosophes a rarement inquit la
conscience; - 2 Il n'y a gure eu de conflits entre elle et les dogmes religieux ; 3 Elle se donne pour entirement satisfaisante et possde des solutions pour
tous les problmes, ce qui n'est le cas d'aucune autre science. - En fait, c'est
l'volution de la pratique qui fait apparatre peu peu des lments nouveaux
dans la thorie.
Retour la table des matires
Cette interprtation de la nature relle du rapport existant entre les morales thoriques et les morales pratiques est confirme par un certain nombre de faits, qu'il
serait difficile d'expliquer autrement.
En premier lieu, il est trs rare qu'une doctrine morale soit combattue au nom de
la conscience. Pourtant, puisque les systmes de morale s'opposent les uns aux autres,
puisque leurs principes s'excluent mutuellement, il semblerait ncessaire, si les uns
ont des consquences acceptables au point de vue de la pratique, que les autres fussent rejets parce qu'ils conduisent des consquences contraires. Sans doute, les
philosophes ne ngligent pas toujours cet argument contre leurs adversaires. Les
partisans de la morale du devoir , pour rfuter la morale du plaisir , ou la morale de l'intrt , ne manquent gure de montrer qu'elles conduisent des consquences inacceptables pour la conscience. Mais les dfenseurs de ces morales dsavouent
les dductions que l'on a tires pour eux. Ils prtendent, au contraire, que leurs doctrines aboutissent prcisment aux prceptes que la conscience rclame. Et, rendant la
pareille leurs adversaires, ils se flattent leur tour de faire voir que la morale du
devoir ne donne nullement satisfaction aux exigences de la conscience. C'est donc
l une objection que les systmes se renvoient les uns aux autres, avec une gale
vraisemblance, car ils sont tous hors d'tat de prouver que la pratique existante se tire
effectivement de leurs principes - et avec une gale injustice, car tous obissent une
mme proccupation : tous prennent garde de choquer, par leurs prceptes, la conscience morale de leur temps.
Aussi, malgr la grande varit apparente des thories morales, surtout chez les
modernes, ne se produit-il gure de systme qui fasse scandale, et qui provoque l'indignation, ou seulement la dsapprobation publique. Si excentrique, si peu comprhensif que soit le principe d'o il part, l'auteur trouve moyen de rintgrer dans sa
doctrine, chemin faisant, les lments qu'il avait d'abord paru ngliger. Sauf exception, il finit par soutenir, comme les autres, que son systme ne refuse la conscience
aucune des satisfactions qu'elle demande. C'est comme si, parmi les courbes que nous
avons supposes tout l'heure, quelques-unes affectaient des formes extraordinaires
ou bizarres, mais sans cesser de remplir les conditions du problme, et de passer par
les points donns.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
52
C'est pourquoi l'tranget apparente d'une doctrine morale n'inquite personne,
tant qu'il s'agit simplement de thorie. Elle n'a d'autre effet, au moins immdiat, que
de fournir un aliment la controverse philosophique. Mais la pratique y est-elle
directement intresse, la doctrine tend-elle introduire quelque chose de nouveau
dans les MURS ou dans la lgislation, les choses changent de face : aussitt se produit une raction des plus vives. Tmoin le cas de Socrate : sa conception de la morale, qui subordonne la pratique la science, tait rvolutionnaire au premier chef, aux
yeux de la tradition athnienne. (Elle le serait encore aujourd'hui.) Tmoin le cas de
Spinoza, qui heurte de front la pratique de son temps, quand il recommande, par
exemple, la mditation de la vie, et non de la mort, quand il condamne l'humilit au
mme titre que l'orgueil. Tmoin le cas de Rousseau, mettant en question les privilges, les droits acquis, et mme le droit de proprit. On citerait sans peine d'autres
exemples, et l'on verrait que c'est toujours une question touchant immdiatement la
pratique qui a soulev contre le philosophe les protestations et les colres de ses
contemporains.
En second lieu, il est remarquable que les conflits aient toujours t rares entre les
thories morales et les dogmes religieux. Ils sont frquents, au contraire, entre ces
dogmes et la spculation philosophique ou scientifique. L'Antiquit les a connus
comme lEurope chrtienne. Mais c'est surtout depuis la Renaissance qu'ils se sont
multiplis. La cause qui les dtermine est toujours une dcouverte ou une nouvelle
mthode, en matire de philosophie naturelle, qui parat contredire la vrit religieusement consacre. Faut-il rappeler les cas les plus clbres : Anaxagore disant
que le Soleil est une pierre incandescente, Protagoras doutant que l'homme puisse
connatre les dieux , Galile prouvant le mouvement de la Terre, Descartes formulant la conception de la physique moderne, Diderot crivant la Lettre sur les aveugles,
Darwin exposant l'hypothse transformiste ? Partout o la tradition religieuse enseigne une certaine interprtation, mtaphysique et positive, de l'univers, et par suite,
implique certaines solutions des grands problmes de la philosophie et de la science
de la nature, il est sr qu'elle s'opposera aux conceptions et aux solutions nouvelles
que le progrs de la philosophie et du savoir positif fait peu peu surgir. De l, quand
elle dispose du pouvoir - soit, comme Athnes, parce que la dmocratie rgnante est
conservatrice ; soit, comme dans nos socits europennes, parce que la foi religieuse
est tenue pour un soutien indispensable de l'ordre publie -, de l, une surveillance
souponneuse exerce sur les philosophes et sur les savants. De l mme des perscutions, si les circonstances le permettent. Qu'on se rappelle les prcautions humiliantes
que les philosophes du XVIIIe sicle ont d prendre pour dissimuler leurs ides tout
en les publiant, et les clectiques mmes du XIXe tremblant l'ide d'tre accuss de
panthisme , de scepticisme et surtout de matrialisme ! Y a-t-il si longtemps que la gologie, l'histoire naturelle, l'histoire n'ont plus se proccuper de
paratre d'accord avec les textes sacrs ?
D'o vient que, si ombrageux, si combatifs, quand il s'agit de philosophie naturelle, les dfenseurs de la tradition religieuse et des dogmes le soient si peu en matire
de spculation morale ? Parfois, il est vrai, des doctrines ont t combattues au nom
de la religion, comme immorales et impies tout ensemble. Encore, y regarder de
prs, leur tait-on hostile pour d'autres causes. Par exemple, quand la philosophie
atomistique ou corpusculaire reprit faveur, dans la premire moiti du XVIIe sicle, elle fut attaque dans sa partie morale au nom de la religion. Mais ce que l'on
visait travers les partisans de l'picurisme renouvel, c'tait les libertins , c'est-dire les incroyants, les athes, ou, comme on dira plus tard, les libres penseurs. La
thorie rellement poursuivie comme dangereuse n'tait pas une morale, mais l'hypo-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
53
thse des atomes, qui, croyait-on, conduisait ncessairement l'athisme. De mme,
les adversaires des philosophes franais au XVIIIe sicle leur ont reproch l'immoralit de leur morale. Mais c'est leur exgse et leur insurrection contre le principe
d'autorit qui taient la raison vritable du conflit. Bref, les attaques diriges contre
une thorie morale en tant que telle pour des motifs religieux, ont toujours t fort
rares, si mme il s'en est jamais produit.
En serait-il ainsi, si la recherche scientifique s'tait dveloppe en morale comme
elle l'a fait dans l'tude de la ralit physique ? N'est-il pas vident qu'elle aurait
rencontr aussi de nombreuses occasions de conflits ? De plus nombreuses mme :
car les croyances morales sont encore plus intimement lies aux dogmes religieux (du
moins dans les socits modernes), que les conceptions relatives la nature. Le
catchisme contient plus de morale que de mtaphysique. Pourtant, la spculation
philosophique sur la morale n'a gure inquit les dfenseurs de la religion. Ils savaient apparemment qu'ils n'avaient rien en craindre. Si l'tude sociologique de la
famille, de la proprit, des rapports conomiques et juridiques entre les diffrentes
classes sociales commence aujourd'hui veiller des dfiances, c'est que cette portion
de la ralit sociale est enleve aux morales thoriques pour tre traite dsormais
par une mthode positive et scientifique.
Jusque-l, le conflit n'clatait pas. Il et t sans objet. Tant que les morales
thoriques tiennent la place d'une tude scientifique, la tradition religieuse n'a pas
en prendre ombrage, ni se dfendre contre elles. Ce qui lui importe, c'est que la
morale universellement admise, et solidaire de ses dogmes, conserve son autorit sur
les mes. Pourvu donc que les systmes de morale thorique aboutissent par un
artifice de dduction plus ou moins habile s'accorder, au point de vue pratique, avec
cette morale, c'est--dire avec la conscience commune du temps, la tradition religieuse ne s'alarmera pas de leurs prtentions philosophiques. C'est bien ainsi que les
choses se sont passes jusqu' prsent. Rien, dans l'histoire de la morale thorique, ne
rappelle, mme de loin, les grandes rvolutions d'ides, consquences incalculables,
qu'ont dtermines dans la conception du monde physique les dcouvertes de Copernic, de Kepler, de Galile. Inoffensive, la spculation morale n'a pas t inquite.
Bien mieux, les systmes de morale, grce leur appareil logique, prtent aux prceptes gnralement admis un air de rationalit dont la tradition religieuse s'accommode
merveille. Car il est de son intrt qu'il y ait une apparence de spculation thorique
sur la ralit morale, et que ce soit seulement une apparence.
En troisime lieu, toutes les sciences rellement spculatives, quels qu'en soient
l'objet et la mthode, vieilles de vingt sicles ou nes d'hier, s'accordent faire un mme aveu. Elles se reconnaissent imparfaites et incompltes. Elles ne dissimulent point
que ce qu'elles savent n'est rien au prix de ce qu'elles ignorent. Cela est vrai de la plus
rigoureuse et de la plus avance des sciences humaines, des mathmatiques, au dire
de ceux qui les ont pousses le plus loin. A plus forte raison cela est-il vrai de celles
qui portent sur une ralit plus complexe. Des branches entires de la chimie sont en
train de se constituer. La chimie physique ne fait que de natre. En biologie, nos ignorances sont encore formidables, et le peu que l'on sait est d'un faible secours l'art
mdical. Enfin la psychologie scientifique et la sociologie sortent peine de leur
priode prparatoire. Par un privilge unique et singulier, la morale thorique, seule
entre toutes les sciences, ne se pose pas de problmes, gnraux ou spciaux, qu'elle
ne leur donne une rponse son gr satisfaisante. Elle se prsente comme matresse,
ds prsent, de tout son objet. Elle n'y reconnat point de rgion inexplore, ou peuttre impntrable ses moyens actuels de recherche. Il est vrai qu'elle est reprsente
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
54
par diffrents systmes, intuitifs et inductifs, utilitaire, kantien et autres ; mais aucun
d'eux n'hsite se donner pour complet et dfinitif.
L'objet de la science morale offre-t-il donc ce que nous ne trouvons pas dans
l'objet des sciences physiques, un caractre de simplicit et de transparence parfaite ?
Ou possdons-nous, pour nous rendre matres de cet objet, une mthode particulirement puissante ? Ni l'une ni l'autre de ces hypothses ne se soutient : le seul fait de la
multiplicit persistante des systmes de morale les carte. Et certes, un coup dil
jet sur la ralit morale fait assez comprendre qu'elle n'est ni moins complexe ni
moins obscure pour nous que le reste de la nature, avant que la science en ait commenc l'analyse.
A dfaut d'autres preuves, la dfinition mme et les prtentions des morales
thoriques suffiraient donc montrer qu'elles n'ont jamais fait oeuvre de science, ni
entrepris l'tude objective de la ralit morale. Un dernier argument confirme cette
conclusion. Dans toutes les rgions de la philosophie naturelle, partout o s'est poursuivie une recherche vritablement thorique, partout o la science s'est dveloppe
pour elle-mme, par un effort dsintress pour se rendre matresse de son objet, il
arrive, tt ou tard, que ses dcouvertes conduisent des applications. La rgle est
mme, quand la science est assez avance, et si la nature de son objet le comporte,
que ses progrs amnent des changements considrables dans la pratique. Si l'on veut
des exemples, l'industrie mcanique, la mdecine, la chirurgie diront ce qu'elles doivent aux sciences. Rien de semblable dans l'histoire de la morale. Comment la thorie
y aurait-elle dtermin des progrs de la pratique, puisque la recherche thorique n'y
est pas indpendante, puisqu'elle est assujettie la condition (plus ou moins nettement
aperue, mais relle) de ne jamais conduire des conclusions dont les consquences
heurteraient les rgles traditionnelles, ou seraient en dsaccord avec les principes de
la conscience commune ? Comme il n'y a pas de progrs proprement dit de la thorie
(ce qui n'est pas incompatible avec l'originalit des grands philosophes, qui d'ailleurs
a ses limites), il ne saurait non plus y avoir de modification de la pratique sous
l'action de ce progrs.
Au contraire, l'influence se fait plutt sentir en sens inverse : ce sont les modifications de la pratique qui dterminent des changements dans la thorie. Elles sont dues
elles-mmes aux causes nombreuses et complexes qui agissent sur les murs, sur la
condition des personnes et des choses, et d'une faon gnrale, sur les institutions :
causes conomiques, dmographiques, politiques, religieuses, intellectuelles, etc. Non
que des thories absolument nouvelles apparaissent. Il est vraisemblable que le
nombre des morales thoriques possibles, comme celui des hypothses mtaphysiques concevables, est limit, et que toutes celles qui pouvaient tre construites sont
dj connues. Nanmoins, elles peuvent se prsenter sous des aspects diffrents, et les
problmes qu'elles discutent se posent alors en termes relativement nouveaux. C'est
ainsi que la morale stocienne, Rome, sous l'Empire, n'est plus tout fait la morale
de Znon, de Chrysippe et de Clanthe. Toujours la mme dans son fond, elle s'est
adapte au milieu, trs diffrent de son terrain d'origine, o elle a t transplante. De
mme, les no-kantiens de la fin du XIXe sicle restent attachs aux principes directeurs de la morale de Kant : cependant, sous l'influence croissante des grands problmes conomiques qui s'imposent notre temps, leur doctrine (celle de M. Renouvier,
par exemple) attribue la morale sociale une place beaucoup plus considrable que
Kant n'avait fait. En un mot, comme l'a montr, dans ses Origines de la technologie,
un des hommes qui ont le plus profondment tudi la philosophie de l'action, M.
Espinas, les morales thoriques , loin d'tre la science de la ralit morale, sont
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
55
elles-mmes une partie de l'objet de cette science. C'est celle-ci qu'il appartient de
les tudier dans leurs rapports avec l'ensemble de l'volution sociale, pour un temps et
pour une civilisation donns.
III
La pratique aurait ses principes propres indpendamment de la thorie. Carnade. - La philosophie morale du christianisme. - Kant et la Critique de la
raison Pratique. -Effort pour tablir la conformit de la raison et de la foi
morale. - Causes de l'insuccs de cet effort.
Retour la table des matires
Les caractres singuliers de la morale thorique n'ont pas tout fait chapp
l'attention des philosophes. Certains d'entre eux se sont bien aperus que la spculation en morale diffrait essentiellement de ce qu'elle est en toute autre matire. Pour
rendre compte de cette diffrence, ils disent que le cas de la morale est sans analogue,
et que la pratique a ses principes propres qui ne dpendent pas de la thorie .
Dj, dans l'Antiquit, nous rencontrons une doctrine qui annonce et prpare cette
thse. Selon Carnade et ses disciples de la nouvelle Acadmie, le philosophe doit
distinguer entre le domaine de la connaissance et celui de l'action. Au point de vue de
la connaissance, nous n'avons pas de critrium du vrai. Nous ne devons pas affirmer
ceci plutt que cela : la seule attitude raisonnable est de suspendre son jugement.
Mais nous ne sommes pas uniquement des esprits qui connaissent ; nous sommes des
tres vivants, embarqus dans l'action. Il nous faut, bon gr mal gr, rpondre aux
questions que la vie nous pose chaque instant. Cette ncessit nous autorise admettre des degrs de vraisemblance, pour nos perceptions par exemple, dont nous ne
pouvons jamais tablir la conformit leur objet, mais qu'au point de vue pratique
nous sommes pourtant obligs de prendre pour point de dpart de nos actes, quand
elles satisfont certaines conditions. Il n'est pas encore question, comme on voit,
pour Carnade, d'une certitude d'un genre particulier qui serait propre la morale, et
indpendante de la connaissance intellectuelle. Rien ne nous permet de croire qu'une
conception de ce genre se soit prsente son esprit. Il n'existe, au contraire, selon
lui, de certitude d'aucune sorte. Son scepticisme logique n'a pas pour contrepoids un
dogmatisme moral. Il est au moins vraisemblable que le philosophe grec aurait rejet,
comme confuse ou inintelligible, l'ide d'une certitude qui ne ft pas la certitude d'une
connaissance. Mais il n'en a pas moins tabli le premier une distinction philosophique
entre le domaine de la spculation et celui de la pratique, admettant pour celle-ci la
possibilit de juger qu'il rejetait pour celle-l.
Une fois ne, l'ide de cette distinction ne devait plus disparatre. Mais, comme
l'ensemble de la philosophie morale, elle s'est modifie profondment sous l'influence
des conceptions et des croyances chrtiennes. La pratique fut mise part de la thorie,
non plus seulement parce que, comme dit Descartes, les actions de la vie ne souf-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
56
frant souvent aucun dlai, c'est une vrit trs certaine que lorsqu'il n'est pas en notre
pouvoir de discerner les plus vraies opinions, nous devons suivre les plus probables ;
mais pour des raisons nouvelles et plus profondes. Elle devient indpendante du
savoir, par essence. Elle a sa dignit, sa valeur, ses principes propres. C'est que, pour
le chrtien, la question du salut prime toutes les autres. Faire son salut est la rgle
suprme de sa vie. Or le salut ne dpend pas seulement du mrite de l'homme. Dans
l'tat d'impuissance o le pch a rduit la crature, le mrite peut tre une condition
ncessaire : il n'est pas une condition suffisante. Il y faut encore la grce.
Mais si le salut ne dpend pas du mrite seul de l'homme, plus forte raison ne
dpendra-t-il pas de son savoir : car le savoir n'est nullement, par lui-mme, un mrite. La science, au point de vue du salut, offre peut-tre plus de dangers que d'avantages. La libido sciendi, diront les jansnistes, n'est pas moins propre perdre l'me
que la libido sentiendi. Moins grossire, ce qui fait que l'on s'en dfie moins, elle
prdispose davantage l'orgueil, et elle ne dtourne pas moins l'homme de son vritable objet, qui est Dieu. Le royaume du ciel sera plutt conquis par les ignorants que
par les savants. Par consquent, puisque la pratique peut tre excellente en l'absence
de toute science, il faut admettre qu'elle se suffit elle-mme. Elle a donc ses principes propres, qui ne relvent pas de l'intelligence. La perfection morale ne dpend
pas de la science, mais de vertus o la science n'a rien voir, telles que l'humilit,
l'obissance, la charit. Conception toute nouvelle, dont il n'y a pas trace dans la
morale antique, qui, du moins chez les philosophes, n'tait jamais subordonne la
pense de l'autre vie, ni au dsir de gagner le ciel .
De l, dans la philosophie moderne, deux grands courants distincts, qui se mlent
souvent intimement sans jamais se confondre tout fait. L'un porte les doctrines intellectualistes et rationalistes, o revit l'esprit de la spculation grecque, et qui cherchent
fonder sur la thorie les rgles de l'action ; l'autre, les doctrines mystiques, sentimentales, volontaristes, o l'esprit de la thologie chrtienne a pris une forme philosophique, et qui proclament l'indpendance de la pratique l'gard du savoir. Ces deux
tendances ne s'excluent pas, comme le prouve la tradition chrtienne elle-mme, o
les ides hellniques entrent pour une part qu'il est difficile d'exagrer. Elles se
combattent et se concilient. Elles entrent toutes deux, pour une part tantt plus grande, tantt moindre, dans les philosophies modernes. Il est toujours possible, cependant, de discerner laquelle des deux prdomine dans un systme, et le signe le plus
caractristique, cet gard, est prcisment la dtermination dans ce systme des
rapports entre la thorie et la pratique morale.
Kant est peut-tre le philosophe qui a pos ce problme avec le plus de nettet et
de franchise. Il en a fait, expressment, un des points essentiels de son systme, un de
ceux par o se rejoignent la Critique de la raison pure et la Critique de la raison
pratique. La question centrale de sa philosophie, autour de laquelle les autres se disposent, semble tre de savoir comment fonder rationnellement, la fois, et la science
et la morale.
La solution propose par Kant veut tre sincrement rationaliste. Il s'arrte peine
rejeter les thories trop aises qui rendent compte de la moralit par l'existence d'un
sens moral en nous. Il insiste avec force sur l'inconsistance et sur la pauvret des
doctrines morales du sentiment, de celle de Jacobi, par exemple. A ses yeux, l'ordre
moral est un ordre rationnel. La symtrie mme qu'il a tablie, au prix de grands
efforts, entre la Critique de la raison pratique et la Critique de la raison pure ne
permet pas d'en douter. La loi morale s'impose nous comme universelle et nces-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
57
saire, ce qui, dans le langage de Kant, signifie qu'elle est rationnelle. Par l, il reste un
des hommes reprsentatifs de ce XVIIIe sicle qui, plus encore peut-tre que le
XVIIe, a eu confiance en la raison. Mais sa doctrine prsente en mme temps un autre
aspect, tout diffrent du premier. Cette raison, laquelle il rapporte l'ordre moral,
n'est pas la raison qui connat, et dont la fonction est de fonder la science : c'est la
raison qui lgifre, et qui le fait au nom de principes que la raison qui connat n'a pas
tablis. Tout en s'efforant de maintenir l'unit de la raison sous la dualit de ses
fonctions, Kant reconnat la raison qui lgifre un droit de prsance. Par elle, nous
obtenons une certitude suffisante, bien que non dmontre, en des questions que la
raison, dans son usage thorique, ne serait jamais capable de trancher. Elle nous difie
sur notre destine, sur notre essence vritable, sur ce que nous avons attendre aprs
la mort. Par le seul fait qu'elle formule l'impratif de la moralit, et qu'elle le reconnat absolu, la raison pratique procure l'homme, sur ces grands problmes, une
lumire qui n'est pas sans doute celle de la science, mais qui y supple ; et cela, sans
que l'impratif moral ait besoin lui-mme d'tre lgitim. Il suffit que la raison
pratique l'nonce, pour qu'en mme temps elle s'y soumette.
C'est l un rationalisme singulier. Il est trange que la raison, dans son usage pratique, dcide sur des questions que la raison thorique tait oblige de laisser ouvertes. A vrai dire, la raison pratique pourrait s'appeler aussi raison rvlatrice. Elle nous
atteste notre essence noumnale, et justifie notre croyance la libert. Elle nous ouvre
l'accs d'un inonde intelligible, dont la raison thorique ne concevrait jamais que la
possibilit vide. En mme temps, elle dcouvre tous les hommes, aux ignorants
comme aux savants, ce qu'il leur est ncessaire de savoir pour bien agir. Enfin, quoi
que Kant en ait pens, elle se place au-dessus de la critique. La loi morale, en tant
qu'imprative, ne souffre point de discussion. Elle s'impose par une autorit qui lui est
propre, qui n'a point d'analogue, et qu'il serait immoral de mettre mme en question.
Les caractres de l'impratif catgorique, que Kant a marqus avec tant d'nergie
(nous sommes les soldats de la moralit, la loi morale exige l'obissance passive, on
ne discute pas avec le devoir, etc.) montrent assez que l'essence de la moralit
consiste pour lui dans la bonne volont conue comme une volont soumise la loi
morale. Sans doute, l'autonomie de la volont permet de dire que si la raison se soumet, elle est en mme temps lgislatrice ; mais notre propre causalit, en tant qu'tres
libres et intelligibles, nous demeure obscure, tandis que rien n'est clair, immdiat,
imprieux, comme le devoir auquel chaque individu se sent oblig d'obir.
Ainsi, malgr le rationalisme de Kant, sa doctrine morale est l'aboutissement naturel des efforts philosophiques qui, sous l'influence des croyances chrtiennes, tendent
soumettre le inonde moral et social des rgles dont la raison thorique n'est pas
juge. Ces rgles chappent la critique, parce qu'elles ont leur origine dans une
rgion suprieure. Monde intelligible, royaume des fins, dit Kant : rgne de la grce,
cit de Dieu, disait-on avant lui. Mais si d'autres avaient pris une position analogue,
jamais aucun d'eux ne l'avait dfendue avec autant de force. Kant ne demande rien
aux puissances non intellectuelles de l'me. C'est dans la raison mme qu'il loge le
principe que les autres distinguaient de la raison. C'est de la raison mme qu'il veut
faire sortir la loi laquelle elle se soumet, la fois lgislatrice et sujette, aussi
souverainement libre comme lgislatrice que pieusement obissante comme sujette.
Jamais effort plus puissant et Plus sincre n'a t tent pour tirer de la raison une
rvlation naturelle, et pour lui persuader qu'en se soumettant une loi absolue, indiscutable, elle n'abandonne ni ne compromet rien de ses droits lgitimes. Mais c'est un
effort suprme, et comme dsespr. S'il ne russit pas, il faudra renoncer tablir, du
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
58
moins rationnellement, que la pratique morale a ses principes propres, indpendants
de la thorie.
Au fond, l'entreprise de Kant ne diffre pas autant qu'il semblerait d'abord des
tentatives si frquentes chez ses prdcesseurs modernes pour tablir un accord ente
la raison et la foi. Le problme pos par Kant est de mme nature que le leur. Les
mtaphysiciens antrieurs cherchaient faire concider les rsultats de la spculation
philosophique avec les vrits enseignes au nom de la religion. Le dernier essai de
ce genre fut fait (peut-tre sans grande conviction) par Leibniz. Kant les juge tous
galement malheureux et striles. Selon lui, les prtentions de la mtaphysique
dogmatique sont insoutenables, et comme elle est incapable de se dfendre contre les
attaques du scepticisme, elle ne fait que compromettre, par ses dmonstrations ruineuses, les vrits qu'elle prtend confirmer. Mais Kant lui-mme cherche, son tour,
tablir l'accord de la raison et de la foi - avec cette diffrence qu'il ne s'agit plus pour
lui d'une foi portant sur des dogmes ou des vrits rvles. Cette foi a pour unique
objet la loi morale, le devoir, sorte de rvlation naturelle laquelle participent tous
les tres raisonnables et libres, capables de moralit. Mais, comme cette rvlation est
pour Kant intrieure la raison, ce qui n'est en ralit qu'une conciliation de la raison
et de la foi devient ses yeux une harmonie naturelle entre la raison dans son usage
pratique et la raison dans son usage thorique. Et comment douter de cette harmonie,
puisque la raison est une ?
Ainsi se retrouve, dans la doctrine morale de Kant, le caractre que le chapitre
prcdent a signal dans les morales thoriques en gnral. Comme les autres, elle est
une thorie d'un genre trange. Elle n'a pas pour objet d'organiser d'abord un systme
de connaissances, sur lesquelles se rglerait ensuite une pratique rflchie et rationnelle : elle est, au contraire, un effort pour rationaliser la pratique, qui prexiste
toute thorie, et qui n'en dpend point. C'est ce qu'exprime trs clairement le Primat
que Kant reconnat la raison pratique. Kant constate ainsi, en essayant de l'incorporer son systme, le fait que l'observation non prvenue ne peut manquer d'apercevoir : savoir, que les rgles obligatoires de la pratique morale ne sont point dduites
de la connaissance thorique, qu'elles ont leur valeur et leur dignit propres, et que la
thorie, mme rationnelle en apparence, est assujettie s'accorder avec ces rgles, qui
sont absolues. Bref, la plus extraordinaire (dans tous les sens du mot) des morales
thoriques fournit ainsi la preuve, par sa structure mme, que l'intrt moral s'y
subordonne l'intrt thorique de la faon la plus stricte, et que l'effort spculatif qui
s'y manifeste n'a rien de commun avec une recherche scientifique.
Pour conclure, l'ide que la pratique a ses principes propres et indpendants de la
thorie contient, sans les distinguer, la constatation d'un fait, qui est exact, et le germe
d'une thorie, qui ne l'est pas. Le fait avait t signal par les nouveaux Acadmiciens
: dfaut d'une certitude thorique o se fonder, la pratique veut nanmoins avoir des
rgles. Elle ne peut s'en passer, et elle s'en procure au moins de provisoires, dont elle
se satisfait en attendant mieux. Cela est vrai de toutes les formes de l'action. Pendant
de longs sicles, l'homme, ignorant les lois de presque tous les phnomnes physiques, n'en a pas moins systmatis, tant bien que mal, une pratique qui s'est modifie
lentement mesure que la science de la nature faisait des progrs. A plus forte raison,
la pratique morale, qui est impose chaque conscience individuelle par une pression
sociale trs forte, a-t-elle exist et existe-t-elle encore indpendamment de toute spculation.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
59
La thorie, qui n'est pas exacte, consiste riger le fait en droit, comme Kant a
essay de le faire en affirmant le Primat de la raison pratique. Elle consiste soutenir
que si les rgles de la pratique morale ne sont point tablies sur une connaissance
scientifique et objective de la ralit, c'est qu'elles n'ont point besoin de l'tre ;
qu'elles se fondent par ailleurs, ou simplement sur -elles-mmes, que la raison et la
moralit le veulent ainsi. C'est pourquoi Kant a appel fait de la raison l'obligation
qu'il saisissait dans la conscience, et il a difi sa thorie morale sur ce fait. Mais un
fait de la raison est un vritable monstre dans une philosophie comme la sienne, o
tout ce qui est fait appartient au monde des phnomnes, et tout ce qui est raison au monde intelligible. Le caractre hybride de l'impratif catgorique trahit
l'artifice de la conception. Ce fait, s'il est vraiment un fait, nous est donn de la mme
faon que les autres, et quoi que Kant conclue de la sublimit du devoir, au mme
titre que les autres. Si Kant y voit un fait de la raison , c'est parce que ce fait incomparable est, ses yeux, une rvlation de l'absolu en nous. Ds lors, la morale
thorique, telle que Kant l'a construite, n'apparat plus que comme un effort pour
concilier, ou plutt pour identifier, la foi morale avec la raison.
IV
Pourquoi les rapports rationnels de la thorie et de la pratique ne se sont pas
encore tablis dans la morale. - Les autres sciences de la nature ont travers
elles aussi une priode analogue. -Comparaison de la morale thorique des
Modernes avec la physique des Anciens. - Tant que la mthode dialectique est
employe, la mtamorale subsiste.
Retour la table des matires
Une dernire question reste lucider. Pourquoi les rapports normaux de la
thorie et de la pratique ne se sont-ils pas, jusqu' prsent, tablis en morale comme
ailleurs ? Les autres portions de la ralit donne dans l'exprience sont devenues peu
peu des objets de recherche scientifique ; s'il y a une ralit morale objective, comment n'a-t-elle fourni matire qu' des morales thoriques ? Ne serait-ce pas qu'en
effet, comme le soutiennent les auteurs de ces morales, un objet diffrent convient
une forme de spculation diffrente ?
La rponse cette question se trouve dj dans les considrations du premier
chapitre sur l'volution gnrale des rapports de la thorie et de la pratique, et sur leur
volution particulire dans le cas de la morale. Des intrts sociaux trs puissants, des
sentiments trs nergiques s'opposent pour ainsi dire a priori ce que les choses
morales fassent l'objet d'une tude objective et dsintresse. Il n'en est pas de la
morale comme de la cristallographie ou de la mcanique. L'attitude scientifique est,
par dfinition, une attitude critique. Comment prendre cette attitude l'gard de rgles
dont le caractre obligatoire imprime le respect toutes les consciences ? De mme
que l'attitude critique, dans la science des religions, a d paratre irrligieuse, bien
qu'elle ne le soit pas ncessairement, de mme, dans une science de la ralit morale,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
60
elle prend presque coup sr un air d'immoralit. Elle semble, tort, insparable
d'une sorte de scepticisme, que la conscience commune condamne, soit comme un
manque de sens moral (correspondant l'indiffrence en matire de religion), soit
comme un principe d'anarchie qui mettrait en question toutes les institutions sociales,
c'est--dire l'existence mme de la socit. Tout effort pour considrer la ralit
morale, en faisant abstraction du respect que la conscience exige pour ses impratifs,
provoque donc aussitt une raction extrmement vive. En un mot, si la premire
condition d'une tude scientifique est de dsubjectiver les faits, de ngliger
l'aspect par o ils touchent notre sensibilit, et de les traduire en une forme qui puisse
tre labore par l'entendement, les faits moraux ne devaient pas devenir aisment
objet de science, et il n'est pas surprenant que les difficults prliminaires n'aient pas
t surmontes jusqu' prsent.
En outre, l'tat actuel de la spculation morale n'est pas aussi exceptionnel qu'il
semble d'abord. A une poque plus ou moins recule, les autres sciences de la nature
l'ont galement travers. Je ne parle pas seulement des tapes successives qui ont
conduit ces sciences considrer enfin leur objet d'un point de vue dsintress : je
parle de la structure mme de la science, de sa mthode, et de la faon de poser les
problmes. Nous n'avons pas encore de physique des murs , qui s'attache
observer et classer les faits moraux, dans leur diversit relle et concrte, selon les
temps et les lieux, et les analyser pour en dgager les lois, au moyen de la mthode
comparative; nous en sommes encore la morale thorique qui spcule abstraitement sur les ides de bien, de mal, de mrite, de sanction, de responsabilit, de justice, de proprit, de solidarit, de devoir, et de droit. - Il est vrai : mais y a-t-il si
longtemps que les sciences aujourd'hui les plus sres de leur mthode, la physique par
exemple, spculaient non moins abstraitement sur les lments et sur le vide ? Dans
l'Antiquit classique, dont nous sommes rests, plusieurs gards, beaucoup plus prs
que nous ne pensons, la science physique offrait des caractres remarquablement
semblables ceux que prsente aujourd'hui la science de la morale .
L'analogie devient frappante si l'on remonte assez haut, jusqu'aux [en grec dans le
texte] qui ont prcd Socrate. Leur tendance expliquer l'ensemble des phnomnes
par un ou plusieurs lments fondamentaux, leur manire de rendre compte des faits
en rapprochant ou en sparant le sec et l'humide, le froid et le chaud, ou les atomes, se
retrouvent dans l'effort de nos philosophes pour expliquer toute la ralit morale par
un ou plusieurs lments fondamentaux (le plaisir, l'intrt, le devoir), et dans leur
faon de sparer ou de rapprocher l'utile et le bien, l'agrable et l'obligatoire. Mme
facilit apparente, des deux parts, pour la construction rapide d'un difice scientifique
achev ; mme rapparition constante de systmes opposs les uns aux autres, dont
aucun n'a jamais assez de force pour triompher de ses adversaires, enfin mme impuissance de tous rendre compte, ne ft-ce qu'imparfaitement, de la complexit
relle des faits. Et comme les Anciens, par cette mthode, n'ont jamais pu btir que
des physiques plus ou moins vraisemblables - qui d'ailleurs n'taient point vraies ;
pareillement, la spculation morale des philosophes n'a jamais produit que des
morales thoriques plus ou moins acceptables pour la conscience de leur temps,
mais dpourvues de valeur scientifique.
Le dbat entre utilitaires, hdonistes, eudmonistes, kantiens, et autres thoriciens
de la morale, le considrer du point de vue formel, correspond donc assez exactement au dbat entre les partisans d'Hraclite, d'Anaxagore, d'Empdocle, de Dmocrite, de Parmnide sur les principes de la physique. Dans les doctrines de ces philosophes, la connaissance positive de quelques faits se trouvait mle des conceptions
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
61
mtaphysiques, et la sparation de ces deux catgories d'lments ne s'est accomplie
que peu peu. De mme, dans nos systmes de morale thorique se trouvent confondues des observations de faits et des conceptions mtaphysiques, que l'on pourrait
plus prcisment appeler mtamorales, si le mot n'est pas trop barbare : j'entends par
l tout ce qui est suppos transcendant par rapport la ralit morale donne, et
ncessaire l'intelligibilit de cette ralit. Nous ne souffrons plus de telles confusions dans la physique ; mais, dans nos morales thoriques , elles ne nous choquent pas encore. La forme que la spculation morale a conserve jusqu' prsent est,
il est vrai, trs propre les entretenir.
Cette spculation porte encore l'empreinte trs reconnaissable du gnie grec, d'o
elle est issue, comme presque toutes nos sciences. Ce gnie a conu l'intelligibilit de
l'univers sous la forme de l'harmonie des ides, et il s'est reprsent l'ordre des tres
dans la nature par le moyen de la hirarchie des genres et des espces. Par suite, pour
construire la science, o il voyait une expression de la ralit mme de l'tre, il a
procd par la dtermination de concepts. C'est donc cette mthode qu'il a demand
aussi l'intelligibilit des choses morales. M. Boutroux appelle Socrate le fondateur de
la science morale. M. Zeller voit en ce mme Socrate le fondateur de la philosophie
du concept. Les deux noms lui conviennent galement ; car ils expriment, au fond, la
mme ide. D'une part, la science morale que Socrate a voulu fonder consiste en
une dtermination des concepts moraux ; et d'autre part la philosophie du concept ,
dont M. Zeller lui attribue la dcouverte, n'a gure t applique par lui qu' des questions concernant la morale.
Cette philosophie du concept est devenue chez Platon la dialectique, et chez
Aristote, la construction mtaphysique et scientifique que l'on sait, o la mthode est
demeure essentiellement dialectique. Malgr le got d'Aristote lui-mme et de beaucoup de savants anciens pour les recherches exprimentales, cette mthode a toujours
empch que leur physique ne fit le pas dcisif qui l'aurait rendue positive. Il fallait,
pour en arriver l, que le contenu et l'usage des concepts antiques de nature , de
mouvement , d' lment , se fussent profondment modifis. Plus prcisment, il
fallut que les physiciens modernes, laissant de ct les concepts gnraux, plus mtaphysiques que physiques, apprissent ne considrer que les faits et les relations
donnes par l'exprience entre les faits. Rvolution qui n'alla point sans des luttes
opinitres, et qui ne fut acheve qu'avec le XVIe sicle.
Combien la mthode dialectique ne devait-elle pas se maintenir plus longtemps
encore en morale ! Dans les sciences qui tudient la ralit physique, ds que la
mthode inductive et exprimentale eut commenc tablir des lois proprement dites
(ce qui ne fut gure possible, il est vrai, qu'aprs certaines dcouvertes en mathmatiques et en mcanique), la fin de la spculation dialectique ne fut plus qu'une question
de temps. La valeur des rsultats obtenus finit par triompher des prventions les plus
obstines. Entre deux mthodes, l'une fertile seulement en disputes, l'autre fconde en
dcouvertes dont les applications vont l'infini, le choix, la longue, ne peut rester
douteux. Mais les sciences qui ont pour objet la ralit morale n'en sont pas encore
ce point. Le prestige de la spculation traditionnelle sur les concepts n'y est pas encore contrebalanc par l'importance des rsultats positifs dus une mthode objective
d'investigation. Ces rsultats n'apparatront sans doute que lentement. L'ancienne
mthode a l'assentiment secret des consciences, l'appui des croyances religieuses et
des forces de conservation sociale. En un mot, elle ne perdra son autorit que trs
difficilement. La critique des concepts moraux a beau montrer que leur simplicit
apparente est illusoire, et qu'en ralit ils sont la fois extraordinairement complexes,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
62
flottants, et mal dfinis : ides claires, si l'on veut, mais non pas ides distinctes. Cette
critique, telle que l'a excute M. Simmel, par exemple, n'est pas dcisive, malgr
l'ingniosit et le talent de son auteur, parce qu'elle est elle-mme dialectique. Tant
que le sentiment de la vrit positive, dans cet ordre de recherches, ne sera pas devenu familier aux esprits comme il l'est depuis longtemps dans l'ordre des recherches
physiques, il est craindre que la spculation morale ne persiste travailler dialectiquement sur des concepts.
Du moins, sans rien prjuger de l'avenir, voyons-nous que cette forme de la
spculation morale n'est pas une anomalie. L'esprit humain n'a pas commenc par
prendre, l'gard de la ralit morale, une attitude diffrente de celle qu'il avait eue
d'abord l'gard de la ralit physique. Ce qui est vrai, au contraire, c'est qu'il a
conserv, pour l'tude des choses morales, une mthode dont il s'est dfait ailleurs
depuis quelque temps : persistance qui s'explique assez par les caractres propres
cette partie de la ralit, et par les sentiments qu'elle veille en nous. La morale
thorique , semblable en ce point aux systmes physiques des anciens, a t et est
encore un effort pour saisir son objet comme intelligible. Mais cet effort n'implique
pas la possession immdiate de la mthode dont il conviendrait d'user, et le philosophe se flatte obstinment d'tablir la science de la morale par une analyse dialectique de concepts. Mieux employ, cet effort cherchera constituer ce que Comte, au
sicle dernier, appelait la physique sociale . C'est l'uvre qu'a entreprise la sociologie scientifique.
Mais, par l'effet d'une loi bien connue de l'histoire des sciences, les sociologues
paraissent - et ils doivent paratre -, se placer en dehors de la science dont ils sont en
ralit les continuateurs actifs, tandis que ceux qui restent attachs une mthode
strile et suranne s'en considrent comme les seuls reprsentants. Les inventeurs
d'expriences, qui contriburent si efficacement, au XVIe sicle, donner la physique l'impulsion qu'elle suit depuis lors, n'taient-ils pas de vulgaires empiriques, ou
moins encore, aux yeux des professeurs qui, dans les cours de philosophie, enseignaient la physique dAristote avec sa mtaphysique et sa logique ?
Pourtant, ce sont les premiers qui taient les vrais successeurs des savants grecs et
d'Aristote lui-mme. Pareillement, la production des morales thoriques est
aujourd'hui fort ralentie, sinon tout fait arrte. A une ou deux exceptions prs,
celles qui ont paru dans le cours du XIXe sicle n'ont gure t que des variantes plus
ou moins ingnieuses de doctrines nes dans les sicles prcdents. Mais la tradition
se perptue par l'enseignement. Beaucoup, parmi les crivains qui l'entretiennent,
seraient sans doute surpris si on leur disait que la vraie spculation morale de notre
temps se trouve, non pas dans leurs livres, mais dans les travaux de ces sociologues
qui ils n'accordent qu' regret le droit d'exister. Ils n'y reconnaissent pas la morale
thorique . Et il est vrai qu'elle n'y est point. Mais les scolastiques non plus ne reconnaissaient pas leur physique dans les recherches exprimentales qui allaient la
supplanter.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
63
CHAPITRE III
LES POSTULATS
DE LA MORALE THORIQUE
Retour la table des matires
La morale thorique, qui prtend tre la fois spculative et normative, se trouve
dtourne, par cette prtention mme, de l'tude objective de la ralit morale.
Proccupe d'tablir rationnellement ce qui doit tre, elle ne procde pas l'gard de
cette ralit comme font les sciences de la nature l'gard des phnomnes donns ;
elle ne s'attache pas l'tude patiente et minutieuse de ce qui est. Cependant, en tant
que normative, la morale thorique se donne pour fin de diriger dans un sens dtermin par elle la conduite des hommes, c'est--dire d'exercer une action positive sur la
ralit morale. Ne faudrait-il pas, pour que son action ft efficace, que cette ralit ft
connue d'une manire scientifique ? Comment la morale thorique, telle que la
prsentent d'ordinaire les philosophes, pare-t-elle cette difficult ?
En fait, le manque de cette connaissance scientifique pralable ne l'a jamais empche de formuler ses rgles et ses prceptes. Elle prend pour accord qu'elle sait de
l'homme et de la socit tout ce qu'il lui est ncessaire d'en savoir. En un mot, elle se
donne un certain nombre de postulats. Elle les considre comme valables sans les
examiner, parce qu'ils sont impliqus par la pratique. Ici encore, le caractre en
quelque sorte sacr dont la morale (en tant que normative) est revtue aux yeux de la
conscience a exclu a priori la critique.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
64
I
Premier postulat : la nature humaine est toujours identique elle-mme, en tout
temps et en tout lieu. - Ce postulat permet de spculer abstraitement sur le
concept de l'homme . - Examen du contenu de ce concept dans la philosophie
grecque, dans la philosophie moderne et chrtienne. - largissement de l'ide
concrte d'humanit au XIXe sicle, d au progrs des sciences historiques,
anthropologiques, gographiques, etc. - Insuffisance de la mthode d'analyse
psychologique, ncessit de la mthode sociologique pour l'tude de la ralit
morale.
Retour la table des matires
Le premier de ces postulats consiste admettre l'ide abstraite d'une nature
humaine , individuelle et sociale, toujours identique elle-mme dans tous les temps
et dans tous les pays, et considrer cette nature comme assez bien connue pour
qu'on puisse lui prescrire les rgles de conduite qui conviennent le mieux en chaque
circonstance. Toutes les morales thoriques supposent ce postulat. La morale kantienne va plus loin encore. Elle lgifre pour tous les tres raisonnables et libres, dont
l'espce humaine n'est peut-tre qu'une petite fraction. Les morales du sentiment, les
morales de l'intrt, moins ambitieuses, se tiennent plus prs de l'exprience ; elles
s'adressent cependant, elles aussi, l'homme pris d'une manire abstraite et gnrale,
indpendamment de toute dtermination particulire de temps et de lieu. Elles aussi
admettent implicitement qu'il y a une nature humaine constante, toujours semblable elle-mme, et que nous n'avons pas besoin, pour la connatre, d'une tude
scientifique analogue celle dont la nature physique est l'objet : l'effort de la morale
peut se porter d'emble la recherche des principes et la formulation des devoirs.
Ce double postulat est aussi ancien que la morale thorique elle-mme. Il naissait,
pour ainsi dire, spontanment de la mthode conceptuelle et dialectique employe par
ses fondateurs. La science, selon eux, devait avoir pour objet non ce qui est passager,
individuel, prissable : les phnomnes, - mais ce qui est immuable, gnral, ternel :
les ides, les formes, les dfinitions. La science morale, en particulier, devait chercher
dans la dfinition gnrale de l'homme l'expression adquate de son essence immuable et ternelle, et spculer ensuite, en toute scurit, sur cette dfinition, en mme
temps que sur les concepts proprement moraux de bien, de mal, de juste, d'injuste,
d'utile et d'agrable. Les morales thoriques modernes sont restes fidles, en ce
point, la tradition. Elles ont modifi, il est vrai, la position et l'nonc de beaucoup
de problmes. Mais elles n'ont pas senti la ncessit de renoncer ce double postulat.
Or l'homme qui a servi d'objet la spculation morale grecque est loin de
reprsenter d'une manire exacte toute l'humanit. C'est, au contraire, l'homme d'une
certaine race et d'un certain temps : c'est le Grec. On sait quelle distance les Hellnes
mettaient entre eux et les barbares. Au moment surtout o leur philosophie morale
s'est fonde avec Socrate, au moment o leur civilisation, leur art, leur industrie
avaient pris leur plein dveloppement, ils pouvaient avoir oubli, ou ils considraient
comme peu de chose, ce qu'ils devaient aux civilisations plus anciennes de l'gypte et
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
65
de l'Orient. Les barbares entraient, sans doute, dans la dfinition de l'humanit, mais
la faon des esclaves, qu'ils taient destins fournir. C'taient des hommes de
deuxime catgorie . C'est peu prs ainsi que les modernes distinguent les peuples civiliss des autres (Naturvlker und Kulturvlker) ; avec cette diffrence, toutefois, que l'ethnographie a entrepris, depuis le XIXe sicle, une tude scientifique des
peuples non civiliss, tandis que les Grecs n'ont jamais song rien de pareil pour les
barbares, avec qui ils taient continuellement en contact. Non par manque de curiosit; mais les murs et les institutions des barbares taient pour eux un objet d'amusement plutt que de science. Ils y trouvaient une pture pour leur got du merveilleux
et des rcits extraordinaires. Les Grecs, a dit Hegel - qui ressentait pour eux une
admiration enthousiaste - les Grecs ont connu la Grce, ils n'ont pas connu l'humanit. Au monde fini de la cosmologie de Platon et d'Aristote correspond la somme
limite des cits hellniques. Le reste des hommes reprsente [en grec dans le texte] :
matire indfinie, indispensable peut-tre, mais rfractaire la beaut et l'ordre qui
sont tout aux yeux des Grecs.
Le mlange des peuples et des ides pendant la priode hellnistique, puis l'organisation romaine du monde antique, firent beaucoup pour affaiblir ce prjug, qui
parut succomber tout fait la victoire du christianisme. La distinction entre le Grec
ou le Romain d'une part, et les barbares de l'autre, ne pouvait subsister quand la limite
s'effaait entre le peuple lu et les gentils. Adam n'avait-il pas entran tous les
hommes dans sa chute ? Le Christ ne les avait-il pas tous rachets ? De l, un effort
pour conqurir les hommes l'glise unique, un esprit de proslytisme inconnu des
Anciens, et une conception de l'humanit tout autre que la leur.
Toutefois, la tradition catholique, bien qu' universelle par dfinition, devait
tendre identifier avec l'humanit mme la portion de l'humanit o elle dominerait.
De fait, depuis la fin du Ve sicle jusqu' la diffusion de l'Islam, le christianisme a
occup la presque totalit du monde connu des Anciens. Il avait mme converti la
plupart des nations barbares qui l'Empire romain avait eu affaire. L'illusion s'tablit
alors que l'humanit chrtienne ou l'humanit tout court, c'tait peu prs la mme
chose. L'ignorance des sicles obscurs aidant, cette croyance s'est enracine avec tant
de force que rien n'a pu, depuis lors, l'extirper : ni les conqutes des musulmans - car
la Providence voulait qu'il y et des infidles au-dehors, comme elle conservait
des tmoins , les Juifs, l'intrieur mme de la chrtient - ni la dcouverte successive des grands Empires de l'Extrme-Orient et des deux Amriques, ni enfin celle
des masses profondes du continent noir. De mme que chaque individu, aussitt qu'il
cesse de s'observer, se prend navement pour le centre du monde, chaque peuple ou
peuplade, chaque civilisation se considre comme rsumant en elle-mme toute l'humanit. La ntre ne fait pas exception cette rgle. On n'ignore pas, sans doute, que
l'Asie compte elle seule plus de bouddhistes que toutes les parties du monde ensemble ne contiennent de chrtiens. Mais la ralit de ces centaines de millions d'hommes
appartenant une civilisation lointaine n'est que conue ; il y faut un acte de rflexion, qui n'a lieu qu' intervalles. Elle n'est pas sentie tout instant comme la civilisation en qui et de qui nous vivons.
Ainsi, la spculation morale qui s'est dveloppe en Europe chez les Modernes a
eu pour objet, en principe, l'homme pris universellement ; en fait, l'homme de la
socit occidentale et chrtienne. Elle correspond la psychologie introspective traditionnelle, qui tudie, elle aussi, l'homme blanc et civilis . C'est encore le postulat
de la spculation morale grecque, modifi, largi, mais reconnaissable.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
66
Ce postulat, dira-t-on peut-tre, tait indispensable, si l'on ne se rsignait pas attendre, pour tablir la morale, que nous eussions une connaissance complte et scientifique des civilisations trangres et des socits infrieures. En outre, il n'y a point
d'inconvnient l'admettre. Il repose sur une induction lgitime, et rien n'empche de
conclure de la nature psychologique et morale des hommes que l'on connat celle
des hommes que l'on n'a jamais vus. C'est ainsi que les Grecs, tout born que ft leur
horizon ethnographique, ont si admirablement connu et dcrit les inclinations et les
passions de l'homme, qu'on n'a gure pu les dpasser en cette matire. Leur littrature,
ce point de vue, ne craint pas la comparaison avec celles des Modernes. A leur tour,
les grands moralistes chrtiens, qui n'avaient pas un champ d'observation beaucoup
plus tendu, n'en ont pas moins formul des vrits valables pour les hommes de tous
les temps et de tous les pays. Partout l'amour, l'ambition, l'amour-propre, l'avarice,
l'envie et les autres passions naissent des mmes causes, traversent les mmes crises,
et produisent les mmes effets. C'est tout comme icy , selon la formule que
Leibniz emprunte Arlequin.
Les philosophes du XVIIIe sicle, qui ne sont certes pas prvenus en faveur du
christianisme, mais qui croient une morale naturelle et universelle, soutiennent eux
aussi, sans nulle hsitation, l'ide d'une humanit toujours et partout semblable ellemme. Hume rpte, aprs Fontenelle et avec les encyclopdistes, que les hommes
d'aujourd'hui sont aussi semblables ceux d'autrefois, que les chnes et les peupliers
de nos campagnes le sont ceux d'il y a cinq mille ans. Veut-on connatre le mcanisme et le jeu des passions chez nos contemporains ? Il suffit d'tudier Dmosthne et
Tacite. Voltaire ne tient pas un autre langage. Une des grandes supriorits du disme
sur les religions rvles, selon lui, tient ce que les dogmes ont toujours une origine
historique, et par consquent ne valent que pour une portion de l'humanit, tandis que
le disme, n spontanment du cur et de la raison de l'homme, est aussi ancien et
aussi universel que l'espce humaine. En tout temps, en tout lieu, l'homme, en prsence des mmes objets, prouve les mmes sentiments, et conoit les mmes ides.
Voltaire en est si fermement convaincu que, en dpit de tmoignages formels rapportant l'existence de la prostitution sacre Babylone, il refuse d'y croire, tant il lui
parat impossible d'admettre que des MURS contraires la nature humaine
aient jamais pu tre pratiques. Et presque tous ses contemporains pensent comme lui.
Pourtant ce postulat, en qui ils avaient une si entire confiance, ne peut plus tre
considr aujourd'hui comme exact, moins qu'on ne le rduise une formule presque purement verbale. S'il exprime seulement la ncessit, pour tous les individus
humains, de prsenter certains caractres psychologiques et moraux communs, il ne
fait que rpter l'axiome scolastique cit par Descartes au commencement du Discours de la mthode, et selon lequel il n'y a du plus et du moins qu'entre les accidents,
et non point entre les essences ou natures des individus d'une mme espce. Cet
axiome ne nous apprend rien sur les caractres qui, en fait, sont ou ne sont pas prsents dans toute l'espce. Il ne supple en rien au dfaut de l'anthropologie compare.
Mais, si l'on donne ce postulat le sens o l'ont pris les philosophes qui en ont fait
usage, plus ou moins expressment, dans leur morale thorique, c'est--dire s'il
signifie qu'ils ont eu le droit d'tendre l'humanit entire ce qu'ils ont appris de la
nature humaine, au point de vue psychologique, moral, et social, par l'observation
d'eux-mmes et de leur milieu, rien n'est plus contestable. Pour que ce postulat ait pu
se maintenir aussi longtemps qu'il l'a fait, il a fallu la runion de deux conditions, dont
l'une au moins est encore prsente : d'abord, l'ignorance o les thoriciens de la morale sont rests gnralement des civilisations autres que celles o ils vivaient (l'Anti-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
67
quit classique excepte) ; puis la subordination de la thorie la pratique. L'intrt
suprme de celle-ci exigeait que les prceptes moraux fussent prsents comme universels, et, par suite, comme obligeant avec la mme force tout tre humain, raisonnable ou libre, sans distinction de temps ni de lieu. Cette exigence soutient encore
aujourd'hui, comme on l'a vu, la conception traditionnelle de la morale thorique.
Mais elle se soutient mal elle-mme. Elle s'affaiblit mesure que l'ignorance dont elle
est solidaire se dissipe peu peu. Car cette ignorance a enfin pris conscience d'ellemme, et le travail qui doit y mettre fin est dj entrepris sur plusieurs points la fois.
En premier lieu, les grandes civilisations indpendantes de la ntre, et de l'Antiquit classique d'o elle est ne, font l'objet, depuis un sicle, de recherches scientifiques. La connaissance des langues, des arts, des religions, des institutions de l'Inde,
de la Chine, du Japon, facilite par un concours de circonstances de plus en plus
favorables, commence substituer une vue positive et prcise l'image un peu trop
simple et conventionnelle que l'on s'en faisait auparavant en Europe. Cette image
voulait tre le plus souvent amusante, ou difiante, ou les deux la fois ; divertir aux
dpens de murs et de croyances bizarres et inexplicables pour nous, ou gourmander
notre fatuit et nos vices, la faon de la Germanie de Tacite. Les crivains franais
du XVIIIe sicle, pour la plupart, n'ont pas eu besoin d'tudier beaucoup les civilisations orientales - ni les sauvages - pour les reprsenter comme ils ont fait. Les Persans
de Montesquieu, les Hindous de Voltaire et les Chinois des autres philosophes sont
des Europens peine travestis. C'est un artifice commode pour faire passer des
rflexions sur les choses de France, qui pourraient n'tre pas sans danger. Quant une
tude dsintresse de ces socits trs diffrentes de la ntre, on n'a ni la pense, ni
les moyens de la faire. Une des gloires du XIXe sicle a t prcisment d'entreprendre ce grand travail, cette vaste enqute anthropologique. Mais, par une consquence
invitable, le concept de la nature humaine se trouve aussitt modifi. Il ne peut
rester un schme artificiel et scolastique ; l'histoire compare des religions, des institutions, des langues, lui fournit un contenu toujours plus riche et plus vari. On comprend l'impatience de Renan, qui s'est intress passionnment la lecture de Burnouf, quand il voit Auguste Comte identifier encore, peu de chose prs, l'humanit
avec les nations issues de la civilisation mditerranenne. Comte ne le ferait certainement plus aujourd'hui ; le rapprochement matriel qui s'est accompli ne le lui permettrait plus. Bombay, et mme Pkin, ne sont pas plus loigns de Paris, aujourd'hui,
que ne l'taient Madrid ou Stockholm il y a cent ans. Force est bien la notion
traditionnelle de l'homme de s'largir.
D'autre part, les socits infrieures ne prtent plus seulement une antithse
facile entre l'Europen corrompu et le bon sauvage . Elles sont devenues, elles
aussi, l'objet d'une tude scientifique - un peu tard, par malheur, et, dans bien des cas,
presque au moment de leur disparition. Pour les peuplades teintes depuis longtemps,
la critique des relations qui nous sont parvenues (surtout de celles des premiers
voyageurs qui les ont dcrites) permet assez souvent, grce la mthode comparative,
de restituer l'essentiel de ce qu'ils avaient vu, parfois sans le comprendre. Cette observation, contemporaine ou rtrospective, nous rvle des faons de sentir, de penser,
d'imaginer, des modes d'organisation sociale et religieuse dont nous n'aurions jamais
eu, sans elle, la moindre ide. Plusieurs ouvrages rcents sur les socits australiennes, et en particulier ceux de MM. Spencer et Gillen, sur Les tribus indignes de
l'Australie centrale, ont mis en lumire des traits fort peu connus de la nature
humaine .
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
68
Enfin, les rgions recules de l'histoire ne sont pas explores avec moins de soin.
l'gypte et l'Assyrie surtout ont donn lieu des travaux de caractre scientifique,
dont les rsultats peuvent tre considrs comme acquis. Au lieu des lgendes dformes et des rcits suspects dont il fallait se contenter autrefois, nous avons dsormais
une connaissance puise aux sources mmes de ces civilisations dj trs dveloppes, de leurs langues, de leurs littratures, sacre et profane, de leur droit, de leur
morale enfin, qui est tantt singulirement prs, tantt singulirement loin de la ntre.
Nouvelle extension, nouvel enrichissement de notre ide de l'humanit, oblige de
faire une place la vie mentale et morale de ce pass lointain, mais certain - sans parler de la longue volution, inconnue de nous, dont il a t le terme. Le mme travail
se poursuit ailleurs : par exemple, sur les anciennes civilisations amricaines. L'anthropologie et l'histoire, en ce qui concerne la restitution des socits disparues, dans
les deux mondes, sont loin d'avoir obtenu tous les rsultats que l'on peut esprer.
Cette palontologie sociale n'est-elle pas ne d'hier ?
Ds prsent, nous ne pouvons plus nous reprsenter l'humanit entire, au point
de vue psychologique et moral, comme assez semblable la portion que nous en
connaissons par notre exprience immdiate, pour que nous nous dispensions d'en
tudier le reste. Peut-tre, un jour, la sociologie saura-t-elle dterminer avec prcision
ce qu'il y a de commun chez les individus de tous les groupes humains. Prsentement,
une tche plus modeste s'impose. Il faut analyser d'abord, avec le plus de rigueur possible, la riche diversit qui s'offre l'observation, et que nous n'avons pas le moyen,
aujourd'hui, de ramener l'unit. Ne sommes-nous pas hors d'tat de concevoir seulement - je ne dis pas de raliser - une histoire universelle ? Depuis que l'on a renonc
aux philosophies de l'histoire, qui se donnaient un principe d'unit sous la forme d'une
ide thologique ou du moins finaliste, la conception de l'humanit comme d'un tout
nous chappe. Dans l'tat actuel de nos connaissances, ce n'est qu'une unit de collection. Une pluralit de civilisations, dont chacune se prsente avec ses caractres
propres, semble s'y tre dveloppe d'une faon indpendante.
L'histoire et l'anthropologie nous mettent en prsence d'une ralit infiniment
varie et complexe, et nous sommes bien forcs de reconnatre que nous n'en obtiendrons la connaissance qu'au prix de longs efforts, mthodiques et collectifs, comme
lorsqu'il s'agit de la nature donne nos sens. Aussitt que nous considrons des
socits diffrentes de celle o tout nous parat clair, parce que tout nous y est familier, nous rencontrons chaque pas des problmes que nous sommes incapables de
rsoudre par le simple bon sens, aid seulement de la rflexion et de la connaissance
courante de la nature humaine . Les faits qui nous dconcertent obissent sans
doute des lois : mais quelles sont-elles ? Nous ne saurions le deviner. La ralit
sociale offre, en un sens, plus de difficults que le monde physique la recherche
scientifique, car, mme en supposant connues les lois statiques, l'tat d'une socit,
moment donn, n'est jamais intelligible que par l'volution antrieure dont il est le
point d'aboutissement actuel ; et combien sont rares les cas o la connaissance
historique de ce pass est assez complte et assez sre pour que rien d'indispensable
ne fasse dfaut ! Aussi bien, est-ce l une raison de plus pour ne jamais s'carter d'une
mthode scrupuleusement objective, et pour nous attendre ce qu'ici, comme dans la
science de la nature physique, le vraisemblable ne soit pas souvent le vrai. D'Alembert s'est amus formuler un certain nombre de lois physiques qui, a priori, nous
paratraient non seulement acceptables, mais trs probablement vraies - si l'exprience
n'en dmontrait la fausset. Le baromtre hausse pour annoncer la pluie. En effet,
lorsqu'il doit pleuvoir, l'air est plus charg de vapeurs, par consquent plus pesant ;
par consquent il doit faire hausser le baromtre. - L'hiver est la saison o la grle
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
69
doit principalement tomber. En effet, l'atmosphre tant plus froide en hiver, il est
vident que c'est surtout dans cette saison que les gouttes de pluie doivent se congeler
jusqu' se durcir en traversant l'atmosphre 1.
Tant que notre interprtation des phnomnes moraux se fonde sur notre connaissance prsume de la nature humaine, et sur l'identit suppose de cette nature en tout
temps et en tout lieu, elle ressemble sans doute la physique vraisemblable de
d'Alembert. Il est vrai que nous n'avons pas toujours le choix du procd. Pour
expliquer les croyances, les coutumes, les institutions mme les plus diffrentes des
ntres, nous sommes le plus souvent obligs de restituer, le mieux qu'il nous est
possible, les reprsentations et les sentiments qui se sont raliss objectivement dans
ces institutions, ces murs et ces croyances. Mais il est ncessaire de contrler et de
complter ce procd par l'usage de la mthode comparative, c'est--dire de la mthode sociologique. Employ seul, il conduit trs facilement l'erreur ; ce sont nos
propres tats d'me que nous introduisons, la place de ceux, trs diffrents, qu'il
faudrait retrouver. L est le vice initial de tant d'explications plausibles, mais fausses,
de tant d'ingniosit dpense en pure perte. Chercher l'interprtation des mythes dans
l'impression que les phnomnes de la nature font sur nous est aussi vain que de
s'expliquer la polygamie par le penchant naturel de l'homme des murs faciles. Les
cas extrmes, o la mthode d'analogie psychologique est impuissante, doivent nous
mettre en dfiance contre ceux o elle parat plus satisfaisante. Que sait-elle nous dire
du totmisme ?
Dans son tat prsent, la psychologie traditionnelle, qui reste attache au concept
de l' homme en gnral, prte la plupart des objections que ce concept soulve.
Comme lui, elle est abstraite et hors du temps. Comme lui, elle prend pour universel
ce qu'elle trouve dans les sujets qu'elle a sous les yeux, hic et nunc. Elle ne tient nul
compte de la diversit des civilisations, ni de l'histoire : peine souffre-t-elle l'ide,
trs vague, d'une volution et d'une diffrenciation progressives des facults humaines. Pourtant, le sujet qu'elle tudie est, au moins dans une certaine mesure, un produit de l'histoire. Nous ignorons pour quelle part, mais cette part srement n'est pas
petite. C'est une des ides les plus profondes et les plus originales dAuguste Comte,
et dont on est loin d'avoir tir toutes les consquences, que les facults suprieures de
l'homme doivent tre tudies dans le dveloppement historique de l'espce. Pour les
phnomnes qui doivent tre examins surtout dans leurs rapports avec leurs antcdents et concomitants physiologiques (sensations, perceptions, plaisirs et douleurs
organiques, etc.), la considration de l'individu peut suffire. Mais la thorie des
fonctions suprieures (imagination, langage, intelligence sous ses divers aspects)
exige l'emploi de la mthode sociologique.
Il y aurait donc profit, toutes les fois que cela est possible, renverser le procd
en usage jusqu' prsent, dans l'tude du dveloppement de ces fonctions. Au lieu
d'interprter les phnomnes sociaux du pass l'aide de la psychologie courante, ce
serait au contraire la connaissance scientifique - c'est--dire sociologique - de ces
phnomnes qui nous procurerait peu peu une psychologie plus conforme la
diversit relle de l'humanit prsente et passe. Pour ne citer qu'un exemple, l'tude
approfondie des rites et des croyances dans les religions primitives, des coutumes
relatives au mariage, des tabous, etc., nous introduit dans des formes d'imagination,
de combinaison, de jugement mme et de raisonnement que notre psychologie ignore
tout fait. Ces formes, il est vrai, ne se prsentent plus chez nous. Mais celles-l, ou
1
D'Alembert, par Joseph BERTRAND, p. 17, Paris, 1889.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
70
d'autres analogues, ont exist, n'en pas douter, chez nos anctres, et une analyse
suffisamment exerce en retrouverait peut-tre les traces au plus profond de nousmmes.
Nous avons, ds l'ge le plus tendre, l'usage d'une langue trs abstraite et trs diffrencie : cet usage se complique bientt de celui des signes visuels de la lecture et
des signes graphiques. Nous sommes donc faonns, uniformment, des habitudes
mentales, des formes d'imagination, des associations et dissociations d'ides, des
catgories de raisonnement qui sont insparables de ce langage. Nous devenons ainsi
peu prs incapables, quelque effort que nous fassions, de reconstituer les tats
mentaux ordinaires des hommes qui n'ont point ces mmes habitudes linguistiques et
logiques. Cependant, selon toute apparence, elles sont rcentes. Que de sicles nos
prdcesseurs n'ont-ils pas vcu sans elles, et quels vestiges ineffaables cette longue
prhistoire n'a-t-elle pas d laisser sur l'homme des temps historiques !
Selon Auguste Comte, a t une erreur commune des, philosophes de s'occuper
presque exclusivement de la logique des signes. Comme nous disposons des signes,
cette logique est celle dont nous discernons le mieux le jeu et le mcanisme : nous la
voyons l'uvre dans la formation des sciences. Mais, au-dessous de cette logique
des signes, il y a une logique des images, plus profondment situe, moins consciente
et aussi plus puissante ; et enfin, au-dessous de la logique des images, une logique des
sentiments, vieille sans doute comme l'espce elle-mme, qui ne s'exprime ni par des
concepts dfinis ni par des signes conscients, mais qui est une source spontane et
incoercible de l'action. Nous ne pouvons gure tudier ces deux dernires logiques sur
nous-mmes ou sur nos contemporains. La prdominance peu prs exclusive de la
logique conceptuelle chez nous - nous parlons intrieurement notre pense, mme
quand nous ne l'exprimons pas -, y oppose un obstacle insurmontable. Mais les religions, les murs, et, d'un mot, les institutions des socits infrieures nous permettent
souvent de remonter leurs reprsentations et leurs sentiments collectifs. Nous
pouvons retrouver l quelque chose de cette logique des images et de cette logique
des sentiments, qui conduisent les membres de ces socits des conclusions, c'est-dire des pratiques, dconcertantes ou inexplicables pour notre logique, mais aussi
ncessaires leurs yeux que les conclusions de nos syllogismes peuvent l'tre pour
nous.
En ce sens, il est exact que la sociologie, dans ses diverses parties, religieuse, morale, juridique, etc., est insparable de la psychologie. Mais ce n'est pas la psychologie gnrale et abstraite, ayant pour objet la vie mentale de l'homme actuel, qui
claire ces parties de la sociologie : elle ne nous fournirait que des explications
vraisemblables, et probablement fausses. C'est, au contraire, le progrs de la sociologie scientifique qui nous donne, sur les fonctions mentales primitives, des lumires
que nous n'aurions pas obtenues autrement. Et comme ce qu'elle nous apprend sur
l'imagination, sur les reprsentations collectives, sur l'organisation des penses et des
croyances, se rapporte l'usage le plus ancien de ces fonctions o nous puissions
atteindre, elle pourra tre un jour de la plus grande utilit pour l'explication positive
de nos fonctions mentales suprieures, si complexes et si obscures dans leur tat
prsent.
Pour conclure, notre connaissance prsume de la nature humaine en gnral,
au point de vue moral et mental, est destine faire place une psychologie toute
diffrente. Celle-ci sera fonde sur l'analyse patiente, minutieuse, mthodique, des
MURS et des institutions o se sont objectivs les sentiments et les penses, dans
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
71
les diverses socits humaines qui existent encore, ou dont l'existence a laiss des
traces interprtables pour nous. Cette analyse, la sociologie vient peine de l'entreprendre, et dj elle a obtenu des rsultats positifs. Elle fait voir, par contraste, combien l'ide de l'homme en gnral, dont la psychologie et la morale thorique se
sont contentes jusqu' prsent, est artificielle, et pauvre. Elle explique mme pourquoi elles s'en sont contentes, et ce qui les a empches d'en apercevoir l'insuffisance. C'est que cette conception est lie, d'une faon plus ou moins consciente, des
croyances religieuses que la sociologie retrouve presque partout : ide d'un principe
spirituel qui habite le corps et qui lui survit ; croyance l'origine divine de ce principe, etc. Tant que ces conceptions animistes dominent, le besoin d'une investigation
scientifique des faits psychiques ne s'impose pas : la spculation dialectique parat
suffire, et elle se regarde comme dfinitive. Aussi, de mme que nos morales thoriques garderont une valeur de documents, et serviront plus tard au sociologue pour
tablir quelle ide notre socit se faisait des rapports de ses membres entre eux ; de
mme, la psychologie abstraite et mtaphysique, qui a pour objet les fonctions de
l'me humaine en gnral, restera comme un tmoin de la forme pseudo-rationnelle
revtue par certaines croyances dans notre civilisation.
A mesure qu'une psychologie scientifique se dveloppera, concurremment avec
les progrs de la sociologie (ces deux sciences se prtant un mutuel secours), l'unit
de structure mentale dans l'espce humaine apparatra probablement. Elle se manifestera par l'analogie frappante des processus mentaux trs compliqus qui se sont
produits chez diverses portions de l'humanit sans communication apparente entre
elles : mme formation de mythes, mmes croyances aux esprits, mmes pratiques
magiques, mmes organisations de famille et de tribu. Mais cette unit, si elle se
confirme, restera nanmoins diffrente de celle qui est admise a priori par le postulat
que nous avons critiqu. Celle-ci, toute schmatique et abstraite, affirmait gratuitement l'identit foncire de tous les hommes, et ne pouvait servir qu' une spculation
dialectique et formelle. L'autre, au contraire, serait le point d'arrive d'une enqute
positive et prcise, portant sur toute la diversit vivante que nos moyens d'investigation peuvent atteindre dans l'humanit actuelle et dans l'histoire. Elle ne se confondrait pas plus avec la premire que l'nergtique moderne, bien qu'admettant l'unit de
la force sous ses diverses manifestations, ne se confond avec les physiques anciennes,
qui expliquaient tous les phnomnes de la nature au moyen d'un principe unique, tel
que le feu, l'eau, ou l'air.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
72
II
Second postulat : le contenu de la conscience morale forme un ensemble harmonieux et organique. - Critique de ce postulat. - Les conflits de devoirs. - L'volution historique du contenu de la conscience morale. - Stratifications irrgulires;
obligations et interdictions d'origine et de date diverses.
Retour la table des matires
Les morales thoriques, normatives avant tout, doivent s'accorder avec la conscience morale de leur temps ; et, en fait, elles se soumettent toujours, nous l'avons
vu, aux conditions essentielles de cet accord. Comme, d'autre part, elles prtendent
tre systmatiques, et dduire leur doctrine entire d'un principe unique, ou du moins
d'un nombre minimum de principes, elles supposent, sans le dire expressment et
surtout sans le prouver, que la conscience morale prsente elle-mme une systmatisation parfaite. Tel est le second postulat des morales thoriques. La conscience morale de l'homme possderait une unit organique, une sorte de finalit interne, comparable celle des tres vivants ; les commandements qu'elle dicte soutiendraient entre
eux des rapports logiquement irrprochables, et cette unit harmonique de la conscience morale correspondrait l'unit systmatique de la morale thorique. Par
exemple, lorsque Kant se demande si l'effort philosophique pour construire une doctrine morale est bien utile, et s'il ne suffirait pas de se confier bonnement la voix de
la conscience, il invoque, pour toute rponse, la crainte des sophismes, la difficult
d'entendre cette voix en toutes circonstances, et de n'entendre qu'elle. Il admet donc,
sans s'y arrter, que les ordres de la conscience forment spontanment un tout aussi
harmonique que son systme de morale. Les morales empiriques impliquent le mme
postulat, puisqu'elles se prsentent aussi comme des systmes, tout en prtendant
exposer ce que l'exprience leur dcouvre en nous.
A ne consulter que la conscience morale elle-mme, rien ne met en dfiance
contre ce postulat. Elle n'y trouve rien qui la choque. Elle se sent homogne et harmonique. Tout ce qui apparat comme moralement obligatoire revt, ipso facto, le mme
caractre sacr, et semble, par consquent, avoir la mme origine, faire partie d'un
mme ensemble. Ce trait est si marqu que des philosophes ont pu affirmer l'existence d'un ordre de ralit distinct, indpendant de tout le reste, qui serait l'ordre des
choses morales (rgne des fins de Kant). Blesser la conscience sur un point, c'est la
mettre toute en rvolte. Par une sorte de propagation immdiate, presque rflexe,
quelle que soit la partie touche, la conscience prend part tout entire la raction qui
se produit aussitt.
Nous examinerons ailleurs les causes sociales de ce fait important ; disons seulement ici qu'il se traduit intellectuellement, comme il est naturel, par la croyance
l'unit organique de la conscience morale. Mais si, au lieu d'interroger celle-ci, qui ne
peut se critiquer elle-mme, nous examinons le postulat du point de vue objectif, il
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
73
devient difficile de le conserver. En effet, le contenu de la conscience morale est loin
de demeurer immuable. Il varie, trs lentement parfois, mais il varie. Des lments
anciens en sont peu peu limins ; de nouveaux cherchent s'y introduire. Ce changement n'a pas lieu sans heurt, sans que des tendances opposes luttent pour le maintien des uns et pour l'exclusion des autres : premire raison de souponner que l'harmonie de la conscience est plutt apparente que relle. En second lieu, il se produit
toutes les poques, et constamment, des conflits de devoirs , des questions de
conscience difficiles, douloureuses, parfois mme tragiques et insolubles. Le postulat
implicitement admis, d'aprs lequel la conscience morale forme un tout un et harmonique, a cart l'explication la plus acceptable de ces faits. Les thoriciens de la morale, qui ont d s'occuper des conflits de devoirs, ont cherch en rendre compte par
des causes extrieures. Ils les font natre, le plus souvent, d'une rencontre de circonstances laquelle le sujet intress ne peut rien, ou d'une opposition entre les devoirs
ordinaires et les obligations rsultant d'une faute antrieure, qu'il se sent tenu de
rparer. Mais que l'on abandonne le postulat, et aussitt la plupart des conflits de devoirs s'expliquent de la faon la plus naturelle. Ils proviennent (et c'est ce qui en fait
souvent le caractre aigu) de contradictions inhrentes la conscience elle-mme,
presse, dchire par des obligations contraires les unes aux autres, qui y coexistent,
et qui s'y combattent.
Ici encore, il faut substituer la considration abstraite de l'homme en gnral,
l'analyse positive et prcise de l'homme donn dans la ralit vivante d'une socit
actuelle ou disparue. Aussitt ses obligations morales comme ses croyances, ses
sentiments, ses reprsentations, laissent voir une complexit extraordinaire ; et rien
n'assure plus, a priori, que cette complexit recouvre un ordre logique, ni qu'elle puisse se ramener quelques principes directeurs.
De ce point de vue, l'ensemble de ce qui apparat comme obligatoire et comme
dfendu l'homme d'une civilisation donne, une poque donne, ne constitue nullement une unit harmonique. Loin de trouver une analogie entre cet ensemble et la
finalit interne des tres vivants, on serait plutt tent de chercher un terme de comparaison dans le monde inorganique. En dpit du sentiment uniforme qui s'attache
tout le contenu de la conscience, elle est, pour l'analyse sociologique, une sorte de
conglomrat, ou du moins une stratification irrgulire de pratiques, de prescriptions,
d'observances, dont l'ge et la provenance diffrent extrmement. Les unes, qui font
notre solidarit avec des formes de socits humaines qui ont disparu sans laisser
d'autres traces, remontent trs haut dans l'histoire, peut-tre mme la prhistoire.
Elles sont plus nombreuses qu'on ne serait tent de le penser. Les folkloristes citent
un nombre surprenant de pratiques de ce genre, qui subsistent encore en Europe, dans
les campagnes, alors que les croyances qui les expliquent se sont effaces entirement
des esprits. D'autres, moins anciennes, et dont nous savons quelle poque elles se
sont introduites, ont dj, si l'on peut dire, la patine vnrable de la tradition.
Quelques-unes sont en plein accord avec les ides et les croyances de notre temps.
Certaines enfin, suscites par des thories nouvelles, ou, le plus souvent, par des institutions en voie de croissance, agissent comme un lment de dissolution, de rnovation, et quelquefois de progrs. Cet ensemble, ou plutt cet amas, n'a d'autre unit
que celle de la conscience vivante qui le contient et qui le dfend. La composition en
est aussi htrogne que possible. Pourquoi telle obligation a-t-elle survcu, tandis
que telle autre, connexe la premire, disparaissait ? Malgr leur harmonie apparente,
ces lments de provenance si diverse sont constamment en lutte. Si les murs sont
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
74
solidaires des autres sries 1 de phnomnes sociaux, et si ces sries voluent, les
murs ne doivent-elles pas voluer en mme temps, et par consquent aussi la
conscience ? Mais cette volution ne se fait pas tout d'une pice : des rsistances et
des conflits sont donc invitables.
Que trouverait-on, si l'on analysait sommairement le contenu d'une conscience
morale une poque de grande stabilit relative : par exemple, la conscience d'un
homme de condition noble, en France, au XIIIe sicle ? Elle contient des lments de
provenance germanique, lis aux croyances et aux pratiques des peuples barbares qui
ont occup la Gaule quelques sicles auparavant. Elle comprend aussi des lments
d'origine chrtienne, c'est--dire orientale, troitement solidaires du dogme et des rites
de l'glise catholique o sont entrs successivement les Gallo-Romains et les
Barbares. On y reconnat encore des lments grco-latins qui se sont imposs aux
vainqueurs, tandis qu'une partie de l'ancienne population se maintenait dans le pays.
Ce mlange a produit des murs que nous appelons fodales ou chevaleresques, dont
la saveur caractristique tient, du moins en partie, ce que nous distinguons les
lments disparates qui y sont runis sans y tre parfaitement fondus.
Mais, trs certainement, notre morale actuelle fera goter le mme plaisir miesthtique, mi-historique, nos petits neveux, qui en auront une sensiblement
diffrente. Nous pourrions, ds prsent, nous le procurer nous-mmes, si, faisant
abstraction provisoirement des sentiments de respect et d'attachement qui consacrent
pour nous le contenu de notre conscience morale, nous cherchions la gense sociologique de toutes les obligations qu'elle nous impose. Cette gense, M. de Groot l'a
expose, pour la conscience morale du Chinois, dans son admirable ouvrage intitul
The religious System of China Il montre, avec la plus parfaite vidence, par quel
processus social et mental se sont introduites et enracines la plupart des obligations
auxquelles un Chinois, aujourd'hui, ne voudrait manquer pour rien au monde, encore
qu'il soit incapable de les justifier. Peut-on douter qu'une analyse analogue de la
conscience occidentale soit possible ? Les actes que nous nous sentons tenus de faire
ou de ne pas faire, les jugeons-nous obligatoires ou interdits pour des raisons connues
de nous, et logiquement fondes ? Personne n'oserait l'affirmer dans tous les cas.
Souvent nous les expliquons par des motifs qui n'ont rien de commun avec leur
origine relle. La remarque en a t faite plus d'une fois pour ces obligations d'un
genre particulier que sont les usages et convenances du monde. Il en est de notre
pratique morale comme de l'orthographe. Le commun des mortels croit pieusement
que celle-ci est tout entire fonde sur des principes, et il l'observe pour elle-mme
jusque dans ses plus bizarres singularits. Mais l'historien de la langue sait combien
de confusions, d'erreurs, d'ides fausses et de tendances diverses ont concouru
former cette orthographe si respecte.
Pour comprendre notre conscience morale actuelle dans le dtail vivant de ce
qu'elle ordonne et de ce qu'elle interdit, il faudrait se reporter la conscience des gnrations qui nous ont immdiatement prcds. Pour expliquer celle-ci, il faudrait de
nouveau remonter plus haut, en tenant compte des influences intercurrentes, d'autant
plus nombreuses et plus entremles que l'on considrera des priodes plus tendues
(causes dmographiques, religieuses, politiques, conomiques, etc.). Et, de proche en
proche, le cercle des antcdents sociaux considrer s'largit jusqu' toucher la
1
Srie est un terme de la langue sociologique d'Auguste Comte, dont nous nous servirons pour
dsigner les diverses espces de faits sociaux : faits conomiques, religieux, moraux, juridiques,
etc.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
75
prhistoire. Leibniz disait que l'analyse d'une portion quelconque du rel va l'infini.
Cela peut se dire aussi, avec non moins de raison, de l'analyse d'une conscience
morale individuelle, quelle qu'elle soit.
Il est vrai que la mthode dialectique opre moins de frais. Par le seul emploi de
la rflexion critique, par une simple dissociation de concepts, elle pense donner une
analyse suffisante de la conscience morale. Mais cette analyse, tout abstraite, demeure
place exclusivement au point de vue statique. Elle reste donc fort loin d'puiser un
objet d'une complexit extrme, et qui ne peut tre compris si l'on fait abstraction de
l'histoire. Elle n'aperoit mme pas le caractre composite du contenu de la conscience morale, qui se donne pour homogne, et qu'elle accepte pour telle. Mais ce
caractre clate, si l'on ose dire, avec une vidence irrsistible, ds que l'on se place
au point de vue gntique, et que l'on emploie la mthode sociologique qui convient.
Le second postulat n'est donc pas mieux fond que le premier, et la conception de
la morale thorique , qui les implique ensemble, s'croule avec eux. Ils sont
d'ailleurs solidaires l'un de l'autre, et suggrs tous deux par le mme besoin. Si la
morale doit en mme temps prescrire et lgitimer rationnellement ses prescriptions, si
elle doit tre la fois normative et thorique, il faut que ses impratifs soient en
mme temps des lois. De l le concept btard et ambigu de la loi morale qui, par son
aspect thorique, se rapproche de la loi de la nature, et par son aspect normatif, de la
loi entendue au sens social et juridique. Ce concept a besoin, pour se former, des deux
postulats dont nous avons montr l'inexactitude. Pour que les impratifs soient levs
la dignit de la loi morale , il faut qu'ils puissent se prsenter comme ayant une
valeur universelle, pour tous les temps et pour tous les lieux. Il faut donc, d'une part,
que leur rapport avec la nature humaine prise en gnral soit vident, de faon que
l'obligation nonce s'impose tous les hommes qui existent ou qui existeront jamais
(premier postulat). D'autre part, il faut que la loi morale avec toutes ses consquences
- ou, si l'on aime mieux, l'ensemble des lois morales - se prsente comme un systme
organique dont aucune partie ne dpend de circonstances locales et accidentelles,
c'est--dire qu'on ne puisse pas montrer la gense historique et les alluvions successives des obligations, souvent incompatibles entre elles (second postulat). De l
l'origine, au moins pour une part, de l'effort constamment renouvel, dans l'histoire de
la philosophie, pour faire de la morale une science dductive, l'image des mathmatiques, qui possdent cette universalit et cette unit systmatique tant recherches.
Le malheur est qu'il n'y a rien, dans les mathmatiques, qui ressemble si peu que ce
soit aux postulats impliqus par les morales thoriques.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
76
III
Utilit des morales thoriques dans le pass, malgr l'inexactitude de leurs
postulats. - Fonction qu'elles ont remplie. - La morale antique plus libre et plus
affranchie d'arrire-penses religieuses que les morales philosophiques des
Modernes jusqu'au XIXe sicle. - Ici la Renaissance n'a pas eu son plein effet. Raction la fin du XVIIIe sicle. - Succs apparent et impuissance finale de
cette raction.
Retour la table des matires
Examine dans sa dfinition, dans ses mthodes, dans ses postulats, la morale
thorique, telle qu'elle est conue habituellement, nous a paru incapable de se soutenir. L'ide d'une science la fois spculative et normative est irralisable, pour ne pas
dire contradictoire. La mthode employe par les morales thoriques tient beaucoup
plus de la dialectique des Anciens que des procds de recherche scientifique des
Modernes, et elle ne peut produire que des dductions presque entirement verbales.
Enfin, les postulats sur lesquels la conception mme de la morale thorique repose ne
rsistent pas la critique. L'ide de loi morale, ide confuse, comprend des lments
qui tendent se dissocier. C'est pourquoi la prtendue science la fois thorique et
normative, on verra peu peu se substituer d'une part une science ou plutt un ensemble de sciences tudiant au moyen d'une mthode objective la ralit morale donne,
d'autre part une pratique rationnelle, ou un art, qui mettra profit les dcouvertes de
ces sciences.
Conclurons-nous que la tentative des philosophes pour constituer une morale
thorique tait superflue, et que leur peine s'est dpense en pure perte ? - En aucune
manire. Jamais, comme on l'a dit, un effort pour parvenir l'intelligence du monde et
de nous-mmes n'est entirement vain. Avant d'atteindre leur forme dfinitive, les
sciences passent par des tats plus ou moins imparfaits, tapes qu'il est sans doute
ncessaire de franchir : l'alchimie vient avant la chimie, l'astrologie avant l'astronomie. - Il est vrai ; encore faut-il que cette vue trop gnrale soit contrle expressment dans chaque cas donn. Il serait peut-tre d'un optimisme excessif de s'y rapporter comme une loi certaine. Que les travaux des astrologues n'aient pas t sans
utilit pour les astronomes qui vinrent ensuite, on peut l'admettre. Mais l'Antiquit
grecque avait produit des astronomes qui n'taient pas astrologues, et l'on conoit sans
peine un dveloppement de la science qui n'aurait pas connu d'astrologie, entre
Hipparque et Ptolme d'une part, Copernic et Kepler de l'autre. Rien ne prouve, a
priori, que l'esprit humain ne puisse s'engager dans des impasses, d'o il ne sort pas
toujours, ou bien d'o il finit par sortir aprs beaucoup de temps perdu, et sans autre
profit que de savoir dsormais les viter.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
77
La morale thorique n'a pas t une de ces impasses.
Au contraire, tant qu'une science proprement dite (c'est--dire objective et dsintresse) des phnomnes moraux n'tait pas encore possible, il tait bon que la place
en ft occupe par une spculation qui s'efforait d'tre rationnelle et philosophique.
Comte a dit avec force que nous devons la plus grande reconnaissance aux premiers
hommes (des prtres selon lui), qui entreprirent de chercher une interprtation des
phnomnes naturels. Peu importe que cette interprtation ait t, pendant de longs
sicles, purement imaginative, mythique, purile mme et absurde. Quelle qu'elle ft,
elle tait d'une utilit capitale, en fortifiant dans les esprits un besoin intellectuel
d'explications thoriques. Peu peu, la mtaphysique est ne des cosmogonies religieuses, et plus tard, quand des circonstances favorables l'ont permis, la physique a
grandi l'ombre de la mtaphysique, pour se sparer d'elle finalement. Fait trs
remarquable : les peuples qui n'ont pas connu de mtaphysique rationnelle ne connaissent pas non plus de physique scientifique. Toute notre jeune science de la nature
rvre dans les mtaphysiciens grecs les anctres qui elle doit d'exister. Pareillement, sans les philosophes (mtaphysiciens pour la plupart) qui ont construit des
morales thoriques, des mtamorales , une science proprement dite des phnomnes moraux ne serait peut-tre jamais ne. Le mrite n'est pas moindre dans ce cas, ni
le service rendu moins important.
Il tait mme plus indispensable. Sans doute, il a fallu beaucoup de temps pour
que les lments mystiques, sentimentaux, religieux, disparussent tout fait de la
conception scientifique de la nature physique. Il est des civilisations trs avances, comme celles de la Chine et de l'Inde, o ce travail ne s'est jamais achev. Chez
les Grecs du moins, bien que la nature restt divine, une mtaphysique et une physique purement rationnelles se sont fondes.
Mais, lorsqu'il s'est agi de la nature morale, le mme processus devait tre
beaucoup moins assur, et, certainement, beaucoup plus lent. D'abord, les phnomnes moraux, qui dpendent visiblement de la volont de l'homme, paraissent comporter un lment d'indtermination, et, si l'on peut dire, d'incalculabilit. Puis, les
rgles directrices de la conduite sont lies de la faon la plus troite et la plus constante aux traditions reues des anctres, comme aux croyances religieuses. Elles ne
sont pas seulement associes des lments mystiques, religieux, sentimentaux ; elles
y sont intimement mles, et elles semblent leur devoir la plus grande part, et la plus
durable, de leur pouvoir sur les mes.
Il n'est donc pas tonnant que l'effort philosophique pour donner une explication
rationnelle des faits moraux et des rgles morales soit rest trs longtemps, et reste
encore, associ des lments irrationnels. L'attitude scientifique ne pouvait tre
prise ici que trs tard : il fallait toute une srie de transitions successives dont nous
voyons sans doute les dernires. De mme que la physique a gard pendant de longs
sicles les traces de la mtaphysique qui lui a donn naissance, de mme l'tude rationnelle de la ralit morale ne s'est diffrencie que lentement de la mtamorale .
Ajoutez que la courbe de cette volution n'est pas simple, et ne reprsente certainement pas un progrs ininterrompu. Au jugement de la plupart des historiens, la morale
antique, dans la priode proprement grecque, tait plus dgage d'lments religieux
et surnaturels que ne l'a t la morale philosophique des Modernes, du moins jusqu'
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
78
notre temps 1. Ce qui a manqu, avant tout, aux Anciens pour constituer une science
proprement dite des choses morales, c'est une mthode inductive rigoureuse, dont leur
dialectique occupait la place ; mais o auraient-ils pris l'ide d'une telle mthode,
puisqu'elle leur faisait dfaut mme en physique ? En revanche, leur conception des
choses morales fut admirablement libre. La morale d'Aristote, par exemple, se dveloppe du commencement jusqu' la fin avec une parfaite srnit, sans qu'on y voie,
sans qu'on y sente jamais intervenir, plus ou moins discrtement, ni la proccupation
de la vie future, ni celle d'un Dieu administrateur des sanctions post-terrestres.
Ces ides sont, au contraire, au premier plan dans la morale chrtienne. Elles tiennent une place moindre, mais encore trs considrable, dans les systmes de morale
des Modernes. Car ces systmes restent d'accord avec la conscience gnrale de leur
temps, et cette conscience est encore tout imprgne de croyances chrtiennes. Mettons part, si l'on veut, Descartes, qui n'a pas donn sa morale dfinitive, Spinoza,
Hume, Hegel et quelques autres : les doctrines morales mme les plus rationalistes
(Leibniz, Locke, Kant, Fichte) n'ont-elles pas gard, d'une faon plus ou moins
apparente, plus ou moins consciente, la proccupation du salut de l'homme dans
l'autre monde ? Aujourd'hui encore, mme dans les pays o l'enseignement de la
morale n'est pas confi aux ecclsiastiques, la morale enseigne au nom de la philosophie et de la raison n'est pas exempte d'arrire-penses du mme genre. En est-il un
seul o l'on ne s'effrayt d'une lacisation complte, c'est--dire d'un simple retour
l'attitude rationnelle des philosophes grecs ?
Ainsi, dans la science de la ralit morale, la Renaissance n'a pas eu son plein
effet, comme dans la science de la ralit physique. Sous son influence (favorise, il
est vrai, par un grand nombre de circonstances) la conception de la nature physique
est redevenue assez vite rationnelle, plus rationnelle mme qu'elle ne l'avait t chez
les Anciens. Le progrs des mathmatiques, la multiplication des expriences,
l'abandon de la mthode dialectique firent disparatre les obstacles qui avaient arrt
la marche de la physique dans l'Antiquit. La tradition chrtienne n'en prenait pas
ombrage. Au contraire, comme la divinit de la nature, admise par les Anciens, lui
faisait horreur, elle tait plutt favorable au dveloppement de la physique moderne,
du moins tant que celle-ci n'en venait pas contredire le dogme. Mais la nature
morale ne pouvait, pour les raisons indiques plus haut, devenir aussi vite l'objet
d'une recherche scientifique proprement dite. La mtamorale , qui en tenait la
place, tait protge avec un soin jaloux par les dfenseurs de la tradition religieuse.
Les premiers essais, les uns bien abstraits, les autres bien htifs, pour constituer une
science sociale, ceux de Hobbes par exemple, de Spinoza, et des philosophes les plus
hardis du XVIIIe sicle, furent combattus avec une extrme violence, et leurs auteurs
fltris du nom de matrialistes et d'athes, sans parler des perscutions diriges
souvent contre leurs personnes et contre leurs oeuvres.
Sous l'influence runie de ces causes, et de beaucoup d'autres que nous ne pouvons passer ici en revue, l'tude scientifique de la ralit morale commenait seulement s'annoncer lorsque clata, vers la fin du XVIIIe sicle, une raction gnrale
en Europe contre l'esprit cartsien et classique, contre le rationalisme, et surtout contre les tendances qui dominaient depuis deux cents ans. Les sciences de la nature
physique, matresses de leurs mthodes, sres de leurs objets, fires de leurs conqutes, n'avaient rien craindre de cette raction. Mais elle parut avoir arrt net,
1
Voyez V. BROCHARD, La morale ancienne et la morale moderne, Revue philosophique, janvier
1901.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
79
pour un temps, la marche de la spculation morale vers une forme scientifique. Le
besoin de rorganisation sociale , que l'on croyait urgent, fit surgir sans doute, en
grand nombre, des travaux relatifs aux questions politiques et sociales, mais o
l'intrt de la pratique l'emportait de beaucoup sur l'intrt spculatif. On se htait
vers des solutions immdiatement applicables. Et quant la spculation proprement
morale, tant sous l'influence de Kant que sous celle de la philosophie traditionaliste et
chrtienne, elle ne fut gure, en France du moins, pendant plus de la moiti du XIXe
sicle, que de la mtamorale . Les philosophes spiritualistes qui l'enseignaient se
dfiaient du XVIIIe sicle, n'aimaient pas parler de Hume, et souriaient de piti au
nom de Condorcet. Les mmes influences expliquent le silence fait autour de l'uvre
de Comte, et le peu d'attention accord la sociologie qu'il fonde. C'est surtout
l'hritier du XVIIIe sicle que l'on craignait et que l'on cartait en lui.
Toutefois, la victoire de cette raction ne fut qu'apparente. Nous verrons plus loin
comment, en partie par l'effet de cette raction mme, le besoin d'une tude scientifique de la ralit morale est devenu de plus en plus vif, de plus en plus net. Dans le
dernier quart du XIXe sicle, la sociologie, si nglige nagure, a attir un nombre
croissant de chercheurs. Tandis que les philosophes s'attardaient rajeunir des morales thoriques , moins diffrentes entre elles qu'ils ne le croyaient, les matriaux
d'une science de la nature morale se prparaient ailleurs, par l'apport incessant des
sciences anthropologiques, historiques, religieuses, juridiques, conomiques, de toutes les sciences enfin dont la seule existence rend chaque jour plus manifeste l'insuffisance des postulats sur lesquels se fonde la conception habituelle de la morale
thorique.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
80
CHAPITRE IV
DE QUELLES SCIENCES
THORIQUES
LA PRATIQUE MORALE
DPEND-ELLE ?
I
L'objet de la science n'est pas de construire ou de dduire une morale, mais
d'tudier la ralit morale donne. - Nous ne sommes pas rduits constater
simplement cet ordre de faits ; nous pouvons y intervenir efficacement si nous
en connaissons les lois.
Retour la table des matires
Tant que l'on admet la conception et la distinction traditionnelles de la morale
thorique et de la morale pratique, on s'en reprsente les rapports sans difficult. La
morale thorique tablit (a priori ou a posteriori, peu importe en ce moment) les
principes d'o la morale pratique tire des applications. Il semble que rien ne soit plus
ais. En fait, les systmes de morale, presque sans exception, ne considrent pas qu'il
y ait l un problme examiner. Ils glissent tout naturellement, et sans rflexion, sur
le passage de la morale thorique la morale pratique. M. Renouvier, cependant, fait
une rserve ce sujet. Il ne croit pas que les applications tires de la morale thorique
soient, immdiatement et telles quelles, ralisables dans la pratique. Il distingue ce
que cette pratique serait dans l'tat de paix (tat d'une socit parfaite), et ce
qu'elle devient dans l'tat de guerre (tat prsent de l'humanit). Cette distinction
est importante. Elle implique que M. Renouvier reconnat l'existence d'un problme
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
81
qui se pose au moment de passer de la thorie la pratique, et qu'il se proccupe de
tenir compte de la ralit sociale donne. Mais M. Renouvier, une fois cette rserve
faite, garde la conception traditionnelle des rapports de la thorie et de la pratique, en
morale. Celle-ci se dduit toujours de celle-l. La dduction est complique par des
lments de fait qu'il ne faut pas ngliger ; mais le rapport entre la thorie et les prceptes reste un rapport de principes consquences.
Mais si, comme nous croyons l'avoir montr, les morales thoriques ne sont
pas ce qu'elles prtendent tre, ce rapport si simple et si ais ne saurait tre lui-mme
qu'une apparence. Loin que la pratique se dduise de la thorie, c'est la thorie qui,
jusqu' prsent, est une sorte de projection abstraite de la morale pratique dans une
socit donne, une poque donne. C'est donc, tout au contraire, la pratique qui est
pose d'abord, et la thorie qui est assujettie ne pas heurter cette pratique. Car, quel
que soit le gnie d'un philosophe, il ne peut faire accepter son systme de morale que
s'il ne s'carte pas trop de la conscience commune de son temps ; tandis que, pour
s'imposer avec une autorit absolue, cette conscience n'a nullement besoin de se fonder sur une thorie abstraite. La recherche spculative, selon nous, en morale, consiste
tudier cette conscience mme, telle qu'elle se prsente dans les diffrentes socits
humaines, et dans le mme esprit o la science de la nature physique tudie son objet.
Que deviennent les rapports de la thorie ainsi entendue avec la pratique ? C'est-dire, en supposant que cette recherche spculative ait atteint un certain degr
d'avancement, qu'elles en seraient les consquences pour la pratique ?
Tout d'abord, l'ancienne conception prtait une illusion qui disparat maintenant
d'elle-mme. Le rapport de principe consquence est facilement confondu avec celui
de cause effet. Quand on se reprsentait la pratique comme dduite de la morale
thorique, on tait en mme temps inclin croire que la philosophie fonde, en effet,
la pratique ; qu'elle lui donne, avec son principe, sa raison d'tre, et, par consquent,
sa ralit mme. C'est de quoi il ne saurait plus tre question dsormais. Les morales , c'est--dire les ensembles observables de rgles, de prescriptions, d'impratifs,
et d'interdictions, existent au mme titre que les religions, les langues et les droits.
Toutes ces institutions sociales se prsentent nous comme galement naturelles, et
comme solidaires entre elles. Construire ou dduire logiquement la morale est une
entreprise aussi hors de propos que si l'on s'avisait de construire ou de dduire logiquement la religion, le langage, ou le droit. En un mot, les morales sont des donnes . C'est un fait que, pour toutes les consciences moyennes de notre civilisation,
par exemple, certaines manires d'agir apparaissent comme obligatoires, d'autres
comme interdites, d'autres enfin comme indiffrentes. Il n'y a pas lieu d' dicter ,
au nom d'une thorie, les rgles de la morale pratique. Ces rgles ont la mme sorte
de ralit que les autres faits sociaux, ralit qui ne se laisse pas impunment mconnatre.
Sommes-nous donc rduits constater, pour ainsi dire, ce qu'ont t les morales
successives ou simultanes des diverses civilisations, constater encore ce qu'est
notre propre morale, et considrer enfin comme tmraire et impraticable toute
tentative d'amlioration ? Cette conclusion ne s'impose nullement 1. La science nous
procure les moyens de modifier, notre avantage, la ralit physique ; il n'y a pas de
raison, a priori, pour qu'elle ne nous donne pas le mme pouvoir sur la ralit sociale,
quand elle aura fait des progrs suffisants. En fait, l'exprience nous montre la pratique morale en voie d'volution, lente, il est vrai, mais peu prs ininterrompue.
1
Voyez mile DURKHElM, De la division du travail social, Ire d., Prface, p. v, Paris, F. Alcan.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
82
Parmi le trs grand nombre de causes qui interviennent pour hter ou pour ralentir
cette volution, la rflexion philosophique n'a pas t, en certains cas, la moins
importante. La pratique morale enveloppe toujours des contradictions latentes, qui se
font sentir, peu peu, sourdement, et qui se manifestent enfin, non seulement par des
luttes dans le domaine des intrts, mais par des conflits dans la rgion des ides.
L'effort conscient pour rsoudre ces contradictions n'a pas peu contribu au progrs
moral.
Ainsi, loin qu'il faille nous rsigner au rle de spectateurs passifs, nous sommes
sollicits constamment nous dcider pour ou contre la conservation ou l'acceptation
de telle ou telle pratique morale. S'abstenir est encore prendre parti. Mais comment
nous dcider, au nom de quel principe, si notre dcision doit tre rationnelle ? videmment d'aprs les rsultats de la science positive de la ralit sociale, qui tend se
substituer la morale thorique . Le problme qui se pose est d'tablir cette
science, et de savoir en tirer des applications.
II
Trois acceptions distinctes du mot morale . - Comment s'tabliront les applications de la science des MURS la pratique morale. - Difficult d'anticiper
sur les progrs et sur les applications possibles de cette science. - Sa diffrenciation et ramification progressives.
Retour la table des matires
Mme en cartant l'ancienne conception de la morale thorique , le mot morale peut encore tre pris en trois acceptions qu'il nous faut soigneusement distinguer.
1 On appelle morale l'ensemble des conceptions, jugements, sentiments, usages, relatifs aux droits et aux devoirs respectifs des hommes entre eux, reconnus et
gnralement respects, une priode et dans une civilisation donnes. C'est en ce
sens que l'on parle de la morale chinoise, ou de la morale europenne actuelle. Ce mot
dsigne alors une srie de faits sociaux, analogue aux autres sries de faits du mme
genre, religieux, juridiques, linguistiques, etc.
2 On appelle encore morale la science de ces faits, comme on appelle physique la science des phnomnes de la nature. C'est ainsi que l'on oppose les sciences morales aux sciences physiques. Mais, tandis que physique sert exclusivement
dsigner la science dont l'objet s'appelle nature , le mot morale est employ
la fois pour dsigner la science et l'objet de la science.
3 Enfin, on peut encore appeler morale les applications de cette science. Par
progrs de la morale , on entendrait les progrs des arts de la pratique sociale : par
exemple, plus de justice ralise dans les rapports entre les hommes, plus d'humanit
dans les relations entre les classes sociales, ou entre les nations. Ce troisime sens se
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
83
spare nettement des deux prcdents, qui ne diffrent pas moins entre eux. De l des
confusions inextricables, et, en particulier, cette consquence que la philosophie morale d'aujourd'hui, semblable en ce point encore la philosophie physique des
Anciens, discute sans fin des problmes purement verbaux, et passe ct des problmes rels sans les voir. Nous viterons donc, autant que possible, de dsigner par le
mme terme l'objet de la science, la science elle-mme, et ses applications. Nous
dirons dans le premier cas les faits moraux, ou les morales ; dans le second, la
science de ces faits, ou de la ralit sociale dans le troisime, l'art moral rationnel.
Cette distinction permet de rpondre une objection qui s'est peut-tre prsente
l'esprit du lecteur. Tantt, semble-t-il, la morale est rapproche ici de la religion, du
langage, des institutions sociales en gnral : elle est conue par consquent comme
un ensemble de faits, comme une ralit donne, objet d'une science ou d'un corps de
sciences analogues la physique. Tantt on la compare (comme l'avait dj fait Descartes) la mcanique et la mdecine, qui sont des arts, ou des ensembles de
procds mthodiques employs par l'homme pour l'application de la connaissance
qu'il a des lois de la nature. Comment la morale peut-elle tre reprsente la fois par
deux conceptions si diffrentes ? - Les comparaisons sont cependant exactes toutes
deux. Pour carter l'objection, il suffit de remarquer que, dans la premire, morale
reprsente l'objet de la science des faits moraux, objet analogue en effet celui des
autres parties de la sociologie ; tandis que, dans la seconde comparaison, il s'agit de la
morale entendue comme art pratique rationnel , et assimilable, ce titre, la mcanique et la mdecine.
En principe, le progrs de cet art dpend du progrs de cette science. Plus notre
connaissance des lois de cette nature sociale sera tendue et exacte, plus nous pourrons esprer en tirer des applications avantageuses. Mais il est difficile, quant
prsent, de prciser davantage. Nous n'avons pas le droit de supposer que les deux
progrs marchent pari passu. La chane des vrits qui s'appellent mutuellement, et
dont la dcouverte devient successivement possible par celle des mthodes nouvelles,
dit Condorcet, n'a aucun rapport avec la suite des vrits qui doivent devenir aussi,
chacune leur tour, d'une utilit pratique 1. D'o la ncessit de poursuivre le travail
thorique d'une faon dsintresse, mme en l'absence de rsultats utilisables tout de
suite, et simplement avec l'espoir d'applications futures dont on n'a encore aucune
ide. On ne fait pas une dcouverte parce qu'on en a besoin, dit encore Condorcet,
mais parce qu'elle est lie avec des vrits dj connues, et que nos forces peuvent
enfin franchir l'espace qui nous en spare 2. Il se peut que la science de la nature
sociale, qui en est ses dbuts, doive passer par une priode, dont nous ignorons la
dure, o les rsultats obtenus par elle ne donneront lieu qu' trs peu d'applications
dans la pratique. Il y a trois sicles seulement que la mcanique est devenue un art
rationnel ; il se passera peut-tre encore plus de trois sicles avant que la mdecine
parvienne son tour au mme point ; cependant l'effort pour obtenir une connaissance
scientifique des lois naturelles dont ces deux arts dpendent, remonte l'Antiquit
grecque. Rien n'autorise penser que, dans le cas de la nature sociale, la priode des
applications rationnelles doive concider avec le dbut des recherches scientifiques. Il
serait donc tmraire de prtendre formuler, ds prsent, une ide prcise de ces
applications. Tout au plus peut-on, dans une certaine mesure, en prvoir le mode
d'apparition, d'aprs la faon dont se sont forms peu peu les arts rationnels qui sont
plus avancs.
1
2
loge de M. de Fouchy, Oeuvres, tome III, pp. 313-314.
loge de M. Duhamel, ibid., Il, p. 642.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
84
Dans le monde inorganique, la subordination de la pratique la science thorique
des lois ne fait plus question, parce que la dmonstration du pouvoir que procure cette
science est trop continuelle et trop clatante. Il n'y a pas d'empirique qui puisse lutter
contre un ingnieur pour l'utilisation d'une chute d'eau ou pour la construction d'un
tunnel. Dans le monde de la vie, cette subordination commence seulement s'tablir.
Les raisons de cette lenteur sont multiples, et la plus forte vient sans doute de ce que,
dans un grand nombre de circonstances, l'art rationnel est encore incapable de se
substituer l'exprience du clinicien. En outre, le rapport de la pratique au savoir
thorique devient ici extraordinairement complexe. L'art rationnel ne se fonde plus
seulement sur des lois tablies par une seule science, ou par un petit nombre de
sciences, comme font les applications si nombreuses aujourd'hui en lectricit et en
chimie industrielle. Il suppose l'emploi de connaissances provenant d'un ensemble de
sciences trs considrable, qui comprend non seulement les sciences biologiques
proprement dites, dj fort nombreuses, mais aussi les sciences physiques et chimiques. L'expression de chimie applique est trs claire : celle de biologie applique est obscure, et, en fait, inusite. Personne n'appellerait aujourd'hui de ce nom
la thrapeutique sous aucune de ses formes. D'une part, en effet, la biologie comprend
beaucoup de connaissances qui ne donnent lieu aucune application, et, d'autre part,
l'art de gurir, en bien des cas, ne se fonde pas encore sur des connaissances de caractre proprement scientifique.
Par suite, le rapport de la pratique la science thorique ne s'tablit pas d'une manire gnrale et systmatique, mais plutt propos de problmes particuliers, et
comme au hasard des dcouvertes et des besoins. Tantt on descend de certaines lois
nouvellement connues des applications qu'elles rendent dsormais possibles, tantt
on remonte d'une question donne aux connaissances thoriques d'o la solution
dpend. Par exemple, de la connaissance, rcemment acquise, des agents par lesquels
se propage une maladie contagieuse, on tire, comme application, un ensemble de
mesures prophylactiques qui rendent la maladie trs rare, ou qui mme la font disparatre (rysiple, fivre puerprale, etc.). Inversement, un problme pratique tel que
celui de la maladie des vers soie tant pos, Pasteur en cherche et en trouve la
solution pour ainsi dire thorique. Elle permet alors d'intervenir coup sr dans
l'ducation des vers, et de supprimer la maladie.
Toutefois, le nombre de cas o le rapport s'tablit avec cette parfaite nettet est
encore fort restreint. Pendant une priode qui sera sans doute trs longue, le progrs
de l'art rationnel de gurir se produira le plus souvent par contrecoup, comme une
consquence, parfois trs indirecte, de dcouvertes faites dans un domaine sans rapport apparent avec la thrapeutique ou la chirurgie. L'histoire de la carrire scientifique de Pasteur est encore riche d'enseignements cet gard. Quand il fit ses premiers
travaux sur le pouvoir rotatoire de certains cristaux, il lui tait impossible lui-mme
de pressentir par quelles transitions il serait amen, de recherches en recherches, des
dcouvertes du plus haut intrt pour la pathologie humaine. Demain, peut-tre, une
marche analogue conduira un physicien de gnie des rsultats non moins importants
ni moins imprvus. Ainsi, comme d'une part les problmes poss par la pratique sont
d'une trs grande complexit, et comme d'autre part la biologie, trs tendue ellemme, intresse encore par surcrot l'immense domaine des sciences physiques et
chimiques, et subit le contrecoup de leurs progrs, le dveloppement de l'art rationnel
dpend presque exclusivement d'heureuses rencontres. Nous n'en pouvons rien dire
l'avance, sinon que celles-ci deviendront de plus en plus frquentes, mesure que les
sciences seront plus avances.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
85
A plus forte raison en est-il de mme dans le domaine de l'art social rationnel.
Toute conjecture prcise sur la loi d'un processus qui commence peine, et qui n'a pu
encore tre observ, serait forcment arbitraire. Le plus vraisemblable est que cet art,
lui aussi, pendant une trs longue priode, s'exercera sur des points particuliers, avant
de s'organiser d'une manire systmatique. Il mettra profit la connaissance scientifique des lois de la nature sociale , l o un heureux concours de circonstances
l'aura favorise. Dj, par exemple, la pdagogie a renonc, sur certains points,
d'anciennes pratiques peu dfendables, et les a remplaces par des applications fondes sur la psychologie scientifique de l'enfant. De mme, dans les questions d'assistance, un effort se produit pour organiser la pratique d'aprs la connaissance scientifique des causes de la misre et du chmage, soit dans les villes, soit dans les campagnes.
Mais, faute d'une science de la nature sociale suffisamment avance, nous ne
voyons pas encore comment l'art social rationnel pourra modifier la pratique tablie
dans les grandes questions fondamentales. Des tentatives sans doute ont t faites, de
tout temps, par les utopistes, et surtout depuis un sicle, par les rformateurs, communistes, socialistes, fouriristes et autres, pour instituer une organisation nouvelle de la
famille, de la proprit, des relations conomiques, et de notre socit en gnral. Ces
tentatives prtendaient se fonder sur la science positive . Mais, en fait, l'effort de
leurs auteurs se portait principalement sur la rorganisation de la socit, et non sur
l'tude objective et patiente de la ralit sociale. C'est pourquoi ils ont pu, sans hsiter, proposer des projets de rorganisation totale de la pratique existante ; mais c'est
pourquoi aussi ils appartiennent encore la priode pr-scientifique. Celle-ci n'est
termine que lorsque ces esprances ambitieuses ont disparu. Une fois la conviction
bien tablie que l'homme ne dispose pas plus aisment de la nature sociale que de
la nature physique , et que le seul moyen de conqurir la premire, comme la seconde, c'est d'en dcouvrir d'abord les lois, les prtentions deviennent plus modestes.
La recherche scientifique apparat comme la condition pralable d'une intervention
rationnelle dans les phnomnes sociaux. Le rformateur se subordonne au sociologue.
En outre, mesure que la sociologie se dveloppera, elle se sectionnera en une
multiplicit croissante de sciences voisines, mais distinctes, les unes des autres. Dans
l'tude de phnomnes extrmement complexes, la division du travail scientifique
devient vite une ncessit. La ramification des gros troncs scientifiques en branches
secondaires, qui se subdivisent leur tour, se poursuit encore aujourd'hui pour la
physique, la chimie, la biologie ; plus forte raison se produira-t-elle pour le vaste
ensemble appel du nom commun de sociologie. Chacune de ses grandes divisions
(sociologie religieuse, conomique, juridique, etc.) se sectionnera son tour. Voyez,
par exemple, le double processus de diffrenciation et d'organisation qui se poursuit
dans L'Anne sociologique.
Quelles sont, parmi ces sciences, celles d'o dpendra principalement le progrs
de l'art social rationnel ? Il est impossible de le prvoir, dans l'tat actuel de la
sociologie, surtout si l'on rflchit aux contrecoups tout fait inattendus que la
dcouverte d'un procd de mthode ou d'un instrument de recherche, dans une
science, peut avoir aussitt sur le progrs d'une autre science, et par suite, sur la pratique elle-mme. Qui et pens, il y a cinquante ans, que la chirurgie serait entirement transforme, et la mdecine profondment modifie, par une srie de dcouvertes dues la chimie biologique ? Qui mme, cette date, avait une ide claire de
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
86
cette chimie ? Il n'est que prudent de s'attendre de pareilles surprises, dans le domaine de la science de la nature sociale . Cet ample domaine commence peine tre
explor scientifiquement. La topographie en est incertaine. La division des sciences
doit y tre regarde comme provisoire ; et l'organisation du travail scientifique y
parat destine subir les changements les plus profonds.
III
On peut se reprsenter cette marche d'aprs l'volution de la science de la
nature physique, plus avance. - Causes qui ont arrt le dveloppement de cette
science chez les Anciens. - La physique d'Aristote se propose de comprendre
plutt que de connatre , et descend des problmes les plus gnraux aux
questions particulires. - Les sciences morales ont encore plus d'un
caractre commun avec cette physique. - Comment elles prennent une forme plus
voisine de celle des sciences modernes de la nature.
Retour la table des matires
Puisque la science de la nature physique a une avance considrable sur celle de la
nature sociale ; puisque, d'autre part, elle n'est arrive son tat prsent qu' travers
une longue srie d'efforts et de ttonnements sculaires, o son progrs n'a pas t
continu, la science de la nature sociale pourra peut-tre profiter de l'exprience de son
ane. Mme l'tude des priodes o celle-ci est reste stationnaire ne lui sera pas
moins utile que l'examen des poques de conqutes rapides et brillantes. Il peut tre
du plus haut intrt, pour elle, de savoir quoi il tient que la science de la nature
physique n'ait pas pris chez les Anciens la forme qui lui a permis, depuis trois sicles,
de se dvelopper au-del de toute attente, et de rendre possible une foule d'applications aussi prcieuses qu'imprvues.
Considrons la physique ancienne (entendue au sens large) chez Aristote. Ce n'est
pas faire tort cette science ; car, si la somme des faits physiques connus a continu
de crotre aprs lui, l'Antiquit n'a pas produit d'esprit plus ferme dans sa conception
logique de la science, et en mme temps plus attach au rel, plus respectueux des
droits du fait et de l'exprience. Or, si nous comparons la physique d'Aristote aux
sciences modernes de la nature, la raison profonde et essentielle de leurs diffrences,
d'ailleurs nombreuses, se rsumera assez bien dans la distinction suivante la physique
moderne borne son ambition connatre la physique aristotlicienne se donnait
pour objet de comprendre . L'obstacle capital au dveloppement de la physique
chez les Anciens a t le besoin de se reprsenter la nature comme intelligible. Le pas
dcisif, pour la physique moderne, a t franchi le jour o elle a rsolument born ses
recherches dterminer comment les phnomnes varient en fonction les uns des
autres, et mesurer ces variations.
Dans la pense d'Aristote, chaque tre, chaque phnomne dtermin et particulier
a sans doute sa cause dtermine et particulire. Mais, en un autre sens, par une
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
87
analogie qui s'tend la nature entire, les mmes causes et les mmes principes se
retrouvent partout, et rendent tout intelligible 1. Partout le savant (qui ne se distingue
pas du philosophe) dcouvre les rapports de la puissance et de l'acte, de la matire et
de la forme, des moyens et de la fin. Mais prcisment cette universalit des principes
et des causes s'opposait la pratique et la conception mme d'une mthode physique
et exprimentale, parce qu'elle donnait l'esprit une explication complte et dfinitive, au-del de laquelle il n'y a plus rien chercher. Comment concevoir que l'on
ignore encore ce que l'on comprend ? Comment se douter qu'un phnomne naturel
est encore connatre, quand on le dduit des principes gnraux qui l'expliquent, lui
et un grand nombre d'autres ?
A cette priode, que toutes les sciences de la nature ont d traverser (les mathmatiques peut-tre exceptes), le savant ne s'aperoit pas que l'intelligibilit dont il se
satisfait est plus apparente que relle. Elle est obtenue, en gnral, au moyen de
principes et de postulats trs simples, mais arbitraires, et dont il n'a qu'obscurment
conscience. On peut dire, en modifiant quelque peu une formule qui vient d'Aristote
lui-mme : Quidquid intelligitur, intelligitur secundum formam intelligentis. Chez lui,
la nature est conue, sous plusieurs rapports, comme une activit interne qui travaille
la faon d'un artiste. Elle ne fait rien en vain. Mais o se trouve le principe de la
distinction entre ce qui est ou n'est pas vain ? videmment dans le jugement de
l'homme, qui dcide de mme de ce qui est bon ou mauvais, utile ou nuisible, beau ou
laid. La reprsentation de la nature reste, pour le physicien, anthropomorphique, esthtique, et, en un certain sens, morale et religieuse. En mme temps, la complexit
des problmes rels demeure inaperue, cause de la simplicit des quelques principes qui suffisent rendre compte de tous les faits connus. Souvent l'intelligibilit
ainsi obtenue dispense le savant, en toute bonne foi, d'une vrification qui parat
superflue. Si Dmocrite avait raison, dit Aristote propos de la pesanteur, tous les
corps tomberaient dans le vide avec la mme vitesse. Or, cette consquence est absurde. - Absurde, en effet, dans la conception aristotlicienne. Mais elle n'en est pas
moins vraie. Tels sont encore les raisonnements par lesquels Aristote prouve que la
forme du ciel doit tre circulaire, et, en gnral, que la disposition des corps clestes
ne pouvait tre autre qu'elle n'est. M. Zeller remarque que ces questions tiennent fort
cur Aristote, et qu'il ne les aborde qu'avec une sorte de respect religieux .
En outre, la physique des Anciens, trs diffrente en ce point encore de celle des
Modernes, s'attaque d'abord des problmes trs gnraux, pour en tirer par voie de
consquence la solution des questions plus particulires que pose l'exprience. C'est
la suite naturelle de son effort vers l'intelligibilit de la ralit considre dans son
ensemble. Si le mouvement, la gnration, l'volution des tres en gnral lui sont
devenus intelligibles, tel ou tel mouvement, la gnration et l'volution de tel ou tel
tre ne prsentent plus de grandes difficults. On en tient pour ainsi dire l'explication
d'avance. Il ne reste qu' la vrifier ; et, si les principes sont assez gnraux et abstraits, la vrification russit immanquablement. Une fois les grands problmes initiaux rsolus, le progrs positif, dans une science de la nature ainsi conue, ne peut
plus tre qu'accidentel ou insignifiant. En fait, tant que cette conception a domin, le
principal effort des physiciens a t d'lucider et de commenter les principes transmis
par Aristote et par ses successeurs. Non sans raison, d'ailleurs, puisque l'essentiel de
la physique tait l. Il est peu quitable d'attribuer ce fait exclusivement au got de
ces physiciens pour la mthode d'autorit ; c'tait conforme de tout point l'esprit de
leur science.
1
ARISTOTE, Mtaphysique, XII, 4, 1070a 31. [en grec dans le texte].
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
88
La science moderne de la nature suit une marche inverse. Elle ne se pose que des
problmes dont les termes sont fournis par l'exprience, parce qu'elle veut connatre
des lois relles. Elle sait qu'elle ne peut tudier et mesurer la fois que les fonctions
d'un trs petit nombre de variables. Sans doute, elle ne s'interdit pas, en principe,
l'usage de l'analogie. Elle se hasarde mme aux gnralisations parfois les plus hardies. Mais ni elle ne s'imagine rendre ainsi la nature plus intelligible, ni elle ne juge
jamais ses hypothses dfinitives : il lui suffit que ces hypothses soient fcondes
pendant quelque temps, c'est--dire la mettent sur la voie de nouveaux faits et de
nouvelles lois. Par cette mthode, la nature physique se trouve peu peu mieux
connue ; mais comme, en mme temps, la complexit des phnomnes apparat plus
clairement, nous devenons plus modestes en devenant moins ignorants. Nous sentons
ce qu'il y avait de naf et d'enfantin dans les prtentions antiques une science de la
nature qui en donnt mieux que la connaissance, c'est--dire l'intelligibilit, ou, pour
parler plus exactement, qui donnt la premire implique dans la seconde. Notre
pouvoir, a dit M. Berthelot, s'tend plus loin que notre savoir. Un savant de l'Antiquit, sans croire manquer de modestie, et dit certainement le contraire. Son pouvoir
tait fort peu de chose : son savoir lui reprsentait la nature entire comme intelligible. Il la sentait divine : il en admirait religieusement le plan et les desseins. Aux
yeux du savant moderne, la majest de la nature n'est pas moindre. Mais il s'abstient
de l'interprter au moyen de concepts anthropomorphiques, et, dans son effort scientifique, tout ce qui ne tend pas la connaissance des faits et des lois est soigneusement cart.
Or, sans supposer un paralllisme exact entre le dveloppement de la science de la
nature physique et celui de la science de la nature morale, ne semble-t-il pas que la
seconde prsente aujourd'hui un certain nombre des traits que l'on constate chez la
premire dans sa priode antique ? N'a-t-elle pas cherch jusqu' prsent plutt
comprendre qu' connatre ? Ne considre-t-elle pas comme suffisamment
connu ce qu'elle pense avoir compris ? Ne va-t-elle pas, elle aussi, des problmes les
plus gnraux aux questions plus particulires ? Ne reste-t-il rien de mystique ni de
religieux dans la faon dont son objet lui apparat ?
La psychologie, par exemple, n'est devenue que rcemment une science positive
et indpendante ; encore l'accord n'est-il pas unanime sur la dfinition qu'il faut en
donner. Selon beaucoup de philosophes contemporains, elle demeure insparable de
la mtaphysique, soit parce qu'elle est la seule route qui nous y introduise directement, soit parce que toute psychologie vritable est dj, en elle-mme, mtaphysique, la conscience profonde tant rvlatrice de l'tre. A cette conception restent
attachs tous ceux qui, sous le nom de spiritualistes et d'idalistes, s'expliquent le
monde et l'humanit au moyen d'un principe d'intelligibilit intelligent lui-mme.
L'esprit leur parat avoir une dignit, une valeur incommensurable avec quoi que ce
soit d'autre que l'univers puisse contenir : il est le principe d'o tout part et o tout
aboutit. Nous qui croyons l'esprit , disait encore rcemment un de ces jeunes
philosophes. C'est en effet une sorte de foi. Cette mtaphysique de l'esprit est
l'enveloppe actuelle de croyances qui se sont manifestes jadis sous la forme plus
concrte de religion. Elle affirme et elle s'efforce de prouver la prsence (d'ailleurs
inexplicable), dans le corps de l'homme vivant, d'un tre d'essence suprieure, incorruptible, immortel, qui n'est atteint qu'en apparence par les maladies et par la
dcadence de l'organisme, et qui continue d'exister quand le corps se dissout. Est deus
in nobis... C'est la faon la plus simple et la plus naturelle de rendre intelligibles
les fonctions psychiques. Sous des formes diverses, elle se retrouve peu prs partout
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
89
dans l'humanit, et, bien qu'affine par la rflexion des psychologues spiritualistes,
elle reste encore reconnaissable.
Connatre est autre chose. C'est la tche plus modeste, plus difficile aussi,
entreprise par les savants qui, renonant comprendre d'emble, procdent
l'gard des phnomnes psychiques comme le physicien fait pour ceux qu'il tudie : je
veux dire, les objectivent, toutes les fois qu'il est possible, par des artifices de
mthode ; en tudient les rapports et les variations concomitantes avec d'autres sries
de phnomnes naturels, plus faciles mesurer, et en particulier avec les phnomnes
physiologiques, o ils paraissent avoir leurs conditions immdiates. De mme, une
nouvelle rpartition des faits s'impose, au fur et mesure qu'ils sont mieux connus.
Les anciennes conceptions de la mmoire, de l'imagination, de l'attention, de la sensibilit, etc., paraissent destines disparatre. Ces termes, suffisamment dfinis pour
l'usage courant et pratique, ne le sont plus assez pour l'usage scientifique. Ils dsignent confusment une multiplicit trs complexe de phnomnes qu'une analyse plus
exacte commence distinguer et classer - avec combien de peine! - en les ramenant
leurs conditions spciales. Si l'ancienne psychologie se satisfaisait ce sujet de
spculations qui paraissent aujourd'hui presque purement verbales, c'est encore parce
que, derrire les fonctions psychiques, elle supposait plus ou moins ouvertement la
prsence d'un principe qui manifeste par elles son activit : l'imagination, c'est l'me
qui imagine, la mmoire, l'me qui se souvient, la douleur, l'me qui souffre, etc.
C'est ainsi que la biologie ses dbuts croyait rendre intelligibles les fonctions
physiologiques en les rapportant l'action d'un principe vital .
Enfin, la psychologie traditionnelle, tout en se rclamant de la mthode d'observation, avait une tendance constante rsoudre d'abord les problmes les plus
gnraux, pour en tirer ensuite par la voie abstraite du raisonnement la solution des
questions plus particulires. Ce trait se rencontre aussi bien chez les empiristes que
chez leurs adversaires. Les uns, sous l'impression des rsultats obtenus dans la
science du monde physique par la mthode combine de l'exprience et du calcul,
c'est--dire surtout sous l'impression des grandes dcouvertes de Newton en astronomie et en physique, ont cherch dans la loi de l'association des ides un pendant
la loi de la gravitation universelle, et ont construit l'difice assez artificiel de la psychologie associationniste. D'autres ont cru que l'essentiel serait fait, s'ils pouvaient
dterminer les facults auxquelles les diffrents phnomnes doivent tre rapports, et quel est le nombre minimum de facults irrductibles qu'il faut admettre.
Le contraste est frappant entre ces problmes d'une ampleur indfinie, sur lesquels
la simple rflexion arrive se satisfaire par ses propres moyens, et l'analyse
minutieuse des faits rels dans leur particularit, telle que la pratique aujourd'hui la
psychologie scientifique. A ce point de vue, les Philosophische Studien, la Zeitschrift
fr die Psychologie der Sinnen und der Sinnesorganen, la plupart des revues psychologiques anglaises et amricaines, l'Anne psychologique (pour ne citer que ces recueils), ne diffrent pas de ceux qui contiennent des travaux de chimie, de physique,
de biologie. La premire proccupation des savants y est de connatre exactement
certains faits, pour tcher d'en dcouvrir, s'il se peut, les relations constantes avec
d'autres faits. La pense de les traiter en masse, pour ainsi dire, par une habile
manipulation de concepts, ne leur vient mme plus l'esprit.
D'autre part, des ouvrages comme Le rameau d'or de M. Frazer, en runissant
certains produits de l'imagination collective, recueillis dans toutes les rgions de la
terre, et en montrant la faon dont ces produits ont d peu peu se modifier (magie
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
90
sympathique, prires, mythes), nous font entrevoir une tude du mcanisme des
reprsentations collectives qui serait scientifique, et dont le progrs est li celui de
l'ethnographie.
Ainsi, l'unit de la psychologie traditionnelle tait factice. Sous l'action de l'esprit
scientifique, appliqu connatre et non plus comprendre , cette unit a cd,
et s'est fragmente. La spculation sur l'me a disparu. Ce qui se rapporte la
thorie de la connaissance a fait retour la logique. Au reste, pour ce qui est des
fonctions mentales suprieures, la dmarcation n'est pas encore tablie d'une faon
dfinitive entre ce qui relve exclusivement de la psychologie, et ce qui intresse en
mme temps la sociologie (langage, intelligence, sentiments altruistes, activit collective). A cette nouvelle distribution de l'objet de la psychologie correspond une nouvelle faon de le traiter : les sciences qui l'tudient s'loignent des caractres de la
physique ancienne pour se rapprocher de ceux que prsentent les sciences modernes
de la nature.
Une volution du mme genre s'annonce pour ce qu'on appelle les sciences
morales ; mais on commence peine en reconnatre la ncessit. La preuve en est
que la plupart des esprits cultivs prouvent encore une extrme difficult considrer l'ensemble de la ralit sociale comme une province de la nature. Il n'en est
gure, mme parmi les plus attentifs garder une attitude scrupuleusement scientifique, qui s'abstiennent toujours de mler la considration de ce qui devrait tre
l'tude objective de ce qui est. Bien peu sont rests tout fait fidles, dans tous les
cas, la distinction de la thorie et de la pratique, qui est une condition pralable de la
recherche scientifique. Tous ceux qui ont insist sur les difficults particulires la
science sociale, depuis Auguste Comte jusqu' M. Spencer et M. Durkheim, ont
signal, comme une des principales, la proccupation invitable des problmes moraux et sociaux actuellement urgents.
En outre, except M. Durkheim et son cole, les sociologues contemporains, comparables en ce point aux physiologues d'avant Socrate, portent moins leurs efforts sur
la connaissance prcise de certains faits et de certaines lois, que sur l'intelligibilit du
vaste ensemble qui s'offre leur tude. Ainsi procde, par exemple, M. Tarde. Et
cette intelligibilit leur semble pouvoir tre saisie sans trop de peine. Sans doute, ils
n'ont pas toujours recours un principe unique auquel ils se flatteraient de ramener
tous les faits, comme les physiologues grecs croyaient retrouver sous tous les phnomnes de la nature une mme essence primitive. Mais tout ce qui est de nature morale
ou sociale leur parat s'expliquer , se comprendre trs suffisamment par le
moyen d'une interprtation psychologique qui ne prsente pas de difficult insurmontable : la nature humaine ne nous est-elle pas connue ? Il n'est pas de murs, de
croyances, de rites religieux, de systme familial et judiciaire dont ces sociologues
n'arrivent rendre compte aisment ; et leurs dmonstrations, si ce mot peut tre
employ, ont la mme sorte de vraisemblance que celles de la physique ancienne.
La tentation est forte de procder comme ils font. Car les phnomnes sociaux de
tout ordre - religieux, juridiques, conomiques, et autres -, ne nous sont fournis que
par des tmoignages oraux ou crits, des textes, des monuments de diverses sortes,
des signes enfin qu'il faut interprter. Nous le faisons en y rtablissant, par la pense,
l'tat de conscience qui les a produits originairement. Quand nous lisons un psaume,
quand nous restituons une inscription, quand nous dchiffrons un acte judiciaire
gyptien ou assyrien, la matrialit objective du document qui nous a t conserv
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
91
nous ajoutons le sens qu'il a eu pour son auteur. S'agit-il d'un fait conomique, d'une
vente par exemple, nous imaginons, bien que d'une manire abrge et purement
schmatique, les motifs qui font agir les personnes intresses. Ainsi, tandis que les
autres phnomnes naturels se prtent d'autant mieux devenir objet de science
positive qu'ils sont mieux objectivs, il semble que beaucoup de faits sociaux nous
soient donns d'abord objectivement, et que pour les connatre nous devions en quelque faon les subjectiver, en y restituant des tats de conscience. Autant dire que les
connatre, c'est en mme temps les comprendre : car que comprenons-nous mieux que
les faits qui se passent en nous, puisque la conscience les saisit au moment o ils se
produisent, et que leur essence mme, selon les philosophes, consiste tre perus ?
Cette conception de la sociologie reste beaucoup plus voisine des anciennes
sciences morales que des sciences positives de la nature. Trait caractristique : la
comptence, dans une science physique ou naturelle quelconque, ne s'acquiert point
aujourd'hui dans de longues tudes spciales, conduites suivant une mthode dont on
ne peut s'carter. Personne ne s'improvise physicien, chimiste ou physiologiste : le
gnie le mieux dou a besoin d'un apprentissage. Personne surtout ne prtend trancher
d'emble les questions sur lesquelles les savants sont partags. Mais on s'improvise
encore sociologue, et l'on peut faire couter du publie, mme instruit, les solutions
plus ou moins ingnieuses que l'on apporte sur les principaux problmes actuellement
soumis la discussion. Des tudes spciales pralables ne paraissent pas tre
indispensables. Le simple bon sens, la pntration psychologique, la finesse morale,
la souplesse dialectique, avec de l'imagination et quelque lecture, peuvent suffire.
Pourquoi ? Parce que, les faits sociaux se traduisant toujours en termes de conscience,
on admet implicitement que nous en avons l'intelligence immdiate.
Il y a l, selon l'expression de Kant, une niche de sophismes. D'abord, les phnomnes de notre propre conscience sont loin d'tre transparents pour nous. Ils sont
immdiatement donns, sans doute, mais par masses, et vus sous l'angle le plus
favorable la pratique. Ils ne sont pour cela ni compris, ni mme connus, du moins si
l'on parle d'une connaissance qui ait une valeur objective, c'est--dire qui lie les phnomnes entre eux et aux autres phnomnes de la nature. Ensuite, quand nous
restituons l'tat de conscience qui est un lment indispensable du phnomne social,
nous y introduisons presque toujours une erreur ; car nous y restituons, non pas l'tat
de conscience qui fut vraiment celui des acteurs ou des contemporains, mais un autre
tat qui nous est propre, avec les nuances, associations, sentiments, qui nous appartiennent nous et notre temps. Au lieu donc de nous imaginer que nous avons sans
peine l'intelligence complte des faits sociaux, il convient de nous montrer trs
circonspects dans l'interprtation de ces faits, surtout quand il s'agit de croyances, de
sentiments, de pratiques, de rites fort loigns de nous. La mthode scientifique
prescrit d'en chercher le sens dans une tude objective de leurs circonstances et de
leurs conditions. Ce sera un progrs semblable celui qui a t ralis en linguistique,
par exemple lorsque, au lieu de deviner les tymologies sur la ressemblance apparente
des mots, on s'est avis de les tudier mthodiquement d'aprs les lois de la drivation, ce qui a fait reconnatre que, dans cette science, comme dans beaucoup d'autres,
le vraisemblable n'tait pas souvent le vrai 1.
Voyez sur ce point, et sur tout le chapitre en gnral, mile DURKHEIM, Les Rgles de la
mthode sociologique, 2e d., particulirement l'introduction et les chapitres I, II, III et V, Paris, F.
Alcan, 1901.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
92
Enfin, et surtout, quand mme nous obtiendrions, en nous fondant sur l'analogie
de notre propre conscience, une restitution fidle des phnomnes moraux, considrs
subjectivement, il resterait encore acqurir la connaissance des lois auxquelles sont
soumis ces phnomnes, considrs du point de vue objectif ou sociologique. Ces lois
ne se rvlent qu' une analyse galement objective, et, dans certains cas, des statistiques rigoureuses et bien tablies sont indispensables. Non seulement la conscience ne
nous donne pas la formule de ces lois, mais elle ne nous avertit mme pas de leur
existence. La science sociale a prcisment pour objet de les rechercher.
Ici encore, le progrs consistera substituer la rflexion philosophique qui cherche comprendre l'effort mthodique qui cherche connatre . La science
nouvelle se rendra compte de l'immense tendue inexplore de son domaine. Elle
prouvera, son tour, qu'une ralit peut tre la fois familire et profondment ignore. Tous les hommes parlent, et combien se doutent des problmes que leur langue
pose au philologue, au logicien, au sociologue ? Tous, nous accomplissons chaque
instant des mouvements, dont nous ne saurions dire comment nous les produisons : il
y a bien peu de temps que la mcanique et l'anatomie savent les expliquer. De mme,
nous vivons dans la ralit sociale, nous en sommes pntrs, envelopps de toutes
parts, et nous contribuons mme la produire : elle nous est pourtant aussi inconnue,
au sens scientifique du mot, que la myologie et la thorie des leviers sont ignores du
fort de la halle. Nos droits, nos devoirs, nos croyances, nos murs, nos relations de
famille et de classe, les institutions de notre socit, tout cela nous parat trs ais
comprendre, parce que nous avons l'habitude de ragir immdiatement d'une certaine
faon un stimulus social donn. Mais s'agit-il d'en rendre compte, la sociologie
scientifique, qui seule le pourrait, n'est gure encore en tat de le faire, et d'ailleurs
peu d'esprits auront l'ide d'y recourir. L'habitude subsiste, pour la plupart, de faire
appel des principes suprieurs l'exprience , c'est--dire une mtamorale, o
se projette, sous le nom d'idal, le respect de la pratique universellement accepte de
notre temps.
Les sociologues, mme positifs, n'chappent pas toujours l'illusion de croire que
ce qui leur est familier n'a pas besoin d'tre analys scientifiquement. Auguste Comte,
par exemple, considrait la famille comme l'unit sociale primitive, indcomposable,
comme l'lment au-del duquel la sociologie ne doit pas remonter. Il prenait pour
vident par soi qu'il n'y a pas de socit humaine possible sans la famille. Mais on sait
aujourd'hui qu'il existe des organisations sociales, fort complexes, dont la famille
n'est pas l'lment premier. La gense et l'volution de la famille dans les socits
humaines sont un problme de sociologie positive, que l'on commence seulement
bien poser et tudier. La solution en clairerait sans doute, sur certains points, la
notion actuelle de la famille europenne, notion dont la rflexion abstraite ne nous
indiquera jamais la gense relle.
Une fois bien comprise l'extrme complexit des relations entre les faits sociaux complexit comparable celle des phnomnes de la nature organique -, la sociologie, mesurant ce qu'il faut d'efforts, de patience et d'ingniosit mthodique pour lucider un seul problme particulier, aura perdu le got de la spculation abstraite et
gnrale. Elle abandonnera les vastes questions, analogues celles o la physique
ancienne s'est complu, qui prtent des raisonnements ingnieux et des variations
brillantes, mais qui n'ajoutent rien notre savoir. Comte pensait qu'en sociologie la
dcouverte des lois plus particulires est subordonne la possession des lois les plus
gnrales, et il s'est efforc, en consquence, de dterminer d'abord la loi universelle
qui domine toute la dynamique sociale, pour descendre de l aux autres lois. Mais
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
93
cette conception prouve seulement que la sociologie de Comte tait encore une philosophie de l'histoire. La science sociale, aujourd'hui, veut tre exactement positive.
Vritable physique, elle tend se fractionner, comme l'autre physique, son ane, en
une multiplicit de sciences, distinctes et connexes, ayant chacune ses instruments de
travail spciaux et ses procds de mthode particuliers. Comme elle encore, elle se
dfie des grandes hypothses qui expliquent tout et ne rendent compte de rien : telle,
par exemple, l'hypothse de la socitorganisme (Lilienfeld, Schffle) ou de la lutte
des races (Gumplovicz), etc. C'est dj un progrs que de ne plus perdre son temps
dvelopper des conceptions de ce genre, et de le donner tout entier des recherches
plus modestes, limites des objets plus restreints, mais dont les rsultats nous
apprennent quelque chose, et s'additionnent au lieu de se combattre.
IV
Rle considrable des mathmatiques dans le dveloppement des sciences de la
nature. - Jusqu' quel point les sciences historiques peuvent jouer un rle
analogue dans le dveloppement des sciences de la ralit sociale.
Retour la table des matires
Il reste, dans le dveloppement de la science de la nature physique , un trait
d'une importance capitale, dont nous n'avons pas encore parl, et qui jetterait peuttre quelque lumire sur la marche future de la science de la nature sociale . Dans
le dmembrement de la physique antique, d'o sont sorties, par voie de diffrenciation
progressive, les diffrentes sciences de la nature inorganique ou vivante, la priode de
progrs dcisif n'a commenc qu'au moment o une science, plus gnrale et plus
avance que les autres, est devenue pour elles la fois un modle et un organon. Un
modle, en tant qu'elle prsentait le type mme de la connaissance scientifique rigoureuse, purge de tout lment tranger (mtaphysique ou pratique) ; un organon, en
ce sens que cette science constituait, selon l'expression d'un philosophe, l'arsenal le
plus riche et le plus complet de tous les artifices de raisonnement dont l'homme puisse s'armer pour la conqute des lois naturelles. Ce fut l le rle des mathmatiques.
Elles jouissent du privilge singulier d'tre cultives pour elles-mmes en tant que
science, et de servir en mme temps d'instrument trs puissant pour les progrs des
sciences plus complexes qui les suivent (astronomie, physique et chimie) ; la faiblesse
de notre entendement et la complexit des problmes ne nous permettant pas, actuellement, de porter plus loin l'application de l'analyse mathmatique. Peut-tre la
science de la nature morale ne devait-elle entrer, elle aussi, dans sa priode de
progrs dcisif et rapide, que lorsqu'elle en aurait trouv l'instrument dans une science
plus avance qu'elle-mme ?
Cette science, videmment, ne saurait plus tre les mathmatiques. Sans doute,
elles pourront servir la reprsentation de certaines lois. L'essai en a t fait, le plus
souvent sans succs, en psychologie, et, avec plus de bonheur, semble-t-il, en conomie politique. Mais, d'une faon gnrale, si les mathmatiques ne peuvent gure
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
94
rendre de services la biologie, parce que les phnomnes vitaux sont trop complexes
et instables, a fortiori n'auront-elles pas d'emploi dans les sciences sociales, o les
phnomnes, sans tre moins complexes ni moins instables, ne peuvent plus, en outre,
tre rapports des forces physiques et chimiques exactement mesurables.
Toutefois, si la ralit qui est l'objet de cette physique morale ne s'objective
pas dans l'espace, comme l'autre, elle s'objective d'une faon qui lui est propre, dans
le temps. Elle devient objet, pour la conscience de l'homme d'aujourd'hui, en s'imposant lui sous forme de faits que cette conscience n'a pas produits et qu'elle ne peut
changer. L'ensemble de ces faits, soit contemporains, soit passs, constitue proprement une nature , mais une nature telle que la connaissance scientifique des faits
contemporains ne serait pas possible sans celle des faits antrieurs. L'tat actuel d'un
groupe social quelconque dpend de la faon la plus troite de son tat immdiatement prcdent, et ainsi de suite. En un mot, ce qui est possible dans l'tude de la
nature physique ne l'est plus dans l'tude de la nature sociale ; les lois statiques (except peut-tre dans quelques cas trs rares, par exemple dans l'conomie
politique abstraite) ne peuvent pas tre recherches part, en faisant abstraction,
mme titre provisoire, des lois dynamiques. Il y a donc des sciences qui doivent
jouer, dans la physique morale un rle indispensable, analogue (je ne dis pas tout
fait semblable) celui des sciences mathmatiques dans la physique proprement
dite. Ce sont les sciences historiques. Car, entre les sciences qui ont pour objet la
nature morale , elles sont la fois les plus avances, et un auxiliaire indispensable
pour les autres. Si l'on entend, comme il convient, par sciences historiques, non pas
seulement l'histoire politique, diplomatique et militaire des nations, mais aussi
l'histoire des langues, des arts, de la technologie, des religions, du droit, des murs,
de la civilisation, et, en un mot, des institutions, ces sciences sont, d'une part, les plus
anciennes et les plus riches en rsultats de celles qui tudient la nature sociale , et,
d'autre part, sans elles, l'effort pour tablir des lois sociologiques resterait vain. La
mthode comparative, indispensable pour parvenir de telles lois, ne devient applicable que grce aux rsultats des sciences historiques.
Sans doute, il ne faudrait pas assimiler de trop prs le rle des sciences historiques
dans la physique morale celui des mathmatiques dans la physique proprement dite.
Les mathmatiques fournissent des dmonstrations, et permettent de mettre en quations les problmes de la physique ; tandis que l'histoire, quel qu'en soit l'objet particulier, ne fait jamais connatre que des faits et des sries de faits, et laisse une
science diffrente le soin d'noncer et de dmontrer les lois. L'histoire ne saurait donc
tre un organon pour cette science, au sens o les mathmatiques en sont un. La nature particulire des services rendus a sa raison dans la nature particulire des phnomnes tudis, qui se prte la mesure exacte, lorsqu'il s'agit de la nature physique, et
s'y refuse quand il s'agit de la nature morale. Mais cette diffrence, et les consquences trs importantes qui en dcoulent, n'effacent pas l'analogie que nous avons
signale. Sans les sciences mathmatiques, point de science de la nature physique ;
sans les sciences historiques, point de science de la nature morale .
La fonction essentielle, et, si l'on peut dire, pralable, des sciences historiques
dans l'tude du monde moral n'a t nettement aperue que depuis un sicle
environ. Auparavant, on attribuait plutt ce rle soit la morale, soit la psychologie.
Le seul nom de sciences morales , que l'on appliquait toutes les sciences ayant
pour objet soit l'individu, soit l'homme en socit, est dj caractristique. Ce nom
correspondait bien au caractre mixte de ces sciences telles qu'on les concevait alors,
occupes la fois la connaissance de ce qui est et la dtermination de ce qui doit
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
95
tre. Cette seconde partie de leur tche n'tait pas la plus malaise ; elle ne demandait
qu'un effort de dialectique dductive, puisque les principes gnraux de ce qui doit
tre taient fournis, avec leur dmonstration, par la science suprieure et centrale de
la morale thorique. De l, les systmes de droit naturel, qui tablissaient gravement
ce que doivent tre la socit, l'tat, la famille, la proprit, et les rapports que doivent
soutenir entre elles ces hautes abstractions. Ce fut la priode pr-scientifique, ou,
selon l'expression propose plus haut, mtamorale, de cette spculation.
Quant la psychologie, elle aurait peut-tre rempli le rle inaugural qu'on lui a
attribu quelquefois dans la science de la nature morale, si elle tait en effet plus
avance que cette science, si elle tait depuis longtemps matresse de sa mthode, et
riche en rsultats acquis. Mais elle en est peu prs au mme point de son dveloppement que les autres parties de la physique morale . En outre, difficult plus grave,
elle ne dpend gure moins, pour son progrs ultrieur, du progrs de ces parties,
qu'elles ne dpendent du sien. Car la connaissance scientifique des fonctions mentales
suprieures, nous l'avons vu, ne saurait tre obtenue par une mthode dialectique ou
de simple rflexion, et sans le secours des sciences sociologiques. Comment donner la
psychologie pour base des sciences dont la psychologie elle-mme a besoin, ou,
pour mieux dire, qui sont une des sources de la psychologie mme ?
Reste donc que la condition pralable et ncessaire du progrs de la physique
morale soit l'exploration mthodique, par l'histoire, des faits sociaux du pass, et, en
mme temps, l'observation des socits existantes qui reprsentent peut-tre des
stades plus anciens de notre propre volution, et sont ainsi, au regard de nous, comme
du pass vivant. Si nous avions une connaissance approfondie de l'histoire de la vie
religieuse dans les diverses socits humaines, de l'histoire compare du droit, des
murs, des arts et des littratures, de la technologie, en un mot des institutions, nous
serions infiniment plus prs que nous ne le sommes de la science proprement dite de
la ralit sociale. Nous prendrions sans peine, en prsence de cette ralit, l'attitude
mentale qui nous cote toujours un effort, et sans laquelle cependant cette science
n'est pas possible ; nous saurions ne considrer que les rapports objectifs des faits
entre eux, et nous abstenir de les interprter subjectivement. A ce point de vue, les
sciences historiques sont bien une introduction, une propdeutique, et en un certain
sens un modle. Elles enseignent regarder la ralit sociale d'un oeil dsintress, et
sans autre but que de connatre ce qui est ou a t. Elles sont aujourd'hui aussi exemptes de mtamorale que les mathmatiques le sont depuis long temps de mtaphysique.
Philosophie de l'histoire, conception hglienne du progrs, action plus ou moins
apparente d'une Providence directrice des vnements, tous ces lments transcendants ont peu peu disparu ; seul est demeur l'effort mthodique et critique vers la
connaissance des faits, et, s'il est possible, de leurs liaisons. De mme donc que les
mathmatiques sont l'cole indispensable du physicien, qui pourtant use de la mthode d'observation, mthode sans emploi pour le gomtre, les sciences historiques sont
l'cole non moins indispensable du sociologue, encore que sa mthode comparative et
son effort systmatique pour tablir des lois soient trangers l'historien.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
96
CHAPITRE V
RPONSE A QUELQUES
OBJECTIONS
I
Comment rester sans rgles d'action, en attendant que la science soit faite ? Rponse : la conception mme de la science des MOEURS suppose des rgles
prexistantes.
Retour la table des matires
Si l'on entend les rapports de la thorie et de la pratique, en morale, tels qu'ils ont
t tablis dans les chapitres prcdents, une difficult grave semble s'lever. La
pratique rationnelle dpend de l'tat d'avancement des sciences sociales. Ces sciences,
de l'aveu des juges mme les plus indulgents, sont encore rudimentaires. Jusqu' ce
que la nature sociale nous soit aussi bien connue que la nature physique ,
jusqu' ce que nous puissions nous fonder, pour agir, sur la science positive de ses
lois, des sicles s'couleront peut-tre, dont nous ne prvoyons pas le nombre. En
attendant, il faut agir. La vie sociale nous pose chaque instant des problmes pratiques qu'il faut rsoudre. Refuser de rpondre, dans la plupart des cas, c'est encore
une faon de rpondre. L'abstention entrane la mme responsabilit que l'action.
Comment concilier la rserve que notre ignorance actuelle nous imposerait, avec la
ncessit immdiate o nous sommes de prendre un parti ? Est-il possible que nous
restions, mme provisoirement, sans rgles directrices de conduite ?
Cette hypothse, que l'on hsite mettre en discussion, n'a pourtant rien d'absurde
en soi. On la repousse d'instinct, car la conscience semble attester que tous, savants et
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
97
ignorants, nous trouvons dans les impratifs du devoir une direction suffisante. Et, en
outre, par une sorte d'optimisme spontan, nous ne concevons pas que quelque chose
puisse la fois nous tre indispensable et nous faire dfaut. Cependant il arrive - et
force nous est de le reconnatre - que nous soyons hors d'tat, pour longtemps peuttre, de donner une solution rationnelle des problmes fort importants pour nous.
Tmoin les maladies, si nombreuses encore, o le mdecin, sachant son* impuissance, s'abstient d'intervenir, except pour soulager les souffrances du patient qu'il ne
peut pas gurir. L'homme-mdecine des sauvages, et mme le mdecin d'il y a quelques sicles, ne doutaient jamais de l'efficacit de leurs remdes. Le progrs du savoir
a rendu les ntres plus rservs et plus circonspects. Ne peut-il en tre de mme en
matire morale et sociale ? Avant la recherche scientifique des lois, toute question
pratique se rapportant la morale parait avoir une solution immdiate, dfinitive, et le
plus souvent obligatoire. Avec le progrs de la science, une priode commence o les
plus clairs ne feront pas difficult d'avouer que la solution rationnelle d'un grand
nombre de problmes leur chappe. Tel, est dj l'tat d'esprit de plus d'un savant en
prsence de beaucoup de problmes sociaux proprement dits.
Mais comment suspendre ainsi son jugement, lorsqu'il s'agit, non plus de problmes gnraux, dont on admet bien que la solution dpend du savoir, mais de rsolutions que la vie nous oblige de prendre sur l'heure, nous mettant en demeure, par
exemple, de rpondre par oui ou par non une question urgente ? On conoit le
silence de la science ; on ne conoit pas le silence, mme provisoire, de la morale.
Cette difficult n'est pas aussi inextricable qu'elle le semble d'abord, et qu'elle le
serait en effet, s'il fallait accepter les termes o elle est pose. Elle provient, pour une
grande part, d'une confusion d'ides. Nous avons vu 1 que le mot morale est pris
par l'usage courant en des sens trs distincts. Tantt il dsigne la ralit morale
existante, c'est--dire l'ensemble des devoirs, droits, sentiments, croyances, qui constituent un moment donn le contenu de la conscience morale commune ; tantt on
appelle de ce nom la pratique morale, en tant qu'art rationnel fond sur la science et
intervenant dans les phnomnes moraux ou sociaux pour les modifier. Or, l'aveu de
notre ignorance peut bien, dans un trs grand nombre de cas, suspendre cette intervention ; mais, que nous l'ignorions ou non, la ralit sociale a son existence propre,
objective, et demeure ce qu'elle est. Notre science et notre ignorance ne sont, son
gard, que des dnominations extrinsques , exactement comme l'gard de la
nature physique , dont les lois, quand elles sont ignores de nous, ne se font pas
moins sentir que lorsqu'elles nous sont connues.
Bref, la morale - si l'on entend par l l'ensemble des devoirs qui s'imposent la
conscience - ne dpend nullement, pour exister, de principes spculatifs qui la fonderaient, ni de la science que nous pouvons avoir de cet ensemble. Elle existe vi
propria, titre de ralit sociale, et elle s'impose au sujet individuel avec la mme
objectivit que le reste du rel. Les philosophes se sont imagin parfois que c'taient
eux qui fondaient la morale : pure illusion, inoffensive d'ailleurs, et dont il leur a fallu
revenir. Hegel, au commencement de sa Doctrine du droit, raille les thoriciens de
l'tat qui se donnent pour tche de construire l'tat tel qu'il doit tre. Il leur explique
que l'tat existe, que c'est une ralit donne, et qu'ils auront dj fort faire pour le
comprendre tel qu'il est. Il leur propose l'exemple du physicien, qui n'a jamais eu
l'ide de rechercher quelles devraient tre les lois de la nature, mais qui se demande
tout uniment quelles elles sont. Cette rflexion ne s'applique pas moins bien la
1
Voyez plus haut, chap. IV, Il.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
98
morale. On ne fait pas la morale d'un peuple ou d'une civilisation, pour cette
raison qu'elle est dj toute faite. Elle n'a pas attendu, pour exister, que des
philosophes l'eussent construite ou dduite. Mais, de mme que les lois, une fois
dcouvertes, nous procurent le moyen d'intervenir rationnellement, et coup sr, dans
les sries de phnomnes physiques, en vue de certaines fins que nous dsirons
atteindre ; de mme, la connaissance des lois sociologiques nous conduirait un art
moral rationnel, qui nous permettrait d'amliorer, jusqu' un certain point, la ralit
sociale o nous vivons.
La clbre formule cartsienne, qui assimile la morale la mcanique et la
mdecine, implique que toutes trois sont conues comme des arts rationnels, se proposant, sous la direction de la science, de modifier une ralit donne. En ce qui
concerne la mcanique et la mdecine, aucune confusion n'est craindre, ni de mots,
ni d'ides. Il est trop clair que la ralit o elles interviennent a son existence propre,
et qu'elle fait l'objet d'un vaste ensemble de sciences (mathmatiques, physique,
chimie et biologie). Mais, si la morale correspond exactement, comme art rationnel,
la mcanique et la mdecine, il faut avouer qu'elle opre, elle aussi, sur une ralit
donne, qui ne dpend point d'elle pour exister.
Si donc l'art moral rationnel doit reconnatre que, dans un grand nombre de cas, il
est aujourd'hui hors d'tat de rsoudre les problmes qui se prsentent, c'est--dire de
savoir comment et par quels moyens modifier la ralit donne, mme quand nous
aurions un intrt pressant le faire, cet aveu n'a rien de particulirement alarmant. il
ne signifie pas que nous nous trouvions sans morale, au sens courant du mot, c'est-dire sans rgles de conduite, sans direction, incapables d'agir et comme paralyss. Au
contraire, en l'absence de cet art rationnel, les rgles d'action traditionnelles psent de
toutes leurs forces sur les consciences, et si elles n'obtiennent pas d'tre obies, c'est
pour des raisons o notre ignorance n'a point de part.
Donc, que cet art soit peine naissant, qu'il soit encore trs loin de soutenir la
comparaison avec les arts triomphants qui mettent notre service une partie des
forces de la nature physique, ce n'est pas la rvlation d'une impuissance dont nous
serions frapps tout coup ; c'est la consquence naturelle de ce fait que la science
des murs en est encore la priode de formation. Je verrais plutt l, au contraire,
l'annonce et la promesse d'une puissance nouvelle pour l'homme. Ce qui est nouveau,
ce n'est pas que nous soyons incapables de modifier rationnellement la ralit morale;
c'est que nous concevions un moyen positif d'y parvenir plus tard, par des applications d'une sociologie scientifique. Jusqu' prsent, cette ralit s'est simplement
impose aux consciences individuelles. Les rformateurs utopistes l'ont fait entrer
docilement dans leurs systmes abstraits de politique ; les constructeurs de morales
thoriques ont rationalis la pratique universellement accepte de leur temps, dans
leur pays. Il appartient aux sociologues d'entreprendre l'tude scientifique, purement
objective, de cette ralit donne.
Pourquoi notre conscience loue-t-elle une action, et blme-t-elle une autre ? Presque toujours pour des raisons que nous sommes incapables de donner, ou pour
d'autres raisons que celles que nous donnons ; l'tude compare des religions, des
croyances et des murs en diffrents temps et en diffrents pays pouvant seule en
rendre compte. Un philosophe ingnieux saura toujours, il est vrai, dduire les devoirs
d'un principe fondamental, avec une ncessit apparente. Mais ncessit et dduction
ne vaudront pour nous que si notre conscience est semblable celle du philosophe, et
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs.
99
si elle a les mmes exigences. Autrement, la ncessit s'vanouit, et la dduction nous
parat artificielle.
M. Simmel, qui n'est pourtant pas dupe de beaucoup de prjugs, nous fournit de
ce fait un exemple assez piquant 1. Au cours de ses rflexions, trs intressantes, sur
l'honneur , il entreprend de dmontrer que le duel entre personnes du mme rang,
pour venger certaines offenses, est une ncessit invitable. La preuve en est faite
avec une belle rigueur dialectique. M. Simmel ne s'est pas dit que, s'il tait sociologue
anglais au lieu d'tre sociologue allemand, sa dmonstration lui paratrait lui-mme
sophistique, ou superflue, ou enfin qu'il n'aurait jamais eu l'ide de la construire, ni
prouv le besoin de l'crire, attendu qu'elle ne rpond rien dans une conscience
anglaise actuelle. Pour le sociologue tranger, la dmonstration de M. Simmel ne
prouve qu'une chose : qu'il persiste en Allemagne, dans une certaine partie de la population, une coutume comparable la vendetta, mais rgularise sous l'influence de
l'esprit militaire. La persistance de cette coutume, chez un peuple d'ailleurs trs civilis, s'explique par une conception de l'honneur spciale une caste peu prs ferme,
qui garde jalousement ses traditions ; la survivance de cette caste ayant elle-mme
telles causes historiques, conomiques et politiques. Supposez que ces causes se
fassent sentir galement par toute l'Europe : la coutume dont il s'agit prendra l'aspect
d'une exigence universelle de la conscience. Trs vraisemblablement, le philosophe
moraliste la formulera en une rgle obligatoire de conduite. Sa morale paratrait
immorale s'il condamnait cette coutume, ou s'il la passait seulement sous silence ; et il
deviendrait subversif de ne pas trouver probante la dmonstration de M. Simmel.
II
N'est-ce pas dtruire la conscience morale que de la prsenter comme une ralit relative ? - Rponse : ce n'est pas parce que nous le connaissons comme absolu que le devoir nous apparat comme impratif ; c'est parce qu'il nous apparat
comme impratif que nous le croyons absolu. - Si les philosophes ne font pas la
morale, ils ne la dfont pas non plus. - Force du misonisme moral. - L'autorit
d'une rgle morale est toujours assure, tant que cette rgle existe rellement.
Retour la table des matires
Soit, pourra-t-on dire ; ignor, mconnu, ou avou par les philosophes, le fait est
constant : ce n'est pas eux qui tablissent les rgles de la conduite. Ils les codifient
tout au plus, et les rationalisent. Ces rgles font partie d'une nature sociale , qui
peut tre regarde comme une ralit objective. Jusqu' prsent, dans chaque socit
humaine, elle a volu selon ses lois propres. Les morales thoriques pourraient
donc laisser la place la recherche sociologique, seule base solide pour un art moral
rationnel : la crainte de voir disparatre en mme temps la morale (entendue au sens
de contenu de la conscience morale, devoirs, sentiments de mrite et de dmrite)
G. SIMMEL, Einleitung in die Moralwissenschaft, I, pp. 193-195.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 100
serait tout fait chimrique. Ce contenu demeurerait prcisment le mme, et nous
vivrions sur la mme morale.
Peut-tre ; mais voici une nouvelle objection. La morale conserverait-elle son
autorit ? L'homme est peu enclin naturellement se faire violence. Sa tendance est
de suivre toujours, quand il le peut, la ligne de moindre effort, c'est--dire la pente de
ses dsirs et de ses passions. Il arrive que ses impulsions sensibles conspirent avec
l'ordre de la conscience. Mais le cas contraire est le plus frquent, et de beaucoup. En
fait, la tentation d'agir contre la rgle morale est presque continuelle. Si l'homme n'y
succombe pas le plus souvent, c'est qu'il est arrt par tout un systme de freins,
moraux et sociaux, dont un des plus efficaces est la sublimit et saintet inviolable du
devoir. Convaincu que ce qu'il va faire est mal, mal par essence, mal en soi ,
indpendamment des consquences, mal en un sens mystique et religieux, l'homme
est plus capable de s'en abstenir que si cette croyance lui manque. S'il apprend qu'elle
est sans fondement rationnel, que la rpulsion ou la condamnation provoque par
certains actes s'explique par des raisons historiques et psychologiques, en un mot que
sa morale est relative, n'enlevez-vous pas celle-ci son prestige, et en mme temps
son pouvoir ? Relative, elle n'est plus infaillible ; elle est comme un juge dont les
arrts peuvent tre ports en appel, et casss. Celui qui continuera nanmoins s'y
soumettre aura le sentiment qu'il est un peu dupe, selon le mot de Renan. Quand la
spculation sur la morale la traite comme une province de la nature , qui volue
selon des lois, elle tend l'affaiblir d'abord, puis mme la dtruire. Dire que la
morale est relative quivaut, en un certain sens, dire qu'il n'y a pas de morale. Ou
l'impratif de la conscience est absolu, ou il n'est pas impratif du tout. Cette spculation se condamne elle-mme par l : car peut-on concevoir une socit humaine
sans morale ?
- L'argument ne manque pas de faire impression. L'intrt de conservation sociale
qui il fait appel est si puissant que la plupart des esprits tiendront ce raisonnement
pour dcisif. Il ne l'est pourtant pas ; mme, parler rigoureusement, ce n'est pas un
argument. On se borne invoquer, contre une certaine mthode de recherche en
matire morale, les consquences funestes que l'emploi de cette mthode entranerait
au point de vue de la pratique. Mais cette faon de critiquer une mthode spculative
n'a pas d'efficacit durable. Elle n'quivaut pas une rfutation directe. Elle ne
dispense pas de montrer que la mthode ainsi combattue est impropre l'ordre de
recherches dont il s'agit, que par suite elle ne peut pas conduire la dcouverte de la
vrit, et que les rsultats obtenus par elle jusqu' prsent sont faux. Combien de nos
sciences en seraient encore leurs premiers pas, s'il leur avait fallu tenir compte
d'objections de ce genre! Il n'est gure de mthode scientifique qui n'ait t considre, pendant un certain temps, comme dangereuse pour l'ordre public, ou, ce qui
tait plus grave encore, comme irrligieuse et impie. Le premier qui s'avisa de dire
que la Lune tait une grosse pierre, et qui proposa de l'tudier comme un corps
minral, faillit payer cette tmrit de sa vie. Tmrit encore, de mettre la nature la
question par des expriences ; tmrit plus grande, de dissquer des cadavres humains ; audace impardonnable, d'appliquer la critique verbale et historique aux textes
sacrs de la Bible et de l'vangile. Faut-il s'tonner si une protestation plus violente
encore se manifeste quand la mthode scientifique fait mine de s'introduire dans les
choses de la morale, et le les traiter avec la mme objectivit impassible que le 'este
de la nature ?
En second lieu, l'objection consiste revendiquer pour a devoir un caractre
intangible et sacr. Sorte de rvlation naturelle (rationnelle, dit Kant), il exige un
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 101
respect absolu, et il se trouve plac, par sa nature mme, au-dessus de toute investigation anthropologique et historique. - Sans doute, c'est bien ainsi que le devoir se
prsente la conscience individuelle, et Kant l'a dcrit avec une parfaite exactitude.
Mais on peut accepter sa description sans se ranger son interprtation. Il n'est pas
impossible de rendre compte des caractres avec lesquels le devoir se prsente la
conscience de l'individu, sans admettre tout l'appareil de la Mtaphysique des murs
et de la Critique de la raison pratique, l'impratif catgorique, la loi s'imposant par sa
forme seule et non par sa matire, l'autonomie de la volont, la causalit par la libert,
le caractre intelligible, le rgne des fins, les postulats de la Raison pratique, etc. Les
morales empiriques et utilitaires croient pouvoir le faire, et, en gnral, toutes les
morales non intuitives, qui tendent de plus en plus vers une forme scientifique, tandis
que les morales intuitives, comme celle mme de Kant, retourneraient de prfrence
une forme religieuse.
Enfin, l'argument implique un postulat qui n'est point vident, ni prouv. Il prend
pour accord que si les ordres de la conscience apparaissent l'homme comme impratifs, c'est parce qu'il les conoit comme absolus. Le mystre sublime de leur origine
obtiendrait de lui une obissance qu'il ne leur accorderait pas autrement. Le devoir lui
ferait comprendre, ou du moins sentir, sa participation une ralit morale, distincte
de la nature o il poursuit son intrt et son bonheur en tant qu'tre sensible : de l,
l'impossibilit pour lui de se soustraire au devoir, qui n'a point de commune mesure
avec ses autres motifs d'action, quels qu'ils soient. Il s'impose, parce qu'il est d'un
autre ordre. - Mais peut-tre, au contraire, ne concevons-nous le devoir comme absolu
que parce qu'il se prsente comme impratif. C'tait la faon la plus naturelle de nous
expliquer nous-mmes ses caractres. De mme que, dans la philosophie spculative des Anciens, les concepts gnraux, les espces et les genres, hypostasis par le
langage, sont devenus les ides , et que ces ides, formant un monde intelligible,
ont alors paru expliquer les objets et les tres donns dans l'exprience ; de mme,
dans la spculation morale des Modernes, la prsence, dans les consciences individuelles, d'impratifs qui se prsentent comme absolus et universels, a produit presque
ncessairement la croyance une origine supra-sensible, pour ne pas dire divine, du
devoir : et cette origine a servi, son tour, expliquer la prsence de ces impratifs dans la conscience. Comme il arrive souvent en mtaphysique, un nonc abstrait
du problme a paru en tre la solution.
Si, au lieu de spculer dialectiquement sur les concepts de devoir, de loi morale,
de bien naturel et de bien moral, d'autonomie de la volont, nous considrons les
actions que les hommes, en fait, croient de leur devoir d'accomplir ou d'viter, et si
nous employons les procds de la mthode comparative, indispensable quand il
s'agit de faits sociaux, la conclusion suivante tend s'imposer : ce qui est aujourd'hui
command ou interdit par la morale au nom du devoir, l'a souvent t dans une
priode antrieure, un autre titre - tantt en vertu de croyances qui se sont effaces,
tandis que les pratiques issues de ces croyances se conservaient, tantt en vue de
l'intrt du groupe. Cette dernire explication, que l'on croyait vraie dans tous les cas,
au XVIIIe sicle, l'est seulement dans quelques-uns. Tout ce qui a t dfendu comme
entranant une souillure (tabou) peut demeurer moralement mauvais, aprs avoir t
interdit religieusement. Si nous avions pour la mise mort des animaux la mme
horreur que pour le meurtre d'un homme, nous prouverions, comme lHindou, autant
de remords d'avoir mang ou simplement touch une nourriture animale, que nous en
ressentirions d'avoir tremp dans un assassinat. Chez tous les peuples, tous les
degrs de la civilisation, nous trouvons de mme des obligations et des interdictions
que l'individu ne viole pas sans les plus cruels remords, parfois mortels.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 102
Mais alors l'objection tombe. Si ce n'est pas d'une conviction thorique ou d'un
systme d'ides que la prescription morale tient son autorit, celle-ci pourra subsister,
par sa force propre, au moins fort longtemps, quelles que soient les mthodes
employes par la science pour tudier les morales ; - de mme que la science des reliions, jusqu' prsent, ne semble pas avoir amen de changement marqu dans l'tat
des croyances religieuses. Le caractre impratif de la morale aujourd'hui pratique,
ne venant pas de la rflexion, n'est gure affaibli non plus par elle. Bref, si les
philosophes ne font pas la morale, les savants ne la dfont pas non plus, et pour les
mmes raisons. Ils sont ici en prsence d'une ralit vraiment objective, bien qu'elle
ne soit pas donne dans l'espace comme la ralit physique. Toute la fonction des
savants, fort importante encore que modeste, est de l'tudier pour la connatre, et de la
connatre pour la modifier, plus tard, rationnellement, dans la mesure o il sera
possible.
Le danger, dont on tait si mu, est donc tout imaginaire.
Les choses qu'il faut faire ou ne pas faire, nos rapports avec nos parents, avec nos
compatriotes, avec les trangers, nos devoirs et nos droits dans les questions de
proprit, de moralit sexuelle, etc., ne dpendent pas de la thorie morale laquelle
la rflexion peut nous conduire. Nos obligations sont dtermines l'avance, et imposes chacun par la pression sociale. On peut, dans un cas donn, y rsister, et agir
autrement qu'elle ne l'exige ; on ne peut pas l'ignorer, et l'on ne peut d'aucune faon
s'y soustraire. Sans parler des sanctions positives qui punissent les crimes et les dlits
dfinis dans la loi pnale, elle se traduit par ce que M. Durkheim appelle trs justement les sanctions diffuses, et par le blme de notre propre conscience ; et nous
n'avons d'autre moyen d'chapper ce blme que par un endurcissement moral, qui
nous parat une dchance pire que le reste. Rien de plus exigeant que le conformisme
de la conscience morale moyenne. Tout ce qu'elle ne couvre pas d'une autorisation
soit formelle, soit tacite (car trs souvent elle tolre en fait ce qu'elle semble interdire
en principe), elle le condamne avec une rigueur qui impose en gnral l'obissance, et
qui assure le respect au moins extrieur de la rgle. Celle-ci passe d'une gnration
l'autre, jalousement conserve par l'esprit de tradition et par l'instinct de conservation
sociale.
En effet, une des principales conditions d'existence d'une socit parat tre une
similitude morale suffisante entre ses membres. Il est ncessaire que tous prouvent la
mme rpulsion pour certains actes, la mme rvrence pour certains autres et pour
certaines ides, et qu'ils sentent la mme obligation d'agir d'une certaine manire dans
des circonstances dtermines. C'est l une des significations essentielles de la maxime : idem velle et idem nolle. La conscience morale commune est le foyer o les
consciences individuelles s'allument. Elle les entretient, et elle est en mme temps
entretenue par elles. Toutes ragissent donc ensemble contre ce qui menace d'affaiblir
cette conscience commune et compromet ainsi l'existence de la socit. L'nergie de
la raction tait extrme, au temps o les rgles de la conduite n'taient point spares
des croyances religieuses, et o toute transgression, toute modification des faons
d'agir obligatoires attirait sur le groupe la colre et la vengeance des puissances invisibles. La faute, mme involontaire, d'un seul pouvait entraner la perte de tous.
Aujourd'hui, dans notre civilisation, la solidarit sociale n'est plus sentie ni comprise
de cette manire. Les actes de l'individu n'engagent, le plus souvent, que lui seul. Le
dlit ou le crime qu'il commet ne contamine pas ipso facto d'autres personnes : notre
ide de la responsabilit est tout autre. Mais, ds que la conscience morale commune
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 103
se sent blesse dans ses prescriptions essentielles, la raction sociale clate encore
trs violente. Qui cherche radapter l'ide de patrie, et la mettre en harmonie
avec la pense philosophique et sociologique d'aujourd'hui, risque d'tre considr
comme tratre et mauvais citoyen. Qui songe une modification (pourtant invitable)
du droit de proprit, passe pour spoliateur, et encourt le mpris des honntes gens
. De mme pour les questions de morale sexuelle, et pour bien d'autres que l'on
pourrait numrer.
Ainsi le misonisme moral est, encore aujourd'hui, un fait universel. Il n'est pas
besoin de recourir l'exemple de socits telles que la Chine, o les principes de la
morale sont fixs tout jamais par les textes classiques, en sorte que l'ide mme de
changement est rejete d'avance comme immorale, toute rforme ne pouvant consister
qu' revenir aux sources, Confucius et Mencius, lesquels ne sont eux-mmes que
les fidles interprtes des anctres. Dans les socits europennes, la tendance de la
conscience morale commune ne serait pas moins conservatrice. Mais les changements
qui s'oprent dans d'autres sries sociales, principalement dans les conditions conomiques et dans les sciences, ont un contrecoup invitable sur le droit, sur les croyances, et enfin sur les pratiques morales. Toutefois, pour ces socits mmes, les variations dans les ides et dans les croyances morales, au cours d'une gnration, sont
ncessairement peu considrables.
Comme la moralit est lie, pour la conscience de chacun, au sentiment vif
interne de la libert, on croit volontiers que l'initiative individuelle se manifeste
frquemment dans les choses morales. Ne dpend-il pas de moi, chaque instant, et
en mille manires, d'obir ou de ne pas obir la rgle ? - Certes, le choix vous appartient, mais non pas l'initiative. Une alternative est en votre pouvoir : restituer un
dpt, ou le garder; dire la vrit, ou mentir ; pratiquer un culte, ou vous en abstenir.
Mais sortir de l'alternative, c'est--dire, agir autrement ; concevoir et raliser un mode
d'action positif, et diffrent de celui qui est prescrit, cela ne dpend pas de vous, et, en
fait, cela n'arrive gure. Qu'un homme se conforme une rgle dtermine, ou qu'il la
viole, mais en prouvant les sentiments et en gardant les conceptions de ceux qui
l'observent, dans les deux cas sa conscience morale reste oriente de la mme manire. La matrialit de l'action diffre seule, et encore pourrait-on soutenir que c'est
toujours la mme action, mais affecte ici d'un signe positif, l d'un signe ngatif. En
gnral, l'ide d'une troisime direction n'est mme pas conue.
Quand, de loin en loin, une initiative morale apparat (Socrate, Jsus, les socialistes), elle est infailliblement dnonce et poursuivie comme subversive. Cela doit tre.
Elle constitue une menace de trouble pour la conscience commune actuelle, et, par
suite, pour tout le systme social en vigueur. Ce qui est une simple transgression s'adapte, d'une certaine faon, la rgle qui est viole, puisque cette violation est prvue
et punie par elle. Ce qui est autre met en danger l'existence mme de la rgle, et
provoque une rpression bien plus acharne.
Le cas d'ailleurs se prsente trs rarement. Le plus souvent, pour qu'une vritable
innovation morale apparaisse, il faut que la dcomposition du systme de droits et de
devoirs qui prvalait soit dj trs avance. Mais cette dcomposition ne se produit
jamais isolment. Elle implique tout un ensemble de transformations, et parfois de
rvolutions, politiques, conomiques, religieuses et intellectuelles. Et dans ce vaste
rseau d'actions et de ractions entremles, il est fort difficile de dire quel moment
prcis telle modification particulire s'est produite, et si elle est plutt cause, ou plutt
effet.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 104
Il n'est donc pas impossible de concevoir la conscience morale autrement que
comme une participation mystrieuse un absolu suprasensible. On peut en comprendre le contenu, un moment donn, comme un ensemble de faits sociaux, conditionns par les autres faits sociaux en mme temps qu'il agit sur eux son tour. tant
donn le pass d'une certaine population, sa religion, ses sciences et ses arts, ses
relations avec les populations voisines, son tat conomique gnral, sa morale est
dtermine par cet ensemble de faits dont elle est fonction. A un tat social entirement dfini correspond un systme (plus ou moins harmonique) de rgles morales
entirement dfinies, et un seul. C'est en ce sens que la morale grecque diffre de la
morale moderne, et la morale chinoise des morales europennes.
Comme il n'y a pas de civilisation tout fait immobile, la morale d'une socit
donne, un moment donn, peut tre considre comme destine voluer en fonction des autres sries sociales, et comme voluant mme toute poque, si peu que ce
soit. Elle est donc toujours provisoire. Mais elle n'est pas sentie comme telle. Au
contraire, elle s'impose avec un caractre absolu qui ne tolre ni la dsobissance, ni
l'indiffrence, ni mme la rflexion critique. Son autorit est donc toujours assure,
tant qu'elle est relle. Mais il se peut, en fait, que l'autorit de telle ou telle prescription dtermine faiblisse. Dans les socits volution rapide, telles que la ntre,
l'imminence de grands changements conomiques retentit par avance sur la morale.
Par exemple, la conscience contemporaine tend de plus en plus reconnatre que le
rgime actuel des droits relatifs la proprit est provisoire. Malgr les protestations
trs vives, et souvent trs sincres, des conomistes orthodoxes, la nature sociale de la
proprit, le caractre surann de nos lois relatives l'hritage, issues du droit romain,
deviennent de plus en plus vidents. Qu'est-ce dire, sinon que la transformation conomique de notre socit tend faire apparatre, en cette matire, un droit nouveau et
une nouvelle morale ? Les dfenseurs de l'ancien droit crient que la socit est perdue, et leur indignation est conforme tous les prcdents. Ils dnoncent, comme
responsables de l'invitable catastrophe, les doctrines sociales et morales qui s'cartent de la philosophie spiritualiste, et de la thorie traditionnelle du droit naturel. En
quoi ils se trompent : car ces doctrines tablissent la relativit de tous les droits, et
soumettent la critique sociologique toutes les rgles morales. Comment se fait-il
que, parmi ces droits, parmi ces rgles, un petit nombre seulement soient branles et
menacent ruine ? Pourquoi celles-l, et non d'autres ? N'est-ce pas parce qu'elles sont
dj affaiblies par ailleurs ?
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 105
III
Mais il y a pourtant des questions de conscience : au nom de quel principe les
rsoudre ? - Rponse : notre embarras est souvent la consquence invitable de
l'volution relativement rapide de notre socit, et du dveloppement de l'esprit
scientifique et critique. - Se dcider pour le parti qui, dans l'tat actuel de nos
connaissances, parat le plus raisonnable. - Se contenter de solutions approximatives et provisoires, dfaut d'autres.
Retour la table des matires
Admettons, dira-t-on peut-tre, que la conception d'une nature sociale , donne
objectivement comme la nature physique , ne dtruise pas, en fait, l'autorit des
rgles morales, et que, l o cette autorit chancelle, ce soit l'effet invitable d'un
ensemble de conditions sociales. Deux objections subsistent, qui rendent difficile
d'accepter cette conception. L'une est d'ordre pratique, l'autre d'ordre spculatif.
En premier lieu, peu importe, prtend-on, que la science ou, pour mieux dire, les
sciences de cette nature sociale en soient encore leur priode de formation, et
que l'art rationnel qui doit se fonder sur elles soit moins avanc encore. Les rgles
d'action sont ce qui nous manque le moins. La conscience nous enseigne imprieusement notre devoir, et la pression sociale nous fait sentir la ncessit de nous y
conformer. En attendant les modifications rationnelles de la pratique, qui ne pourront
se produire sans doute que dans un avenir loign, cette pratique existe, par sa force
propre, et s'impose par elle-mme. - Cette constatation n'est vraie qu'en gros, et il faudrait distinguer. Sans doute, il y a un trs grand nombre d'actions que la conscience
commande ou interdit sans hsiter. Si l'on ne considre que celles-l, ce qui a t dit
plus haut peut paratre satisfaisant. Mais il en est d'autres devant lesquelles la conscience est perplexe. Il y a des cas o, tout en sentant la pression sociale qui s'exerce
sur nous, nous sentons aussi une tendance et nous voyons des raisons qui nous
poussent y rsister ; d'autres tendances, d'autres raisons nous inclinent y obir. Qui
n'a connu de ces problmes de conscience o la vie entire est indirectement engage,
o toute notre activit future dpend de la solution que nous aurons prfre ? Ces
crises morales, que nulle conscience un peu avertie ne saurait viter, sont de tous les
temps, mais plus frquentes et plus graves peut-tre dans notre temps qu'en aucun
autre, cause des progrs de l'esprit critique appliqu aux questions morales et
sociales. Pour en sortir, quel secours m'apporte votre science rudimentaire et votre art
rationnel plus rudimentaire encore ? A quoi me sert d'esprer qu'un jour la pratique
actuelle sera modifie conformment aux rsultats de la science ? C'est aujourd'hui
qu'il me faut savoir si j'essaierai de la modifier ou non, dans la mesure de mes forces.
L'ancienne spculation morale pouvait avoir ses points faibles. Du moins
fournissait-elle une rponse gnrale aux questions de ce genre. Elle proposait l'acti-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 106
vit volontaire un idal de justice, ou d'intrt gnral, le plus grand bonheur du
plus grand nombre , d'aprs lequel on essayait de se diriger. Que cette rponse ne ft
pas toujours assez claire, que l'erreur se glisst trs souvent dans les applications du
principe, que cet idal pt s'interprter, dans la pratique, en des sens tout fait
diffrents, et tre invoqu par les conservateurs comme par les rvolutionnaires, il est
difficile de le nier. Mais une direction, mme insuffisante, ne vaut-elle pas mieux que
le manque de toute direction ? Nous voudrions tre justes, et savoir quel parti la justice nous commande de choisir dans les grands problmes sociaux de notre temps. Si
une ide, mme imparfaite, de la justice nous est prsente, comment ne nous y
attacherions-nous pas ? Nous ne l'abandonnerons, en tout cas, que pour une autre plus
exacte et plus vraie, c'est--dire plus belle, mais non pas pour en laisser la place vide
jusqu' ce que le progrs de la science nous permette d'en esprer une nouvelle.
- Le fait signal par cette objection est exact. Nous ne trouvons pas toujours notre
conduite toute trace, et la conscience de chacun, dans notre socit, rencontre tt ou
tard de trs graves questions qu'elle hsite trancher. Nous sommes si loin de
mconnatre ce fait que nous l'avons nous-mme invoqu et dcrit 1. Seulement, au
lieu de le considrer subjectivement, c'est--dire tel qu'il se manifeste dans la conscience individuelle, et color par les sentiments qu'il y veille, nous l'avons tudi tel
qu'il apparat objectivement. Nous avons montr que la morale volue ncessairement, par suite de sa solidarit avec les autres institutions sociales, et que cette
volution ne peut s'accomplir sans frottements et sans chocs, lesquels se traduisent,
dans le domaine des intrts, par des luttes, et, l'intrieur de la conscience, par des
conflits de devoirs parfois insolubles, au moins en apparence. On ne saurait donc
opposer la conception positive de la nature sociale un fait qu'elle reconnat
expressment, et dont elle rend compte par le moyen des lois gnrales de cette
nature.
Quant la difficult que nous prouvons rsoudre ces cas de conscience, et au
peu de secours que nous trouvons dans la science sociologique et dans ses applications, la question est plus complexe. L'embarras o nous nous trouvons parat tre
la consquence invitable du progrs de l'esprit critique, d'une part, qui s'attaque
mme aux rgles morales, et d'autre part, de l'acclration de l'volution sociale, qui
est un des phnomnes les plus marqus de notre civilisation. Cette volution implique ncessairement celle de la morale. L'volution de la morale, son tour, entrane
la dsutude de certaines rgles, l'apparition de nouvelles obligations, de nouveaux
droits, de nouveaux devoirs ; bref, elle tend branler la parfaite stabilit qui parat
tre le caractre essentiel des prescriptions morales, dans les socits mouvement
trs lent. Dans la socit fodale, ou dans la socit chinoise, la conduite est rgle,
en gnral, jusque dans ses plus petits dtails, par des prceptes que personne ne
songe mettre en discussion. Ce trait est particulirement marqu chez les Chinois,
o la ligne de dmarcation entre la morale et le crmonial, si nette chez les Europens, ne peut plus tre trace. Pour nous, au contraire, qui sommes accoutums aux
ides de progrs social et mme de rvolution, qui avons assist, dans les derniers
sicles, des changements sociaux et conomiques d'une importance capitale, qui
voyons aujourd'hui la science mettre en question les institutions fondamentales de
toute socit, lorsqu'elle en cherche la gense, et qu'elle en tudie les diffrents types
par la mthode comparative, comment n'tendrions-nous pas la relativit universelle
1
Voyez plus haut, chap. III, II.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 107
la morale ? Et comment cette attitude nouvelle ne nous mettrait-elle pas beaucoup
plus souvent dans l'embarras que ne faisait autrefois le conformisme indiscut de
toutes les consciences individuelles la conscience morale commune ?
A mesure que nous connaissons mieux notre ignorance de la ralit sociale, nous
nous trouvons plus hsitants, et parfois mme plus impuissants en prsence de
certains problmes. Cela est fcheux ; mais dpend-il de nous que cela ne soit pas ?
Qui nous garantit que nous ne nous apercevrons jamais d'une difficult de morale
pratique sans que la solution en soit notre porte ? Nous le supposons tacitement, et
nous ne souffrons gure que cette supposition soit dmentie par le fait. Rien pourtant,
a priori, ne nous autorise la prendre pour certaine. Nous ressemblons au commun
des malades, pour qui chaque maladie doit avoir son remde, qui y correspond : que
le mdecin lasse le diagnostic, qu'il prescrive le traitement, et la maladie va disparatre. En fait, les choses ne se passent pas avec cette heureuse simplicit : que d'affections dconcertent le clinicien, et dfient la thrapeutique actuelle ! De mme, plus
la recherche scientifique accrotra notre connaissance de la ralit sociale, et plus
notre pratique perdra de sa sret primitive, plus nombreux se dresseront devant notre
conscience les problmes dont nous n'aurons pas la solution. Bon gr mal gr, il faut
nous y attendre.
Est-ce dire qu'il faille nous y rsigner d'avance, et dfaut d'une solution rationnelle, immdiate, nous dsintresser des problmes, en attendant l'heure encore
lointaine o l'on pourra les aborder ? - Nullement. Il n'est pas question d'imiter les
sceptiques, et de suivre la coutume, en disant : Pourquoi pas ? Autant ceci que
cela. De toutes les attitudes imaginables, aucune ne convient moins des hommes
convaincus que le progrs est possible, en matire sociale, et que ce progrs dpend
de la science. La confiance en la raison ne peut s'accommoder d'une pratique purement routinire, ni surtout conseiller de s'en contenter toujours. Que prescrira-t-elle
donc dans les cas douteux ? - De se dcider pour le parti qui, dans l'tal actuel de nos
connaissances, parat le plus raisonnable. L'art rationnel moral est oblig de suivre
l'exemple de la mdecine. Que de fois le mdecin se trouve en face de difficults qu'il
ne sait pas rsoudre, soit cause de l'obscurit des symptmes, soit cause d'indications et de contre-indications qui se font mutuellement obstacle ! S'en tiendra-t-il
l'abstention pure et simple ? - Non, le plus souvent il agira, mais avec prcaution, en
tenant compte de tout ce qu'il sait et de tout ce qu'il prsume. A dfaut du traitement
rationnel que la science formulera un jour, il tentera du moins le traitement qui parat
aujourd'hui le plus raisonnable. C'est des solutions du mme genre que nous nous
rallierons pour bien des problmes qui se posent aujourd'hui devant la conscience
morale. Approximations plus ou moins lointaines, plus ou moins sres, il est vrai :
mais, except dans les sciences exactes et dans leurs applications, avons-nous le droit
d'en faire fi ? L'esprit de la science positive est aussi loign que possible de
l'exigence qui s'exprime par la formule : Tout ou rien. Il est accoutum, au contraire, aux progrs lents, aux solutions obtenues par tapes successives, aux rsultats
fragmentaires qui se compltent peu peu. Ni le relatif ni le provisoire ne lui
rpugnent : il sait qu'il n'atteint gure autre chose.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 108
IV
Qu'importe que l'autorit de la conscience morale subsiste en fait, si elle disparat en droit ? Que devient l'idal moral ? - Rponse : analyse du concept d'idal
moral. - Part de l'imagination, de la tradition et de l'observation de la ralit
prsente dans le contenu de ce concept. - Rle conservateur, au point social,
d'une certaine sorte d'idalisme moral. - La recherche scientifique, hritire
vritable de l'idalisme philosophique d'autrefois.
Retour la table des matires
Reste une dernire objection, plus ou moins directement implique, vrai dire,
par les prcdentes. Qu'importe que, dans la conception d'une nature sociale
analogue la nature physique , l'autorit des rgles morales subsiste en fait, si en
droit elle disparat ? Nous avouerons que notre conscience individuelle continue se
conformer la conscience morale commune de notre temps, et que la pression sociale
produit les mmes effets qu'auparavant. Mais nous saurons que nous y sommes
soumis, bon gr mal gr, presque comme la loi physique de la pesanteur. Qu'y a-t-il
de commun entre le fait de subir une ncessit naturelle qu'on ne peut viter, et le
dvouement d'une activit, matresse de soi, un idal de justice et de bont ? La
morale perd jusqu' son nom, si elle n'a pas sa ralit propre, si elle se confond avec
la nature .
Cette objection reparat constamment. Nous l'avons rencontre sous les formes les
plus diverses. Que le devoir se prsente la conscience avec un caractre sacr, qu'il
lui imprime un respect religieux, c'est un fait que personne ne conteste. Mais infrer
de l qu'en effet le devoir ne peut provenir que d'une origine supranaturelle, et que la
moralit nous introduit dans un monde suprieur la nature, c'est simplement transformer le fait lui-mme en explication. Il se peut que ces caractres du devoir et, en
gnral, de la conscience morale, soient l'effet d'un ensemble de conditions qui se
trouvent runies, peu prs semblables, dans toutes les socits humaines un peu
civilises. C'est l'hypothse que la science sociologique jug la plus conforme aux
faits. Il faut croire qu'elle n'a rien de particulirement choquant, puisque bien avant
qu'il ft question de sociologie, et ds l'Antiquit, elle tait soutenue par les philosophies empiristes et utilitaires.
Quant opposer la ralit donne un autre tat social, conu ou imagin par
nous, o la justice rgnerait seule, et que l'on nomme idal , c'est en effet de cette
faon que nous croyons le mieux sentir combien la moralit nous lve au-dessus de
la pure nature.
Mais, en fait, cet idal n'est autre chose que la projection - plus ou moins transfigure - de la ralit sociale de l'poque qui l'imagine, dans un pass lointain, ou dans
un avenir non moins lointain. Pour les Anciens, c'tait l'ge d'Or ; pour les Modernes,
c'est la cit de Dieu, ou le rgne de la justice. Chaque civilisation, chaque priode
dfinie de chaque civilisation, a son idal moral, qui la caractrise aussi bien que son
art, sa langue, son droit, ses institutions, et son idal religieux. Bref, cet idal fait
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 109
partie prcisment de cette ralit sociale laquelle on l'oppose : mais les lments
imaginatifs qui y entrent pour une grande part permettent de l'en distinguer, et de le
sparer du prsent pour se le reprsenter soit dans le pass, soit dans l'avenir.
Dans ce dernier cas, c'est la forme que prend l'ide de progrs social pour des esprits qui n'en ont pas encore une conception positive et scientifique. Supportant avec
impatience les maux et les iniquits de leur condition prsente, ils se font une image,
imprcise mais consolante, de la ralit qui sera plus tard : d'un monde o les hommes seraient justes et bons, o les gosmes se subordonneraient docilement au bien
gnral, o les institutions produiraient ce bien sans contrainte ni souffrance pour
personne. Mais, en remontant assez haut dans le pass de l'humanit, nous retrouverions des imaginations du mme genre au sujet du monde physique. Partout l'homme s'est plu opposer la nature relle, d'o proviennent pour lui tant de souffrances,
de douleurs et de terreurs, l'ide d'une nature bienveillante et douce, o il serait
garanti contre la faim, la soif, la maladie, les intempries :
vestem vapor, herba cubile
Praebebat...
Il reste toujours quelque chose de ce rve dans les descriptions de l'ge d'Or, comme dans celles des paradis. Elles peignent la race humaine non seulement plus innocente, mais aussi plus exempte de souffrance, et affranchie de la douleur comme du
pch.
Aujourd'hui, l'on a cess d'imaginer une nature physique autre que celle qui est
donne : on a entrepris la tche, plus modeste et plus hardie la fois, de conqurir la
nature relle, au moyen de la science et des applications qu'elle permet. De mme,
quand la notion de la nature morale sera devenue familire tous les esprits,
quand on ne s'en reprsentera plus les phnomnes sans concevoir en mme temps les
lois statiques et dynamiques qui les rgissent, on cessera d'opposer cette nature un
idal dont les traits les plus prcis sont emprunts d'elle. L'effort de l'esprit humain
se portera vers la connaissance des lois, condition ncessaire, sinon toujours
suffisante, de notre intervention raisonne dans les sries de phnomnes naturels. A
la conception imaginative d'un idal aura succd la conqute mthodique du rel.
Nous sommes ainsi ramens l'ide d'un art rationnel, fond sur la science de la
ralit sociale. Admettre que cette ralit a ses lois, analogues celles de la nature
physique, n'quivaut nullement la regarder comme soumise une sorte de fatum, et
dsesprer d'y apporter aucune amlioration. Au contraire, c'est l'existence mme
des lois qui, en rendant la science possible, rend aussi possible le progrs social
rflchi. Sur ce point encore, la comparaison de la nature sociale avec la nature
physique est instructive. Ni l'une ni l'autre, semble-t-il, n'a t faite et dispose en
vue du bien-tre de l'homme par une toute-puissance favorable. Mais l'une est peu
peu asservie par lui, et si les progrs futurs des sciences rpondent ceux des trois
derniers sicles, de grandes esprances sont permises. Pareillement, quand les sciences sociales auront fait des progrs comparables ceux des sciences physiques, on
peut penser que leurs applications seront aussi trs prcieuses.
A ce moment - malheureusement encore trs loign de nous, puisque les sciences
dont il est question en sont elles-mmes leurs premiers pas, et que nous ne nous
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 110
faisons mme pas une ide prcise de ce que pourront tre ces applications -, l'autorit
de telle ou telle pratique, de telle ou telle institution, de tel ou tel droit se trouvera
compromise, si cette pratique, cette institution, ce droit, sont incompatibles avec les
consquences de faits bien tablis. Nous voyons dj quelques exemples de ce
progrs dans l'abandon de pratiques considres autrefois comme excellentes, ou
mme comme indispensables, et qui sont contraires en fait - l'conomie politique l'a
dmontr -, la fin mme o elles tendaient (dfense d'exporter le bl et les mtaux
prcieux ; prolongation du travail dans les manufactures jusqu' seize et dix-huit
heures ; secret de la procdure criminelle, etc.). A mesure que la science avancera, les
occasions deviendront plus frquentes de substituer aux pratiques traditionnelles des
modes d'action plus rationnels, ou simplement de renoncer des interventions
diriges par des ides fausses, et qui produisent les rsultats les plus funestes. De
combien de mfaits irrparables la mdecine et la chirurgie ne se sont-elles pas
charges innocemment, dans leur priode pr-scientifique, qui n'est termine que
d'hier ! De mme, que d'efforts perdus, que d'activit dpense contresens, que de
souffrances et de dsespoirs causs aujourd'hui par nos arts sociaux, qui en sont
encore cette priode, par notre politique, par notre conomie politique, par notre
pdagogie, par notre morale ! Loin donc de nous alarmer, la constatation du fait que
notre morale tend perdre son caractre absolu et mystique, pour tre conue comme
relative et soumise la critique, devrait nous rjouir comme un grand et heureux
vnement. C'est le premier pas dans la voie de la science : voie longue et ardue, mais
seule libratrice.
Mais, dira-t-on peut-tre, en supposant que ces prvisions se vrifient un jour,
suffiront-elles satisfaire l'exigence de la conscience morale ? Le progrs de l' art
pratique rationnel lui tiendra-t-il lieu du bien o elle aspire ? Malgr tout, il semble
que la conception d'une nature sociale analogue la nature physique mutile
cruellement l'me humaine. Elle enlve l'homme ce qui en fait un tre part dans le
monde connu de nous, ce qui lui donne sa noblesse, sa grandeur, son minente
dignit: la facult de s'lever au-dessus de sa condition terrestre, de mourir pour une
ide, de s'oublier lui-mme dans la tendresse de la charit ou dans l'hrosme du
sacrifice. Vous faites voir que la science lui enseignera tirer le meilleur parti des
conditions sociales o il se trouve, comme il sait dj faire pour les conditions physiques : il vivra mieux, et plus heureux. C'est un rsultat qui ne sera pas ddaigner,
surtout si de nouvelles occasions de souffrir ne naissent pas quand de plus anciennes
dispararont. Mais ce rsultat pourra-t-il contenter le cur de l'homme, qui n'est
produit, dit Pascal, que pour l'infinit ? Ce ralisme terre terre peut-il occuper la
place de l'idalisme qui, sous forme religieuse ou philosophique, a nourri jusqu'
prsent la vie spirituelle de l'humanit, et qui a inspir tout ce qu'elle a produit de
grand, jusqu' cette science mme au nom de laquelle on prtend le bannir ?
Ces considrations sentimentales ont beaucoup de force. Mme, en tant que sentimentales, elles sont irrfutables. Les meilleurs arguments, couts de trs bonne foi,
ne les branleraient que pour un instant. En ces matires, une conviction bien
enracine et trs chre se rend rarement des raisons d'ordre logique. Mais elle cde
peu peu l'action des faits. Cette question : La noblesse de la vie humaine estelle compatible avec une conception positive de la nature sociale et morale ? ressemble fort une autre question que les sicles prcdents ont longtemps agite: Un
athe peut-il tre honnte homme ? Quelques philosophes soutenaient l'affirmative.
Mais, pour la grande majorit de leurs contemporains, le lien entre la foi religieuse et
la moralit tait si troit, et surtout un mme sentiment les fondait si intimement l'une
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 111
avec l'autre, que leur rponse ne pouvait tre que ngative. Bien mieux, ils regardaient
de mauvais oeil quiconque rpondait autrement, et se sentaient disposs le traiter de
malhonnte homme, mme s'il ne faisait point profession d'tre athe. Personne
aujourd'hui ne pose plus le problme. Personne ne conteste plus que le rapport entre
la foi aux dogmes religieux et la valeur morale d'un homme ne soit beaucoup moins
troit qu'on ne l'imaginait jadis. Ceux qui croient se bornent dire que les incroyants
honntes gens mriteraient d'avoir aussi la foi. D'o vient ce grand changement ? Il a
fallu se rendre l'vidence des faits, et cesser d'affirmer ce que des exemples
journaliers et clatants ont dmenti.
Pareillement, la question que soulve aujourd'hui la transformation des sciences
morales a peu de chances d'tre rsolue par un change d'arguments entre ceux qui
affirment que la noblesse de la vie humaine n'y survivra pas, et ceux qui le nient.
Seul, le temps montrera si des croyances et des sentiments universellement rpandus
n'ont pas prsent comme lis d'une faon indissoluble des lments en ralit trs
sparables.
Est-il certain, en outre, que cette doctrine soit incompatible avec tout idalisme,
rompe avec ce qu'il y a eu de plus grand et de plus beau dans le pass de l'humanit,
et exige ainsi un sacrifice auquel elle ne se rsignera jamais ? Idalisme est un
terme que les philosophes emploient en plusieurs sens. Ici, trs videmment, on veut
dsigner, non seulement l'acte de la raison humaine quand elle pense les ides comme
plus relles que les sensations et les lois comme plus relles que les faits, mais aussi
et surtout son mpris de l'intrt immdiat, sensible, particulier, en comparaison de
fins plus hautes, plus pures et toutes dsintresses.
Il faut alors ne pas tre dupe des mots, et prendre garde que les dfenseurs de
l'idalisme ne sont pas toujours des idalistes vritables - non plus que les dvots ne
sont toujours vraiment religieux, ni les patriotes ceux qui entendent le mieux ce
que l'on doit la patrie. Il peut arriver que les gardiens de l'idal ne soient en
ralit, selon l'expression d'Ibsen, que des soutiens de la socit . Un idal moral
dfini, qui occupe une place pour ainsi dire officielle dans le cadre gnral des ides
philosophiques d'une poque donne, est une pice de son systme mental et social.
Tout ce systme est intress sa conservation. De la sorte, par une vritable ironie
de l'histoire, l'idalisme le plus pur et le plus sublime, en apparence, peut se trouver
dfendu, au fond, par des intrts positifs et matriels, qui trouvent leur compte le
protger. Les vrais idalistes, ce mme moment, ne sont-ils pas ceux qui refusent de
professer des lvres, dans un intrt de conservation sociale, une foi qu'ils n'ont plus ?
La premire et la plus indispensable condition de l'attitude idaliste n'est-elle pas une
sincrit parfaite, et un respect absolu de la vrit, qui ne se distingue pas, au fond, du
respect de soi-mme et du respect de la raison humaine ? Si, par une compromission
tacite, on se rsout affirmer que l'on croit encore ce que l'on ne croit plus vraiment,
comment se refuser d'autres concessions du mme genre, quand des intrts non
moins pressants et non moins considrables les solliciteront ? Et l'on descend ainsi
peu peu jusqu' dfendre, pour des raisons intresses dont on a plus ou moins
conscience, un ensemble de vrits traditionnelles, dont on n'est pas bien sr qu'elles
soient vraies. Rien ne saurait tre plus oppos l'idalisme.
Rien n'y est plus conforme, au contraire, que la recherche proprement scientifique
du vrai, mme en matire morale ou sociale, sans arrire-pense concernant les consquences que les vrits dcouvertes pourront entraner. Sans parler du dvouement
l'humanit qui anime un effort dont le savant lui-mme ne verra peut-tre pas les
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 112
applications pratiques, la recherche scientifique attache tout entire la poursuite de
la vrit, et indiffrente au reste, est peut-tre la forme la plus parfaite du dsintressement. Au lieu que dfendre une doctrine idaliste parce qu'elle est idaliste, et parce
qu'il est bon de dfendre les doctrines idalistes, dans l'intrt suprieur de la morale
et de la socit, cette rsolution part d'un bon sentiment ; mais elle part aussi de
considrations utilitaires, qui sont peut-tre mal fondes - car qui sait si ces doctrines
seront toujours socialement avantageuses ? - et qui, coup sr, ne sont pas idalistes.
L'hritier des grands idalistes d'autrefois n'est pas celui qui s'obstine soutenir des
mtaphysiques ou des mtamorales dsormais insoutenables ; c'est le savant, qui
transporte l'tude de la ralit, soit physique, soit morale, l'enthousiasme de leur foi
rationaliste et leur soif de vrit.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 113
CHAPITRE VI
ANTCDENTS HISTORIQUES
DE LA SCIENCE DES MURS
I
tat prsent de la science des murs. - Principales influences qui tendent
maintenir les anciennes sciences morales : traditions religieuses ; prdominance de la culture littraire. -Les moralistes ; caractres gnraux de leurs
descriptions et de leurs analyses. - Plus prs de l'artiste que du savant, proccups de peindre ou de corriger, ils ont peu de got pour la recherche
spculative.
Retour la table des matires
Les rvolutions relatives la mthode, selon l'observation trs juste de Comte, ne
sont aperues, en gnral, que lorsqu'elles sont presque accomplies. Les dbuts en
sont insensibles. La grande majorit des esprits suit encore de prfrence les voies
traditionnelles, et surtout personne ne prvoit la porte qu'auront plus tard certains
procds que l'on commence employer : - pas mme ceux qui en ont pris l'initiative.
Quand la lutte se dclare entre les anciennes mthodes qui se sentent menaces, et les
nouvelles qui prtendent s'y substituer, l'issue n'est dj plus douteuse. Le combat
sera plus ou moins long ou acharn, mais le mme processus qui a rendu invitables
l'apparition et le progrs de la nouvelle mthode, plus adquate aux faits, plus positive, rend non moins inluctable la disparition de l'ancienne mthode, par dsutude . C'est l un des aspects de la dialectique naturelle qui se dveloppe dans l'histoire des sciences.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 114
Si la remarque de Comte s'appliquait la morale (en tant que science), nous
devrions nous trouver en prsence d'une transformation presque acheve. Car il y a
longtemps que le besoin d'un changement de mthode a t aperu, et mme que ce
changement a t dcrit. Sans remonter jusqu' Hobbes, qui a eu l'ide, trs nette dj,
d'une mthode de la science sociale analogue celle de la physique, et qui a fait une
tentative admirable pour la raliser, nous rencontrons au cours du XVIIIe sicle, et
surtout plus tard chez Saint-Simon et ses successeurs, la politique et la morale conues comme sciences d'observation. Auguste Comte fonde la sociologie. Enfin, les
dernires annes du XIXe sicle ont vu apparatre des travaux de sociologie positive,
qui permettent, semble-t-il, de penser que la rvolution est acheve, que le conflit des
mthodes a pris fin, et que seules, dsormais, compteront dans la science les
recherches conduites par la mthode proprement sociologique.
En fait, si ce rsultat est acquis, il n'est pas unanimement avou, et les choses ne
sont pas aussi avances qu'il le semble. Quand il s'agit de sciences telles que les
mathmatiques, l'volution de leur mthode suit une courbe relativement simple, et la
remarque de Comte se vrifie. Mais le cas de la morale et de la politique est tout
autre. A peine la distinction de la thorie et de la pratique commence-t-elle s'y
tablir d'une faon normale. Nous avons vu qu'elle rencontre une trs vive opposition.
De mme, une dfaveur particulire est reste longtemps attache aux doctrines que
nous avons cites tout l'heure. Hobbes, les encyclopdistes, Saint-Simon, Auguste
Comte, et jusqu' la sociologie scientifique d'aujourd'hui ont pti de l'alarme donne
aux conceptions et aux mthodes traditionnelles. L'histoire mme a souvent partag
cette prvention, et, par exemple, la philosophie sociale de Hobbes, pendant deux sicles, a t condamne sans tre examine. En un mot, des lments extra-scientifiques
interviennent ici, cause des consquences sociales que le changement de mthode
semble rendre imminentes. Dans la rsistance violente et opinitre qu'il rencontre,
nous reconnaissons la raction qui se produit aussitt que les murs, les croyances,
les traditions collectives d'une socit se croient menaces. Et cette rsistance doit
naturellement se traduire aussi dans le domaine des ides : c'est--dire que la conception positive d'une science de la ralit sociale, analogue la science de la ralit
physique, pourra tre longtemps encore conteste, quoique reconnue en principe.
Dans tout ce qui touche la pratique morale, on continue, non seulement agir, mais
penser, d'aprs les convictions traditionnelles, longtemps aprs que l'on croit les
avoir remplaces par de nouvelles ides.
C'est ce dont nous sommes tmoins aujourd'hui. L'ide d'une sociologie positive
est suffisamment lucide. Elle n'est pas reste l'tat de conception abstraite ; elle
est entre dans la priode de ralisation (sociologie conomique, religieuse, juridique,
morphologie sociale, etc.). Et cependant, cette ide est encore contrebalance aujourd'hui, dans un grand nombre d'esprits, mme d'esprits qui se croient trs libres, par
l'ancienne conception des sciences morales. Ainsi, bon nombre de philosophes, ou,
pour parler plus exactement, de professeurs de philosophie, se sentent attirs vers la
sociologie par un intrt fort vif et fort sincre, et en acceptent les positions essentielles ; mais ils n'en continuent pas moins enseigner la morale thorique d'aprs les
mthodes traditionnelles. Ils semblent n'y trouver aucun embarras, et ne pas s'apercevoir qu'il faudrait opter. Si cette confusion ne choque pas des esprits habitus
l'analyse des ides, et qui s'adonnent professionnellement la rflexion philosophique, plus forte raison persistera-t-elle, encore plus gnrale et plus difficile
dissiper, dans le public instruit, mais qui ne fait pas une tude particulire des choses
morales ou sociales. Pour ce public, mme s'il admet en principe la possibilit d'une
science objective et positive de la ralit sociale, cette science demeure une expres-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 115
sion presque purement verbale. Les travaux de sociologie proprement dite sont encore
trop rcents et trop peu connus. Les esprits ne sont pas accoutums cette science
nouvelle. Pour leur faire prendre l'attitude qu'elle demande, il aurait fallu l'action
constante d'influences nombreuses agissant dans le mme sens. Celle du progrs
gnral de l'esprit scientifique sera sans doute irrsistible, la longue. Mais elle est
lente, et elle n'agit d'abord que sur un petit nombre de personnes.
Que d'influences, au contraire, contribuent maintenir les esprits dans l'attitude
oppose ! Sans les numrer toutes, c'est de ce ct qu'agissent et la force des habitudes traditionnelles, si tenaces quand elles proviennent de trs loin dans le pass, et
tout le poids de l'ducation et de l'instruction distribues dans les coles. Laissons de
ct la reprsentation de la ralit morale qui est imprime par le catchisme dans
l'esprit des enfants en mme temps que le dogme religieux. Elle partage ordinairement la fortune de ce dogme ; elle est conserve ou rejete pour les mmes raisons
que lui. Toutefois, chez beaucoup de ceux qui, a un certain moment, cessent de croire,
il subsiste une rpugnance obscure et presque instinctive concevoir la nature
morale comme analogue la nature physique. Un sentiment mystique survit en
eux la croyance disparue, et il en protge le fantme. Mais c'est surtout la culture
littraire donne aux enfants, la lecture continuelle des potes, des historiens, des
orateurs, des prdicateurs qui les prpare aussi peu que possible se placer aisment
au point de vue de la sociologie. Cette ducation, dont ils gardent une empreinte
d'autant plus profonde que la valeur esthtique des crivains classiques est plus haute,
et qui porte le nom justifi d' humanits , implique une reprsentation de l'homme,
et en gnral de la ralit sociale, tout fait approprie la rflexion du moraliste (de
qui d'ailleurs elle vient), mais sans usage possible pour le savant. D'autre part,
rarement accoutums comprendre la mthode et la signification des sciences physiques et naturelles dont on leur a enseign les lments, la grande majorit des esprits
cultivs a contract des habitudes qui les empchent d'accepter l'ide d'une science
objective de la ralit sociale, et de se familiariser avec sa mthode. D'o l'embarras,
la rsistance, et parfois l'hostilit qu'elle rencontre. Elle dconcerte, elle choque mme
des esprits habitus de longue date recevoir des moralistes leur conception des
choses humaines.
Les moralistes procdent, comme on sait, par l'observation attentive d'eux-mmes
et d'autrui. Leur rflexion analyse le jeu des motifs et des mobiles de nos actions, plus
ou moins avous ou cachs, les sophismes et les ruses de l'amour-propre, les impulsions de l'instinct, les dguisements infiniment varis de l'hypocrisie individuelle et
sociale, l'influence de l'ge, du sexe, de la maladie sur les caractres et sur les faons
d'agir, la formation et la persistance des habitudes, la solidarit morale, les conflits
des gosmes, et gnralement le mcanisme des passions. Les moralistes ont pour
devise le vers clbre de Pope :
The proper study of mankind is man,
mais ils ont leur manire propre d'entendre cette tude. La philosophie spculative, qui prtend comme eux la connaissance de l'homme, ne croit pas pouvoir y
parvenir sans s'attaquer en mme temps aux plus hauts problmes (touchant le monde
et Dieu), dont la solution implique celle des questions considres. Les moralistes ne
sont pas proccups, au moins ce degr, du soin de rendre leur pense systmatique.
Ils sont peu curieux, pour la plupart, de logique ou de mtaphysique. Ce qui les
intresse directement, c'est l'homme vivant et agissant, dans ses rapports avec ceux
qui l'entourent et avec sa propre conscience, partag entre le devoir et l'intrt, pour-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 116
suivant le bonheur et jamais dcourag dans cette poursuite, commettant des fautes,
s'endurcissant ou se repentant, capable de bien et de mal selon son temprament, ses
habitudes et surtout selon les circonstances : tude qui exige sans doute l'esprit de
finesse, mais non pas ncessairement l'esprit de gomtrie.
Il y a, pour l'homme vivant en socit, un tel intrt possder une ide au moins
approximative de la vie morale des autres membres de son groupe, qu'en prenant le
mot de moralistes en un sens assez large, il n'est pas tmraire d'affirmer que les
poques les plus recules ont d en connatre. De mme que, si la mdecine est toute
rcente comme science, elle remonte la plus haute Antiquit comme pratique, de
mme, si la recherche scientifique concernant la ralit morale date d'hier, la rflexion
spontane a d s'y porter ds que l'initiative individuelle a eu quelque importance
dans la vie sociale. Les chefs de groupes, prtres, Anciens, rois, sorciers, ont d surtout ceux qui s'levaient au-dessus du commun -, observer l'effet produit sur leur
entourage par leur manire de parler et d'agir en des circonstances dtermines. Trs
incapables sans doute de donner une expression, mme rudimentaire, aux observations et aux rgles sur lesquelles ils se fondaient pour agir, ils n'en suivaient pas
moins une marche qui, partout o elle n'tait pas prescrite par la tradition, ne pouvait
avoir d'autre raison que ces observations et ces rgles.
Aujourd'hui encore, des phnomnes analogues se produisent tous les tages de
l'difice social. Depuis l'homme d'tat qui sait manier une assemble souveraine et en
incliner les dcisions dans le sens de ses propres desseins, jusqu'au politique de
village, qui gouverne officiellement ou secrtement les affaires de sa commune, ce
qui donne l'ascendant, ce n'est pas seulement la pntration de l'intelligence et l'nergie du caractre, qui se rencontrent chez d'autres au mme degr, ou mme un degr
suprieur. Ceux-l savent agir sur les hommes, et ils le savent parce qu'ils les connaissent. Non d'une science qui puisse s'exprimer et se transmettre par des propositions
expresses ; mais ils prvoient peu prs coup sr quelles consquences proches et
lointaines sortiront de telles paroles, de telle action, de telle drogation aux usages, et
ils se rglent sur cette prvision. Ce sont des moralistes d'instinct, affins par
l'exprience. Ce sont, si l'on aime mieux, des hommes qui ont un sens plus dlicat que
les autres de la logique des sentiments dont parle Comte, logique inexprimable
dans les termes analytiques de notre langage, toute-puissante chez les animaux, et
forte encore chez les hommes. Peut-tre s'est-il rencontr, dans les socits primitives,
des moralistes de gnie, dont nous ne pouvons mme plus concevoir le mrite et
l'originalit, prcisment parce que nous avons des choses morales la connaissance
explicite et analytique qui leur manquait ; - de mme qu'ayant l'usage de l'criture et
des livres, nous avons grand-peine comprendre ce que pouvait tre un esprit
suprieur dans les socits o la tradition orale existait seule. Hypothse oiseuse, dirat-on peut-tre, puisque ces moralistes primitifs, s'ils ont exist, n'ont rien laiss. Mais
leur activit sociale du moins a marqu sa trace, et nous ne pouvons savoir si elle ne
persiste pas, encore aujourd'hui, dans quelques-unes des traditions dont nous ne
connaissons point l'origine.
Si les moralistes de ces temps lointains ont d tre des hommes d'action, ceux des
poques civilises, et surtout ceux des priodes littraires, tiennent plutt de l'artiste.
La preuve en est superflue dans le pays de Montaigne, de Pascal, de La Rochefoucauld, de La Bruyre, de Bourdaloue, de Vauvenargues, et de tant d'autres. La mme
conclusion sortirait de l'histoire des littratures anciennes et modernes. La connaissance de l'homme que nous devons ces moralistes est toujours d'autant plus
pntrante, instructive, originale, que leur talent d'crivains a t plus grand. Ce n'est
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 117
point un hasard si ceux qui sont mdiocres au point de vue littraire le sont aussi en
tant que moralistes, et si les plus grands artistes sont en mme temps les plus
profonds. De vrai, comme les peintres nous apprennent peu peu voir, et nous
rendent sensibles des valeurs , des oppositions de couleurs et des jeux de
lumire qu'un oeil sans ducation ne remarque pas ; de mme, les moralistes nous
enseignent saisir en nous-mmes et chez les autres les nuances subtiles des sentiments et des passions. Nous ne les verrions pas, s'ils ne nous les dcrivaient, ou nous
n'en aurions qu'un sentiment confus. Mais, quand ils nous ont montr ce qu'ils voient,
nous ne pouvons plus ne pas le voir avec eux. Ce ne sont proprement ni des anatomistes, car si loin que pntre leur analyse, ils n'ont leur disposition ni scalpel, ni
microscope, et ils ne peuvent aller au-del de l'observation descriptive ; - ni des
peintres, car ils ne crent pas, et leur oeuvre garde toujours un caractre gnral et
abstrait. Mais, tout prendre, ils sont plus prs de l'artiste que du savant.
Comme la psychologie introspective, avec qui elle a les plus troites affinits
(tout psychologue n'est pas moraliste, mais tout moraliste du moins est psychologue),
la connaissance de l'homme obtenue par le moraliste vaut uniquement par la
pntration, par la finesse d'analyse, par le talent spcial d'observation de ceux qui la
pratiquent. Or rien n'assure que le temps prsent ou les sicles venir produiront des
moralistes mieux dous cet gard que ceux du pass. Rien n'assure que l'ensemble
des conditions les plus favorables ce genre trs particulier d'observation ne se soit
pas rencontr dans une priode antrieure, et que la limite de ce qui peut tre obtenu
par ce moyen n'ait pas t atteinte. En un mot, le progrs, si manifeste dans les
sciences, parat ici extrmement douteux. De bons esprits pensent que les moralistes
anciens ont t au moins les gaux des modernes, et qu'on fera difficilement mieux
qu'eux. Sans rouvrir la querelle des Anciens et des Modernes, avouons qu'il sera
malais de surpasser, l'avenir, les uns et les autres. Les oeuvres morales sont un
genre peu prs disparu, de notre temps du moins, Le thtre de murs et le roman
en ont pris la place.
Le moraliste se proposait la connaissance de l'homme en gnral : en ralit, il
tudiait presque exclusivement l'homme de son temps et de son pays. Sans doute, il
distingue autant qu'il peut ce qui est accidentel et local de ce qui est profond et universel. S'il s'agit de passions comme l'amour, la jalousie, la peur, la tendresse maternelle, son analyse fixe des traits qui se retrouvent semblables en tout pays. Ce sont
alors des sortes de schmes gnraux. Ds que l'observation devient prcise et minutieuse, elle reproduit invitablement l'homme qui appartient une certaine civilisation, qui vit sous un certain climat, imbu de certaines croyances, respectueux de
certaines traditions, frapp, en un mot, l'empreinte de la socit dont il est membre.
Thucydide, Euripide, Platon, Aristote, picure et tant d'autres observateurs, si fins et
si perspicaces, n'ont presque rien su nous dire des barbares qui les entouraient, et avec
qui ils entretenaient des relations constantes. Mme l'intrieur de la cit grecque, ils
ont admirablement dcrit la mentalit et la moralit de l'homme libre ; ils nous ont
laiss bien peu de chose sur celle de la femme, marie ou non, et de l'esclave. Platon
nous initie la casuistique de l'amour entre hommes ; il parle peine de l'amour qui a
tant occup les moralistes modernes. Nous n'entendons pas sans surprise un personnage d'une tragdie grecque expliquer que la perte d'un mari n'est pas irrparable,
tandis qu'un frre mort ne se remplace pas. Le moraliste d'aujourd'hui reste embarrass devant ce raisonnement. Il faut que la sociologie vienne son secours, et lui
montre que ce trait d'apparence singulire se retrouve dans d'autres civilisations.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 118
En gnral, plus un moraliste a de vigueur et de talent, et plus est intime, dans sa
description de l'homme , le mlange, ou, pour mieux dire, la fusion des lments
particuliers et locaux avec les lments plus gnraux et mme universels. De mme,
dans un portrait de Rembrandt, nous sentons la fois, sans pouvoir rien sparer, ce
qu'il exprime de profondment humain et d'irrductiblement individuel. Quand le
moraliste appartient la socit o nous vivons, et qu'il y a pris les sujets de ses
observations, nous ne pensons pas faire cette distinction, parce que nous avons une
tendance naturelle croire que les traits qui nous caractrisent sont tous des traits
essentiellement humains. Mais, chez un moraliste tranger, nous distinguons fort
bien. Pascal et La Bruyre nous semblent presque purement humains ; nous ne remarquons pas quel point ils ont dcrit le Franais du XVIIe sicle, et mme du ntre. En
revanche, si nous lisons Confucius et Mencius, nous les trouvons secondairement
humains, et surtout chinois,
Enfin le moraliste, constamment et par-dessus tout, se proccupe de la pratique ;
et ce souci ne le spare pas moins du savant que de l'artiste. Sans doute, le savant n'est
pas indiffrent aux applications possibles de ses dcouvertes ; il arrive mme (surtout
dans certaines sciences, telles que la chimie), que le choix des problmes lui soit
indiqu par des besoins prsents de l'industrie. Nanmoins, les sciences de la nature
n'ont pu s'tablir et se dvelopper que grce la distinction soigneusement observe
entre le thoricien qui poursuit la connaissance des faits et des lois, et le praticien qui
fait usage de cette connaissance une fois acquise. Chez le moraliste, au contraire,
l'intrt spculatif ne se dtache pas de l'intrt pratique. Quelque plaisir qu'il trouve
analyser et peindre, s'il n'est pas un pur dilettante, il a toujours l'arrire-pense de
diriger ou de corriger. Amer ou indulgent, pitoyable ou satirique, selon la nature de
son esprit et de son talent, il oppose toujours, plus ou moins ouvertement, l'homme
tel qu'il est, l'homme tel qu'il devrait tre. Chez les prdicateurs, l'intention ne se
dissimule pas. Mais les autres moralistes, sous une forme plus voile, sont comme
eux des gens qui nous font de la morale.
Au nom de quel principe le font-ils ? D'o leur vient cet idal de l'homme tel qu'il
devrait tre, qui leur sert tantt humilier, tantt encourager l'homme qui ils
s'adressent ? Ils le trouvent tout form dans leur propre conscience, ou, pour mieux
dire, dans la conscience commune de leur temps. Comme cette conscience s'exprime
par des impratifs absolus, ils l'acceptent sans examen. Ils ne songent pas la critiquer, se demander si elle est parfaitement cohrente, ou si elle n'est pas, sous son
harmonie apparente, tiraille entre des tendances inconciliables. Ils ne s'inquitent pas
davantage de savoir si elle ne contient pas des lments d'ge diffrent, de provenance
diverse, et si ces lments sont plus ou moins bien fondus ensemble. En un mot,
l'idal moral de leur temps et de leur pays s'identifie pour eux avec l'idal moral en
soi., Par l, ils deviennent les porte-parole de la conscience morale de leur poque. Ils
en expriment les aspirations et les inquitudes, et c'est d'accord avec elle qu'ils distribuent le blme et l'loge. Fonction socialement utile, et mme, en certaines circonstances, tout fait indispensable ; mais fonction qui n'a rien de commun avec celle du
savant. Aussi le moraliste se fait-il couter tout de suite d'un public trs tendu. Il ne
rencontre gure la rsistance gnralement provoque par ce qui est nouveau. Violent
et paradoxal dans l'expression, il pique la curiosit, et se fait lire s'il a du talent.
Modr et ingnieux, il a de grandes chances de plaire tous ceux qui sont capables
du petit effort de rflexion ncessaire pour le suivre, et qui retrouvent chez lui leurs
ides directrices, leurs prconceptions et leurs croyances.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 119
Ainsi, chez les moralistes, la finesse la plus pntrante peut se trouver jointe une
indiffrence presque complte pour la critique spculative. Ce sont des connaisseurs
d'hommes , et leur curiosit se satisfait entirement par l'analyse toute psychologique et intime d'o ils tirent cette connaissance. Aussi voit-on que leur oeuvre,
indpendamment de sa valeur esthtique, est trs prcieuse pour l'ducateur, et intressante pour tous ceux qui ont manier les hommes. Tant qu'une science proprement
dite de la ralit morale n'aura pas fait des progrs suffisants, tant qu'un art rationnel
ne sera pas fond sur cette science, les moralistes contribueront pour une part
suppler au dfaut de l'un et de l'autre. On peut, ce point de vue, les comparer aux
cliniciens du temps o la biologie scientifique n'existait pas encore. Il y a eu certainement, dans l'Antiquit et au Moyen ge, des mdecins et des chirurgiens qui
joignaient des thories enfantines ou absurdes une habilet et une adresse remarquables. Leur anatomie et leur physiologie taient ridicules, faute de mthode et d'instruments, et surtout cause des ides prconues, des systmes respects qui s'interposaient entre eux et la ralit des faits. Mais leur ignorance, et mme leur fausse
science, n'excluaient pas une certaine sret de savoir empirique. Ils pouvaient
observer, comparer entre elles leurs observations, suivre la marche des symptmes,
tablir mme parfois des diagnostics diffrentiels. Incapables sans doute de justifier
leur intervention, ou de dire pourquoi ils prfraient tel traitement tel autre dans un
cas donn, ils choisissaient souvent le meilleur, par une sorte de tact, impossible
analyser, produit de l'exprience et de l'attention. Et peut-tre, pour une maladie
banale, n'tait-il pas plus dangereux d'avoir affaire un grand mdecin de ce temps-l
qu' un mdiocre du ntre.
Pareillement, chez les moralistes, les dogmes et les thories les plus insoutenables
touchant la ralit sociale peuvent trs bien coexister avec une admirable clairvoyance dans la connaissance pratique des hommes, et avec une surprenante habilet
les manier. Mme, l'exactitude de la description et le succs au point de vue pratique ont d dissimuler plus d'une fois efficacement la pauvret ou l'absurdit du
savoir. Si l'on et dit quelqu'un de ces grands mdecins du XIIe ou du XIIIe sicle,
qu'il ne savait peu prs rien de ce qui se passe dans le corps humain, ni l'tat de
sant ni l'tat de maladie, qu'il avait tout apprendre, et aussi tout dsapprendre, il
aurait sans doute hauss les paules. Si l'on avait insist, il aurait renvoy aux gurisons qu'il obtenait. Argument dcisif ses yeux, aux yeux de tous ses contemporains.
Argument irrfutable, et qui pourtant ne prouvait rien.
Sans poursuivre jusqu'au bout la comparaison entre les moralistes et les cliniciens,
il reste que ni le talent de peindre les murs et les passions des hommes, ni l'adresse
se faire couter et suivre par eux, n'impliquent ncessairement que l'on possde une
connaissance rationnelle et scientifique de ce qu'ils sont. Ces qualits peuvent mme
coexister avec la foi qui accepte sans discussion telle ou telle explication mythologique ou thologique de la nature humaine . Les moralistes ne se font point scrupule d'accepter telle quelle la conscience morale de leur temps : ils n'hsitent pas
davantage admettre les postulats qui y sont plus ou moins consciemment associs.
Leur grande affaire est de dcrire ou de corriger, et non pas de rechercher une
connaissance scientifique de la ralit sociale, ni de fonder un art rationnel, dont la
pratique actuelle ne permet pas de sentir le besoin. Bref, la sagesse des moralistes
a son prix ; mais, prcisment parce que l'intrt spculatif y tient peu de place auprs
de l'intrt esthtique et pratique, elle ne devait gure aider la science naissante de la
physique morale . Les germes de cette science taient ailleurs.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 120
II
Les philologues et les linguistes, vritables prcurseurs d'une science positive
des murs. - Leur mthode rigoureuse et scrupuleuse. - Rle analogue des sciences conomiques et de la psychologie exprimentale. - Influence des thories
transformistes. - Rle capital des sciences historiques. - Conflit apparent et connexion vritable de l'esprit historique avec la mthode d'analyse gntique du
XVIIIe sicle.
Retour la table des matires
Depuis longtemps des savants et des rudits ont entrepris, modestement et sans
bruit, l'tude de certaines catgories de faits moraux par une mthode rigoureuse et
objective. Ce furent d'abord les philologues de la Renaissance et les linguistes, puis
les fondateurs de la grammaire compare et des autres sciences positives qui ont les
langues pour objet. Ces savants excluent de parti pris tout ce qui rappelle la psychologie vague, gnrale et purement littraire, et les procds dialectiques qui mnent
seulement au vraisemblable. Ils prsentent les mmes caractristiques logiques que le
physicien ou le chimiste. Ils se sentent tenus aux mmes scrupules, ils pratiquent la
mme prudence l'gard des hypothses : ils observent, en un mot, l'gard de leur
objet, la mme circonspection scientifique. Leurs audaces mmes sont mthodiques.
A leurs yeux, ce sont toujours les faits qui dcident en dernier ressort.
Quoi de plus technique et de plus inoffensif, en apparence, que la constitution de
ces sciences philologiques et linguistiques ? Comment imaginer un rapport entre ces
tudes d'un caractre tout spcial, et la faon d'entendre la morale, individuelle et sociale ? Et pourtant, une fois ces sciences fondes, un processus mthodologique commenait, dont les consquences devaient s'tendre de proche en proche, et contribuer,
pour une part importante, la transformation des sciences morales . Les plus
grands, parmi les philologues, ont eu le sentiment trs net que leurs travaux, tous
d'rudition et de dtail, portaient nanmoins en eux une vertu exemplaire. Ils en ont
signal la dignit et la haute importance sociale.
Tels les frres Grimm, Burnouf, et surtout Renan, qui, dans l'Avenir de la science,
a dploy en un tableau enthousiaste les esprances presque infinies que lui paraissaient justifier les travaux de ses matres.
Mme s'il faut en rabattre, comme Renan le fit lui-mme plus tard, il demeure vrai
que le succs d'une mthode strictement rigoureuse dans les sciences linguistiques et
philologiques marquait une date capitale dans l'histoire de l'esprit humain. Les faits
tudis par ces sciences participent la fois de la ralit physique (objective), et de la
ralit morale, que nous sommes accoutums regarder surtout sous son aspect
subjectif. En tant que sons mis par les organes vocaux, les mots sont du domaine du
mouvement, et ils peuvent tre l'objet d'tudes exprimentales dans un laboratoire.
Par leur sens et par leur syntaxe, par l'volution de leurs formes, ils relvent de la vie
psychologique et sociale. Il devient vite vident que cette volution s'effectue confor-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 121
mment des lois. Ces phnomnes constituent ainsi la transition la plus naturelle
entre ce qu'on appelait autrefois le physique et le moral . Les sciences qui les
tudient taient ainsi prdestines, si l'on ose dire, servir de vhicule la mthode
employe par les physiciens et par les physiologistes, quand elle viendrait s'introduire dans les sciences dites morales. C'est en effet ce qui eut lieu. Les frres Grimm,
par exemple, se trouvrent insensiblement amens, par leurs travaux philologiques,
tudier, toujours avec la mme mthode, tantt les antiquits et le folklore germaniques, tantt le vieux droit allemand, tantt enfin les croyances et les murs. Ainsi, de
proche en proche, une portion trs tendue de l'ancien domaine des sciences morales tait gagne, ou du moins prpare, l'emploi d'une mthode objective, positive,
et semblable autant que la nature des faits le permet, celle qui produisait de si
excellents rsultats dans les sciences philologiques et linguistiques.
Une autre influence s'exerait aussi dans le mme sens.
A mesure que l'conomie politique se dveloppait, elle tendait dfinir sa mthode avec une exactitude croissante, et sparer de plus en plus nettement la connaissance thorique des faits d'avec les applications pratiques de la science. La lutte trs
vive entre les diverses coles conomiques du XIXe sicle, lutte o les intrts taient
engags comme les principes, a conduit peu peu dissiper toute confusion entre les
uns et les autres. Sans doute, certains conomistes, avocats dtermins d'une cause
politique et financire, ne considrent la science thorique que comme un arsenal
d'arguments contre leurs adversaires. Mais ceux qui font avancer la science ne veulent
plus tre dsormais que des savants, tout entiers l'tude de phnomnes naturels
qu'ils reconnaissent tre trs complexes, trs mouvants, difficiles saisir. Leurs
progrs sont lents, mais ils sont srs. Ils annoncent la conqute, assurment longue et
laborieuse, mais certaine aussi et fconde, d'une portion importante de la ralit
sociale par la mthode objective. Chaque anne, dans tous les pays civiliss, les faits
conomiques, dmographiques, juridiques, sont l'objet de statistiques de plus en plus
rigoureuses et minutieuses. L'usage se rpand, et on peut presque dire, s'impose, de
les reprsenter par des courbes, et de rechercher, par l'analyse de ces courbes, comment les phnomnes varient en fonction les uns des autres : application de la mthode des variations concomitantes, la seule que nous sachions employer jusqu' prsent,
en gnral, dans la recherche des lois o de nombreuses sries de phnomnes se
trouvent intresses, sans qu'il nous soit possible d'isoler chacune d'elles pour
l'tudier.
Enfin, sans parcourir ici l'immense domaine de la ralit sociale, pour montrer
comment peu peu la mthode objective s'y insinue de tous cts, il suffira peut-tre
d'appeler l'attention sur un fait capital. La psychologie semblait devoir tre, de toutes
les sciences, la plus rfractaire cette mthode. Introspective pour ainsi dire par
dfinition, elle tait, en outre, par tradition, troitement lie la mtaphysique. Pourtant une psychologie exprimentale est ne. Elle s'est dveloppe, elle s'est constitue
l'tat de science spciale et positive, indpendante de la mtaphysique. Elle a su
fixer ses procds propres d'investigation. Elle a ses laboratoires. Cet exemple ne
devait pas tre perdu pour les sciences morales . Sans doute, elles ne peuvent pas
avoir recours, comme la psychologie, l'observation et l'exprimentation prcises
au moyen d'instruments. Mais, lorsqu'il s'agit de mthode, ce n'est pas seulement le
matriel des instruments et des procds qui importe ; c'est aussi, c'est surtout peuttre, l'attitude du savant en prsence des faits, et la faon dont il essaie de les saisir et
de les lier. La science des religions, la science du droit, la science des murs ne
pourront jamais exprimenter ; cela est trop clair. Mais, selon la remarque dAuguste
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 122
Comte, la nature, c'est--dire l'histoire, a expriment pour elles. La mthode historique comparative devient entre les mains du sociologue un instrument puissant, dont
on n'a peut-tre pas mesur encore toute la porte.
Ce mouvement s'est acclr dans le dernier quart du XIXe sicle. Un certain
nombre de causes conspiraient le favoriser, s'il est permis de parler de causes l o
l'action rciproque est la rgle, en sorte qu'on ne saurait dire, pour un ensemble donn
de faits, o sont les effets et o sont les causes. Nous ne songeons pas tracer ici un
tableau, mme sommaire, de l'ensemble des conditions favorables ce mouvement,
qui tendirent l'emporter sur les influences adverses, dont nous avons signal les
principales. En vertu du consensus qui rend toutes les sries sociales solidaires les
unes des autres, nous devrions tenir compte des conditions conomiques, politiques,
religieuses et autres, o se trouvait notre civilisation. Pour ne considrer que la srie
intellectuelle (o d'ailleurs l'influence des autres se fait toujours sentir), l'apparition et
le succs des thories transformistes dans les sciences naturelles retentirent dans les
sciences voisines, et jusque dans les sciences les plus loignes. Ce succs fut un
encouragement reprendre les tentatives d'analyse par gense. Les philosophes du
XVIIIe sicle avaient dj connu et recommand cette analyse ; mais ils l'avaient
pratique eux-mmes avec une hte si tmraire, avec tant de got par la simplification abstraite, qu'aprs eux on l'avait abandonne. L'exemple et le succs de Darwin la
remirent en honneur. Patiente dsormais, prudente, scrupuleuse, ennemie des systmes et respectueuse des faits, la mthode d'analyse gntique s'tendit de proche en
proche jusqu'aux sciences de la ralit sociale.
Elle recevait en mme temps le secours efficace, et proprement parler indispensable, de l'histoire : car les faits sociaux sont prcisment ceux dont on ne saurait
tudier la gense sans avoir recours l'histoire. Le dveloppement de celle-ci, trs
favorable par consquent la science positive de ces faits, est un des traits les plus
saillants de la physionomie du XIXe sicle. D'une part, l'histoire a si bien organis sa
mthode, et le travail de ses sciences auxiliaires, qu'elle a serr la ralit du pass
d'aussi prs que possible, et obtenu le maximum de certitude qu'elle comporte.
D'autre part, elle est entre en matresse dans un grand nombre de domaines qu'on
tudiait, auparavant, d'une faon toute diffrente, c'est--dire du point de vue dogmatique, moral, ou par la critique abstraite. Elle a transform ainsi peu peu la science
des religions, du droit, des littratures, des arts, de la technologie, des institutions ;
bref, presque tous les objets des anciennes sciences morales.
Nous voyons aujourd'hui, avec une entire vidence, que l'analyse gntique et
l'histoire concourent une mme investigation de la ralit sociale, et prparent ainsi
l'une et l'autre la formation d'une mme science. Mais on ne l'a pas toujours aussi bien
vu. Ceux qui ont le plus fait pour la diffusion de la mthode historique, il y a un
sicle, croyaient prcisment le contraire. Ils recommandaient l'histoire comme un
antidote contre la mthode abstraite et philosophique d'analyse gntique. Ce fut l
une des ides directrices de Savigny, par exemple, qui fut le matre et l'ami des frres
Grimm et de Ranke. Tous les romantiques insistent, comme lui, sur l'impossibilit
d'expliquer un processus historique rel par une analyse conceptuelle. Tous s'appliquent montrer ce qu'il y a d'individuel dans la langue, dans la religion, dans la nationalit de chaque peuple, ce qu'il y a d'irrductiblement divers de race race, de civilisation civilisation : c'est la gense concrte et naturelle de l'histoire qu'ils opposent
partout l'analyse gntique abstraite du philosophe. Et certes, ils triomphent aisment des encyclopdistes, de l'abb Raynal ou de Dupuis. Mais ils ne s'aperoivent
pas qu'ils prparent eux-mmes l'apparition d'une analyse gntique beaucoup plus
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 123
puissante que la premire, et contre laquelle ils ne pourront plus rien, prcisment
parce que, grce eux, elle ne sera plus abstraite et hypothtique, mais historique et
comparative.
Aux analyses surtout logiques et dialectiques du XVIIIe sicle, des arguments de
fait, parfois dcisifs, emprunts l'histoire, pouvaient tre opposs : c'est ce que fit
l'cole traditionaliste, non sans clat ni sans succs. Mais que rpondre l'exgse
qui, sans passion, sans loquence, fait voir, avec la froide impartialit de la science,
comment telle croyance ou telle pratique est apparue dans une socit donne, un
certain moment, et par l'effet d'un ensemble de circonstances dtermines, surtout si
l'tude compare d'autres socits apporte d'autres exemples de faits semblables ?
Comment ce qui est ainsi situ , incorpor la ralit historique, conserverait-il un
caractre surnaturel et transcendant, et resterait-il l'objet d'une vnration presque
religieuse ? En cherchant dans l'histoire la justification de ce qui est traditionnel, on
n'a pas pris garde que cette justification mme en entranait la relativit.
Partout o l'histoire introduit sa mthode, le devenir s'introduit avec elle. Ce
devenir , except pour Hegel peut-tre, n'est jamais quelque chose d'universel ou
d'absolu. Il se droule en tel point de l'espace, tel moment du temps, dans telles
conditions ; en un mot, il est localis. Nous ne pouvons plus le voir avec d'autres yeux
que le reste des phnomnes sociaux du prsent et du pass. Insensiblement, l'histoire
a ainsi dpossd la mtaphysique. Ce n'est plus seulement des empires qu'elle
recherche les conditions de naissance, de dveloppement et de mort ; c'est aussi des
civilisations, des espces, des mondes, et, dans notre monde, des religions et des
institutions : par exemple, des diffrentes formes de la proprit, et de la famille. Un
sicle qui a commenc par l'histoire compare des langues, et qui a fini par l'histoire
compare des religions, soumettait dj l'ide de relativit universelle tous les objets
des sciences morales . C'est dire qu'il prparait la science positive de la ralit
morale, et qu'il continuait, sans le vouloir, l'uvre du XVIIIe sicle, alors mme qu'il
s'en dclarait l'adversaire.
III
Lenteur invitable des changements de mthode. - Exemple pris de la physique
du XVe sicle. -Causes qui retardent la transformation des sciences morales .
- Formes de transition o les anciennes mthodes sont encore mles aux
nouvelles. - Ncessit d'un clivage nouveau des faits. - Raisons d'esprer que la
transformation s'achvera.
Retour la table des matires
La transformation des sciences morales tait donc invitable. Le mouvement
gnral des ides, que le dessein de cet ouvrage ne nous permet pas d'analyser, le progrs des sciences naturelles, et surtout l'ascendant de l'esprit et de la mthode historiques, ne permettaient plus aux sciences morales de conserver la forme indcise et
mal dfinie qui plaisait la philosophie spiritualiste. Mais nous savons aussi que les
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 124
rsistances cette transformation devaient tre et sont, en effet, extrmement vives.
Nous ne seront pas tonns si elles ne sont surmontes que peu peu, et plutt par des
sortes de pousses successives que par une marche continue. A considrer les choses
d'ensemble, ce mouvement peut tre regard comme la consquence, ou mieux,
comme la continuation de celui qui a substitu la physique des scolastiques la science moderne de la nature. Il s'agit, cette fois encore, d'un changement profond dans les
procds de la science et dans la faon d'en concevoir l'objet. La fondation de la
physique moderne est donc bien l'antcdent par excellence du mouvement que nous
dcrivons. C'est de l sans doute qu'est venue l'impulsion principale, sans cesse renouvele par le prestige extraordinaire que la physique moderne exerce sur les esprits
de notre temps, sur les savants comme sur les ignorants.
Or cette fondation a exig plusieurs sicles pour s'accomplir. La reprsentation et
l'explication des phnomnes de la nature se faisaient traditionnellement au moyen
d'un certain nombre de schmes provenant d'Aristote. Telle tait la force de cette tradition, telle tait la vitalit acquise de ces schmes, que ni le progrs des mathmatiques, ni le nombre toujours croissant des faits connus et des expriences ne purent les
carter qu' grand-peine. Il y fallut une srie d'efforts successifs dont chacun n'tait
suivi que d'un petit pas en avant. Les scolastiques avaient conserv l'ide aristotlicienne du mouvement, troitement lie plusieurs autres ides mtaphysiques (ides
de cause finale, de forme, de matire, de puissance et d'acte). Leur physique reposait
sur la distinction qualitative du mouvement naturel et du mouvement contraint. Pour
passer de l l'ide du mouvement telle qu'elle se trouve chez Galile, chef-duvre
d'abstraction scientifique, propre la mesure et au calcul, et prte entrer dans les
quations de la mcanique 1, combien d'intermdiaires a-t-il fallu traverser ! Que de
temps et de transitions a demands le passage des lments traditionnels aux corps
simples de la chimie ! L'histoire des autres sciences de la nature proclamerait de
mme avec quelle lenteur toutes les substitutions analogues se sont faites ; rien n'tant
plus difficile ni plus dsagrable l'esprit humain que de renoncer aux concepts,
c'est--dire aux formes o s'est organis pour lui l'ordre de la nature, et de s'en construire de nouveaux. En fait, il ne s'y rsigne que lorsqu'il ne lui est plus possible de se
drober une tche ingrate entre toutes.
S'il a fallu tant d'efforts, s'il a fallu tant de gnrations de savants pour venir
bout de la physique traditionnelle, ne faut-il pas s'attendre ce que la rsistance soit
encore plus longue et plus opinitre, quand il s'agit de la ralit sociale, quand la
transformation doit porter sur le corps entier des sciences morales ? Cette rsistance prend les formes les plus diverses. Tantt la conception traditionnelle des sciences
morales dmontre dialectiquement, son entire satisfaction, sa propre lgitimit, et
elle en trouve une preuve de plus dans son anciennet mme. Tantt (et le plus
souvent), elle fait ressortir les consquences fcheuses qui se produiront infailliblement si on l'abandonne. Car elle se considre comme insparable de l'ordre existant,
dont elle croit fonder les principes ; ou, pour mieux dire, elle le considre comme
solidaire d'elle-mme. Elle croit, de bonne foi, que le sort de ces institutions est li au
sien. D'o elle conclut qu'une faon diffrente de concevoir la science de la ralit
morale ne pourra tre que fausse, et, en mme temps, immorale et antisociale.
Ce moyen de dfense est constamment employ contre les mthodes dangereuses et les mauvaises doctrines. Comme il parat d'abord efficace, parce qu'il
1
Voir l'histoire des phases successives de cette transformation dans K. LASSWITZ, Geschichte der
Atomistik, tome II, pp. 3-37.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 125
intresse la protection des bonnes doctrines et des mthodes lgitimes toutes
les forces conservatrices, mme celles qui ne s'occupent gure ordinairement des
choses de l'esprit, on y a volontiers recours. On ne rflchit point qu'aux yeux de la
raison il ne saurait y avoir de mauvaises doctrines que les fausses, ni de bonnes que
les vraies. C'est donc un moyen de prolonger la rsistance, mais nullement de l'assurer. A mesure que la science fait des progrs, le moment approche o la solidarit
invoque cesse d'avoir des avantages pour les doctrines que l'on voulait dfendre, et
commence compromettre les croyances et les institutions qu'on y a lies.
Sur ce point encore, l'histoire de la substitution de la physique moderne la
physique scolastique est un antcdent instructif. Un des arguments qui ont le plus
servi combattre ce mouvement ne consistait-il pas montrer que les mthodes
nouvelles compromettaient de la faon la plus grave les intrts suprmes de la
socit ? La religion et l'tat taient galement menacs par la tmrit des novateurs.
L'Inquisition et les Parlements firent voir, dans des procs rests clbres, qu'ils ne
ngligeaient point leur devoir de conservation sociale. C'est en plein XVIIe sicle que
Galile fut condamn, et Descartes oblig de vivre hors de France ; c'est un peu plus
tard que l'arrt burlesque de Boileau vint empcher le Parlement de Paris d'en rendre
un plus burlesque encore. Pourtant, moins d'aller intrpidement jusqu'au bout de la
thse qui subordonne la recherche de la vrit scientifique l'intrt suprieur de la
conservation sociale, moins d'imiter les Chinois qui enseignent, dit-on, une astronomie fausse, la sachant fausse, parce que c'est l'astronomie des anctres, il fallut bien
finir par reconnatre que la physique nouvelle l'emportait sur l'ancienne, avouer que la
nature n'a pas horreur du vide, et que le Soleil ne tourne pas autour de la Terre. Mais
cet aveu ne fut fait qu'en dsespoir de cause.
La tnacit presque instinctive et rflexe de cette rsistance tient des raisons
profondes. Il peut paratre sans grande importance que telle conception physique se
substitue telle autre. Mais il importe beaucoup que les esprits se dtournent d'une
certaine mthode pour s'accoutumer une autre. La victoire de la mthode inductive
et objective, dans la science de la nature physique , peut sembler inoffensive par
elle-mme, et devenir redoutable par l'extension possible, probable, imminente, de
cette mthode l'tude de la nature sociale . C'est le prsage d'une autre bataille
sculaire livrer, et sans doute avec le mme sort.
Nous assistons maintenant cette seconde lutte, et nous y voyons reparatre, sous
une forme diffrente, les procds de la premire. Les ennemis de la physique
scolastique taient combattus comme hrtiques et impies, parce qu' cette poque le
grand dfenseur des intrts sociaux tait encore l'glise. Aujourd'hui, les adversaires
de la conception traditionnelle des sciences morales sont compts, qu'ils le veuillent
ou non, parmi les rvolutionnaires, parce que la dfense conservatrice actuelle s'appuie surtout sur l'tat. L'adoucissement des murs et la libert dont nous jouissons
font que cette dfense n'est plus brutale comme autrefois. Mais elle n'en est pas moins
vive. Il faut, pour qu'elle cde, que les esprits s'accoutument dissocier des sentiments, qui leur sont chers juste titre, d'avec ce qui leur parat, tort, une reprsentation exacte de la ralit sociale. Or cette dissociation ne peut tre que lente. Il
semblait aux savants et aux philosophes du XVe sicle, et la foule qui pensait
d'aprs eux, que tout serait perdu si l'on cessait de suivre Aristote dans la physique.
On l'a abandonn pourtant, malgr leurs prdictions sinistres, et le monde n'en a pas
t plus mal. Il semble aujourd'hui beaucoup de moralistes et d'conomistes que la
socit va prir, si la famille, la proprit et les institutions analogues, au lieu de
reposer sur un fondement a priori (c'est--dire, en dernire analyse, sur une concep-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 126
tion religieuse qui se prend pour rationnelle), sont considres dsormais comme
faisant partie d'une nature sociale, donne dans l'exprience comme la nature
physique. Et comme ces craintes trs vives ne sont pas dpourvues de sincrit, elles
ne disparatront que peu peu. Pour que la dissociation indispensable s'opre, il faut
que la science nouvelle se soit dveloppe, et s'impose non seulement par ses dmonstrations, mais par ses applications. On reconnatra alors que l'intrt social
vritable, c'est--dire l'intrt gnral, n'avait pas s'en alarmer.
Toutefois, les obstacles les plus difficiles surmonter ne proviennent pas de
l'opposition dclare aux conceptions et aux mthodes nouvelles. Si cette opposition
en retarde la victoire, la lutte n'est pas sans profit pour elles. Des adversaires
clairvoyants et sans indulgence ne leur permettent pas d'ignorer leurs points faibles, et
les obligent ne pas se contenter d'-peu-prs. Elles sont ainsi contraintes prendre
une conscience nette de ce qu'elles sont, se formuler d'une faon prcise, dgager
les principes qui les fondent. Plus redoutable est l'ennemi qu'elles portent presque
toujours en elles-mmes : je veux dire, ce qui subsiste des anciennes conceptions et
des anciennes mthodes dans les nouvelles, l'insu de ceux qui les soutiennent comme de ceux qui les repoussent. Le passage des unes aux autres se faisant avec lenteur,
les novateurs, pendant la priode de transition, demeurent tout imprgns des conceptions qu'ils combattent. Si hardis, si pntrants que soient les premiers esprits qui
s'affranchissent d'une tradition sculaire, ils ne se librent jamais que trs imparfaitement. Bacon, par exemple, adversaire dclar de la physique aristotlicienne, promoteur d'une mthode inductive oppose la dduction syllogistique des scolastiques, et, qui plus est, contemporain de Galile et de Gilbert, persiste cependant donner pour objet la science de dcouvrir les formes . Ce qu'il entend par l (autant
que nous pouvons le saisir sous l'clat obscur de ses expressions), est quelque chose
d'hybride, intermdiaire entre les lois que cherche la physique moderne, et les formes substantielles que poursuivait la physique aristotlicienne. De mme, Descartes
veut rompre avec la philosophie scolastique, et il semble bien avoir mis son projet
excution. Pourtant ses Mditations conservent, en maints endroits, plus que des
traces de la terminologie et des doctrines de l'cole. Comte, enfin, formule l'ide
d'une sociologie positive, et sa propre sociologie ressemble encore, dans ses traits
essentiels, une philosophie de l'histoire.
L'histoire de la philosophie et des sciences est pleine de faits analogues. Ils prouvent l'vidence que, mme dans les conditions extrieures les plus favorables, les
changements de mthode ne se font que progressivement. Le principal obstacle
l'tablissement d'une science de la nature sociale provient ainsi d'habitudes mentales
invtres. Parmi ceux qui se dclarent partisans de cette nouvelle science, et qui se
flattent d'y collaborer, combien y apportent ces anciennes habitudes, et continuent les
sciences morales traditionnelles sous le nom plus neuf de sociologie ! Ceux mmes qui sont en garde contre ce danger ne russissent pas toujours y chapper. Pour
viter les rechutes, il leur faut se tenir continuellement en dfiance contre la tendance
naturelle retourner aux habitudes communes, contre le langage qui en est imprgn :
il faudrait, s'il tait possible, n'employer jamais que sous rserve les concepts gnraux o l'exprience des gnrations antrieures s'est cristallise, et o l'exprience
nouvelle est son tour irrsistiblement attire, parce que l'esprit obtient ainsi tout de
suite le maximum d'ordre, c'est--dire le maximum d'intelligibilit apparente, avec le
minimum de peine et d'effort.
Lorsqu'il s'agit de la science de la ralit morale, la force des habitudes mentales
est encore augmente par le respect que cette ralit inspire. Nous considrons au-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 127
jourd'hui - on n'a pas toujours pens de mme - que dans la nature physique il n'y a
point de substances, nobles ou viles. Le physiologiste s'occupe de l'urine comme du
sang : du point de vue de la science, on fait abstraction de tout sentiment esthtique,
comme de tout sentiment religieux et moral. Aucune considration extrieure n'intervient dans la constatation des faits ni dans la recherche de leurs lois. Mais, lorsqu'il
s'agit de la ralit morale, nous avons encore des habitudes toutes diffrentes. Nous
ne prenons gure connaissance des faits - du moins de la plupart d'entre eux -, sans
porter en mme temps sur eux un jugement de valeur , accompagn de sentiments
que nous ne voudrions pas ne pas prouver. Cette faon de rapporter les faits nos
concepts moraux est trs prjudiciable la connaissance scientifique, puisqu'elle les
range, non selon leurs relations objectives et relles, mais selon des schmes dont
l'origine, au regard de la ralit, peut tre considre comme arbitraire. La classification, la gnralisation, l'analyse mme des faits deviendraient certainement tout
autres, le jour o elles seraient entreprises d'un point de vue purement spculatif. Bien
mieux, la structure mme, le clivage de ces faits seraient autres ; en un mot, la ralit
sociale, en tant qu'objet de science, offrirait un aspect tout diffrent de celui sous
lequel elle apparat dans la reprsentation commune. En gnral, ce que nous
percevons est la matire de la science, mais condition de ne pas rester dans l'tat o
nous le percevons d'abord. Ces donnes doivent subir une laboration pralable. Un
travail de dissociation est ncessaire pour rompre les rapports qu'ont tablis, le plus
souvent, les besoins de la pratique, ou parfois certains traits saillants de la perception.
Avant Lavoisier, dans le processus de la combustion, le fait capital est la prsence
suppose du phlogistique - peut-tre parce que la flamme s'imposait l'attention des
observateurs comme le facteur essentiel dans ce processus.
Elle ne faisait pourtant que dissimuler leur esprit le phnomne chimique rel, la
combinaison de l'oxygne avec un autre corps.
Il est au moins vraisemblable que les rapports rels des faits sociaux sont masqus
encore davantage par l'intensit des sentiments qu'ils provoquent en nous, et par
l'habitude o nous sommes de les disposer selon des catgories d'origine pratique.
C'est pourquoi l'on aurait tort de croire que la connaissance accumule de faits de plus
en plus nombreux aurait pour consquence ncessaire d'assurer le triomphe de la
conception objective de la ralit sociale, et le progrs de la science nouvelle de cette
ralit. On suppose, en entretenant cette esprance, que l'apprhension primitive des
faits et le clivage qu'ils prsentent d'abord en permettent tout de suite l'laboration
scientifique. Mais cette hypothse est gratuite. De vrai, ce ne sont pas les faits qui
manquent le plus aux sociologues. Dans un grand nombre de cas, ils en connaissent
dj assez pour tenter de dterminer les lois. Ce qui leur fait encore souvent dfaut,
c'est l'apprhension scientifique des faits : c'est de savoir substituer aux schmes
traditionnels d'autres cadres plus favorables leurs recherches, c'est de dcouvrir les
plans de clivage qui feraient apparatre les lois. Cette prparation de la matire
scientifique a t tout fait indispensable, nous l'avons vu, dans le cas de la nature
physique , et les progrs rapides, clatants, des sciences physiques ne se sont produits que lorsque ce travail prparatoire, qui a exig des sicles, a t suffisamment
avanc. Il en sera sans doute de mme pour la science de la nature sociale . Une
longue priode sera employe la redistribution de sa matire. Presque toujours
cette redistribution sparera ce que nous rapprochions, rapprochera ce que nous sparions. Ici, l'imagination du savant joue un rle capital. Toutes les hardiesses lui sont
permises, pourvu qu'elles russissent, je veux dire, pourvu que ses hypothses soient
fcondes.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 128
Ainsi, l'tude sommaire des antcdents historiques montre la fois comment la
conception d'une science objective de la ralit sociale a d apparatre, aprs que la
science objective de la ralit physique se fut dveloppe, et pourquoi cette conception ne peut tre accepte que lentement. Cette science ne se heurte pas seulement aux
difficults qu'avait rencontres son ane, elle en rencontre d'autres qui lui sont
propres. Dans quelle mesure et en combien de temps les surmontera-t-elle ? Personne
ne saurait hasarder aujourd'hui une rponse ces questions. L'histoire des sciences
s'est montre aussi ironique que les autres l'gard des prophtes. Toutefois, si l'on se
risque raisonner ici par analogie, les prcdents historiques sont encourageants. Que
l'on songe l'ide que les hommes les plus cultivs de l'Europe, au XVe sicle, se
faisaient de la nature physique : si on la compare l'ide que quelques gnrations de
savants en ont construite pour nous, si l'on tient compte enfin, non seulement du
chemin parcouru, mais des obstacles formidables qui, ds les premiers pas, barraient
la route, on est irrsistiblement tent de croire avec Descartes, avec les philosophes
du XVIIIe sicle, avec Auguste Comte que, dans notre socit, l'effort scientifique
finira par tre victorieux. Il serait permis d'esprer que, dans quelques sicles, les
sciences auront tabli une reprsentation objective de la nature morale qui sera la
ntre ce que notre physique est celle d'Albert le Grand et de saint Thomas. Mais
cette comparaison mme, si elle est exacte, nous fait comprendre combien il serait
vain de vouloir imaginer par avance ce que cette reprsentation pourra tre.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 129
CHAPITRE VII
LA MORALE NATURELLE
I
La recherche scientifique consiste non fonder la morale, mais analyser la
ralit morale donne. - Sa premire dmarche est de reconnatre que cette
ralit, quoique familire, n'en est pas moins ignore.
Retour la table des matires
A l'ancienne division de la morale en thorique et pratique, une conception plus
conforme aux analogies scientifiques tend substituer, d'une part, la science ou le
groupe de sciences dont l'objet est la ralit sociale, d'autre part l'art rationnel fond
sur cette science. Cette substitution commence peine s'effectuer. Elle ne peut
avancer que lentement. Il est prsumer que, longtemps encore, les progrs qu'elle
fera, loin de dsarmer les rsistances, auront plutt pour effet de les rendre plus vives.
Nous n'ignorons pas non plus que les obstacles les plus importants, pour une priode
qui sera sans doute encore longue, seront ceux que nous portons pour ainsi dire en
nous-mmes. Des habitudes invtres de sentiment et de pense, mille liens insensibles par lesquels nous tenons encore un pass que nous croyons aboli, font que,
bon gr mal gr, nous versons toujours notre vin nouveau dans les vieilles outres, et
nos conceptions neuves dans les anciens cadres. Il y a l des conditions presque
organiques qui s'imposent l'volution des ides et des mthodes : nul effort de
rflexion ne peut nous y soustraire. Pourtant, nous savons aussi que lorsque nous
avons une ide nette d'une volution de ce genre, c'est qu'elle est presque acheve, ou,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 130
du moins, que le terme n'en est plus trs loign. Pour aider la transition, pour la
rendre moins pnible et moins rude, il nous est loisible, et en mme temps utile, de
nous reprsenter par avance les consquences les plus immdiates que dterminera la
nouvelle attitude mentale, quand elle sera ferme et universellement adopte. La vue
anticipe de ces consquences peut nous pargner quelques-unes des conciliations
imparfaites, quelques-uns des compromis intenables, et, par suite, des conflits qui
marquent chacune des tapes.
En premier lieu, il ne saurait plus tre question, pour les philosophes, de fonder la morale. Cette prtention excessive, mais en un certain sens respectable,
puisqu'elle provenait d'un besoin de rationaliser l'action, a toujours t illusoire. La
morale n'a pas plus besoin d'tre fonde que la nature au sens physique du
mot. Toutes deux ont une existence de fait, qui s'impose chaque sujet individuel, et
qui ne lui permet pas de douter de leur objectivit.
Pour ce qui est de la nature physique, cela est trop clair. Pour la nature sociale,
en peut-on douter davantage ? A un individu normal, vivant dans une socit quelle
qu'elle soit, dans la ntre par exemple, une ralit sociale s'impose, qui lui prexistait
et qui lui survivra. Il n'en connat ni l'origine, ni la structure. Obligations, interdictions, murs, lois, usages mme et convenances, il lui faut se conformer toutes ces
prescriptions, sous peine de sanctions diverses, tantt extrieures, tantt intimes, plus
ou moins dtermines, plus ou moins diffuses, mais qui se font sentir de la faon la
plus incontestable par les effets qu'elles produisent et par l'intimidation qu'elles
exercent. Libre aux philosophes de concevoir une mtaphysique des murs, comme
ils conoivent une mtaphysique de la nature. Mais, de mme qu'il ne se trouve plus
aujourd'hui de mtaphysicien pour confondre sa spculation avec luvre de la
science proprement dite, qui se borne patiemment, et avec une humilit glorieuse,
tudier les phnomnes donns et leurs lois ; de mme, la mtamorale, si elle subsiste, devra dsormais se distinguer de la science, ou plutt du groupe complexe de
sciences qui se proposent l'tude positive de la ralit sociale. Cette ralit n'est pas
plus que l'autre construire , ni fonder . Elle est simplement, comme l'autre,
observer, analyser et ramener des lois.
Cette assimilation de la nature sociale la nature physique entrane son
tour d'autres consquences. Elles peuvent surprendre d'abord, mais, si l'on a admis le
principe, il est difficile de les rejeter. Par exemple, dans les sciences physiques et
naturelles, une pratique dj longue de la mthode exprimentale a accoutum les
savants s'avouer leur ignorance a priori. tant donn un corps rcemment dcouvert,
quelles en sont les proprits physiques, chimiques, thrapeutiques, etc. ? Nous pouvons faire ce sujet des hypothses : il est mme ncessaire que nous en fassions,
pour servir de point de dpart aux expriences. Mais personne ne doute que la
vrification ne soit indispensable, et que seules les expriences ne dcident en dernier
ressort : que de fois les hypothses les plus vraisemblables n'ont-elles pas t dmenties par le fait !
Avons-nous de mme, l'gard de la ralit sociale, la conviction bien assure,
passe pour ainsi dire l'tat d'axiome, qu'avant de l'tudier scientifiquement, nous
l'ignorons ? - Certainement non. - Par quelle raison expliquer cette diffrence d'attitude en prsence d'une ralit dont la science ne semble pas plus nous tre infuse dans
ce second cas que dans le premier ? - De raison objective, il n'y en a point. La cause
principale de cette diffrence doit tre cherche en nous. Notre science de la ralit
sociale est loin d'tre aussi avance que celle du monde physique. Or, en vertu d'une
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 131
loi constante du dveloppement de notre savoir, le manque d'une science positive
d'une portion dtermine de la ralit est d'autant moins senti qu'il est plus grand.
Sans paradoxe, il faut qu'une science existe depuis assez longtemps, qu'elle ait obtenu
des rsultats incontests, qu'elle soit presque universellement admise, pour que l'objet
en soit conu comme une ralit que nous ignorons peu prs entirement, et qui doit
faire la matire de recherches mthodiques, longues et patientes. Jusque-l, l'ignorance s'ignore elle-mme. La place de la science absente est occupe par des reprsentations pr-scientifiques, par des constructions et des systmes o l'imagination et
l'entendement trouvent une gale satisfaction. Tout s'explique , sans difficult
insurmontable, par des principes gnraux et abstraits. Il en a t longtemps ainsi
pour la ralit physique. Nous touchons au moment o il va cesser d'en tre ainsi pour
la ralit sociale.
Toutefois cet aveu, ou, pour mieux dire, cette constatation de notre ignorance, qui
est insparable de l'attitude scientifique, n'est pas encore accept unanimement. On
hsite reconnatre que la ralit morale est inconnue de nous avant que la recherche
scientifique s'y applique. Cette rsistance tient surtout, nous le savons, la confusion
des ides courantes touchant la thorie et la pratique en morale, confusion qui a t
favorise et entretenue jusqu' prsent par les philosophes. Ils ont eu, de bonne foi, la
double prtention de construire la science de la morale et d'enseigner la morale pratique ; et ils ont cru fonder leurs prescriptions sur leur science. Mais ils sont tombs ici
dans une illusion commune, produite par le double sens du mot savoir . Sans
doute, il est vrai que tout individu normal et adulte, qui fait partie d'une socit plus
ou moins civilise, sait ce qu'il doit faire et ne pas faire, connat ce que la
morale lui commande et ce qu'elle lui interdit. C'est un effet naturel, invitable, de
l'ducation qu'il a reue sous diverses formes, et de la pression sociale qui s'exerce sur
lui d'une faon constante. Mais ce savoir de la conscience morale, qui ne doit rien
la rflexion, n'a rien de commun non plus avec la science. Si chacun, dans notre
socit, sait ce qu'il a faire au point de vue moral, c'est dans le sens o l'on dit
que tout Franais est cens connatre la loi ; ou, pour emprunter une comparaison
Darwin, un peu comme le chien d'arrt sait qu'il doit arrter.
Instinct, dressage, ducation, conformisme social, de quelque nom qu'on appelle
la connaissance dont il s'agit, elle se rapporte uniquement la pratique, et elle est
aussi loigne que possible de ce que nous appelons science, ou savoir thorique. Le
sociologue qui tablit d'o vient la loi, dans quelles conditions le lgislateur l'a faite,
sous l'empire de quelles croyances, de quelles ides, de quels sentiments, par respect
ou imitation de quels antcdents, quelles en sont, en un mot, la filiation historique et
la place dans l'ensemble du systme juridique, a la science de cette loi : le Franais
ordinaire ne l'a pas. De mme pour la morale. Chacun est cens connatre ce qu'elle
ordonne. Personne n'argue jamais de son ignorance, quand il a commis un acte que la
conscience des autres et sa propre conscience considrent comme rprhensible ou
coupable. Mais, si l'on considre les ordres et les interdictions de la conscience
comme un objet de science, nous ne pouvons pas plus en rendre compte que des lois
civiles, sans une longue tude pralable. Pour n'tre pas sentie, cette ignorance n'en
est pas moins relle. Et prcisment parce qu'elle n'est point sentie, nous avons peine
en convenir. Il faut, pour que nous nous persuadions qu'elle existe, qu'elle cesse
d'tre totale. Il faut que la science tablisse peu peu que si nous regardons telle
faon d'agir comme obligatoire et telle autre comme criminelle, c'est, le plus souvent,
en vertu de croyances dont nous avons perdu jusqu'au souvenir, et qui subsistent sous
la forme de traditions imprieuses et de sentiments collectifs nergiques. Nous conce-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 132
vons alors que les ordres de la conscience, qui sont si clairs pour nous en tant qu'ordres, ne le sont plus du tout en tant que faits sociaux.
Ici encore, la comparaison entre la religion et la morale est instructive. Les
Australiens connaissent admirablement les rites, crmonies et pratiques de leur religion si complique : il serait ridicule de leur en attribuer la science. Mais cette science
qu'il leur est impossible mme de concevoir, les sociologues l'tablissent. Pareillement, les Chinois savent jusque dans le plus petit dtail ce que le culte des anctres
exige d'eux dans chaque circonstance de la vie ; mais ils n'en ont pas la science, et
cette science qui leur manque, un savant europen nous la donne. Ce qui est vrai de la
conscience religieuse ne l'est pas moins de la conscience morale. Autre chose est d'en
connatre pratiquement les ordres, autre chose d'en possder la science. Mais, dira-ton, ce que la conscience morale nous prescrit spontanment, les philosophes le lgitiment en remontant au principe rationnel des impratifs ; c'est justement l ce qu'on
appelle fonder la morale. - Il est vrai; mais de la mme faon qu'ils ont fond la
religion naturelle, c'est--dire en essayant de justifier par une dduction rationnelle
des croyances dont l'origine est aussi peu rationnelle que possible. La science des
religions fait comprendre aujourd'hui d'o proviennent le Dieu et l' me des
philosophies religieuses et spiritualistes. La science des murs montrera bientt de
mme l'origine de ce que les philosophes appellent la raison pratique . Dans un cas
comme dans l'autre, la prtendue lgitimation reste purement dialectique. L'intrt
en demeure nanmoins considrable, car cet effort pour fonder rationnellement la
morale signifie que la rflexion s'y applique, qu'elle est prte subir un travail de
systmatisation, et devenir, quand les circonstances s'y prteront, un objet d'tude
dsintresse et scientifique.
II
La morale d'une socit donne, une poque donne, est dtermine par l'ensemble de ses conditions, au point de vue statique et dynamique. - Postulats finalistes sous-jacents aux conceptions courantes sur le consensus social. - Critique
de l'ide philosophique de morale naturelle . - Toutes les morales existantes
sont naturelles. - Comparaison de la morale naturelle avec la religion naturelle. L'anthropocentrisme moral, dernire forme de l'anthropocentrisme physique et
mental.
Retour la table des matires
Parmi les consquences qu'entrane cette nouvelle conception, il en est une qui
nous parat particulirement pnible, surtout pour des raisons sentimentales ; c'est la
ncessit o nous nous trouvons placs d'envisager la mme morale (c'est--dire le
mme ensemble d'obligations, prescriptions et dfenses) deux points de vue tout
fait diffrents, selon que nous la considrons du dedans ou du dehors, selon que nous
nous sentons soumis ses impratifs, ou que nous les regardons comme des faits
sociaux, objets de science. Du premier point de vue, l'excellence de cet ensemble de
prescriptions ne fait pas question. Il nous prsente un idal de bont, de saintet, de
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 133
justice et d'amour, auquel nous savons trop que nous ne pouvons pas atteindre. Aussi
la plupart des hommes se reprsentent-ils les lois morales comme les ordres de Dieu
mme, ou ne croient-ils pas pouvoir s'y conformer sans le secours de sa grce. Bref, la
reprsentation de l'idal moral provoque des sentiments de vnration et d'adoration
tels que toute possibilit de critique se trouve exclue d'avance. La conscience morale
se repose sur son propre impratif comme sur un absolu. Du point de vue du dehors,
ou de la science, l'ensemble des prescriptions morales ne nous apparat plus avec les
mmes caractres. Nous ne les jugeons plus a priori les meilleures possible, ni
sacres, ni divines. Nous les prenons pour solidaires, en fait, de l'ensemble des autres
sries concomitantes de phnomnes sociaux. Les sentiments moraux, les pratiques
morales d'une socit donne sont ncessairement lis, pour le savant, aux croyances
religieuses, l'tat conomique et politique, aux acquisitions intellectuelles, aux conditions climatriques et gographiques, et par consquent aussi, au pass de cette
socit ; et, comme ils ont volu jusqu' prsent en fonction de ces sries, ils sont
destins voluer de mme dans l'avenir. Cette vue gnrale, consquence immdiate
de la conception scientifique, se trouve constamment vrifie par l'emploi de la mthode comparative. Elle s'applique notre propre morale comme toutes les autres.
Celle-ci (de mme que toute autre) ne nous apparatra plus comme une reprsentation idale de l'activit parfaite et de l'excellence morale. Nous avouerons qu'elle
est, un moment donn, prcisment aussi bonne et aussi mauvaise qu'elle peut tre.
Nous reconnatrons ici un cas d'application du principe des conditions d'existence,
que le progrs du savoir positif substitue partout la considration mtaphysique de
la finalit. De mme que toute espce viable vit, tant qu'elle peut rsister l'ensemble
des conditions qui la menacent, mme quand ses organes sont manifestement imparfaits ou dgnrs, mme quand leur adaptation la fin qu'ils doivent atteindre nous
semble trs mdiocre ; de mme, toute socit viable se maintient, tant qu'elle n'est
pas englobe ou dtruite par une autre plus puissante ; et elle se maintient avec sa morale propre, fonction de ses conditions d'existence, et qui est prcisment ce que ces
conditions exigent qu'elle soit. Quelles sont ces conditions et leurs consquences dans
un cas donn, nous ne pouvons le deviner a priori, en nous fondant sur des principes
d'conomie, de moindre action, de finalit, etc., mais nous devons le chercher dans
l'tude des faits.
La propagation d'un grand nombre d'espces animales et vgtales est assure par
le moyen d'une quantit immense de millions de germes qui prissent presque tous,
tandis que quelques-uns seulement voluent et parviennent maturit : procd d'une
prodigalit effroyable, et qui devrait choquer notre sentiment de l'adaptation raisonnable des moyens la fin, si nous n'avions pas une attitude d'admiration prconue
l'gard de ce que la nature nous prsente. Pareillement, les socits humaines se
maintiennent, et c'est un fait naturel : mais l'ordre social qui s'y perptue (et dont la
morale est un des facteurs essentiels) y est peut-tre obtenu par un gal ddain de ce
que nous appelons conomie et finalit. Peut-tre y a-t-il l aussi une prodigalit
norme, une dpense injustifiable (du moins pour notre raison) de souffrances, de
misres, de douleurs physiques et morales, un sacrifice, qui se renouvelle chaque
gnration, de l'immense majorit des individus au fonctionnement de l'ensemble
social. A tout le moins, jusqu' preuve du contraire, rien ne nous autorise penser
qu'il n'en est pas ainsi. Car, ds que nous concevons la ralit sociale comme faisant
partie de la nature, nous devons la concevoir comme rgie par les lois gnrales de
cette nature, et tout d'abord par le principe des conditions d'existence. Or ce principe
n'implique nullement la raison du meilleur , qui servait Socrate et aux Anciens
pour comprendre la nature physique, comme elle sert encore aux Modernes pour
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 134
comprendre la nature morale. Il exprime, au contraire, que tous les tres et systmes
d'tres compatibles avec l'ensemble de leurs conditions, internes et externes, se conservent aussi longtemps que cette compatibilit dure, et si grandes que soient, nos
yeux, leurs imperfections. Les socits humaines ne font point exception, ni, en
particulier, les croyances, sentiments et prescriptions morales qui dominent dans
chacune de ces socits.
Il suit de l que l'ide d'une morale naturelle doit faire place l'ide que toutes
les morales existantes sont naturelles. Elles le sont toutes au mme titre, quel que soit
le rang que chacune occupe dans une classification tablie par nous. La morale des
socits australiennes est aussi naturelle que celle de la Chine, la morale chinoise
aussi naturelle que celles de l'Europe et de l'Amrique : chacune est prcisment ce
qu'elle pouvait tre d'aprs l'ensemble des conditions donnes. Nous sommes habitus
entendre morale naturelle en un sens diffrent. Ce mot signifie pour nous que
toute conscience humaine reoit, par cela seul qu'elle est humaine, une lumire spciale qui lui dcouvre la distinction du bien et du mal. Prts admettre (comme les
faits d'ailleurs nous y contraignent) que cette lumire peut tre obscurcie de mille
manires, et presque entirement, dans les socits sauvages, corrompues ou dgnres, nous n'en sommes pas moins persuads qu'il suffirait d'enlever ce qui l'offusque pour qu'elle recomment briller. En un mot, nous croyons que l'homme est
naturellement moral, au mme titre qu'il est naturellement raisonnable. Cette croyance
est au fond des doctrines philosophiques qui tudient la raison pratique . Mais elle
repose elle-mme sur une confusion d'ides. Sans doute, l'homme est naturellement
moral, si l'on entend par l que l'homme vit partout en socit, et que dans toute
socit il y a des MURS , des usages qui s'imposent, des obligations, des tabous.
Mais on ne fait ainsi que constater un fait qui se vrifie dans tous les temps et dans
tous les lieux. Et cela n'quivaut nullement dire que la moralit est naturelle
l'homme, si l'on entend par cette formule qu'il y a dans sa conscience une rvlation
plus ou moins nette d'un ordre moral, par une sorte de privilge attach sa qualit
d'tre raisonnable ou responsable.
Cette ide d'une morale naturelle , proche voisine du droit naturel , est peuttre ce qui s'oppose le plus opinitrement en nous la ncessit d'admettre que les
morales, comme les institutions, comme les langues, se sont produites, tablies, et
maintenues en vertu de lois sociologiques purement naturelles (en prenant ici le
mot dans le sens de physiques), et doivent tre tudies comme telles. Pour remonter
aux raisons les plus profondes de cette rsistance, on peut rapprocher la prtendue
morale naturelle de la religion naturelle , avec qui elle a les plus troites affinits. Que de bons et gnreux esprits, depuis le XVIIIe sicle, se sont complu
distinguer la religion d'avec les religions ! Aux religions historiques, la diversit,
l'tranget, l'horreur de leurs dogmes, de leurs mythes, de leurs cultes, on opposait
la religion naturelle, ne spontanment de l'me humaine, raisonnable par consquent
et bienfaisante, aussi simple que les autres taient compliques, aussi logique qu'elles
taient absurdes, aussi pacifique qu'elles taient sanguinaires, aussi tolrante qu'elles
taient jalouses, aussi une qu'elles taient divises. Voltaire croyait vraiment cette
religion naturelle. Selon lui, elle avait, sur toutes les autres, l'avantage d'une plus
haute antiquit. Celles-ci n'en taient que des dformations, destines disparatre le
jour o l'humanit, devenue majeure, n'couterait plus que la voix de la raison.
Cette conception a enchant beaucoup d'esprits, et nous voyons aisment pourquoi. Elle leur permettait de se dtacher sans remords des religions positives auxquelles ils avaient cess de croire, et de conserver nanmoins une religiosit trs vive,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 135
laquelle la religion naturelle fournissait un aliment suffisant. Elle rendait compte
de la diversit des religions positives par des circonstances historiques particulires,
et de l'unit de la religion naturelle par une disposition (pour ne pas dire une rvlation) essentielle l'humanit.
Pourquoi cette explication sduisante n'ose-t-elle plus se produire aujourd'hui ?
Parce que en ralit elle n'expliquait rien, parce que la prtendue religion naturelle
n'tait nullement ce que pensaient ses partisans. Loin de reprsenter l'essence des
lments communs toute religion humaine, elle tait un produit trs spcial de la
pense philosophique (c'est--dire rflchie), dans une petite partie de l'humanit,
une poque fort peu religieuse. Elle n'tait, en fait, que le monothisme europen des
sicles prcdents, rduit la forme ple et abstraite d'un disme rationaliste. Chaque
progrs fait par l'tude positive des religions des socits infrieures a rendu plus
vident le dsaccord entre les faits et l'hypothse de l'universalit de la religion
naturelle. Cette tude ne contredit sans doute pas l'assertion que dans toutes les socits humaines passes et prsentes on constate des phnomnes auxquels convient le
nom de religieux . Mais, parmi ces phnomnes constants, on ne trouve certainement pas, comme le croyaient les philosophes du XVIIIe sicle, la croyance un
sage auteur du monde , ni l'ide d'une Providence et d'un Dieu rmunrateur et
vengeur . S'il est possible de dgager les lments permanents des religions humaines, ce n'est pas par une analyse idologique a priori que nous y parviendrons jamais,
mais bien par l'tude attentive, a posteriori, de ce que ces religions ont t en effet,
dans les socits les plus diverses dont nous puissions obtenir une connaissance
suffisamment exacte.
Ces rflexions ne s'appliquent pas moins bien la morale naturelle , si voisine
d'ailleurs de la religion naturelle que le disme du XVIIIe sicle les comprenait
toutes deux peu prs indistinctement. Ceux qui s'taient attachs avec empressement
l'ide d'une religion naturelle, naissant de la raison et du cur de l'homme, ne le faisaient point pour avoir constat, par une tude scientifique, l'universalit des croyances dont se composait, leurs yeux, cette religion, mais parce qu'ils ne pouvaient
concevoir la nature humaine dnue de ces croyances. Nous ne voyons plus l,
aujourd'hui, qu'une expression de leurs propres besoins religieux. De mme, ceux qui
restent fidles l'ide d'une morale naturelle , ne s'y attachent pas pour avoir
constat en fait que les hommes font partout la distinction du juste et de l'injuste, et
connaissent partout les principes de cette morale, mais parce qu'ils ne peuvent concevoir la nature humaine dpouille de ce qui en est, selon eux, le plus essentiel attribut.
Mais c'est encore l une expression de la ferveur de leur foi morale. Scientifiquement,
il est aussi vain d'opposer la morale aux morales, que la religion aux religions. Cette
distinction peut tre intressante, comme symptme d'un effort des consciences pour
se dgager de ce qu'il y a d'accidentel dans leurs murs comme dans leurs croyances ;
mais elle ne nous instruit nullement, et ne saurait nous dispenser de chercher, dans
l'tude des faits, et l seulement, quels sont les lments constants dans les murs des
diverses portions de l'humanit prsente et passe.
Au fond, de mme que l'ide de religion naturelle bien qu'oppose par les philosophes du XVIIIe sicle l'ide de religion rvle, n'est pourtant que cette mme ide
sous une forme un peu diffrente, une rvlation lacise, si l'on ose dire ; de mme
l'ide d'une morale naturelle , sous une forme philosophique, demeure une conception essentiellement religieuse. La nature qui claire l'homme sur la distinction du
bien et du mal, et qui en fait ainsi un tre moral, seul parmi tous les autres, est encore
une faon de Providence , lacise elle aussi. Ce postulat optimiste est reconnais-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 136
sable chez Hume comme chez les philosophes franais ; et il se concilie aussi bien
avec leur empirisme qu'avec le rationalisme de Leibniz. Car il a lui-mme son origine
dans un instinct contre lequel aucun de ces philosophes ne s'est mis en dfiance. C'est
l'instinct de ce qu'on peut appeler l' anthropocentrisme moral , plus profond et plus
difficile combattre que l'anthropocentrisme physique, bien que d'origine et d'essence
analogues. C'est le besoin spontan de disposer les faits et les lois du monde moral
autour de la conscience humaine comme centre, et de les expliquer par elle ; et l'on y
cde avec une complaisance si immdiate, que l'on ne se doute pas que l'on y a cd,
ni mme qu'il existe.
On sait quels efforts il a fallu pour convaincre l'homme qu'il n'tait pas situ au
centre du monde physique. La conception astronomique de Copernic, de Kepler, de
Galile a d, pour s'imposer, triompher d'une rsistance opinitre : des thories anciennes et respectes, des croyances religieuses, des habitudes d'esprit et des sentiments invtrs se trouvaient coaliss contre cet ennemi commun. Elle a fini cependant par l'emporter ; mais cette grande rvolution intellectuelle, qui date de prs de
trois sicles, n'a pas eu jusqu'ici, surtout au point de vue moral, les consquences
lointaines et profondes que l'on pouvait en attendre. Certes, elle a rendu possibles les
merveilleux progrs de la mcanique cleste, et, par contrecoup, elle a contribu plus
ou moins indirectement ceux des autres sciences physiques. Elle n'a sans doute pas
t sans influence sur l'apparition des thories transformistes, qui, leur tour, ont
port un coup sensible l'anthropocentrisme. Pourtant celui-ci subsiste toujours. Les
religions et les morales des peuples les plus avancs au point de vue intellectuel le
prennent pour accord, et elles ne paraissent pas avoir perdu beaucoup de leur empire.
Comment la substitution du monde cleste de Newton celui de Ptolme, du
monde des espces de Darwin celui de Cuvier n'a-t-elle pas eu, jusqu' prsent,
d'action nergiquement dissolvante sur les dogmes qui appartiennent un systme
d'ides tout diffrent ? - C'est que les dcouvertes scientifiques modernes ne ruinent
l'anthropocentrisme qu'au point de vue physique, ou pour mieux dire, spatial. Que
l'homme occupe le centre du monde, ou qu'il se voie isol sur un grain de poussire
dans l'espace illimit, la diffrence des deux conceptions, qui parat d'abord capitale,
ne tarde pas s'attnuer, principalement sous l'influence de deux rflexions. D'abord,
notre imagination est seule mise en branle et frappe par la reprsentation d'un espace
qu'elle ne peut jamais embrasser tout entier. Pour l'entendement, l'espace ne prsente
que des rapports, qui lui deviennent vite familiers par la considration des infinis de
diffrents ordres. Aucune quantit n'est ni grande ni petite par elle-mme, mais seulement par comparaison avec une unit arbitrairement fixe. Mais surtout, si nous
sommes perdus dans un canton isol de l'univers, nous savons que nous le sommes,
nous mesurons notre distance au Soleil, et la distance de notre Soleil beaucoup
d'autres ; d'o il suit que si le fait humilie notre orgueil, la connaissance de ce mme
fait le relve. Peu importe la place que nous occupons matriellement dans le inonde,
s'il se dispose toujours autour de notre raison. Des considrations du mme genre
arrtent les effets qui pourraient sortir des thories transformistes.
C'est ainsi que l'anthropocentrisme a pu subsister, et qu'il a subsist en effet, en
prenant non plus la Terre, mais la raison humaine pour le centre du monde, c'est-dire en se modifiant de faon devenir un anthropocentrisme spirituel. De l limportance croissante de l'ide d'un ordre moral, dont la conscience de l'homme, seul dou
de raison et de libert, est la fois le principe et la raison d'tre. Cette conscience
apparat de plus en plus comme le centre auquel se rapporte et par lequel s'explique
toute la riche diversit des phnomnes naturels, et spcialement, des faits moraux.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 137
C'est donc toujours, au fond, la mme attitude mentale, c'est toujours la mme
conception anthropocentrique, finaliste, religieuse (ces termes sont tels que le passage
de l'un l'autre se fait insensiblement, qui se rend la ralit intelligible en l'imaginant
faite et organise en vue de l'homme. Sans doute, il a fallu abandonner cette explication de la nature physique, sous la pression de la science positive qui en a montr la
fausset; mais l'homme n'en est pas moins rest le centre moral de l'univers.
La lutte contre l'anthropocentrisme est donc loin d'tre acheve ; ses positions les
plus fortes ne sont pas entames. Il n'a perdu, pour ainsi dire, qu'une enceinte
extrieure. Il garde une citadelle qui sera beaucoup plus difficile emporter. Le sige
en est commenc cependant, par les sciences sociologiques, qui ont entrepris d'tudier
la ralit sociale au mme titre que la ralit physique, et qui, au lieu de partir de la
conscience morale comme d'une sorte de rvlation naturelle, analysent les morales
existantes comme les sciences naturelles analysent les corps. Mais cette tche est
beaucoup plus complexe, beaucoup plus ardue, que celle des Copernic et des Galile,
et la rsistance que les savants rencontreront sera encore plus obstine.
Renoncer l'anthropocentrisme moral, en effet, ce sera renoncer dfinitivement
aux postulats finalistes et religieux, et faire rentrer la science des choses morales ou
sociales dans le droit commun des sciences de la nature. La srie des phnomnes
moraux prsents par une socit donne n'aura plus un caractre unique entre toutes
les sries de phnomnes (juridiques, politiques, conomiques, religieux, intellectuels, et autres), qui se produisent simultanment dans cette socit. Elle sera conue
comme relative eux, de mme qu'ils sont relatifs elle. Elle sera naturelle dans
le mme sens que les autres. Du point de vue religieux, la conscience pourra toujours
s'apparatre elle-mme comme lgislatrice universelle dans le rgne des fins ,
membre de la cit cleste , sujet dans le royaume de Dieu . Mais la science, place un point de vue tout diffrent, loin de ramener l'ensemble de la ralit sociale
la conscience comme son centre, rendra compte au contraire de chaque conscience
morale Par l'ensemble de la ralit sociale dont cette conscience fait partie, et dont
elle est la fois une expression et une fonction.
III
Ncessit d'tudier dsormais les morales, passes ou existantes, au moyen de
la mthode comparative. - Impossibilit de les ramener notre propre conscience prise pour type.
Retour la table des matires
Les consquences de cette introduction de la mthode scientifique ne modifient
pas seulement le caractre de la spculation morale : elles en dplacent l'axe et le centre de gravit. Ce qui servait de principe d'explication, la conscience morale, devient
au contraire l'objet de l'investigation scientifique. Au lieu de spculer sur l'homme,
tre naturellement moral, il s'agit de voir comment l'ensemble des prescriptions,
obligations et dfenses, qui constituent la morale d'une socit donne, s'est form en
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 138
fonction des autres sries de phnomnes sociaux. Ds lors, nous n'avons plus le droit
d'affirmer, sous la diversit relle des morales existantes ou passes, l'existence d'une
racine ou origine morale commune toutes. Ou du moins, si nous faisons cette
hypothse - et il nous est permis de la faire, condition de la soumettre l'preuve
des faits -, il nous reste rechercher quels sont les lments constants de toutes les
morales humaines. Nous ne pouvons dterminer l'avance quels ils sont, ni surtout
nous fonder sur cette dtermination pralable pour considrer telle ou telle morale
donne comme un type aberrant, comme une dformation plus ou moins grave de la
morale originelle. Ce serait revenir l'ide de la morale naturelle , qui nous
avons d refuser un caractre scientifique, et o nous avons reconnu une expression
de l'anthropocentrisme mtaphysique et religieux.
L'usage lgitime de cette hypothse nous est montr par l'emploi qui en est fait
dans les autres sciences sociales. La science compare des religions, des arts, du droit,
des institutions en gnral, des langues, tend montrer que, dans des socits qui ont
volu, ce qu'il semble, indpendamment les unes des autres, le processus de
dveloppement a prsent souvent des analogies frappantes. Celles-ci sont si prcises,
parfois jusque dans le plus petit dtail, si rgulires dans la succession uniforme des
phases, qu'on ne saurait les considrer comme fortuites. Il semble donc naturel
d'admettre que, dans les diffrentes socits, les institutions voluent suivant les
mmes lois psychologiques et sociologiques. C'est en cela que consiste l'hypothse
dont il s'agit. Mais il ne faut la prendre que comme heuristique , et non comme
explicative.
Au lieu de construire a priori un homme suppos primitif, au lieu de dterminer,
par une induction rtrospective et hasardeuse, ses fonctions sensibles, intellectuelles
et morales, nous devons considrer au contraire que c'est l un schme, parfois utile
sans doute, mais un schme vide. Il ne peut tre rempli que par l'analyse et par la
comparaison des diffrents processus de dveloppement social qui se sont produits
rellement ; analyse et comparaison qui nous mettront en tat de sparer ce qui est
commun de ce qui ne l'est pas. L'tude compare des religions, par exemple, particulirement des religions des peuples peu civiliss, convainc bientt le savant que toute
la pntration psychologique, toute la subtilit dialectique imaginables, rduites
elles-mmes, ne sauraient reproduire l'tat mental dont ces religions sont les tmoins
irrcusables. Les hommes qui ont cru ou qui croient encore ces mythes, qui ont
organis ces cultes et pratiqu ces rites, avaient des faons de se reprsenter les
objets, de grouper leurs reprsentations, d'imaginer, de classer les tres, de tirer des
consquences, prouvaient des motions collectives si profondment diffrentes des
ntres, que nous avons une peine extrme les restituer, mme par le plus grand
effort de souplesse intellectuelle dont nous soyons capables. Il y a l une logique, une
symbolique, toute une vie mentale que nous ne pouvons lire livre ouvert en la
rapportant simplement la ntre. Il nous faut la dchiffrer pniblement, en nous
dgageant le plus possible de nos propres habitudes mentales. Ou plutt le problme,
considr dans sa totalit, s'nonce ainsi : tant admis, par hypothse, que le processus de dveloppement des socits humaines obit partout aux mmes lois, retrouver
les stades intermdiaires que les religions, les institutions, les arts des socits plus
leves ont d traverser, pour arriver leur tat prsent.
Dans le cas particulier de la morale, nous ne devons donc pas non plus faire usage
de notre conscience actuelle pour comprendre ou pour clairer ce qu'a pu tre la
conscience dans les socits primitives. Nous ne pouvons mme pas poser a priori
qu'elles aient connu un quivalent de notre conscience morale individuelle, qui est
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 139
capable d'affirmer son initiative et son indpendance, soit en s'opposant aux rgles
gnralement acceptes, soit mme en s'y conformant par une dcision rflchie. Ici
encore, une mthode prcisment oppose s'impose au savant. Il devra essayer de
dterminer ce qui, pour les membres d'une socit de ce genre, est ordonn ou
interdit, comment les obligations ou les dfenses se manifestent, quelles en sont les
sanctions sous forme d'expiation, de chtiment ou de remords, et surtout de quelles
croyances et de quelles reprsentations ces obligations et dfenses sont solidaires. Il
ne devra pas transporter dans ce pass recul la distinction nette, videmment plus
rcente, entre ce qui est religieux, juridique, ou purement moral. Enfin, pour poser le
problme gnral dans toute sa complexit, il devra essayer de dterminer, autant qu'il
le pourra, les stades par lesquels la coutume et le tabou du sauvage deviennent peu
peu la loi, dans les textes la fois religieux et juridiques, tels que le Pentateuque, et
aboutissent l'impratif catgorique du philosophe, expression abstraite de la conscience morale d'aujourd'hui, qui se prend pour rationnelle.
Il faut avouer que nous sommes encore extrmement loin de pouvoir rsoudre ce
problme, ou mme d'en possder les donnes positives indispensables. Dans cette
srie de phnomnes sociaux, plus peut-tre que dans toute autre, nous ignorons
presque tout, et nous commenons peine nous apercevoir de notre ignorance.
Notre conscience morale, si nous la considrons objectivement, est pour nous un
mystre, ou plutt un ensemble de mystres actuellement indchiffrables. Elle nous
prsente comme obligatoires ou comme interdites des manires d'agir dont les raisons, croyances disparues depuis de longs sicles, sont presque aussi insaisissables
pour nous que les globules du sang du mammouth dont on retrouve aujourd'hui le
squelette. Nous savons qu'il s'y trouve des lments de provenance et d'ge trs
divers, des lments germaniques, chrtiens, classiques, prclassiques et prhistoriques, peut-tre mme pr-humains. Nous n'ignorons plus que la stratification de ces
apports successifs n'est peut-tre pas plus rgulire que la disposition des couches
gologiques dans une rgion souvent bouleverse. Et pourtant, comme notre conscience morale est imprative et que nous nous sentons soumis ses ordres, non
seulement nous ne la trouvons pas obscure (puisqu'elle nous commande clairement),
mais nous la prenons pour la conscience morale universelle, ternelle, pour la conscience morale absolue et en soi.
La spculation morale a eu longtemps pour objet de faire voir que cette prtention
spontane et nave tait fonde en raison ; elle invoquait la nature privilgie de
l'me humaine, fille de Dieu, divine elle-mme. La spculation morale scientifique,
plus modeste, ne se proposera, pendant longtemps sans doute, que des problmes
beaucoup plus spciaux, et historiquement dfinis. D'o provient telle obligation, telle
interdiction qui se retrouve dans plusieurs socits distinctes ? Quel a t le sens de la
responsabilit individuelle, soit pnale, soit civile, quand elle est apparue ? Par quelles formes a pass la proprit de la terre, des biens meubles, des esclaves ? Quelle a
t la succession des formes du mariage, de la famille ? - Mais, dira-t-on peut-tre, ce
n'est pas l de la spculation morale : c'est de la sociologie. - Il est vrai, mais quelle
spculation morale scientifique peut-il y avoir dsormais, sinon l'tude compare des
morales existantes ou ayant exist ?
Enfin, en devenant oeuvre scientifique, la spculation morale devient du mme
coup oeuvre collective. Auparavant, elle produisait des systmes, dont chacun tait d
au gnie individuel et aux facults organisatrices d'un philosophe, qui en dcouvrait
les principes, en dessinait l'ensemble, et quelquefois mme en achevait le dtail. La
spculation morale, sous sa forme scientifique, suggre l'ide d'une compagnie de
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 140
pionniers dont les efforts communs s'emploient dfricher une terre vierge. Elle sait
qu'elle ne produit rien qui ne soit destin tre complt, remani, transform peuttre jusqu' devenir mconnaissable. Mais elle sait aussi que c'est l le sort commun
de tous les travaux scientifiques, surtout dans la priode initiale. Elle s'estime satisfaite, si elle fraye le chemin d'autres, qui iront plus loin.
IV
Objection : les vrits morales ont t connues de tout temps. - Rponse : cette
conception est inconciliable avec la solidarit relle des diffrentes sries de
phnomnes sociaux, qui voluent ensemble. - En fait, la ressemblance des formules n'empche pas une trs grande diversit de leur contenu. - La justice sociale est un devenir, sinon un progrs continu. - Influence des grands changements conomiques.
Retour la table des matires
Buckle a soutenu, en s'appuyant sur un grand nombre de faits, que le progrs des
socits humaines dpendait principalement de la dcouverte de vrits scientifiques
nouvelles, et nullement de la dcouverte de vrits morales, attendu que celles-ci se
transmettent de gnration gnration, et mme de civilisation civilisation, toujours semblables elles-mmes par leur formule, sinon dans leurs applications. Selon
lui, aussi loin que l'histoire nous permette de remonter, nous trouvons des socits
dj en possession des principes fondamentaux de la morale, bien que fort ignorantes
des sciences de la nature. Cette conception n'est pas nouvelle. Les philosophes anciens, surtout les stociens, en avaient dj fait un lieu commun. Elle est en contradiction avec ce que nous avons essay d'tablir, car elle n'est, au fond, qu'une expression un peu diffrente de la croyance un droit naturel et une morale naturelle.
Nous pourrions donc, la rigueur, la considrer comme suffisamment rfute par ce
qui prcde. Toutefois, comme elle prtend s'appuyer sur l'observation, il ne sera
peut-tre pas inutile de la critiquer en elle-mme, et d'examiner la valeur et la porte
des faits qu'elle invoque.
Ces faits sont, en gnral, emprunts des civilisations qui, par comparaison avec
celles qui nous sont plus familires, paraissent fort recules dans le temps, et, par
suite, relativement primitives, l'gypte, lAssyrie, la Babylonie (3 ou 4 000 ans avant
le Christ). On trouve en effet un certain nombre de textes qui tmoignent, ds cette
poque, d'une conscience morale dj largement ouverte la notion de la justice et au
respect du droit d'autrui, en mme temps qu'aux devoirs d'assistance et de protection
pour les faibles. Mais ces civilisations, pour recules qu'elles nous paraissent, sont
dj trs complexes, trs dveloppes, remarquablement diffrencies au point de vue
social, et d'un type lev en organisation. Nous ne savons absolument pas quel espace
de temps les a spares d'un tat analogue celui o nous voyons aujourd'hui les
socits infrieures de l'Afrique, des deux Amriques et de l'Australie ; mais nous
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 141
risquons peu de nous tromper en le supposant trs considrable. Les faits allgus
tendraient donc prouver que partout o les socits humaines parviennent un haut
degr de civilisation, les relations morales des hommes entre eux en portent le
tmoignage. Mais le contraire seul serait surprenant ; et on peut faire la mme constatation au sujet de leurs relations conomiques, de leur art, de leur langue, de leur
religion. C'est une consquence immdiate de la solidarit qui unit les unes aux autres
les diffrentes sries fondamentales de phnomnes sociaux. Sans doute, cette
solidarit n'est pas toujours galement manifeste, et des causes intercurrentes peuvent
favoriser, ou entraver, le dveloppement de telle ou telle srie ; mais, d'une faon
gnrale, et si l'on a soin de tenir compte des perturbations qui peuvent provenir des
causes les plus diverses, la loi se vrifie.
Par suite, en vertu de cette mme loi, il serait de la dernire invraisemblance que
dans une socit de civilisation encore trs basse et sauvage, la conscience morale ft
dj trs diffrencie, et se possdt elle-mme. Comment une srie sociale, et une
seule, aurait-elle volu isolment jusqu' un degr dj lev de complexit et de
diffrenciation, tandis que les autres seraient demeures un tage de beaucoup
infrieur ? Comment concevoir qu'avec une mentalit trouble, ne permettant encore ni
pense abstraite ni gnralisation, en l'absence d'une division du travail un peu
avance, d'un sentiment net de l'opposition possible entre l'individu et le groupe, des
notions aussi dlicates que celles de justice distributive et rparative, de responsabilit
individuelle, et de respect du droit, puissent, je ne dis pas s'exprimer, mais seulement
se former ?
Le supposer serait admettre l'hypothse d'une rvlation spciale ; et c'est bien
cette hypothse que nous avons trouve, en effet, quand nous sommes parvenus la
racine la plus profonde de l'ide de morale naturelle .
Mais nous avons vu aussi que cette hypothse n'est nullement confirme par les
faits. Sans doute, partout o existent des groupements humains, existent aussi entre
leurs membres des relations que l'on peut qualifier de morales, c'est--dire qu'il s'y
prsente des actes permis ou dfendus, en dehors de ceux (en petit nombre) qui sont
indiffrents, et qu'il s'y prsente aussi des sentiments de blme, d'admiration, de
rprobation, d'estime, pour les auteurs de ces actes. Mais il y a fort loin de ces faits
la connaissance consciente et rflchie de vrits morales , et surtout de vrits
comparables celles qui jouent un si grand rle dans les socits civilises. Dans les
socits dites primitives, la prsence d'une conscience morale individuelle en possession de ces vrits, en possession d'elle-mme, serait une sorte de miracle. Pour autant
que nous sachions, ce miracle ne s'est ralis nulle part.
En outre, mme dans les socits dj plus leves, il ne faut pas que la ressemblance extrieure des formules nous dissimule la diffrence intime des vrits
morales qu'elles expriment. Par exemple, les rgles essentielles de la justice, dit-on
souvent, taient aussi bien connues de l'Antiquit civilise la plus recule que de nos
jours : Neminem laedere ; suum cuique tribuere. - Peut-tre; mais tout ce que l'on
peut en conclure lgitimement, c'est que, depuis cette Antiquit trs recule, le langage a permis une expression abstraite des rapports moraux essentiels. La ressemblance
s'arrte l. Elle n'est que dans la gnralit et dans l'abstraction de la formule. Pour
qu'elle ft aussi dans la signification, il faudrait que le sens des termes ft peu de
chose prs le mme dans les diffrentes civilisations. Or il s'en faut, et de beaucoup.
Comment entendre neminem ? A quels actes peut s'appliquer laedere ? Dans les
socits demi civilises, l'tranger n'est pas compris dans neminem. Le bateau jet
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 142
par la tempte sur une cte trangre est pill, les hommes qui le montent, gorgs ou
rduits en esclavage, sans que personne y voie une infraction la rgle neminem
laedere. De tels exemples abondent, non pas seulement dans le pass, mais chez nous,
et de notre temps. La faon dont les indignes des colonies, mme civiliss, comme
les Annamites, sont traits en gnral par les Europens, montre que les vrits
morales souffrent une singulire clipse hors de leur pays d'origine. - De mme
pour la rgle suum cuique tribuere. Comment se dfinit suum ? Dans une socit o
des castes existent, la justice consiste traiter chacun selon sa caste, le brahmane en
brahmane, le paria en paria ; chez un grand nombre de peuples demi civiliss,
regarder les enfants du sexe fminin comme une charge importune, les femmes
comme des btes de somme ; dans la socit fodale, prendre le vilain pour une
matire taillable et corvable merci. Mme dans les socits les plus dveloppes,
certaines applications de cette formule de la justice peuvent provoquer les protestations d'un petit nombre de consciences, tandis que les autres n'en sont point troubles.
L'industriel qui juge qu'il ne gagne plus assez d'argent peut fermer d'un jour l'autre
son usine, et penser qu'il ne fait tort personne , puisqu'il a pay ses ouvriers,
maintenant sur le pav, le travail fourni par eux jusqu' ce jour. Au milieu du XIXe
sicle, lors du dveloppement rapide des manufactures en Angleterre, et de l'horrible
consommation qui fut faite d'enfants et de femmes travaillant dans les usines jusqu'
seize et dix-huit heures par jour, il ne semble pas que les patrons aient eu conscience
de violer la rgle de la justice : suum cuique tribuere. Ne payaient-ils pas le salaire
convenu ?
Ces formules, prises abstraitement, n'ont donc pas la vertu qu'on leur attribue
d'exprimer en tout temps et en tout lieu l'essence ternelle de la justice. Considres
en elles-mmes, elles sont vides. Elles ne reoivent leur signification et leur valeur
morales que de leur contenu. Or ce contenu ne leur est pas fourni a priori par une
sorte d'intuition naturelle, ni par une estimation immdiate de l'utilit commune. Il
leur vient de la ralit sociale existante chaque poque, et qui impose chaque
individu la faon dont il doit se conduire dans un cas donn. Elles reprsentent ainsi
des expressions de la morale de telle ou telle socit, un certain moment, et non pas
des expressions de la vrit morale en soi. Elles disent galement l'gyptien
contemporain des premires dynasties, l'Assyrien du temps de Sargon, au Grec du
temps de Thucydide, au baron et au prlat du XIe sicle : Il faut tre juste, il faut
rendre chacun le sien. Mais il n'y a de commun dans ces cas, et dans tous les
autres qu'on pourrait citer, que la formule ordonnant de se conformer, en fait, des
rgles dfinies d'action, sous peine de sanctions sociales, prcises ou diffuses, qui se
rpercutent dans chaque conscience individuelle.
Les progrs effectifs de la justice sociale ne peuvent donc pas tre attribus,
comme leur cause dcisive ou mme principale, une conception prexistante de la
justice dans les esprits. Sans doute, en fait, quand un progrs se ralise dans les
MURS ou dans les lois, il tait dj rclam, exig depuis quelque temps, et parfois
depuis fort longtemps, par un certain nombre de consciences. Mais d'o vient que ces
consciences en ressentent le besoin ? Ce n'est pas une consquence nouvelle qu'elles
ont tire de la formule de la justice antrieurement connue ; car pourquoi cette consquence serait-elle aperue ce moment prcis, et ne l'tait-elle pas auparavant ? La
dduction n'est donc qu'apparente. Le fait rel dont elle est la manifestation abstraite,
c'est, le plus souvent, une modification profonde qui s'est produite dans une autre
srie de phnomnes sociaux, presque toujours dans la srie conomique. C'est ainsi
que l'esclavage, le servage, aprs avoir t considrs comme des phnomnes tout
fait normaux, comme des institutions excellentes et ncessaires l'ordre social, ayant
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 143
t peu peu limins par la transformation conomique des socits europennes, se
sont trouvs exclus du droit par la conscience, et condamns au nom de la morale.
C'est ainsi que la condition des proltaires dans le rgime capitaliste moderne, aprs
avoir t longtemps considre par les conomistes comme normale, invitable, et
mme, en un certain sens, comme providentielle, est regarde d'un tout autre oeil,
aujourd'hui que le proltariat, ayant pris conscience de sa force, exige et obtient des
conditions d'existence plus humaines. La conscience morale commune commence
estimer que les revendications des proltaires sont justes. Sans doute, une fois la
transformation conomique commence, l'ide d'une justice meilleure qu'il faut raliser concourt efficacement en acclrer le mouvement. Mais cette ide elle-mme ne
serait pas ne, et surtout ne se serait pas dveloppe, n'aurait pas acquis une force
capable d'entraner les adhsions par millions, si l'ensemble des conditions o se
trouve la socit ne l'avait fait surgir. Autant le matrialisme historique est difficile
soutenir, s'il prtend subordonner toute l'volution des socits leur vie conomique,
autant il est vrai qu'aucune srie de phnomnes sociaux, pas plus celle des
phnomnes moraux et juridiques que les autres, ne se dveloppe indpendamment
des autres sries.
La justice, et, plus gnralement, la morale, doit tre conue comme un devenir . Rien n'autorise, a priori, affirmer que ce devenir soit un progrs, et un progrs
ininterrompu. Admettre ce postulat, ce serait revenir encore l'ide de la morale
naturelle. Elle prendrait seulement une forme diffrente. Au lieu de la supposer
rvle d'une faon immdiate, dans la conscience de tout homme venant au monde,
on la supposerait se rvlant d'une faon successive, dans l'volution historique des
socits civilises. Mais l'hypothse, pour tre ainsi projete dans le temps, ne
changerait pas de caractre. Elle resterait au fond finaliste, religieuse, et anthropocentrique. Du point de vue scientifique, l'tude des faits ne prouve pas que l'volution des
socits humaines, non pas mme celle des socits suprieures, soit telle que chaque
srie de phnomnes, et toutes ensemble, ne varient que dans le sens du mieux .
Elle fait voir au contraire qu'une foule de causes, internes et externes, peuvent enrayer
ou faire dvier le dveloppement d'une ou de plusieurs sries, et, par contrecoup, celui
de toutes les autres. Si l'on considre les tat successifs qu'a traverss une partie du
monde antique (Espagne, Italie et Gaule), entre le 1er sicle de l're chrtienne et le
XIIe, il est difficile de soutenir que la marche vers le mieux y a t ininterrompue. A
quelque point de vue que l'on se place (conomique, intellectuel, moral, politique ou
autre), il est incontestable que le changement, dans l'ensemble, a t une rgression
plutt qu'un progrs. Donc, en vertu de la loi de solidarit des sries sociales, il a d
se produire simultanment une pjoration des rapports sociaux au point de vue moral,
et une obnubilation correspondante de la conscience morale et de l'ide de justice.
C'est en effet ce qui est arriv. La civilisation arabe, celle de l'Inde, celle de la Chine,
fourniraient des exemples analogues.
Ainsi le contenu variable des vrits morales ne subit pas, mme chez les peuples les plus civiliss, un processus ininterrompu d'puration. Il volue paralllement
l'volution gnrale de la socit. Il perd de ses anciens lments, il en acquiert de
nouveaux. Parfois il en perd que, de notre point de vue, il aurait mieux valu conserver, il en conserve qu'il aurait mieux valu perdre. Il en acquiert enfin qu'il aurait
mieux valu pour lui ne pas s'incorporer. Cette ventualit, toujours possible, ne serait
exclue que par le soin d'une Providence toute-puissante qui dirigerait l'volution
sociale : elle est parfaitement compatible avec le principe des conditions d'existence.
Par suite, la conscience morale d'un temps donn, fonction de l'ensemble de la ralit
sociale de ce temps, ne donnera jamais la formule gnrale de la justice un contenu
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 144
qui soit dans toutes ses parties digne du respect qu'elle exige pour lui. Par ce qu'elle
ordonne, par ce qu'elle interdit, et mme par ce qu'elle ne songe ni ordonner ni
interdire, elle retient ncessairement des traces plus ou moins importantes de ce qu'on
peut appeler la superstition et l'ignorance sociales de cette poque. Superstition - au
sens tymologique du mot -, toutes les fois qu'il s'agit de distinction de classes, d'obligations ou d'interdictions tablies anciennement, sous l'empire d'ides et de croyances
que la conscience rejette aujourd'hui, et qui persistent nanmoins. Ignorance, toutes
les fois qu'insuffisamment avertie par les faits, notre justice reste indiffrente des
droits naissants qui n'ont pas encore la force de s'imposer.
Il est vain d'imaginer que nous puissions tre dlivrs, comme par un coup de
baguette magique, de ces superstitions et de ces ignorances. Pour ce qui est de l'ignorance, l'impossibilit est manifeste. Comment pourrions-nous tre avertis des modifications de la justice qui seront exiges par des changements encore lointains et
peine dessins de l'ensemble des conditions sociales, alors que souvent nous ne discernons mme pas ceux qui sont tout prs de nous, et accomplis plus qu' moiti ? Ce
qui prouve une fois encore combien est chimrique l'ide d'une justice en soi, absolue
et immuable ; car la justice prend, chaque priode nouvelle de la vie sociale, une
forme que les priodes prcdentes ne pouvaient prvoir, et qui ne se serait jamais
ralise, si l'volution de la socit et t diffrente. On peut trs bien imaginer, par
exemple, que le rgime de la production capitaliste ne se ft pas tabli dans l'Europe
occidentale ; dans ce cas, une bonne part de ce qu'exige aujourd'hui la justice sociale
n'aurait jamais t conue. De mme, nous sommes aujourd'hui, quoi que disent la
plupart des conomistes libraux ou socialistes, dans une ignorance profonde du
rgime social qui se substituera au ntre dans un avenir plus ou moins loign, et, par
consquent, des modifications que le contenu des vrits morales devra subir.
Nous ne saurions donc remdier que fort peu notre ignorance.
Nous pouvons seulement (mais cela mme est loin d'tre ngligeable), faire une
tude aussi complte et aussi objective que possible de la ralit morale prsente.
Nous pouvons dterminer le sens, la force, le caractre socialement utile ou nuisible
des diffrentes tendances qui s'y combattent, des droits qui priclitent et des droits qui
naissent. Nous pouvons rendre ainsi les transitions moins pnibles dans les esprits,
moins douloureuses dans les faits, et contribuer obtenir que l'volution de notre
socit - s'il est trop ambitieux de parler de l'volution de l'humanit -, affecte autant
que possible la forme d'un progrs, et d'un progrs pacifique.
Quant aux superstitions (au sens o nous avons pris le mot tout l'heure),
nous ne saurions non plus les affaiblir que trs lentement, surtout les plus anciennes,
celles qui, se transmettant de gnration en gnration, ont fini par acqurir une force
comparable celle de l'instinct. Il ne faut pas d'ailleurs que ce mot de superstition ,
ou de survivance , fasse illusion. Nous ne l'entendons pas comme les philosophes
du XVIIIe sicle, qui condamnaient impitoyablement, au nom d'un idal rationnel
abstrait, toutes les traditions qui ne pouvaient se concilier avec cet idal. Les imiter,
ce serait de nouveau admettre cette morale naturelle , dont l'existence leur paraissait vidente, et qui nous a sembl incompatible avec la ralit des faits. Il ne s'agit
donc pas pour nous d'entreprendre une sorte de croisade rationnelle contre les
superstitions qui vivent encore dans notre conscience. De vrai, tout ou peu prs
tout y est superstition, puisque tout y est un hritage du pass, et d'un pass qui
remonte parfois au-del de l'histoire. Tout n'est pas dit quand on a montr que les
croyances qui sont l'origine d'une coutume taient mal fondes, que les raisons qui
ont conduit telle interdiction n'ont plus de sens nos yeux. Si cette coutume, si cette
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 145
interdiction ont eu des effets favorables au progrs de la socit, si elles se sont
mles si intimement sa vie qu'on ne saurait les en arracher sans la dchirer tout
entire, au nom de quel principe entre prendrions-nous de les draciner ? Pour tre
vraiment rationnelle, notre action sur la ralit sociale doit tre dirige, non pas par un
idal abstrait - qui prtend une valeur absolue, et qui exprime simplement les
exigences de la conscience morale d'aujourd'hui -, mais par les rsultats de la science.
Quand celle-ci aura dtermin, pour chacune des obligations de la conscience morale,
comment elle s'est tablie, fortifie, impose, quels effets elle a produits, et quelle
fonction elle a encore dans la vie sociale, nous saurons aussi dans quelle mesure il est
expdient - et possible - de la modifier. Ce sera l'emploi de l'art rationnel que nous
concevons comme l'application mthodique des rsultats obtenus par la spculation
morale devenue scientifique.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 146
CHAPITRE VIII
LE SENTIMENT MORAL
I
Les sentiments et les reprsentations sont insparables les uns des autres. L'intensit des sentiments n'est pas toujours proportionnelle la clart des
reprsentations. - En quel sens on peut faire une tude part des sentiments. Difficults spciales de cette tude. - Mthode employe par la sociologie
contemporaine. - Rsultats obtenus.
Retour la table des matires
On dit communment que, de rares exceptions prs, ce n'est pas la reprsentation qui dtermine la plupart des hommes agir, mais le sentiment. Les tendances
naturelles ou inclinations, les passions auxquelles les individus sont sujets, les besoins
dont ils ne peuvent s'affranchir, seraient les grands moteurs et rgulateurs de l'activit
humaine. C'est par eux qu'il faudrait s'en expliquer la direction gnrale et les
dcisions particulires, et non par des ides ou reprsentations. Celles-ci n'entraneraient gure l'action, hormis le cas, il est vrai trs frquent, o ces reprsentations sont
troitement lies des tendances puissantes et des sentiments qui veulent tre
satisfaits.
Nous n'avons pas entrer dans l'examen de cette thse psychologique. Nous ne
partons pas de la nature du sujet individuel, suppose connue, pour en dduire, par
voie dialectique, la manire dont il agit, ou la manire dont il devrait agir. Nous
sommes partisans d'une mthode tout autre, qui considre objectivement la ralit
sociale donne, qui l'tudie dans la civilisation o nous vivons, et qui compare celleci aux autres que nous pouvons connatre. En un mot, nous demandons que l'on use,
autant que les caractres propres de la ralit sociale le permettent, de la mme m-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 147
thode qui s'est montre si fconde dans les sciences de la ralit physique. Ds lors,
l'tude psychologique ou morale des sentiments, si intressante qu'elle soit
certains gards, ne fait point partie de la science qui nous occupe. Notre principe
directeur est de remonter des faits, dment analyss, leurs lois constantes, et des
effets, dment constats, aux forces qui les produisent. Si les instincts, les besoins, les
sentiments, et plus particulirement les sentiments dits moraux, sont au nombre de ces
forces, l'tude de la ralit sociale donne nous le fera connatre, et de la seule faon
qui soit scientifique, c'est--dire par la constatation et par la mesure de leurs effets.
A vrai dire, prendre les choses ainsi, on ne voit pas bien ce que peut tre le
sentiment , si on l'isole des reprsentations, des croyances et des coutumes. Si l'on
met part les besoins purement physiologiques, comme le manger et le boire, et
l'instinct fondamental et obscur du vouloir vivre , commun tous les organismes,
l'homme vivant en socit (et surtout dans les socits primitives) est dtermin
agir, non pas par des sentiments, en tant que distincts des ides et des reprsentations,
mais par des tats psychologiques complexes, o dominent des reprsentations nergiques et impratives. Cette nergie imprative se traduit pour lui par la conscience
trs vive qu'il faut faire telle action, qu'il faut s'abstenir de telle autre, et, s'il l'a
commise nanmoins, mme involontairement, par le repentir, le remords, et une horreur religieuse qui va jusqu' causer la mort. Quel sentiment plus puissant que le
respect du Polynsien pour son tabou ? Et cette puissance est-elle autre chose que le
caractre inviolable d'une certaine croyance, d'une certaine reprsentation collective,
en tant qu'elle s'impose certaines consciences individuelles du groupe ? Car le
tabou des nobles peut fort bien ne pas exiger le respect des plbiens ; les femmes,
dans la mme tribu, peuvent avoir les leurs, distincts de ceux des hommes, etc.
Par consquent, l'tude scientifique des reprsentations, croyances, coutumes,
murs collectives, comprend ipso facto celle des sentiments, du moins en tant que
celle-ci trouve une place dans la spculation morale proprement dite, c'est--dire dans
la connaissance scientifique de la ralit morale donne. Toutefois, ce sont l des faits
trs complexes. Ils se composent la fois, dans la conscience individuelle, de reprsentations et de croyances (c'est--dire d'images et d'ides lies d'une certaine faon),
de pratiques et d'usages (c'est--dire de sries de mouvements et d'actes conscutifs
ces reprsentations) ; et enfin de sentiments d'obligation, de repentir, de remords et de
respect. Il peut arriver que l'lment proprement reprsentatif s'affaiblisse, jusqu'
devenir indistinct et presque s'effacer, tandis que les pratiques et les actes subsistent,
toujours aussi fortement sentis comme obligatoires. On sera tent alors d'avoir
recours l' explication psychologique, selon laquelle ces pratiques auraient leur
principale origine dans le sentiment. Il n'en est rien pourtant, et une tude scientifique
ne manque point de restituer les lments reprsentatifs qui semblent avoir disparu.
Dans notre propre socit, ne voyons-nous pas le sentiment religieux - non pas un
sentiment vague et indtermin, mais un sentiment religieux spcifiquement catholique ou protestant, par exemple -, persister dans un grand nombre d'mes, aprs que la
croyance proprement dite s'est vanouie, et manifester sa persistance en mille occasions ; non seulement conserver l'attachement certaines pratiques, mais exercer son
influence sur la conduite en gnral ? Trs souvent, des croyances que nous ne pensons plus avoir sont encore des mobiles d'action, et, inversement, des convictions
nouvelles que nous croyons actives n'ont pas encore d'effet dans la pratique ; en sorte
que notre conduite relle ne rpond pas l'image intellectuelle que, trs sincrement,
nous pouvons avoir de nous-mmes. Nous continuons tre mus par d'anciennes
reprsentations et de vieilles croyances, alors que nous pensons les avoir abandonnes
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 148
pour d'autres que nous jugeons plus vraies. Il ne suffit pas que nous voulions les
quitter pour qu'elles nous quittent.
Ds lors, la clart des reprsentations et des croyances, le degr de distinction
qu'elles ont pour la conscience individuelle, la perception mme plus ou moins nette
de leur prsence ne peuvent tre pris pour la mesure de leur nergie en tant que
mobiles d'action. Car cette mesure dpend principalement de leur imprativit , et
celle-ci son tour dpend d'un grand nombre de conditions (historiques et actuelles),
qui n'ont rien de commun avec la clart et la distinction des ides. Or, cette imprativit se traduit dans chaque conscience individuelle sous la forme de sentiments,
qui poussent accomplir ou approuver certains actes, s'abstenir de certains autres
ou les blmer. En ce sens, mais en ce sens seulement, il y a lieu une tude des
Sentiments en tant que spars des reprsentations et des croyances ; en ce sens, des
sentiments anciens, traditionnellement respects, peuvent s'opposer des reprsentations et des croyances nouvelles. L'antagonisme, au fond, est bien plutt entre des
reprsentations anciennes, qui subsistent dans les actes et dans les sentiments dont
elles taient accompagnes, et des reprsentations plus rcentes, qui tendent introduire des actes et des sentiments nouveaux. Nous nous conformerons cependant au
langage courant, et nous considrerons, du moins dans leur forme gnrale, les actions et les ractions rciproques des sentiments et des reprsentations, mais en sousentendant toujours que nous ne concevons ni reprsentations sans sentiments, ni
sentiments sans reprsentations.
Il est vrai que cette tude prsente des difficults spciales. Les sentiments ne
laissent pas de traces immdiatement saisissables, ni de tmoignages objectifs de leur
existence, qui survivent cette existence mme. Le savant est oblig de les restituer
par un procd d'induction rtrospective souvent hasardeux. Sans doute, toute connaissance de nature historique, reposant sur un tmoignage, implique une interprtation psychologique, que les documents qui nous sont parvenus soient des inscriptions ou des monuments, des ouvrages crits ou des traditions, des actes publics ou
privs. Pourtant, quand nous avons la description dtaille des rites mortuaires ou
nuptiaux d'une socit donne, nous ne risquons pas beaucoup de nous tromper sur
les ides et les croyances qui taient associes ces rites ; et notre interprtation
approche de la certitude (s'il est permis de parler de certitude en pareilles matires),
quand nous pouvons la confirmer par des faits analogues dans d'autres socits
d'autres poques. De mme pour les mythes qui nous ont t conservs sous la forme
de textes anciens ou de traditions orales, ou pour les institutions familiales cristallises dans le droit. Mais des sentiments qui ont accompagn ces ides, ces croyances,
ces pratiques, ces institutions, qui les ont abandonnes peu peu, ou qui leur ont plus
ou moins survcu, rien ne subsiste, pour en faire directement connatre l'intensit, la
tonalit propre, ni mme, certains moments, la prsence. Ce sont les parties molles
des fossiles sociaux. Elles ont disparu, tandis que le squelette a demeur. Pour les
restituer, le sociologue se trouve en prsence d'un problme semblable celui qui se
prsente au palontologiste, quand du systme osseux retrouv il induit l'appareil
circulatoire disparu. Encore est-il craindre que la tentative du sociologue ne soit de
beaucoup la plus hardie. Car les rapports sur lesquels la palontologie fonde ses
raisonnements fournissent des analogies jusqu' prsent plus sres.
La prudence conseillerait donc, pour l'tude objective des sentiments moraux, de
se borner l'observation des socits civilises dont les murs, les croyances, les
religions, les institutions nous sont suffisamment connues, par une abondance assez
grande de documents et de tmoignages, pour que nous ne risquions pas beaucoup de
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 149
nous tromper dans la restitution des sentiments : sauf nous servir de la connaissance
des rapports ainsi obtenus entre les sentiments et les reprsentations, pour passer de
l, par infrence, ces mmes rapports, tels qu'ils ont d exister dans les socits plus
primitives. Mais cette mthode est loin d'tre pleinement satisfaisante. En premier
lieu, les civilisations historiques les plus anciennes que nous connaissions sont dj
fort compliques et probablement trs vieilles. Bien que nous remontions 4 000 ans
avant l're chrtienne en gypte, et jusqu' 6 000, dit-on, en Assyrie-Babylonie, nous
nous trouvons, dans cette Antiquit en apparence si recule, en prsence d'une
organisation politique, conomique, juridique, religieuse, qui suppose avant elle des
sicles de formation, sur lesquels nous ne savons rien. Et, par suite, elle ne nous
instruit pas beaucoup plus sur les rapports des sentiments moraux avec les autres
sries de phnomnes sociaux, que ne peut le faire l'tude approfondie des civilisations classique et smitique d'o les ntres sont sorties.
En outre, le problme capital ici n'est pas, comme en palontologie, une question
d'anatomie ou de classification ; c'est un problme surtout historique, comme le veut
la nature du sujet tudi. Ce qui importerait avant tout, ce serait de savoir comment
les sentiments moraux, que nous trouvons tablis et prdominants dans les civilisations historiques les plus anciennes, y ont pris l'ascendant que nous les voyons y
exercer. Or ce n'est pas l'analyse de ces civilisations mmes qui pourra jamais nous
l'apprendre. Tout au plus nous suggrera-t-elle des hypothses, pratiquement invrifiables. Rien ne sert de remonter par voie d'infrence, quand toute donne fait dfaut
pour vrifier si la gense ainsi suppose est exacte.
Nous n'aurions donc aucun moyen de sortir d'embarras, si, outre les socits historiques, et les socits, inconnues de nous, qui les ont prcdes, il n'en existait
d'autres, d'un type infrieur, dont quelques-unes nous ont t dcrites avec une exactitude et une abondance de dtails trs suffisantes : par exemple, les socits aborignes
de l'Australie, certaines tribus de l'Amrique du Nord, de l'Inde, de l'Afrique, de la
Polynsie, de la Mlansie, etc. En mme temps que l'on peut encore constater l, de
visu, des institutions disparues ailleurs, mais ayant laiss des traces encore visibles,
comme le totmisme, on y observe aussi des sentiments moraux dont une analogie
lgitime peut faire admettre l'existence dans les civilisations prhistoriques. Nous
trouvons l, sinon un quivalent, du moins un succdan trs prcieux des socits
dont il ne nous reste rien ou peu prs rien, except, peut-tre, des sentiments et des
habitudes mentales indchiffrables pour nous-mmes. Par l'tude attentive des murs,
des religions, des sentiments dans ces socits infrieures, nous acqurons les donnes les plus prcieuses pour la restitution de l'tat moral et mental d'une humanit
relativement primitive, restitution que l'effort le plus ingnieux et le plus opinitre
n'aurait jamais pu raliser en partant uniquement de l'humanit observe dans les
civilisations historiques. Une fois tablie, cette restitution, mme sommaire, clairerait en nous un fond de sentiments si anciens, qu'ils ne nous paraissent mme pas
obscurs. Lumen index sui et tenebrarum. Ceci n'est plus un schme purement idal,
une simple vue de l'esprit ; le travail est dj commenc.
Des rsultats obtenus par la sociologie contemporaine, il ressort que les cadres
ordinaires de la psychologie traditionnelle ne s'appliquent pas, sans de profonds
changements, aux phnomnes psychiques tels qu'ils se produisaient dans les socits
primitives. Cette psychologie se place d'emble et demeure constamment au point de
vue de la conscience individuelle. Ce caractre est si marqu que les philosophes
insistent d'ordinaire sur l'impossibilit de concevoir comment les consciences communiquent entre elles. Ils ont mme tir de l le nom d'une espce particulire d'ida-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 150
lisme (solipsisme). Un artifice dialectique leur permet ensuite de retrouver, sans
compromettre l'unit irrductible de chaque conscience, l'universalit dont semble
dpendre la valeur objective des vrits scientifiques et morales - sujet universel uni
au sujet individuel ; raison impersonnelle ; harmonie des monades, etc. Toutes ces
hypothses deviennent superflues dans la psychologie qui nous occupe. En effet, elle
n'a pas de raison de s'enfermer dans la conscience individuelle. Elle ne rapporte
primitivement cette conscience que les faits de sensation proprement dits, et ceux
qui rsultent des impressions faites sur les sens, plaisir ou douleur, faim, soif, blessures, etc., ceux, en un mot, qui provoquent une raction plus ou moins immdiate de
l'organisme. Mais tous les autres faits psychologiques, conceptions, images, sentiments, volitions, croyances, passions, gnralisations et classifications, elle les
considre comme tant collectifs en mme temps qu'individuels. L'individu, dans une
socit infrieure, pense, veut, imagine, se sent oblig, sans s'opposer par la rflexion
aux autres membres du groupe auquel il appartient. Les reprsentations qui occupent
sa pense encore confuse lui sont communes avec eux, de mme que les motifs
habituels de ses actions. La conscience est vraiment celle du groupe, localise et
ralise dans chacun des individus.
S'il en est ainsi, le problme qui se posait aux psychologues se renverse. On ne
demande plus : des consciences individuelles tant donnes, qui existent pour ellesmmes seulement, comment est-il possible qu'elles communiquent entre elles ? problme qui ne comporte peut-tre pas de solution, sinon par la mtaphysique. La
question prend la forme suivante : tant donn, dans chaque individu, des sries de
faits psychiques de caractre collectif, comment se constituent, par voie de diffrenciation progressive, des consciences vraiment individuelles ? Cette question est positive ; elle comporte videmment une solution scientifique. Car il ne s'agit que d'une
individualit relative. Ces faits psychiques ne perdront jamais tout fait leur caractre
collectif original, qui est entretenu, dvelopp mme, certains gards, par la multiplication des rapports entre les tres humains d'un mme groupe, et particulirement
par les progrs du langage. Mais on conoit que, en raison mme de ces progrs, la
conscience de l'individu existant de plus en plus pour soi l'ait amen se poser en
s'opposant , comme disent les mtaphysiciens.
Ainsi, l'individualit psychique existant pour elle-mme n'est pas une sorte
d'absolu, qui oblige la rflexion aux paradoxes les plus audacieux de l'idalisme ou du
panthisme, si l'on veut comprendre les rapports des moi entre eux et avec le
milieu o ils vivent. Ces difficults proviennent de ce que le mtaphysicien ou le
psychologue substitue la ralit de la vie mentale son moi abstrait et clos. C'est
un autre aspect de ce que M. James appelle la psychologist's fallacy. Pour y chapper,
il est ncessaire, mais il suffit, de ne pas mconnatre le caractre primitivement social
de tout ce qui est proprement humain en nous. Il ne faut pas expliquer l'humanit
par l'homme, disait dj Comte, mais au contraire l'homme par l'humanit. Cette
formule peut tre considre comme acceptable, si on l'applique l'tude des faits
psychiques, condition de la restreindre de la faon suivante : Il ne faut pas partir
des consciences individuelles pour expliquer ce qu'il y a de commun dans la vie
psychique des individus d'une socit donne, mais chercher au contraire la gense de
ces consciences individuelles en partant de la conscience collective.
L'emploi de cette mthode scientifique a pour consquence immdiate de tirer les
socits humaines de la position isole o les met la psychologie traditionnelle, et de
les replacer au sommet de l'chelle animale. Car la vie psychique primitive des
groupes humains, ainsi conue, ne diffre plus en nature, mais seulement en degr, de
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 151
la vie psychique considre dans les socits animales, surtout dans celles dont les
individus se rapprochent le plus de l'homme par leurs habitudes et par leur manire de
vivre. M. Espinas a excellemment montr comment, dans ces socits, la conscience
individuelle de chaque membre du groupe est troitement subordonne la vie mme
de ce groupe ; d'o il suit qu'il est permis de parler de conscience collective et de
prendre le groupe pour le vritable individu. Nous pouvons admettre, avec une
vraisemblance proche de la certitude, que dans les groupes humains qui diffraient
autant des socits australiennes que nous diffrons d'elles, l'individu n'existait gure,
mentalement, pour lui-mme , n'avait gure conscience, si l'on ose dire, de sa conscience individuelle, et que sa vie psychique tait de nature presque purement collective.
II
Analyse sociologique du sentiment d'obligation, dans son rapport avec les reprsentations collectives. - Critique de l'ide de sentiment moral naturel .
Exemple de la pit filiale chez les Chinois. - Comment des sentiments contradictoires peuvent coexister indfiniment dans une mme conscience. - La force
de persistance des sentiments est plus grande que celle des reprsentations. Exemples pris de notre socit.
Retour la table des matires
S'il en est ainsi, nous sommes munis dsormais d'une mthode gnrale, d'un fil
conducteur , pour l'analyse des sentiments moraux que nous constaterons, directement ou indirectement, dans une socit donne. Bien que la conscience de chacun
les prouve comme originaux et personnels, comme naissant d'elle-mme , surtout
dans les socits les plus civilises, o l'individu se considre comme autonome ,
et comme lgislateur du monde moral, nous les tiendrons pour collectifs en
principe, et pour lis aux croyances, aux reprsentations, aux passions collectives qui
se maintiennent dans cette socit depuis un temps indfini. Nous nous expliquerons
par l le caractre d'universalit que la conscience morale de chacun attribue ses
propres ordres, ou pour mieux dire, qu'elle exige pour eux. Car ce caractre d'universalit n'est que la traduction logique du sentiment imprieux, li lui-mme la
reprsentation collective, qui commande tel acte comme bon, interdit tel autre comme
mauvais, et qui s'indigne l'ide de toute infraction, qu'elle soit le fait d'autrui ou le
ntre. Dans ce dernier cas, le sentiment prend, comme on sait, la forme particulire du
remords, de la honte, ou d'une horreur sacre.
Il semble naturel d'admettre que le processus de dveloppement, qui a fait passer
les socits humaines d'un tat analogue celui o nous voyons les Australiens
l'tat des civilisations occidentales, s'est exerc sur les sentiments au mme titre que
sur les croyances et sur les institutions. De mme que les individus ont d prendre une
conscience d'eux-mmes de plus en plus nette, bien que la socialisation de chaque
esprit n'ait fait que crotre, puisque l'hritage commun d'ides, de connaissances, de
gnralisations acquises et cristallises dans le langage s'est augment presque conti-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 152
nuellement ; de mme, quoique la continuit et la solidarit sociales deviennent de
plus en plus conscientes mesure que les socits sont plus diffrencies et plus
complexes, chaque individu nanmoins prouve davantage comme siens les
sentiments moraux. Rien ne lui parat plus caractristique de sa personne que le degr
de vivacit en lui de ces sentiments, qu'il ne spare pas de sa conscience morale. Plus
d'un philosophe s'est complu opposer la raison et la science impersonnelles
le sentiment du devoir et le mrite moral, ncessairement lis l'effort personnel de
l'individu. En fait, la ralisation progressive de la personnalit morale par la vertu
propre de son ide est incontestable ; mais elle ne doit pas faire mconnatre tout ce
qui reste de collectif dans les sentiments moraux qui sont parties intgrantes de cette
personnalit morale, et qui en sont mme le principal ressort. Sentiment du devoir,
sentiment de la responsabilit, horreur du crime, amour du bien, respect de la justice :
tous ces sentiments, qu'une conscience dlicatement diffrencie au point de vue
moral croit tirer d'elle-mme, et d'elle seule, n'en sont pas moins d'origine sociale.
Tous puisent leur force dans les croyances et dans les reprsentations collectives qui
sont communes tout le groupe social.
Presque toujours les plus profonds de ces sentiments sont aussi les plus gnraux
et les plus anciens. Plus encore que les croyances et les coutumes correspondantes, ils
tmoignent d'une continuit ininterrompue entre notre socit et celles qui l'ont
prcde, mme celles dont nous avons perdu jusqu'au souvenir, et qui appartiennent
la prhistoire. Cette Antiquit si recule est prcisment ce qui assure ces sentiments moraux la force irrsistible propre ce qui se prsente comme naturel,
instinctif, spontan. Ce fait n'a pas chapp aux philosophes. Ils l'ont expliqu
leur manire. Les uns ont dit que les principes moraux et le sentiment de l'obligation
morale taient a priori ; d'autres ont cru constater l'existence en nous d'un sens
moral inn ; d'autres enfin ont pens que l'homme, sociable par nature, tait donc
aussi moral par nature. C'tait avouer, implicitement, le caractre la fois collectif et
trs ancien des ractions sentimentales qui ne manquent pas de se produire chez un
membre d'une socit donne, quand lui-mme ou d'autres membres du groupe ont
agi soit conformment soit contrairement aux croyances communes et aux exigences
traditionnelles de cette socit.
De l sortent plusieurs consquences importantes :
1 Puisque les sentiments moraux d'une socit donne dpendent de la faon la
plus stricte de ses reprsentations, de ses croyances et de ses coutumes collectives, ils
sont chaque moment ce que ces reprsentations, ces coutumes et ces croyances
(prsentes et passes) exigent qu'ils soient. Si ces reprsentations tmoignent d'une
imagination enfantine, incapable de faire nettement le dpart entre ce qui est rel,
objectif, et ce qui est chimrique, subjectif, si ces croyances paraissent absurdes et
contradictoires notre logique, si ces coutumes sont pour la plupart irrationnelles, et
un obstacle plutt qu'une aide au progrs social, par quel miracle les sentiments seuls
prsenteraient-ils des caractres diffrents, et seraient-ils proprement moraux , au
sens o notre conscience d'aujourd'hui prend le mot ? En fait, le principe des conditions d'existence s'applique encore ici. Toute socit viable vit, avons-nous dit, aussi
longtemps qu'elle offre une rsistance suffisante aux causes de destruction externes et
internes, si misrable, si mal btie, si mdiocrement organise qu'elle soit, si
surabondante que s'y accumule la somme des souffrances inutiles et du labeur perdu.
Le principe vaut, non seulement pour chaque socit considre dans son ensemble,
mais pour chaque srie de phnomnes sociaux prise part, par consquent aussi pour
les sentiments, dans la mesure o l'on peut les considrer isolment. Ceux-ci sont,
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 153
chaque priode, prcisment ce qu'ils peuvent tre d'aprs l'ensemble des conditions
donnes : ce qui est compatible, comme l'exprience le prouve, avec un niveau fort
bas. Il n'y a donc pas plus de sentiment moral naturel qu'il n'y a de morale
naturelle .
Sans doute, si les sentiments collectifs d'un groupe donn tendaient la destruction de ce groupe, il cesserait bientt d'exister. Du fait mme que les socits humaines sont durables, il suit que les sentiments collectifs de leurs membres ne sont pas
essentiellement antisociaux. Mais cette constatation est fort loin d'exclure la prsence,
dans ces socits, de sentiments collectifs oppressifs, sanguinaires, horribles, absurdes, comme la ralit sociale mme dont ils font partie et qu'ils contribuent conserver. L'emploi de la mthode comparative vrifie sans peine cette conclusion. L'infanticide (surtout commis sur des enfants du sexe fminin), les sacrifices humains, les
mauvais traitements infligs aux femmes, aux esclaves, aux classes infrieures, les
interdictions de toutes sortes fondes sur des superstitions, nous montrent dans un
grand nombre de socits le sentiment collectif tolrant, ou mme commandant de
faon catgorique des actes que notre conscience actuelle juge immoraux .
Mme dans des socits de civilisation avance, comme la Chine, nous constatons
la solidarit de croyances et de coutumes irrationnelles avec des sentiments collectifs
intenses, qui sont regards comme des sentiments moraux par excellence. Telle est la
pit filiale des Chinois, si singulire aux yeux des Europens, d'un dvouement
admirable, selon les uns, d'un gosme mprisable, selon les autres : implique en
ralit dans tout un rseau de MURS et de croyances traditionnelles depuis la plus
haute Antiquit. Il n'y a pas, aux yeux des Chinois, de plus grand malheur que d'tre
priv, aprs sa mort, du culte qui est ncessaire l'me pour qu'elle demeure en paix.
En outre, tout esprit qui ne reoit point cette satisfaction est dangereux pour les
vivants, surtout pour ceux qui devraient la lui assurer. Le culte de ses ascendants
morts est ainsi, pour le Chinois, le premier et le plus urgent des devoirs, et la pit
filiale, la premire des vertus. Mais aussi sa plus vive proccupation est d'avoir le
plus tt possible des descendants mles, seuls qualifis pour lui rendre, leur tour, les
devoirs qu'il remplit. Il veut tre crancier au mme titre qu'il est dbiteur, et savoir
avec certitude que, s'il meurt, la pit filiale de ses enfants lui rendra ce qu'il a fait luimme pour ses propres parents. De l, les mariages prcoces ; de l, la surpopulation
qui occasionne la plus pouvantable misre, presque dans tout l'empire, malgr la
fertilit du sol, malgr l'industrie, la patience et la sobrit des habitants ; de l, les
horribles famines et les morts par milliers, pour peu que la rcolte ait t mauvaise.
L'observateur tranger, missionnaire ou laque, s'avoue le plus souvent impuissant
indiquer un remde au mal. Sentiments, croyances et murs sont si troitement lis,
que personne ne sait quelle mthode il serait prfrable de suivre. Attaquer les
croyances relatives aux esprits des anctres ? - Mais le sentiment collectif qui y est
attach de temps immmorial les rend pratiquement invulnrables. Il semble aux
Chinois, si l'on veut les leur ter, qu'on les dmoralise. Les jsuites, dit-on, tolrent
tacitement ces croyances chez leurs nophytes. S'en prendre aux sentiments ? Tentative inutile, tant que les croyances subsistent. Nous voyons l, avec la plus
parfaite vidence, comment les sentiments moraux, troitement solidaires de certaines
reprsentations et croyances collectives, leur donnent et leur empruntent la fois tant
de force qu'ils deviennent peu prs indracinables, mme lorsqu'ils sont, tout bien
pes, plus nuisibles qu'utiles socialement. Il serait facile de montrer que d'autres
singularits des sentiments moraux chez les Chinois (manque de sympathie, rsignation passive leur sort, etc.), sont de mme lies l'ensemble des conditions gnrales de leur socit.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 154
Dans nos propres sentiments moraux, rien ne nous surprend ni ne nous choque,
puisqu'ils sont ntres. Leur accord apparent avec nos reprsentations collectives, avec
nos croyances et nos coutumes, empche que rien nous y paraisse bizarre, inconsistant, nuisible ou surann. Mais le tmoignage spontan que notre conscience se rend
elle-mme n'est pas dcisif. Il ne prouve pas plus que celui d'une conscience chinoise
en faveur de sa propre moralit. Nous savons, au contraire, que ces sentiments font
partie de l'ensemble des phnomnes qui constituent la vie de notre socit, qu'ils sont
solidaires des phnomnes des autres sries, qu'ils participent leurs caractres, et
que, pour les connatre, il ne faut rien de moins qu'une tude sociologique des principales de ces sries, tude qui est peine bauche. Loin donc que nous puissions
trouver dans nos sentiments une norme pour nos jugements, nous ne sommes pas en
tat de juger de nos sentiments mmes. Ils emportent, il est vrai, notre action le plus
souvent, ou bien, si nous agissons en sens contraire, les sentiments moraux lss
provoquent en nous-mmes une raction douloureuse. Mais ce pouvoir qui leur
appartient, nous le trouvons aussi fort dans le sentiment du tabou chez le Polynsien.
Il ne suffit pas de l'invoquer pour les lgitimer. Ils valent prcisment ce que vaut la
ralit sociale dont ils sont la fois une expression et un soutien.
2 Nous ne pouvons tre srs non plus de l'homognit de nos sentiments
moraux, bien que rien en nous ne nous avertisse d'en douter. Il est vrai, tout ce qui est
vivant dans la conscience morale est conserv par elle au mme titre, sinon avec la
mme nergie. Mais la considration objective des sentiments existant une poque
donne nous convaincra bientt que cette homognit n'est qu'apparente 1. Elle
n'existe nullement pour les croyances, ni pour les reprsentations collectives qui les
sentiments sont troitement lis : elle n'existe donc pas non plus pour ceux-ci. Mme
en supposant entre les conceptions et les croyances collectives une cohrence, une
harmonie logique que l'on n'a encore trouve dans aucune socit - la ntre en est
loin, et les meilleurs esprits de notre temps sont partags entre des penses et des
conceptions souvent fort disparates -, il ne suivrait pas de l que les sentiments aussi
fussent harmoniques entre eux. Car, la force de persistance des sentiments collectifs
tant suprieure celle des reprsentations collectives, ils peuvent se maintenir indfiniment, avec les coutumes et les murs, aprs que les croyances dont ils taient
solidaires ont fait place d'autres. Ils semblent alors exister pour eux-mmes, bien
que, dans un temps dont le souvenir s'est perdu, ils aient eu leur raison dans l'ensemble des conditions sociales, et en particulier dans les reprsentations collectives 2.
En outre, il est vrai que des conceptions et des croyances contradictoires peuvent
coexister longtemps sans que les esprits en souffrent, c'est--dire sans qu'ils s'en aperoivent. Nanmoins, dans les socits qui ne sont pas intellectuellement stagnantes,
les contradictions une fois connues sont condamnes disparatre, et l'exprience qui
s'enrichit finit par liminer les reprsentations incompatibles avec elle. Le progrs des
sciences amne une adaptation de plus en plus approche des conceptions gnrales
la ralit objective. Au contraire, ni la logique ni l'exprience ne peuvent rien sur la
coexistence de sentiments opposs dans une mme conscience, aussi longtemps
qu'elle les prouve. Par suite, le processus de modification des sentiments est, en gnral, plus lent que celui des reprsentations. Ajoutez que les sentiments sont troite-
1
2
Voyez plus haut, chap. III, II.
Voyez: mile DURKHEIM, La prohibition de l'inceste, Anne sociologique, I, 1898, p. 1-70,
Paris, F. Alcan.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 155
ment lis l'accomplissement physique des actes, c'est--dire aux mouvements. Ils
participent par l du caractre organique des habitudes.
L'imagination collective, qui a produit les mythes et les cosmogonies religieuses,
trahit dj la mme indiffrence la contradiction logique. Elle admet en mme
temps, et sans y voir de difficult, que Dieu est un et qu'il y a plusieurs dieux ; que
Dieu est le monde, et qu'il est hors du monde qu'il a cr la matire et qu'elle est
ternelle comme lui que l'me fait la vie du corps, et qu'elle lui est entirement trangre ; qu'elle subit le contrecoup de tout ce qui lui arrive, et qu'elle est loge en lui
comme un principe inviolable. Elle en affirme au mme moment l'immanence et la
transcendance. A plus forte raison, les sentiments qui accompagnaient certaines reprsentations collectives peuvent-ils subsister, quand celles-ci sont remplaces par
d'autres. Un grand fait est trs significatif cet gard : le long temps que les religions
durent encore, aprs que la dcomposition intellectuelle en est acheve. Elles continuent pendant des sicles rsister aux assauts les plus violents ; elles ont mme
parfois des retours de vigueur apparente, alors que les dogmes ont perdu leur prise sur
les esprits cultivs. D'o vient cela, sinon de la persistance presque indfinie des
sentiments collectifs attachs aux symboles, aux gestes, aux crmonies, aux monuments, aux chers souvenirs de toute sorte que ces religions reprsentent, et qui ne
veulent tre satisfaits que par elles ?
Ainsi, parmi les sentiments collectifs que notre conscience nous prsente comme
moraux, il s'en trouve de fort anciens mls d'autres plus rcents. L'tude de leur
gense, de leur ordre d'apparition et de leurs rapports appartient la science de la
ralit sociale qui commence se constituer. Mais on peut noncer, ds prsent, une
sorte de loi que l'exprience n'a jamais dmentie. Quand un sentiment moral est accompagn, dans la conscience individuelle, des reprsentations et des croyances dont
il est solidaire, nous ne pouvons rien prjuger sur la date laquelle il s'est form. Si,
au contraire, le sentiment moral collectif s'impose purement et simplement, au nom
de la conscience, et avec une autorit qui prtend se suffire elle-mme, il est penser que l'origine en est fort ancienne. Deux hypothses se prsentent alors, entre
lesquelles l'examen des faits doit dcider. Ou bien les reprsentations collectives
contemporaines de ce sentiment subsistent comme lui, mais affaiblies, et peine
perceptibles la conscience individuelle, d'o cependant elles n'ont pas tout fait
disparu. Ou elles se sont entirement diffrencies et transformes, tandis que le
sentiment continuait se transmettre de gnration en gnration avec les murs et
les coutumes. Ce dernier cas comprend les sentiments collectifs puissants que nous
sommes hors d'tat la fois de nous expliquer nous-mmes et de ne pas prouver
trs vivement, tellement que nous serions suspects autrui et dgrads nos propres
yeux, si nous cessions de les ressentir. Beaucoup de criminels sont atteints d'une
insensibilit spciale, qui n'est que l'absence chez eux de sentiments collectifs intenses dans notre socit. Peut-tre ce trait de leur nature inspire-t-il plus d'horreur
encore et de dgot que leur crime mme. A son tour, l'homme normal qui prouve
cette horreur et ce dgot, transport au milieu de ngres et de Chinois, fera preuve
d'une insensibilit semblable. Mais il ne se croira pas criminel, parce que, dans ces
conditions nouvelles, le sentiment collectif se tait.
3 L'volution des sentiments collectifs, quoique solidaire de celle des croyances
et des reprsentations collectives, ne la suit pas pari passu. Elle est gnralement plus
lente. Cette consquence se tire de ce qui vient d'tre dit ; elle peut aussi tre constate directement. Par exemple, les prjugs relatifs l'esprit de cit et l'esclavage ont
t battus en brche dans l'Antiquit, ds le IVe sicle avant l're chrtienne, par les
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 156
philosophes socratiques, et en particulier par les cyniques. Au ,je sicle, les stociens
ont montr, en termes admirables, dont la nettet n'a jamais t surpasse, que tous les
hommes sont au mme titre des citoyens, gaux en droit, dans la cit de Jupiter, et
que le genre humain forme une socit unique, o tous sont frres, sans distinction
d'origine ni de condition sociale. A Rome, au 1er sicle de l're chrtienne, Snque a
parl de la dignit humaine des esclaves comme un philosophe du XVIIIe sicle aurait
pu le faire. Il est croire cependant que cet ensemble d'ides humanitaires n'a pas t
immdiatement accompagn d'une modification dans les sentiments moraux : car
l'esclavage, avec ses consquences juridiques et morales, s'est maintenu jusqu' la fin
du monde antique.
L'influence des conceptions philosophiques ne se fit sentir que tardivement, lorsque quelques changements furent introduits dans la condition lgale des esclaves par
les jurisconsultes romains du je et du ,le sicle de l're chrtienne. Sans doute, les
sentiments collectifs s'taient modifis peu peu ; mais le changement restait trop
faible pour contrebalancer les murs traditionnelles, que le spectacle journalier de
l'ordre social tabli tendait conserver. Tacite raconte que, sous le rgne de Nron, un
patricien fut trouv un jour assassin dans sa maison. Tous les esclaves qui y habitaient, au nombre de plusieurs centaines, furent mis la question, conformment la
loi, et excuts. Tacite ajoute que ces mesures barbares provoqurent dans la population romaine une explosion de sentiments indigns, et une vritable meute. Ainsi,
dans des circonstances exceptionnelles, la modification du sentiment collectif
l'gard des esclaves clatait au grand jour; mais, dans le courant ordinaire de la vie,
elle tait encore insuffisante pour dterminer le changement d'un tat social incompatible avec les ides nouvelles, bien que ces ides fussent trs rpandues, et
gnralement acceptes.
Dans notre socit contemporaine, les occasions ne manquent pas de constater un
retard analogue des sentiments collectifs sur les conceptions. Tel est le cas, par
exemple, pour l'ide et le sentiment de la justice sociale dans les questions touchant
au droit de proprit. Il y a un sicle peu prs, l'conomie politique des Ricardo et
des J.-B. Say ne rencontrait gure de contradicteurs ce sujet. Elle expliquait qu'en
vertu des lois naturelles - ce mot, dans le langage de l'conomie classique, signifie
la fois ncessaires et providentielles -, la rpartition des richesses ne saurait
tre autre qu'elle n'est dans notre socit. Bien que la richesse soit le produit du
travail, il faut qu'il y ait d'une part des capitalistes, en nombre restreint, et de l'autre
des millions de proltaires qui la loi des salaires ne permet, en gnral, que de
gagner juste de quoi ne pas mourir de faim. Ils vivent d'ailleurs, du moins tant que les
crises commerciales et industrielles ne sont pas trop aigus ni trop prolonges ; ils
sont accoutums leur condition, l'argent ne fait pas le bonheur, etc. Bref, ce moment, il y a une harmonie suffisante entre les conceptions les plus rpandues et les
sentiments collectifs, dont l'conomiste est l'interprte parfois candide. L'entrepreneur
n'prouve point de scrupule rduire le salaire de l'ouvrier au strict minimum dont
celui-ci peut vivre. En exigeant, pour ce salaire, la plus grande somme de travail
possible, il ne croit pas tre injuste, puisqu'il paye le prix convenu, et que d'ailleurs
l'conomiste lui assure que sa ruine est certaine s'il agit autrement. Le sentiment
gnral ne se soulve pas contre cette thorie, qui parat naturelle , comme la
prtendue loi sur laquelle elle se fonde.
Cependant, au cours du XIXe sicle l'conomie politique orthodoxe est battue en
brche de tous cts, et ses dogmes ne paraissent plus soutenables. Tous les thoriciens finalement - except un petit groupe de conservateurs irrductibles -, admettent
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 157
que la proprit, selon l'expression de Comte, est de nature sociale , et que, par
consquent, la rpartition de cette proprit ne peut pas exclure, a priori, tout contrle, toute intervention de l'tat. Non seulement les droits de coalition et de grve
sont reconnus aux ouvriers, mais une lgislation se dveloppe, chez les peuples les
plus avancs, qui rglemente les heures du travail, surveille l'hygine des ateliers,
protge les femmes et les enfants, autorise les syndicats, etc. A ce changement dans
les ides, dans la lgislation, devrait correspondre, semble-t-il, un changement corrlatif dans les sentiments. Et, en effet, on en discerne quelques symptmes. On
n'entend parler que de solidarit sociale. Ce beau mot, dont le sens reste vague pour la
plupart de ceux qui l'entendent et qui l'emploient, est devenu pour les hommes politiques ce que les comdiens appellent un effet sr . Personne n'ose plus soutenir tout
haut, avec l'inconscience doctrinale de nagure, que la misre noire, que la dtresse
physique et mentale de toute une population ouvrire soient les consquences ncessaires d'une loi naturelle aussi inluctable que les lois de la pesanteur. Au contraire,
devant un fait particulirement saisissant - par exemple devant le suicide collectif
d'une famille d'indigents qui ne trouvent pas de travail, et qui ne savent pas mendier -,
les journaux les plus dvous la dfense de la richesse acquise sont les premiers
proclamer que c'est une honte , que dans une socit comme la ntre, o les
moyens de production surabondent, o la plthore des produits est parfois mme si
incommode, c'est un scandale public que des gens se tuent parce qu'ils ont faim et
froid. Pourtant, le sentiment qui clate cette occasion manque encore, sinon de sincrit, du moins de profondeur. Il consiste surtout en une sympathie demi physiologique, excite par le spectacle d'un malheur mouvant. Cette sympathie est soigneusement entretenue par la presse, qui s'empare des hros du drame, et qui agit sur les
nerfs du publie en multipliant les dtails et les images ralistes.
Mais cette explosion momentane, comme l'meute rapporte par Tacite, ne prouve point que l'ancienne faon de sentir soit profondment modifie. Si l'on sentait
vraiment que l'on est en prsence d'une injustice sociale, dont tous les membres de la
socit sont personnellement responsables, puisqu'ils contribuent, par leur consentement constant ses institutions prsentes, la maintenir telle qu'elle est, comment
resterait-on indiffrent tant d'autres misres, moins dramatiques, il est vrai, mais
innombrables, journalires, incessantes, aussi injustes, aussi inhumaines que celle-l,
et dont le spectacle ne touche peu prs personne ? Par exemple, les journaux de
Paris publient chaque semaine le bulletin sanitaire de la ville. On y voit que la diphtrie, la rougeole, la scarlatine, ou la typhode, sont frquentes comme chaque anne
en cette saison , et les cas mortels assez nombreux, mais presque tous dans les
arrondissements de la priphrie , ceux du centre restant indemnes. Cette constatation est fort agrable aux lecteurs aiss des arrondissements du centre, qui adorent
leurs enfants. Ils ne songent pas se demander ce qu'en pensent les pres et les mres
dans les arrondissements de la priphrie. Ils admettent tacitement, comme tant dans
l'ordre des choses, que les pauvres gens, gagnant fort peu, soient mal logs, mal
nourris, mal chauffs, que leurs enfants soient plus accessibles aux contagions, moins
bien soigns, et plus exposs mourir. Ils sont donc demeurs dans l'tat sentimental,
et, par suite, doctrinal, des classes possdantes du sicle dernier. Navement, ils
jugent naturelles et providentielles les conditions sociales o ils sont privilgis.
Le commerant retir des affaires avec une honnte aisance, qui jouit de ses
rentes en parfaite tranquillit de conscience, et qui n'est troubl dans cette jouissance
ni par la pense ni mme par la vue des misres, des souffrances, et des injustices
sociales qui pullulent autour de lui, n'est pas un monstre de cruaut. Mais il n'prouve
que les sentiments traditionnels, et les sentiments traditionnels le confirment dans
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 158
l'ide que l'tat actuel des choses est normal, que l'argent qu'il a gagn est bien
lui , et qu'il ne fait tort personne en le dpensant sa guise. L'ancienne manire de
sentir soutient l'ancienne notion de la justice, tandis que la nouvelle notion de la
justice n'a pas encore la force de faire prvaloir une nouvelle manire de sentir, du
moins dans la plupart des consciences. Et le mme processus se rptant au sujet des
autres sentiments collectifs, relatifs la religion, la patrie, la libert politique, etc.,
des conflits doivent clater, longs et douloureux. Les socits humaines ne savent
jusqu' prsent que les subir, faute d'en discerner les causes et les lois.
III
nergie des ractions que les sentiments moraux dterminent. - Rien de plus
difficile modifier que les sentiments collectifs. - Sentiments religieux se
portant chez les Anciens sur toute la nature, chez les Modernes sur la nature
morale seulement. - Signification, ce point de vue, de la religion de l'Humanit.
- Comment nous pouvons restituer la conception sentimentale, aujourd'hui
disparue, de la nature physique.
Retour la table des matires
Les sentiments moraux collectifs, bien que solidaires des reprsentations et des
croyances collectives, au point de n'en pouvoir tre spars que par abstraction, se
montrent donc particulirement stables. Ils suivent le mme processus d'volution
(qui n'est pas toujours un progrs) ; mais ils le suivent d'un mouvement plus lent, et
avec une difficult plus grande se dtacher du pass. C'est une srie, si l'on ose dire,
conservatrice par excellence : c'est surtout grce elle que se perptuent, dans un
groupe donn, les superstitions sociales dont il a t question au chapitre prcdent.
Les sentiments collectifs traditionnels forment avec les coutumes et les croyances des
amalgames presque indissolubles, et si bien fondus qu'il est impossible d'y faire la
part de chaque lment, et de dire si c'est plutt le sentiment qui entretient l'habitude
et la croyance, ou la croyance et l'habitude qui entretiennent le sentiment.
La puissance propre des sentiments se manifeste encore par l'intensit des ractions qu'ils dterminent. Dj l'homme qui pense d'une autre faon que les autres,
mme sur un problme qui ne touche pas immdiatement l'action et que tous sont
capables de considrer sans passion, provoque chez eux un certain malaise, un
tonnement qui n'est pas exempt de mauvais vouloir. On s'loigne volontiers de lui,
comme d'un esprit dangereux et inquitant. Mais si la divergence est la fois d'ide et
de sentiment, s'il s'agit de choses qui intressent directement la pratique et les murs,
ce n'est plus seulement la dsapprobation et le soupon, c'est l'indignation et le besoin
de vengeance qui clatent. D'une faon gnrale, un attachement presque instinctif
aux manires traditionnelles de sentir et d'agir est au fond des rsistances conservatrices. Tant que les novateurs n'y peuvent opposer que de pures ides, ils ont le
dessous. Il faut, pour qu'ils l'emportent, que ces ides se soient fondues avec des
sentiments collectifs, et que la masse sociale se soit imprgne de ces sentiments.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 159
Aussi n'y a-t-il rien, dans la ralit morale, de plus difficile modifier - du moins
directement -, que les sentiments collectifs. Sans doute, ils ne sont pas tout fait hors
de notre porte, comme certaines sries de phnomnes physiques, sur lesquels nous
ne pouvons rien, bien que nous en ayons une science dj assez avance (les faits
astronomiques, par exemple). La solidarit des phnomnes sociaux est telle, que si
nous pouvons agir sur certains d'entre eux, cette intervention retentit coup sr dans
les autres sries, sans que nous puissions toujours en prvoir, et surtout en mesurer le
contrecoup. Toutefois, les sries diffrent beaucoup entre elles ce point de vue.
Nous connaissons des moyens d'agir sur les faits conomiques, juridiques, intellectuels mme dans une socit donne : nous n'avons gure de prise sur les sentiments
collectifs, sinon en modifiant d'abord d'autres sries. Jusqu' prsent, les changements
apprciables dans les sentiments moraux collectifs ne se sont encore produits que
comme consquences de grandes transformations religieuses ou conomiques, accompagnes de la diffusion d'ides nouvelles, ou de la renaissance d'ides anciennes
qui s'taient effaces pour un temps.
C'est qu'en effet, de toutes les sries de phnomnes sociaux, celle-ci exige de
nous le plus grand effort pour tre reprsente , et, par suite, pour tre connue
d'une manire objective. Les faits conomiques se traduisent aisment pour nous en
formules et en courbes ; les faits intellectuels, religieux, juridiques, sont lis des
phnomnes extrieurs, des mouvements, des signes qui nous permettent de les
extrioriser et de les considrer indpendamment des consciences individuelles o ils
se ralisent ; mais combien cette reprsentation est plus difficile quand il s'agit de
sentiments ! Il semble que, de quelque faon que l'on s'y prenne, un sentiment ne soit
traduisible qu'en termes de mme nature, c'est--dire encore en sentiments. De fait,
c'est le rsultat o la rflexion morale a toujours abouti jusqu' prsent. La prsence
en nous des sentiments moraux, quand nous y rflchissons, veille pour ces sentiments mmes un nouveau sentiment de vnration, de respect, de soumission religieuse et sacre : c'est--dire que le sentiment collectif prend ainsi une conscience
plus profonde et plus nergique de lui-mme dans l'individu. Mais l'individu qui
l'prouve ainsi avec une intensit accrue, ne l'en connat pas pour cela davantage.
Seule, nous le savons, la mthode sociologique, la mthode historique et comparative, peut conduire cette connaissance ; et la premire condition pour faire usage de
cette mthode, c'est de se proposer les sentiments tudier non pas en tant qu'on les
prouve, mais en tant qu'ils font partie de la ralit morale donne. Il faut donc que,
dans cet ordre de faits comme dans les autres, cette ralit soit regarde par le savant
avec la mme objectivit que la ralit physique. Et si nous prouvons, devant cette
ncessit mthodologique, une sorte de rpulsion, comme devant une profanation de
ce qu'il y a de plus sublime en nous, rappelons-nous, une fois encore, qu'une rpulsion
analogue a t ressentie quand la ralit physique est devenue objet de recherche
scientifique.
Aux yeux des Anciens, la nature entire tait divine. Elle comprenait tout l'ensemble des phnomnes et des tres, les hommes et les dieux. Leur sentiment religieux
s'tendait la fois aux divinits proprement dites, au dieu qui habite en nous sous le
nom d'me, et toutes les forces qui animent le monde. Les religions antiques taient
vraiment des religions de la nature. Pour le christianisme, l'Infini, l'Absolu, le Parfait,
est devenu l'objet unique du sentiment religieux : la nature, finie et dchue, s'vanouit
pour ainsi dire en prsence de Dieu. Qu'elle puisse inspirer un sentiment religieux,
c'est une pense impie qui fait horreur au chrtien. Cependant, sous l'action de causes
multiples - et le rveil des philosophes antiques n'en a pas t la moins efficace - la
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 160
foi aux dogmes chrtiens s'est affaiblie. A-t-on vu reparatre en mme temps une
religion de la nature ? - Non, moins que l'on ne veuille appeler ainsi une expression
de vague sympathie pour la pense antique, et de protestation contre l'esprit chrtien.
Du moins, toute la portion de la nature dont l'homme a commenc de se rendre matre
par la science n'est pas redevenue objet de sentiment religieux, sinon d'une faon trs
gnrale, en tant qu'elle fait partie de l'univers infini o nous sommes plongs. Mais,
fait trs remarquable, chez des philosophes qui ont entirement rompu avec la religion chrtienne, et qui en considrent le rle intellectuel comme termin, on voit
apparatre une religion de l'humanit (Feuerbach, Auguste Comte). Qu'est-ce dire,
sinon que le sentiment religieux se reprend prcisment la seule portion de la nature
qui touche encore nos contemporains comme la nature tout entire touchait les
Anciens ?
Il est donc permis de prvoir, pour la nature morale, un processus analogue celui
qui s'est droul pour la nature physique : mesure que la ralit sociale deviendra
davantage objet de science, elle sera moins objet de sentiment. Luvre d'Auguste
Comte Symbolise trs exactement cette transition. Chez lui, la ralit morale ou
sociale, sous le nom d'humanit, se prsente la fois sous les deux aspects. D'une
part, il fonde la sociologie qu'il appelle aussi physique sociale , il rintgre la ralit sociale dans la nature, il montre que les lois statiques et dynamiques de la
sociologie sont solidaires des autres lois naturelles. Mais, d'autre part, en tant que le
rgime positif institue une religion, l'humanit devient le Grand tre sur qui se
reportent tous les sentiments qui s'adressaient auparavant Dieu. Auguste Comte - et
c'est l un des traits les plus caractristiques de sa doctrine -, n'a pas vu de difficult
garder en mme temps les deux attitudes, l'une scientifique, l'autre religieuse, en
prsence d'une mme ralit. Mais la divergence qui est immdiatement apparue entre
ses successeurs a bien montr qu'elles ne pouvaient se concilier. Car les adeptes de sa
religion n'ont pas pris grand souci des progrs de la sociologie ; et, inversement, les
sociologues actuels, hritiers de sa pense scientifique, sont fort indiffrents la
religion de l'humanit.
Ainsi, l'exemple mme du fondateur de la sociologie montre de la faon la plus
clatante quel point la reprsentation moderne de la ralit sociale est encore mle
au sentiment, et quels efforts seront ncessaires pour qu'elle devienne tout objective et
proprement scientifique. Toutefois, les inconvnients de l'tat actuel ne sont pas sans
compensations. Il nous permet de restituer, par une analogie rtrospective, l'tat mental du temps o la nature entire tait conue comme seule l'est aujourd'hui la ralit
sociale. Habitus, comme nous le sommes, une reprsentation entirement objective
et intellectuelle de la nature physique - du moins en tant que la science s'y applique -,
nous avons la plus grande peine comprendre que cette reprsentation ait pu jadis
tre toute diffrente, trs peu objective, peine intellectuelle, ou pour mieux dire,
qu'un ensemble d'images, de croyances et de sentiments en ait tenu la place. Nous n'y
parviendrions jamais, si nous-mmes nous ne concevions encore ainsi une partie de la
nature. Caractre religieux et imprieux des croyances et des pratiques, pression
intense de la conscience collective sur les consciences individuelles, attente confiante
de rsultats dtermins la suite de certaines pratiques traditionnelles et le plus souvent inintelligibles, innovation synonyme d'impit - tous ces traits caractrisent
encore aujourd'hui la reprsentation de la ralit morale. Reportons-les, par la pense,
sur la conception de la nature physique, et nous pourrons nous faire une ide de ce
qu'elle tait autrefois, de mme que la science actuelle de cette nature nous permet de
concevoir par avance, en quelque mesure, ce que sera un jour la reprsentation
intellectuelle de la ralit sociale.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 161
CHAPITRE IX
CONSQUENCES PRATIQUES
I
Ide d'un art rationnel fond sur la science des murs. - En quoi il diffrera de
la pratique morale qu'il se propose de modifier. - Le progrs moral n'est plus
conu comme dpendant uniquement de la bonne volont. - Il portera sur des
points particuliers et dpendra lui-mme du progrs des sciences. - Tentatives
faites jusqu' prsent pour rformer systmatiquement la ralit sociale. Pourquoi elles ont t prmatures.
Retour la table des matires
On juge l'arbre son fruit, et les principes d'aprs leurs consquences. En particulier, aussitt que la spculation intresse la morale, la critique n'hsite pas condamner, avec l'assentiment unanime du public, toute doctrine dont les consquences,
lgitimement tires, blesseraient ce que la conscience morale est habitue regarder
comme sacr. Aussi voit-on que les morales pratiques donnent, en gnral, toute
satisfaction cette exigence de la conscience. Quelles que soient les divergences
thoriques des systmes de morale, ils se retrouvent convergents, pour une poque
donne, au point de vue de la morale pratique : nous avons eu l'occasion de signaler et
d'interprter ce fait.
Mais, de mme que nous ne nous sommes pas propos, dans ce travail, d'tablir,
aprs tant d'autres, une morale thorique , et que nous avons essay, au contraire,
de montrer qu'il n'y a point, et qu'il ne peut y avoir de morale spculative , de m-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 162
me on ne trouvera ici, sous forme de consquences pratiques, rien qui ressemble la
morale pratique tire par les philosophes, en apparence du moins, de leur morale
thorique . A la spculation dialectique sur les concepts et les sentiments moraux se
substituera la connaissance scientifique des lois de la ralit sociale ; pareillement, la
morale pratique traditionnelle sera modifie par un art rationnel moral ou
social, comme on voudra l'appeler, fond sur cette connaissance scientifique. Ainsi se
compltera, du point de vue de l'application, ce que nous avons essay d'tablir du
point de vue de la thorie. Si vraiment la morale est un art comparable la mcanique
et la mdecine, selon le mot de Descartes, cet art emploiera l'amlioration des
murs et des institutions existantes la connaissance des lois sociologiques et psychologiques, comme la mcanique et la mdecine utilisent la science des lois mathmatiques, physiques, chimiques et biologiques.
Nous ne tenterons donc pas d'instituer des rgles de conduite, des prceptes
destins tre suivis par chaque conscience, ni d'tablir une hirarchie de devoirs
pour tout tre raisonnable et libre. Nous essayerons, ce qui est fort diffrent, de dterminer, dans la mesure de nos forces, ce que serait l' art rationnel moral . Dtermination ncessairement trs imparfaite, car les applications ne peuvent se dcouvrir, en
gnral, que lorsque la science a atteint un certain degr d'avancement, et les sciences
sociologiques ne sont pas encore sorties de la priode inchoative. En fait, nous devons
regarder cet art, aujourd'hui, comme un desideratum. Ne pouvant anticiper sur ce qu'il
sera plus tard, nous le dfinirons, soit par analogie avec les autres arts rationnels que
des sciences plus avances ont permis de constituer ds prsent, soit par comparaison avec ce qui en tient aujourd'hui la place, c'est--dire avec la morale pratique, la
politique, la pdagogie, etc., actuelles.
A ce dernier point de vue, une diffrence frappe tout d'abord. L'art moral rationnel, qu'il s'agisse de l'action individuelle ou de l'action collective, est faire tout
entier. Il ne se formera qu'au fur et mesure du progrs des sciences dont il dpend,
trs lentement peut-tre, par inventions successives et partielles. La morale pratique
, au contraire, existe tout entire ds prsent. Rattache ou non, par des liens plus
ou moins logiques ou artificiels, tel ou tel principe mtaphysique ou religieux, la
prescription de ce qu'il faut faire ou ne pas faire s'impose avec la mme force la
conscience de tous et de chacun. Elle se prsente comme dfinitive et complte.
Sans doute, l'exprience suscite tout instant des espces qui n'ont pu tre
prvues dans leur dtail et dans leur singularit par des prceptes ncessairement gnraux. D'o une casuistique, indispensable pour les moralistes comme pour les
juristes. Mais cette casuistique suppose justement que les principes sur lesquels elle
se fonde sont admis de tous, et que les devoirs gnraux et les grandes rgles directrices de la conduite sont tablis ne varietur. Mme, la seule ide que ces rgles et ces
principes puissent ne pas tre immuables cause la conscience un malaise auquel elle
ne s'accoutume point. Que notre morale ne soit pas absolue , au moins dans ses
rgles essentielles, c'est l, ses yeux, une ide immorale . Cette conviction se
rvle, par exemple, dans la faon dont on se reprsente d'ordinaire le progrs moral.
On conoit que les hommes connatront de mieux en mieux leurs devoirs, s'y
attacheront toujours davantage, prfreront de plus en plus toute autre satisfaction la
conscience de les avoir accomplis ; qu'ils deviendront, en un mot, plus sages et plus
vertueux. Mais on ne conoit pas que les devoirs eux-mmes changent et se transforment, bien que la rflexion et l'histoire montrent qu'en fait ils ne sont pas immuables.
Chaque socit obit ainsi au besoin imprieux de regarder comme absolues des
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 163
rgles dont elle croit instinctivement que sa stabilit et son existence mme dpendent.
Considre objectivement, la morale pratique qui s'impose la conscience,
une poque donne, pour une socit donne, est une fonction de toutes les autres
sries sociales qui composent cette socit, et les dterminations trs prcises qu'elle
comporte proviennent de sa solidarit avec ces sries, dans leur tat prsent et pass.
Elle reprsente donc, vrai dire, la ralit mme que l'art social rationnel aurait
modifier, s'il existait, ou du moins une partie de cette ralit. Elle ne saurait donc se
confondre avec lui.
Autre diffrence connexe la premire. L'art moral rationnel, mme si nous le
supposons dj suffisamment avanc, ne pourra modifier la ralit donne que dans
certaines limites. Nous voyons jusqu' quel point notre connaissance des lois
physiques, chimiques et biologiques nous permet d'intervenir dans les phnomnes
naturels pour les tourner notre avantage, et si nous pouvons regarder avec quelque
satisfaction les progrs faits depuis un sicle, nous savons aussi que dans une infinit
de cas l'intervention est inutile ou impossible. Il suffit, pour se rendre compte des
bornes de notre pouvoir, de rflchir l'tat actuel de la mdecine et de la chirurgie.
Que de temps ne faudra-t-il pas pour que les sciences sociologiques nous permettent
de possder des arts sociaux aussi dvelopps que ceux-l ! Et savons-nous si
prcisment le progrs de ces sciences ne nous apprendra pas que l'intervention efficace et scientifique ne peut se pratiquer que sous des conditions difficiles raliser, et
dans de trs troites limites ? - La morale pratique , au contraire, ne connat point
de difficult dont elle ne donne, en principe, la solution. De tous les arts humains, elle
est le seul qui ne s'avoue pas imparfait et tenu en chec, au moins partir d'un certain
point, par des obstacles insurmontables. Elle connat seulement ceux que lui opposent
les passions, les prjugs, les faiblesses, en un mot la nature sensible de l'homme.
Supposez celle-ci entirement soumise, soit par un effort constant et toujours victorieux, soit par l'aide divine de la grce : la moralit et la saintet mme sont ralises
autant qu'elles peuvent l'tre. Comme cette morale pratique ne dpend point, en
ralit, du savoir thorique, elle a sa perfection propre, et elle peut tre acheve alors
que ce savoir est encore rudimentaire.
Mais c'est surtout du point de vue de la morale sociale que le contraste est frappant. Nulle hsitation dans les prceptes de cette morale, relatifs, par exemple, la
famille, aux relations sexuelles, la proprit, aux rapports des diffrentes classes ou
castes, etc. ; nous trouvons mme ces prceptes extrmement prcis, impratifs et
minutieux, dans nombre de socits o les rgles de la morale dite individuelle
sont encore indcises et flottantes. Et tandis que cette morale sociale se trouve
partout, nulle part n'existe encore la science sur laquelle l'art moral rationnel devra se
fonder ; nulle part on n'a encore une connaissance scientifique de ce qu'est la famille,
c'est--dire des conditions juridiques, religieuses, conomiques dans lesquelles elle a
pris telle ou telle forme, ni des diffrentes formes de la proprit, etc. On suppose
ainsi que la morale sociale ne rencontre pas de rsistance dans la nature de la ralit
sociale ; et la raison en est, non pas qu'elle repose sur une connaissance scientifique
de cette ralit, mais simplement qu'elle est une expression, ou, pour mieux dire, une
partie de cette ralit mme. De l dcoule une troisime diffrence. Quand l'art social rationnel commencera tirer des applications pratiques des sciences sociologiques, elles porteront d'abord sur des points plus ou moins particuliers. Cet art
paratra ncessairement fragmentaire, incomplet (comme le sont notre mcanique
applique et notre mdecine) ; il n'aura pas le caractre d'un ensemble achev et coh-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 164
rent, que prsentent, chaque poque, les morales pratiques. Apparence d'ailleurs
trompeuse. Car la cohrence des rgles de ces morales pratiques n'est telle que pour la
conscience, qui toutes ces rgles apparaissent indistinctement avec un prestige commun d'obligation indiscutable et sacre. Elle peut n'tre, en ralit, qu'une incohrence
inaperue, rsultant de la prsence simultane, dans cette conscience, de sentiments,
de croyances, de mobiles d'action qui sont d'origines et de tendances diverses, les uns
trs anciens, les autres plus rcents, mais dont l'incompatibilit ne se trahit pas, tant
qu'ils sont runis dans les impratifs d'une mme conscience.
Enfin, il rsulte de tout ce qui vient d'tre dit que la morale pratique se suffit
elle-mme. C'est ce que certains philosophes ont fort exactement observ. Ils ont
remarqu le caractre original, spontan, de la conscience morale commune, la forme
absolue de ses ordres ; et Kant, qui a admirablement dcrit le fait, a cru ncessaire, pour l'expliquer, d'admettre que la pratique a ses principes indpendants de la
thorie, en d'autres termes, que la conscience morale ne dpend rationnellement que
d'elle-mme. Elle n'a, pour commander, nul besoin de la science ; elle est tout aussi
claire, souvent mme plus claire, chez l'homme qui n'a que la simple lumire
naturelle , que chez celui dont l'intelligence est cultive. Mais l'art social rationnel
reposera au contraire sur la science ; non pas sur une science de la morale qui puisse
se construire a priori, par l'effort spculatif et dialectique d'un philosophe, mais sur
une science trs complexe, ou pour mieux dire sur un ensemble de sciences complexes, dont l'objet est la nature sociale, que l'on commence peine explorer par
la mthode positive. Ces sciences seront par consquent, comme les autres, l'uvre
collective des gnrations successives de savants, dont chacune reprendra les
problmes au point o ses devanciers les auront laisss, rectifiant leurs observations,
compltant ou remplaant leurs hypothses, et accoutumant ainsi l'esprit humain
concevoir enfin tous les faits qui lui sont donns comme soumis des lois.
Il est vrai que la conscience commune de chaque poque ne considre pas sa morale pratique comme une ralit donne, mais comme une expression de ce qui doit
tre . Le fait mme qu'elle se manifeste sous la forme de commandements et de
devoirs prouve assez qu'elle ne croit pas simplement traduire la ralit naturelle, mais
qu'elle prtend la modifier. Par cette prtention, elle semble vraiment tenir la place de
l' art moral et social que nous cherchons. Et ce n'est pas une pure illusion : elle en
tient en effet quelque peu la place, dans la mesure o elle exerce sur cette ralit une
action qui la modifie.
Si nous la comparons ce que cet art devra tre, nous verrons qu'elle prsente la
plupart des caractres qui sont propres aux arts humains dans leur priode prscientifique. C'est d'abord l'absence d'une ligne de dmarcation nette entre ce qui est
possible ou impossible atteindre. Avant la conception positive de la nature, le sorcier, le magicien, l'homme-mdecine, l'astrologue, l'alchimiste, oprant sans une
connaissance claire du rapport des effets aux causes, et en vertu de croyances ou de
raisonnements d'une porte trs gnrale (magie sympathique, observation d'analogies
superficielles, associations d'images ou de mots, etc.), ne trouvent pas plus de difficult dans un cas quelconque que dans un autre, quelle qu'en soit la diffrence relle.
Il ne leur est pas plus malais de faire tomber la pluie que de fondre du minerai, et de
soigner une maladie nerveuse qu'une fivre ruptive. Leur foi en la puissance de leurs
procds les empche de sentir l'ignorance o ils sont des phnomnes qu'ils prtendent modifier. Peut-tre, pour que l'tude scientifique de ces phnomnes s'tablisse,
est-il ncessaire qu'un concours de circonstances favorables ait d'abord branl cette
foi.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 165
De mme, la morale pratique, en tant qu'elle se propose de modifier la ralit
sociale donne, n'est nullement embarrasse par le manque d'une connaissance scientifique de cette ralit. Elle y supple par sa confiance en ses procds. Elle ne
reconnat, en principe, aucune limite leur pouvoir. Tout revient, pour elle, convertir les mes. Si elles taient invinciblement attaches leurs devoirs, cette condition ncessaire serait en mme temps suffisante : la socit deviendrait, ipso facto,
aussi bien ordonne, aussi pntre de justice et gnratrice de bonheur qu'elle saurait
jamais l'tre. Ne voyons-nous pas des philosophes soutenir que la question sociale
est une question morale ? Dans cette conception caractristique, nul compte n'est
tenu des lois statiques ni des lois dynamiques des faits sociaux, que la science seule
peut dcouvrir, en particulier des lois conomiques, si complexes dans une civilisation comme la ntre, ni surtout de l'extraordinaire ensemble de croyances, sentiments, tendances, besoins, prjugs, que la longue suite des sicles de l'histoire et de
la prhistoire a amass dans les mes humaines. La pratique du devoir aurait raison de
tout : elle exercerait sur cette nature une sorte de toute puissance. Aussi bien est-ce
surtout du point de vue social que l'idal moral manifeste le plus videmment son
caractre religieux (cit de Dieu, rgne de la grce, royaume des fins, la moralische
Weltordnung considre comme une dfinition de Dieu, etc.).
Dans la priode pr-scientifique, l'empire de l'homme sur la nature, prcisment
parce qu'il est imaginaire, croit se raliser par la solution directe de quelques
problmes vastes et simples, dont les cas particuliers les plus divers ne sont que des
applications. Ainsi l'alchimiste poursuit les formules qui lui donneront tout pouvoir
sur la matire (pierre philosophale, transmutation des mtaux) ; le mdecin d'avant la
science dispose de quelques recettes souveraines qui chassent la maladie et produisent
la sant. Les yeux fixs sur le rsultat immdiat atteindre, l'art, intrpide et crdule,
n'aperoit pas le rseau infiniment compliqu des phnomnes qui sont les causes
relles des maux que nous subissons. Par une illusion analogue, la pratique morale
traditionnelle possde quelques procds simples pour produire la vie heureuse, la
vertu, la saintet, pour chasser l'injustice et le vice; et la thorie qui, comme nous
l'avons vu, ne fait que reflter cette pratique, se propose de rsoudre le problme
moral . Mais c'est l une expression peu intelligible. Il n'y a pas plus de problme
moral que de problme physique , ou de problme physiologique . Nous ne
pouvons pas plus nous flatter de raliser le bonheur en gnral, que la mcanique ne
peut raliser le captage de la force naturelle en gnral, ou la mdecine procurer la
sant en gnral. Ds que la science est constitue, et qu'elle marche, elle nglige
ces abstractions. Elle est toute la dcouverte de relations relles, dont la connaissance deviendra un jour une mainmise sur les forces de la nature.
En fait, rien ne nous assure que les rsultats poursuivis par la morale pratique
puissent jamais tre atteints. Les socits humaines ne sont peut-tre pas susceptibles
de diminuer la somme des maux et d'augmenter la somme des biens du plus grand
nombre de leurs membres au-del d'une certaine limite. Peut-tre un certain degr de
justice seulement y est-il ralisable - la conception de la justice devant d'ailleurs
voluer avec les socits elles-mmes. Seuls, les progrs de la science sociologique
nous apporteront des donnes positives sur ces divers points. Jusque-l, les postulats
impliqus par l'art moral, et admis par lui sans que rien en garantisse la lgitimit,
resteront hypothtiques. Mais, de mme que les hommes qui croyaient agir sur la
nature par des moyens mystrieux ou magiques ne paraissent pas avoir jamais t
dcourags par leurs checs, tant que leur foi en ces moyens est reste ferme, de
mme la morale pratique ne se lasse pas de conduire l'homme la vie heureu-
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 166
se , la saintet, la justice sociale parfaite, malgr les dmentis constants que lui
inflige l'exprience. Et comme le conjureur de pluie, si le ciel reste sans nuages, conclut que le dieu de la pluie ne s'est pas laiss flchir ou contraindre, ainsi le moraliste,
voyant que l'injustice, la mchancet, la souffrance ne diminuent point dans une
socit humaine, en tire simplement cette consquence que l'homme n'a pas voulu ou
su se rformer.
Cette illusion tenace est d'autant plus remarquable que, par ailleurs, la morale
pratique , l o elle est efficace, sait fort bien utiliser le mcanisme des phnomnes
naturels. Ainsi, dans l'enseignement moral proprement dit, donn par les parents, par
les personnes ges, par les prtres, et en gnral par ceux qui dtiennent l'autorit,
les lois de l'association des ides et des images, de la suggestion, de l'imitation, de la
contagion sociale sont souvent employes trs ingnieusement, comme si les dcouvertes de la psychologie la plus rcente taient connues : une observation aiguise et
sagace en a tenu lieu. On peut constater l une pratique morale , fort bien organise, trs habile, exactement adapte le plus souvent au but qu'elle doit atteindre. Le
contraste est frappant entre le caractre positif de la mthode employe dans cet
enseignement et le caractre illusoire des fins gnrales o il tend, dans la pense de
ceux qui le donnent - lorsqu'il ne s'agit pas simplement (il est vrai que c'est le cas le
plus frquent), de la transmission des murs sociales d'une gnration la suivante.
En somme, si nous considrons comme faisant partie de la ralit donne, de la
nature , l'ensemble des obligations et des devoirs qui s'imposent aux consciences
une poque donne, nous n'observons point que jusqu' prsent les efforts qui tendent
modifier cette ralit se soient fonds sur une tude scientifique et positive. Ces
efforts se sont ports de prfrence sur la recherche des moyens propres amener
l'homme agir conformment l'exigence du devoir. L'ensemble de ces moyens
constitue, si l'on veut, un art, mais un art qui se meut tout entier l'intrieur de la
ralit morale donne, et trs diffrent, par cela mme, de l'art rationnel qui se
fonderait sur la connaissance scientifique de cette ralit pour la modifier. Au reste, il
est vrai que depuis longtemps des utopistes et des rformateurs ont conu, ou du
moins imagin, un tat social trs suprieur, selon eux, celui que l'exprience
mettait sous leurs yeux. En particulier, les philosophes du XVIIIe sicle, puis SaintSimon et Auguste Comte, leurs hritiers, ont eu l'ide trs nette d'une politique qui
serait fonde sur une science exprimentale. Au XIXe sicle, socialistes et communistes ont propos des mesures qui, dans leur pense, conduisaient scientifiquement
une amlioration de la ralit sociale. En ce sens, l'ide n'est pas nouvelle ; elle date
mme de loin, et elle s'est dveloppe et prcise au fur et mesure que les sciences
dites morales et sociales ont tendu de plus en plus vers une conception positive de
leur objet et de leur mthode. Il reste nanmoins que la proccupation de la pratique,
comme il tait invitable, a t dominante chez tous ; et, comme notre science sociale
est encore fort peu de chose, l'art social n'a pu tre jusqu' prsent qu'empirique, pour
sa plus grande part, et non pas rationnel.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 167
II
Objection : n'est-ce pas aboutir au scepticisme moral ? - Rponse : rien n'est
plus loign du scepticisme que la conception d'une ralit soumise des lois, et
d'une action rationnelle fonde sur la connaissance de ces lois. - Sens de cette
action. Amlioration possible d'un tat social donn, sous quelles conditions.
Retour la table des matires
Une objection, une protestation mme peut-tre se sera dj prsente l'esprit du
lecteur. Est-ce l tout ce que votre conception nouvelle de la morale nous apporte au
point de vue pratique ? Nous attendions un principe directeur de l'action, une rgle de
vie, qui permit d'organiser la conduite individuelle et d'introduire plus de justice dans
les rapports sociaux ; et tout se rduit la conception, purement schmatique jusqu'
prsent, d'un art moral rationnel qui se ralisera plus tard, on ne sait quand, lorsque
les sciences sociologiques auront atteint un degr d'avancement suffisant ! Mais, en
attendant les rsultats que nous devons nous promettre de cet art, il faut vivre, il faut
agir, il faut prendre parti sur les questions individuelles et sociales les plus graves.
Comment ferons-nous ? Vous ne nous donnez aucune indication. Bien mieux, vous
nous reprsentez que toute morale est ncessairement relative, variable en fonction de
toutes les autres sries sociales dont elle est solidaire, et que la ntre en particulier,
dans son idal comme dans ses prescriptions, est une partie de la ralit sociale existante ; d'o se conclut presque ncessairement le scepticisme moral, car il est vident
que dans une civilisation diffrente, des obligations tout autres s'imposent aux
consciences avec une autorit et une lgitimit gales celles dont nos devoirs sont
revtus nos yeux. Ainsi, non seulement vous ne nous apportez point de rgle
d'action, mais vous dtruisez, autant qu'il dpend de vous, celle que nous avions. Et
ce grand effort scientifique aboutit, en dfinitive, nous laisser dsempars, dmunis
et paralyss devant les ncessits de la vie. Qui ne voit que tout sera prfrable un
tel tat d'impuissance, tout, mme les doctrines les moins scientifiques et les moins
acceptables la raison, pourvu qu'elles rpondent aux exigences de l'action ? Le rle
du sceptique, disait Spinoza, est de rester muet. Encore les sceptiques s'abstiennent-ils
d'ordinaire de toucher aux rgles de la pratique.
Nous avons rpondu dj explicitement cette objection trs redoutable 1 d'apparence, mais qui en ralit ne porte pas contre notre conception.
Quant au dernier point, que nous examinerons d'abord, nous avons montr que le
reproche de scepticisme n'tait pas fond. De ce que notre morale est relative, il ne
s'ensuit pas qu'elle perde aussitt toute valeur. Nous ne sommes pas obligs de choisir
entre ces deux alternatives : ou notre morale a un caractre absolu, ou bien elle perd
toute autorit. La preuve qu'une position intermdiaire est possible, et qu'elle n'a rien
de paradoxal, c'est que tous les systmes empiriques de morale (et Dieu sait s'ils sont
nombreux, dans l'Antiquit et dans les Temps modernes!) s'y sont placs sans croire
compromettre par l la validit de leurs prceptes. De mme que la relativit de la
1
Voyez plus haut, chap. V, II et III.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 168
connaissance peut tre admise sans que la connaissance humaine soit dpouille de
toute valeur logique ; de mme, admettre la relativit de la morale, ou, pour mieux
dire, des morales, ne leur enlve pas ipso facto toute autorit et toute lgitimit. Mais
cette autorit et cette lgitimit deviennent elles-mmes relatives, et c'est ce que nous
avons voulu dire.
Reste le corps mme de l'objection : l'art moral, qui se fondera - plus tard - sur les
sciences de la nature sociale, ne nous fournit pas la rgle de vie dont nous avons
besoin ds prsent. - Je rponds que cet art, ft-il dj constitu et mme assez
avanc, ne donnerait pas ce qu'on semble attendre de lui, et qu'il n'a pas le donner.
Quelle en sera, en effet, la fonction ? Modifier, par des procds rationnels, la ralit
morale donne, au mieux des intrts humains, comme la mcanique et la mdecine
interviennent, en vue de ces mmes intrts, dans les phnomnes physiques et
biologiques. Mais cette fonction mme suppose que cette ralit existe, qu'elle nous
est donne objectivement, titre de nature , et qu'il nous faut donc commencer par
peler et dchiffrer cette nature, que nous n'avons pas faite, et que vraisemblablement
une intelligence semblable la ntre n'a pas faite pour nous. Or, l'objection que l'on
nous oppose implique l'hypothse contraire celle-l. Elle consiste, au fond, refuser
d'admettre ce que nous avons essay de prouver dans les premiers chapitres de cet
ouvrage, et nier que la spculation morale porte sur des faits donns, qu'il faut
observer, analyser, classer, ramener des lois, si nous voulons qu'elle conduise des
rsultats applicables et fconds. Elle maintient, au contraire, qu'il n'y a point de ralit
morale objective, au sens o nous l'entendons, que l'existence mme de la morale est
lie au principe d'o elle dcoule tout entire, et qu'enfin si ce principe est branl ou
abattu, la morale chancelle et tombe avec lui.
Mais, outre les raisons que nous avons fait valoir, l'exprience mme tmoigne
contre cette objection. Tout homme vivant dans une certaine socit y trouve organis
un systme souvent trs compliqu de rgles pour son activit, prescrivant ce qu'il
faut faire ou ne pas faire dans un cas donn. Ces rgles prennent l'aspect de devoirs
pour sa conscience ; elles n'en sont pas moins, par rapport lui, une ralit objective
qu'il n'a pas faite, qui s'impose lui, et dont la raction, s'il s'y heurte, se fait sentir
lui de la faon la plus sre et parfois la plus cruelle. Il ne suit pourtant pas de l que
l'individu soit priv de toute initiative en matire morale. Ici comme ailleurs, la
rflexion et la raison soulvent des problmes : il se produit dans les consciences des
scrupules, des hsitations, des conflits parfois tragiques. Mais presque toujours ces
conflits mmes supposent l'existence d'une ralit morale objective. Quand un homme, par exemple, se demande s'il commettra une action qualifie crime, en vue d'un
intrt qu'il juge suprieur, ou au nom d'une autre rgle, plus sacre ses yeux, qu'estce qui est en question pour lui ? Est-ce l'existence de la rgle morale qu'il va peut-tre
violer tout l'heure ? Assurment non : son hsitation mme, la reprsentation vive
des sanctions auxquelles il sait qu'il s'expose, prouvent au contraire qu'il a la notion
trs nette de son devoir. Ce qui est douteux pour lui, c'est de savoir s'il vaut mieux,
dans la conjoncture prsente, s'y conformer ou passer outre, quoi qu'il arrive. De
mme que le sauvage qui viole un tabou n'atteste pas moins pour nous, par les
circonstances de son acte, l'existence et le caractre sacr de ce tabou, que ses compagnons qui le respectent ; de mme, dans notre socit civilise, le dlinquant et le
criminel ne tmoignent pas moins, leur faon, de l'existence des obligations morales
auxquelles ils se soustraient, que l'honnte homme qui s'y soumet. Bref, rien n'est plus
facile constater, dans les socits humaines, plus ou moins avances, que la ralit
objective des rgles de conduite obligatoires. Si elles ne sont point obies (ce qui en
fait arrive assez souvent), c'est pour des raisons en gnral faciles assigner ; mais ce
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 169
n'est point parce que ces rgles sont inconnues ni mme mconnues. Donc les
philosophes auraient tort, comme nous l'avons dit 1, de s'imaginer que la morale est
faire ; quelles que soient l'poque et la socit o ils naissent, ils s'y trouvent en
prsence d'une morale objectivement relle, et qui s'impose eux comme aux autres.
Enfin, il parat difficile de contester que les rgles morales obligatoires dans une
socit donne soient troitement lies l'ensemble des conditions qui ont produit et
qui maintiennent un certain tat de cette socit. Nous ne doutons pas, par exemple,
que la morale si curieuse des tribus de l'Australie centrale ne soit une fonction de
l'organisation sociale de ces tribus. Nous ne doutons pas davantage que la morale
chinoise ne soit dans le rapport le plus troit avec les croyances, avec l'organisation
familiale et conomique du pays. La mme observation vaut videmment pour tous
les cas, y compris celui de notre propre civilisation. L'idal moral (unique ou
multiple, peu importe) d'une socit, quelle qu'elle soit, est une expression de sa vie,
au mme titre que sa langue, son art, sa religion, ses institutions juridiques et politiques. Qu'il soit amen par la rflexion philosophique une forme abstraite et
d'apparence rationnelle, ou qu'il reste l'tat de motif pratique d'action, cela ne change rien au fait. Car le philosophe, dans son oeuvre, comme le pote, comme l'artiste,
comme l'homme d'tat, est reprsentatif de tous ceux qui sentent et pensent plus
ou moins confusment ce qu'il sait exprimer en un langage clair. Plus sa doctrine a
d'influence et d'autorit, plus il est naturel d'admettre qu'elle est la conscience mme
de tous parlant par sa voix. A supposer - ce qui n'est gure vraisemblable - que le
philosophe recommandt des faons d'agir trangres ou odieuses la conscience
gnrale, sa doctrine serait aussitt rejete. Plus probablement, elle resterait tout fait
ignore. Mais cette hypothse est peu prs gratuite. Les plus hardis novateurs, en
fait de morale, sont 'encore de leur temps ; ce qu'ils modifient est peu de chose auprs
de ce qu'ils conservent. L comme ailleurs, les rvolutions qui russissent sont celles
qui taient si bien prpares par la priode immdiatement prcdente, qu'elles en
sont la suite naturelle et comme invitable.
Pour conclure, il n'y a pas rpondre, selon nous, cette demande Donnez-nous
une morale ! parce que la demande est sans objet. On ne pourrait donner aux
demandeurs que la morale qu'ils ont dj ; et si, par aventure, on leur en proposait une
autre, ils ne l'accepteraient pas. Une socit vivante ne s'accommode pas d'une morale
ad libitum. Sa morale est partie intgrante de l'ensemble des phnomnes solidaires
entre eux qui la constituent : nous pensons en avoir donn la preuve dans ce qui
prcde. Mais suit-il de l que nous soyons rduits assister impassibles et indiffrents l'volution sociale, sans plus de moyen d'agir sur elle que sur le mouvement
des plantes ? A cette rapparition du sophisme paresseux il suffit de faire la
rponse ordinaire. C'est prcisment quand nous avons compris que les phnomnes
naturels sont soumis des lois, et quand nous obtenons la connaissance scientifique
de ces lois, que nous pouvons entreprendre de les modifier a coup sur, si une
intervention est possible pour nous. Un art rationnel peut se substituer ds lors des
pratiques plus ou moins empiriques et illusoires. Dans le cas qui nous occupe, peut-on
douter que, si nous avions une connaissance scientifique de notre socit, c'est--dire,
d'une part, des lois qui y rgissent les rapports des phnomnes dans les diffrentes
sries et de ces sries entre elles, et, d'autre part, des conditions antrieures dont l'tat
prsent de chacune de ces sries est le rsultat, si nous en possdions, en un mot, les
lois statiques et dynamiques, peut-on douter que cette science ne nous permt de
Voyez plus haut, chap. V, II.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 170
rsoudre la plupart des conflits de conscience, et d'agir, de la faon la fois la plus
conomique et la plus efficace, sur la ralit sociale o nous sommes plongs ?
Par consquent, si l'art moral rationnel ne nous apporte pas une morale , s'il ne
nous enseigne pas o est le souverain bien , s'il ne rsout pas le problme moral
, il n'en promet pas moins d'avoir des consquences importantes, puisque, grce
lui, la ralit morale pourra tre amliore, entre des limites qu'il est impossible de
fixer d'avance.
- Amliore, dites-vous ? Mais quel sens peut avoir ce terme dans une doctrine
telle que la vtre ? Vous jugez donc de la valeur des institutions, des lois, des rgles
d'action, au nom d'un principe qui leur est extrieur et suprieur ? Vous revenez donc
au point de vue de ceux qui, au nom de la morale, distinguent ce qui doit tre de ce
qui est? - L'objection n'est pas nouvelle. Nous l'avons rencontre dj plusieurs
reprises. Rfute sous une forme, elle reparat aussitt sous une autre, tant est vivace
le sentiment qui la suscite : Si la morale n'est pas quelque chose d'absolu, de suprieur par essence la ralit phnomnale, si elle est lie celle-ci et relative comme
elle, il n'y a pas de morale. - Mais on conoit trs bien que la ralit donne puisse
tre amliore , sans qu'il soit ncessaire d'invoquer un idal absolu. Helmholtz a
pu dire que lil tait un mdiocre instrument d'optique, sans faire appel au principe
des causes finales, en montrant simplement qu'une disposition plus avantageuse de
l'appareil visuel est concevable. De mme, le sociologue peut constater dans la ralit
sociale actuelle telle ou telle imperfection , sans recourir pour cela aucun principe indpendant de l'exprience. Il lui suffit de montrer que telle croyance, par exemple, ou telle institution sont surannes, hors d'usage, et de vritables impedimenta
pour la vie sociale. M. Durkheim a parfaitement mis ce point en lumire. En fait,
l'homognit morale d'une socit humaine, un moment quelconque, n'est jamais
qu'apparente. Chacun des sicles qu'elle a traverss y a peut-tre laiss sa trace
indlbile ; les invasions, les mlanges de sang, les rapports avec les civilisations
trangres, les religions et les formes sociales successives, les mythes et les conceptions du monde, toute la vie du pass en un mot, en vertu de la continuit qui est
comme la mmoire inconsciente des socits, subsiste sous une forme plus ou moins
reconnaissable dans la vie du prsent. Par quel extraordinaire hasard cette infinit
d'lments de date et de provenance si diverses se trouveraient-ils compatibles entre
eux ? S'accordent-ils ncessairement parce qu'ils sont coexistants ? Et les luttes
intestines qui se produisent continuellement dans les consciences et dans les socits
ne naissent-elles pas, le plus souvent, de cette incompatibilit ?
Ainsi, par le moyen d'un art social rationnel, une socit donne pourrait tre,
dans une certaine mesure, amliore. Prenons pour exemple, dans la ntre, une
fonction indispensable : la rpression des actes dlictueux et criminels. Notre systme
pnal actuel est-il le meilleur que nous puissions concevoir ? Pouvons-nous nous
dissimuler qu'il repose sur un ensemble de traditions et de lois, de croyances et de
thories dont nous ne sommes pas certains qu'elles soient cohrentes, et qui se trouvent runies par des raisons tout autres que des raisons logiques ? Sommes-nous
seulement d'accord entre nous, ou avec nous-mmes, sur les conditions et sur le sens
de la responsabilit, sur la raison d'tre des peines, sur leur effet utile ? Il y a cinquante ans, la thorie la plus rpandue voyait dans la peine, non seulement un moyen
d'intimidation et de correction, mais aussi et surtout une rparation du dommage
apport l'ordre social. Aujourd'hui, les thories utilitaires prdominent. Qui sait si
d'autres ne trouveront pas faveur demain ? La discussion dialectique peut se prolonger
ou se renouveler indfiniment. Mais supposons que les sciences de la ralit sociale
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 171
aient fait des progrs suffisants, et que nous connaissions d'une faon positive les
conditions physiologiques, psychologiques et sociales des diffrentes sortes de dlits
et de crimes : cette connaissance ne fournira-t-elle pas des moyens rationnels, et qui
ne seront plus matire discussion, non pas sans doute de faire disparatre les dlits et
les crimes, mais de prendre les mesures, soit prventives, soit rpressives, les plus
propres les rduire leur minimum ? Cette science conduirait videmment la
constitution d'une hygine sociale. Notre ignorance seule nous empche de sentir
combien elle nous manque. Cette hygine sociale ne donnerait d'ailleurs pas des
prceptes identiques pour des socits diffrentes, pas plus que l'hygine du corps ne
recommande la mme manire de vivre dans nos climats ou sous les tropiques.
Prcisment parce qu'elle serait fonde sur la science des lois des phnomnes et sur
la connaissance du pass de chaque socit donne, elle saurait prescrire chacune ce
qui lui conviendrait le mieux.
Les mmes considrations s'appliquent l'organisation conomique, l'organisation politique, la pdagogie, etc. Toutes les sries importantes de phnomnes
sociaux doivent tre d'abord tudies d'une faon scientifique, et de cette tude sortira
l'art rationnel qui pourra les amliorer. Mais elles ne sauraient ni tre tudies, ni
surtout tre amendes isolment. Comme Auguste Comte l'a montr, le consensus
caractristique des faits sociaux est tel que l'volution ou les variations d'une srie
donne (par exemple de la srie conomique) ne sauraient tre comprises sans la
connaissance des autres sries dont l'influence se fait sentir continuellement sur la
premire, qui ragit sur elles son tour. C'est pourquoi l'art social rationnel ne pourra
pas se fonder sur la science de certaines catgories de phnomnes, plus accessibles
ou mieux connus, l'exclusion des autres. Il utilisera toutes les sciences sociologiques, comme l'art mdical utilise la plupart des sciences biologiques, et mme, par
surcrot, des sciences physiques et chimiques. Sans doute, le principe de la division
du travail s'appliquera ici comme ailleurs, pour le plus grand profit de la science
thorique. Il sera trs avantageux, et tout fait lgitime, de diviser les difficults
pour les mieux rsoudre . La vaste science de la nature sociale se ramifiera en un
grand nombre de branches. Mais, au point de vue de l'application, l'intime solidarit
des sries s'oppose toute intervention, mme rationnelle, dans une seule d'entre
elles, qui ne tiendrait pas compte du contrecoup certain sur les autres sries, et des
chocs en retour qui se produisent invitablement. L'histoire est pleine des surprises
fcheuses que cette solidarit ignore a causes aux empiriques de l'art politique. Une
fois connue, au contraire, elle donne un sentiment trs vif de la difficult, des dangers,
et souvent de l'inutilit d'une intervention.
Rien de plus instructif, cet gard, que la querelle retentissante, et toujours
renaissante, qui met aux prises, au sujet de la prostitution, les rglementaristes et les
abolitionnistes. Chaque fois que la discussion se rouvre, la mme impossibilit de la
limiter reparat. Aussitt, et en dpit de tous les efforts, les questions les plus gnrales se posent. Comment concilier le respect de la libert individuelle avec la protection de la sant publique ? La prostitution doit-elle tre soumise des lois spciales ?
Comment se fait-il qu'elle subsiste et se dveloppe, humiliant dmenti nos belles
phrases sur le respect d la personne humaine ? N'est-ce pas que toute notre organisation sociale en est solidaire, et que, pour la faire disparatre, avec les maux qu'elle
produit son tour, il ne faudrait pas moins qu'une transformation radicale de la
condition des proprits et des personnes ? Aussi voyons-nous que la conscience
gnrale la condamne en principe, et s'en accommode en fait. Contradictions dont la
science aura d fixer les origines et les causes, avant que l'art social rationnel y puisse
porter remde. De mme que le mdecin, avant de formuler sa prescription, tient
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 172
compte la fois des indications gnrales et des contre-indications spciales l'tat
de son malade, de mme l'art social ne s'appliquera pas automatiquement, pour ainsi
dire comme une formule algbrique, mais tiendra compte, dans chaque cas particulier,
de l'ensemble des circonstances propres ce cas. Et, comme le mdecin encore, lorsque son intervention entranera plus d'inconvnients que d'avantages, il s'abstiendra.
Car, si tout malade n'est pas gurissable, il n'est pas certain non plus que toute socit
soit amliorable. Peut-tre en est-il qui ne peuvent que continuer vgter telles
qu'elles sont, ou mourir. A quoi tient-il qu'une socit donne soit vigoureuse,
rsistante, expansive, et sorte comme rajeunie de crises terribles, tandis que d'autres
paraissent subir une sorte de processus de dcadence et de lente paralysie ? Le fait est
certain : les conditions en sont-elles physiologiques, conomiques, morales, ou, si un
grand nombre de causes y sont intresses, comme il est trs probable, quelles sontelles, et pour quelle part chacune entre-t-elle dans l'effet total ? Sur ce point encore,
nous nous heurtons notre ignorance de la nature sociale, et des lois qui la
rgissent. Seules, les religions et les philosophies de l'histoire ont rpondu jusqu'
prsent cette sorte de questions. A peine commenons-nous concevoir qu'un jour
la science y rpondra son tour.
III
Les prescriptions de l'art rationnel ne valent que pour une socit et dans des
conditions donnes. - Ncessit d'une critique des obligations dictes par notre
propre morale. - Impossibilit de leur reconnatre une valeur immuable et universelle. - Hypocrisie sociale naissant de l'enseignement moral actuel. - Comment
la morale existante peut tre un obstacle au progrs moral.
Retour la table des matires
Nous pouvons maintenant, non pas dterminer d'une faon plus prcise ce que
sera l'art social rationnel - toute tentative de ce genre serait vaine, dans l'tat actuel de
notre science - mais en mieux voir le rapport notre morale pratique. En premier lieu,
il n'est pas destin se substituer entirement elle ; elle ne devra pas disparatre
pour lui faire place. Le craindre, ou l'esprer, c'est revenir une fois encore la conception que nous avons critique sous bien des formes, savoir, que la morale est
faire , et qu'il dpend de nous de la faire telle ou telle . Au contraire, tout notre
effort a t de montrer comment la morale, dans une socit donne, est troitement
solidaire des autres sries de phnomnes sociaux, et constitue, avec ces sries, la
ralit sociale existante. C'est sur cette ralit que l'art rationnel devra agir. Non pas
pour la transformer, comme par un coup de baguette magique, comme s'il ne tenait
qu' nous de la faire disparatre tout d'un coup, et de la remplacer par une autre toute
diffrente, mais pour la modifier, dans les limites assez troites o la connaissance
des lois rendra notre intervention possible.
La morale pratique, se donnant pour rationnellement fonde, prtend une valeur
universelle pour les obligations qu'elle formule. Elle lgifre, selon l'expression de
Kant, non seulement pour tous les hommes de tous les temps et de tous les pays, mais
pour tout tre libre et raisonnable. En fait, ses prceptes positifs sont l'expression d'un
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 173
ordre social donn, applicables seulement dans cet ordre social, impraticables et
mme inintelligibles pour les contemporains qui appartiennent une civilisation
diffrente. Aussitt que l'on sort des formules trs gnrales mais indtermines,
soyez justes, soyez bienfaisants , et qu'il s'agit de fixer les droits et les devoirs
respectifs dont le respect s'appellera justice, les divergences irrductibles apparaissent. Le musulman ne comprend plus l'Occidental. Mais l'universalit apparente des
principes dissimule la particularit relle des prceptes.
La position de l'art rationnel est prcisment inverse. Il ne prtend pas une
universalit de droit. Comme il se fonde sur l'tude positive de la ralit sociale, et
comme cette tude conduit reconnatre qu'il existe, en fait, non pas une socit
humaine, mais des socits, qu'une longue solidarit avec leur propre pass fait
aujourd'hui profondment diffrentes les unes des autres, il n'hsite nullement
avouer que chacune de ces socits a sa morale, comme sa langue, sa religion, son art,
ses institutions. Et, sans mconnatre ce que l'tude compare pourra rvler de
commun dans le dveloppement des morales des diffrentes socits, l'intervention
scientifique ne consistera pas en des mesures identiques partout, mais elle sera, rgle
la fois par ce que les cas auront de diffrent et par ce qu'ils auront de commun.
Suppos, par exemple, que nous ayons une connaissance scientifique de notre propre
socit, dans son pass et dans son prsent, et de mme une connaissance scientifique
du prsent et du pass de la socit chinoise, les applications de cette connaissance
l'amlioration de l'une et de l'autre socit ne concideraient certainement pas.
Plus modeste dans ses prtentions que notre morale pratique actuelle, cet art
social est, en ralit, plus largement humain. Car la morale pratique actuelle, s'imaginant lgifrer pour l'homme en soi , se contente, en ralit, d'hypostasier sous le
nom d'humanit l'homme de notre civilisation et de notre temps. Aprs quoi, elle se
croit en droit d'exiger, pour tout ce qui lui apparat comme obligatoire, le mme
respect absolu. Le champ de sa spculation abstraite est indfini ; le rayon de sa
vision relle est trs limit. Il en est tout autrement de l'art social rationnel, qui suppose comme condition pralable et indispensable l'tude sociologique, c'est--dire
l'tude compare et critique des morales existantes. Et de cette tude pourront sans
doute sortir des indications pratiques prcieuses, que jamais la rflexion n'aurait pu
obtenir par l'analyse abstraite d'une morale ou d'une socit unique.
Beaucoup de consciences s'effraient ou se rvoltent peut-tre l'ide de prendre
une attitude critique l'gard de leur propre morale. Elles y voient une profanation,
une drision de ce qu'il y a de plus sacr leurs yeux. Cette opposition sentimentale
nergique, irrflchie et comme instinctive, nous l'avons dj rencontre plusieurs
fois. Elle serait une preuve nouvelle, s'il en tait besoin, du fait que la morale est
une ralit sociale objective au mme titre que la religion, par exemple, et le droit, et
qu'elle ne s'vanouira donc pas plus qu'eux, pour avoir t tudie comme eux scientifiquement. Mais on peut aller plus loin. Ce n'est pas un paradoxe de soutenir que
l'attitude critique l'gard de notre propre morale, loin d'en menacer l'existence, est
trs propre, au contraire, en favoriser et en acclrer le progrs. Elle contribuera
affaiblir une des rsistances les plus opinitres qui s'opposent sa marche.
Parmi ces rsistances, en effet, il n'en est pas de plus difficile vaincre que le
respect dont la conscience commune enveloppe et protge indiffremment toutes les
faons d'agir, toutes les obligations ou interdictions, tous les droits et devoirs que la
gnration prcdente lui a transmis. Inquite sur un point, elle se hrisse pour ainsi
dire tout entire. Elle se prsente toujours comme un bloc, qui ne souffre d'tre
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 174
entam sur aucune de ses faces. Comme, d'autre part, elle se sent troitement solidaire
des croyances religieuses et des institutions, juridiques et autres, elle veut tre
intangible, et elle y russit presque toujours. C'est ainsi que, malgr la diversit des
morales, vidente si l'on regarde l'ensemble des civilisations, la stabilit de chacune
d'elles dans chaque civilisation existante lui permet, quand elle se rflchit dans la
spculation philosophique, de se prendre pour immuable, et par suite pour absolue et
ternelle. L'illusion s'explique, bien qu'elle ne se justifie pas. En fait, la morale volue
avec une extrme lenteur. Dans les socits trs stables, comme la Chine, elle peut
paratre entirement immobile : c'est a peu prs ainsi que la prsente M. de Groot.
Dans les socits marche rapide, comme la ntre, sa solidarit ncessaire avec les
autres sries sociales (religieuse, intellectuelle, conomique, etc.) l'oblige voluer
comme elles. Encore le fait-elle plus lentement, et souvent au prix des conflits les
plus graves.
Que la morale existante puisse tre ainsi, par la tnacit avec laquelle elle dfend
indistinctement tout ce qui la compose, un obstacle au progrs moral, ce n'est qu'un
cas particulier d'une loi connue depuis longtemps. On peut en dire autant de l'organisation gnrale d'une socit donne, par rapport son progrs en gnral : on peut
faire la mme observation sur telle ou telle srie sociale en particulier. Rien ne nous
paratrait mme plus conforme aux conditions d'existence de la nature sociale , si
nous n'avions une tendance - instinctive ou acquise, peu importe, mais presque irrpressible -, nous reprsenter cette nature comme organise et dirige par le principe du meilleur . Dans toute socit humaine, des forces trs nergiques, dont nous
ne connaissons pas encore scientifiquement les lois, s'emploient au maintien et la
conservation de ce qui est (langage, institutions, droit, morale, etc.) et font contrepoids aux forces, aussi peu connues que les premires, qui tendent amener des changements. Mais qui nous garantit que ces forces agissent, les unes et les autres, de
faon produire comme rsultante un tat satisfaisant ? Et ce qui est satisfaisant,
utile, indispensable mme un moment donn, ne peut-il devenir tout le contraire
aprs un certain temps ? Par exemple, l'habitude de spculer abstraitement sur des
concepts, qui nous vient des Grecs, est un des legs les plus prcieux que ce peuple
admirable nous ait laisss. Sans lui, nous n'aurions eu ni notre philosophie, ni sans
doute nos sciences. Mais il vient un moment o la dialectique abstraite, oprant sur
des concepts, loin de servir au progrs de la science, lui est au contraire un obstacle :
c'est cette habitude qui a paralys, au moins en partie, les sciences dites morales et
sociales. L'organisation domestique et conomique de la Chine actuelle a t, pour
autant que nous sachions, un progrs sur son tat antrieur ; mais, plus tard, cette
organisation semble avoir frapp la civilisation chinoise d'un arrt de dveloppement.
En France, le Code civil, il y a un sicle, a marqu un progrs, du moins sur un grand
nombre de points, en comparaison de l'tat juridique antrieur ; mais on commence
sentir trs vivement qu'il s'oppose, son tour, au progrs, et qui sait quand cet
obstacle pourra tre surmont ?
En un mot, toute institution qui consolide et matrialise, pour ainsi dire, un progrs acquis, tend devenir un empchement l'gard du progrs ultrieur. Ce qui
tait protection devient tyrannie. La forteresse devient prison, le droit devient privilge. Pour draciner ensuite les tyrannies, pour dmolir les prisons, pour abolir les
privilges, la violence est trop souvent ncessaire.
Dans les socits marche relativement rapide, telles que la ntre, comme toutes
les sries sociales n'voluent pas pari passu, la rsistance au changement devient
particulirement sensible pour certaines d'entre elles, et pour la morale plus que pour
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 175
toute autre. La conscience gnrale sent sa stabilit menace par l'volution commune
de l'organisation sociale. Elle s'alarme instinctivement de cette menace, et elle s'efforce d'y parer par une affirmation d'autant plus nergique de l'immutabilit de la
morale. Effort louable peut-tre dans son principe, mais qui a pour consquence
ncessaire une sorte d'hypocrisie gnralise.
Par une convention tacite, les consciences individuelles feignent d'accepter
comme obligatoires de prtendus devoirs qu'elles ne se sentent plus rellement
obliges de remplir. Que l'on parcoure la liste des devoirs - devoirs envers soi-mme,
devoirs envers autrui, devoirs envers Dieu - qui figurent, aujourd'hui encore, dans les
manuels de morale, religieux, laques, ou neutres, et l'on verra combien il en est qui,
pour la conscience actuelle, n'ont plus qu'une ralit illusoire et verbale. - Mais,
pourra-t-on dire, il en a toujours t ainsi. Jamais, en effet, la conscience morale commune n'a correspondu exactement, dans le dtail de ses prescriptions, l'tat d'avancement des autres sries sociales : il suffit qu'elle se trouve assez en harmonie avec
elles pour qu'elle ne soit pas choque par les contradictions. - Il est vrai ; mais le
dsaccord que nous signalons ne porte pas seulement sur des points de dtail. Il
touche aux questions fondamentales, la conception mme de la vie. Ce qui le prouve, c'est l' indiffrence de l'homme d'aujourd'hui l'gard de plusieurs de ces
devoirs traditionnels. A d'autres poques, il ne les remplissait peut-tre pas mieux,
mais au moins il les violait, et il savait qu'il les violait. Ils taient prsents sa
conscience ; ils se faisaient sentir elle par le commandement, et, au besoin, par le
remords. Maintenant on ne les transgresse plus, on les ignore. Pourquoi ? Parce que
les croyances religieuses qui en taient l'me et la raison d'tre se sont elles-mmes
affaiblies, et ne peuvent plus leur servir de soutien. Aussi, comme chacun de nous sait
fort bien distinguer ce qui est l'objet d'une sanction relle de la conscience commune,
et ce qui n'est command ou interdit par elle que verbalement, pour la forme, il
s'ensuit que notre morale relle ne concide plus avec la morale que nous professons.
Parmi les obligations que tous font semblant de reconnatre, il en est, et de fort importantes en apparence, que personne ne se soucie plus de remplir. Ce n'est pas, comme
jadis, parce que notre faiblesse, notre gosme, ou nos passions nous en empchent :
c'est qu'au fond elles ne sont plus senties comme des obligations.
On allguera peut-tre que cette hypocrisie universelle ne cause pas grand dommage, prcisment parce qu'elle est universelle et qu'elle ne trompe personne. - Ce
dernier point ft-il exact, les consquences de cette hypocrisie n'en seraient pas moins
graves socialement. D'abord, elle vicie et corrompt l'enseignement moral. Les qualits
de droiture, de franchise, de respect de soi-mme et d'autrui, que cet enseignement
devrait dvelopper avant toute autre, sont par l irrmdiablement compromises.
Chaque enfant doit professer en paroles des respects qu'il n'prouve nullement en
ralit, et qu'il ne voit prouver par personne autour de lui. On lui enseigne a mpriser
le mensonge, mais on le pratique dans cet enseignement mme, et on lui donne le
got et l'habitude de le pratiquer aussi : trange cole de moralit ! En outre, l'habitude d'affirmer que nous croyons ce que nous ne croyons pas ajoute une difficult de
plus, et non des moindres, toutes celles qui s'opposent dj ce que nous voyions
les choses telles qu'elles sont. Elle rend plus pnible et plus rare l'effort ncessaire
pour subordonner nos imaginations la connaissance objective du rel. Enfin, en
maintenant opinitrement la ralit apparente de ce qu'on peut appeler des superstitions sociales, elle incline la conscience morale conserver aussi les croyances
surannes de tout ordre, les institutions primes, tout ce qui enfin, dans l'tat actuel
de la socit, reprsente le poids mort du pass arrtant le progrs.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 176
Si fcheux que soient ces inconvnients, il ne suffirait sans doute pas d'y insister
pour mettre fin l'hypocrisie qui les produit. La forcer disparatre n'est pas affaire
de simple persuasion. Le seul moyen peut-tre d'y parvenir serait de s'attacher la
connaissance objective et scientifique de la ralit sociale, puisque cette connaissance
ferait distinguer ce qui est vraiment vivant et rel de ce qui ne l'est plus qu'en
apparence. C'est de l que partirait l'action efficace de cet art social rationnel , dont
nous n'avons encore que l'ide.
IV
Conclusion. Schme gnral provisoire de l'volution des rapports de la pratique
et de la thorie en morale. Trois grandes priodes. Disparition, dans la troisime,
des Postulats religieux, finalistes, anthropocentriques. - tude de la ralit
sociale par une mthode scientifique. -Applications possibles de cette science
dans l'avenir.
Retour la table des matires
Si maintenant, abandonnant le point de vue de la pratique, nous revenons considrer les morales humaines du point de vue du savoir, dans leur diversit concrte, en
allant des plus humbles aux plus avances, nous pourrons en distinguer trois formes
principales, sans prtendre qu'elles doivent traverser toutes ncessairement les mmes
stades d'volution. Rien ne permet d'affirmer, a priori, qu'il doive en tre ainsi, et rien
ne le prouve non plus, a posteriori, jusqu' prsent.
Dans une premire forme, qui se rencontre encore dans les socits infrieures, et
qui a trs probablement exist chez les autres, la morale d'une socit donne, un
moment donn, est purement et simplement ce que les croyances religieuses, les
institutions, l'tat conomique, les conditions ambiantes et le pass de cette socit
font qu'elle est. Elle est fonction des autres sries de phnomnes sociaux, et, s'ils
voluent, son volution suit la leur, suivant des lois que nous ignorons encore, avec
plus ou moins d'exactitude et de rapidit. Elle en dpend uniquement : ses singularits, ou du moins ce qui parat tel nos yeux, ont leur explication dans l'ensemble
social dont elle fait partie. On peut donc la dire spontane ; non qu'elle apparaisse
sans raison visible puisque, au contraire, tout y a sa raison dans la ralit sociale
donne, mais parce que la rflexion n'intervient ni pour la produire, ni pour la
modifier, du moins d'une faon apprciable. A cette priode, chaque individu connat
ses obligations morales comme il parle sa langue, comme il pratique sa religion,
comme il vit sa vie sociale. Sa conscience morale, indistincte ou peu distincte de celle
du groupe, dpend de certaines reprsentations collectives, qui dterminent sa
conduite : se demander d'o elles viennent et sur quoi se fonde leur autorit est une
ide qui ne se prsente pas lui. Si elle lui tait suggre, elle lui resterait entirement
incomprhensible. Les sentiments qui accompagnent ces reprsentations collectives
n'en sont que plus nergiques : voyez, par exemple, les cas si nombreux o l'homme
qui a viol, mme involontairement, un tabou, tombe dans un dsespoir mortel.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 177
Le signe le plus caractristique de cette priode est la particularisation des
pratiques morales. Elles sont autres pour l'homme, autres pour la femme ; autres pour
le membre du totem, du clan, de la famille, et pour celui qui n'en est pas membre ;
autres l'gard de telle ou telle catgorie de personnes, l'gard de cet animal-ci ou
de celui-l, telle poque de l'anne ou telle autre, en tel lieu ou en tel autre, en
temps de paix ou en temps de guerre, etc. Le rseau des obligations et des interdictions peut tre extrmement complexe, et d'une complexit organique, comparable
celles des langues plutt qu' celle des oeuvres de la rflexion humaine. L'individu les
subit et s'y conforme sans les ramener a un principe. Il accepte chaque obligation et
chaque interdiction spciale sans s'inquiter de rechercher pourquoi elle est dfinie et
formule de cette faon, et non d'une autre. Beaucoup de morales humaines n'ont pas
dpass ce point. Dans les socits suprieures, il subsiste un grand nombre d'individus chez qui cette forme de la conscience morale est encore reconnaissable.
Le second stade est celui o la rflexion commence s'appliquer la ralit
morale, mais non pas tant pour la connatre - n'en a-t-on pas la connaissance immdiate dans les ordres de la conscience ? - que pour la rgler et la lgitimer aux yeux de
la raison. Un effort d'analyse et de gnralisation tend dterminer les ides du bien
et du mal, du juste et de l'injuste, de la vertu et du vice, du mrite et du dmrite, etc.
C'est, sous forme abstraite, luvre des moralistes, des psychologues, des philosophes, et, sous une forme moins systmatique, luvre des conteurs et des potes. Il est
peu de socits humaines o cet effort ne se soit produit. Mais, dans les socits qui
ne sont pas intellectuellement trs avances, les conteurs et les potes sont surtout des
voix qui expriment les reprsentations et les sentiments collectifs, et, dans les socits
les plus dveloppes, les psychologues, les moralistes, les philosophes mmes emploient une mthode soit d'observation immdiate et surtout littraire, soit d'analyse
dialectique et surtout conceptuelle, qui ne les conduit pas trs avant dans la connaissance positive de la ralit sociale 1. Leur tentative n'en est pas moins de la plus haute
importance. En essayant de fonder les pratiques morales sur un principe qui leur soit
propre, elle ne rompt pas la solidarit invincible qui les relie aux autres sries sociales; mais elle contribue dgager cette srie de celles avec lesquelles elle est plus
spcialement en rapport (croyances et pratiques religieuses, institutions juridiques).
Elle lui procure une indpendance relative, et par l mme elle modifie dans une
certaine mesure la ralit sociale existante. Car, si lche que soit en effet le lien entre
la morale thorique et la morale pratique d'une socit donne, le seul fait que la
morale pratique est reprsente (mme tort) comme dduite de la morale thorique,
tend introduire un peu d'ordre logique, et par suite plus de raison, dans l'ensemble
des pratiques traditionnelles. Nul doute, par exemple, que la rflexion philosophique
des Grecs n'ait exerc une influence sur l'volution de leur morale, et, par elle, sur la
morale de tout l'Occident civilis.
Le signe caractristique de cette priode est l'universalisation des principes de la
morale. Dans la phase prcdente, la ralit sociale objective s'imposait simplement
chaque individu sous forme d'obligations et d'interdictions, et le respect qu'elle
inspirait et exigeait avait quelque chose de religieux. Pour la rflexion philosophique,
ce sentiment se lacise. L' imprativit des prescriptions, pour devenir intelligible,
se fonde sur l'universalit des principes d'o elles sont censes dcouler. De l des
systmes de morale, qui rattachent la riche complexit de la vie morale un
principe unique, comme les mtaphysiques ramnent toute la ralit phnomnale
1
Voyez plus haut, chap. VI, 1.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 178
l'absolu de l'tre. La porte universelle des principes est admise sans difficult, parce
qu'ils paraissent rationnels, et surtout parce qu' cette priode la pense philosophique
rflchit en effet la ralit morale existante, mais ne la critique pas. Fait significatif :,un caractre analogue se retrouve jusque dans les doctrines empiriques. Tout
opposes qu'elles sont l'a priori, l'absolu, tout ce qui dpasse l'exprience, elles
prtendent aussi dterminer, par la mthode qui leur est propre, la conduite de l'homme en gnral, le bien, le juste, etc. Et dans leurs doctrines, non moins que dans les
systmes rationalistes, le dsaccord clate entre l'universalit apparente des formules
et la particularit effective des obligations enseignes.
Enfin, nous voyons aujourd'hui s'annoncer, dans les socits les plus avances au
point de vue intellectuel, une troisime priode, o la ralit sociale sera tudie
objectivement, mthodiquement, par une arme de savants anims du mme esprit
que ceux qui, depuis longtemps, se sont attaqus la nature inorganique et la nature
vivante. Dans cette priode, dont on peut peine dire qu'elle commence, et dont nous
avons essay de dfinir les ides directrices, on se persuaderait qu'une ralit trs
vivement sentie peut nanmoins tre trs mal connue, et que telle est prcisment la
ralit morale qui s'impose chacun de nous. On se rendrait compte, en mme temps,
que cette ralit morale est autre dans d'autres civilisations, qui ont chacune leur
volution indpendante : d'o la possibilit, et mme la ncessit, d'une tude comparative. Aprs s'tre ainsi familiaris avec l'ide de la pluralit des morales, qui correspondent, chaque poque donne, l'ensemble des conditions existant dans chaque
socit considre, on serait prpar la recherche des causes religieuses, conomiques, etc., qui ont agi sur elles. Cette recherche suppose videmment la constitution
tant des sciences sociologiques particulires que de la sociologie gnrale. Plus tard,
dans un avenir qu'il nous est peine permis d'entrevoir, ces sciences seront assez
avances pour rendre possibles des applications. Des arts rationnels apparatront,
donnant l'homme un pouvoir sur la nature sociale analogue, sinon gal, celui
qu'il exerce dj sur la nature physique. Nous en voyons quelques commencements, encore faibles, en pdagogie, par exemple, et en conomie sociale. Dans
l'intervalle, notre socit continuera de vivre avec la morale qui lui est propre. Malgr
le travail critique, insparable de la recherche scientifique, il n'y a pas lieu de craindre
pour cette morale une dcomposition rapide, les forces sociales qui tendent la
conserver, mme dans ses parties surannes ou mortes, tant de beaucoup suprieures
aux forces qui tendent la modifier, du moins dans l'tat actuel de notre socit.
Le trait le plus caractristique de cette priode - autant que nous pouvons nous
hasarder le dfinir - est l'habitude constante de considrer la morale d'une socit
donne, mme de la ntre, dans son rapport ncessaire avec la ralit sociale dont elle
est une partie. Attitude la fois modeste et critique. On ne pense plus que la
conscience morale du sicle o l'on vit et du pays que l'on habite, soit prcisment,
par une concidence merveilleuse, la conscience absolue, lgislatrice de ce que tout
tre raisonnable et libre est tenu de faire ou de ne pas faire, de toute ternit. On se
demande plutt si elle ne garde plus de vestiges de l'tat infrieur ou sauvage, qui
nous parat si loin de nous et dont nous sommes pourtant encore si prs ; si nous
n'obissons pas souvent, sans le savoir, des reprsentations et des sentiments
collectifs dont l'origine et le sens sont perdus pour nous, et dont il faudrait examiner
l'importance pour notre tat actuel ; si enfin, avant de construire la morale meilleure
o nous aspirons, nous n'avons pas apprendre d'abord ce qu'est la morale que nous
pratiquons.
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 179
La connaissance de la nature physique, si imparfaites et si jeunes que soient encore nos sciences, a affranchi les esprits d'une foule de conceptions puriles ou absurdes, de prjugs, de croyances sans fondement, et de systmes imaginaires ; en mme
temps, elle nous a ouvert le monde de l'infiniment grand et de l'infiniment petit, qui
parle plus puissamment notre me que ne faisait le monde fini, avec la Terre et
l'homme au centre. On peut prsumer que les sciences de la ralit sociale ne seront ni
moins libratrices, ni moins fcondes. Elles aussi, elles affranchiront peu peu l'esprit
des conceptions puriles et absurdes, des croyances mal fondes et des systmes imaginaires, et, par une consquence immdiate, elles feront disparatre, plus ou moins
vite, mais srement, les pratiques inutiles, barbares, malfaisantes, et les sentiments
inhumains qui y sont attachs. De mme encore, la nature sociale que nous feront
connatre ces sciences surpassera sans doute de beaucoup, en complexit vivante et en
intrt pathtique, le monde moral , le rgne des fins , et la cit de Dieu ,
pauvres et monotones imaginations que les thologiens et les philosophes se sont
transmises jusqu' prsent.
Bref, pour emprunter George Eliot un mot profond : We are all born in moral
stupidity. (Nous naissons tous dans un tat de stupidit morale.) Cette rflexion s'applique aux socits comme aux individus. Si nous voulons sortir de cet tat, la seule
voie qui nous offre quelque chance de succs est celle de la science. Socrate et ses
grands disciples l'avaient admirablement dit. Revenons leur ide ; mais, instruits par
l'exprience des sicles et par le succs des sciences de la nature physique, ne revenons pas leur mthode. Laissons l'analyse dialectique des concepts. Mettons-nous
modestement, mais rsolument, l'tude de la ralit sociale, c'est--dire l'analyse
scientifique du pass des diffrentes socits humaines et des lois qui rgissent les
diffrentes sries de phnomnes sociaux et leurs rapports. Prenons ainsi conscience
et de notre ignorance, et de nos prjugs. Mesurons, s'il est possible, tout ce que nous
avons apprendre, et aussi tout ce que nous avons dsapprendre. L'normit de la
tche ne nous effrayera pas, si nous rflchissons qu'elle sera luvre de sicles, et
que chaque gnration aura bien mrit des suivantes, si elle a fait seulement un peu
de ce qui est faire, dfait un peu de ce qui est dfaire. Sans doute, nous ne pourrions mme pas entrevoir cette tche, sans le travail accumul des gnrations qui
nous ont prcds. Mais dire que nous concevons la ralit morale comme un objet de
science implique prcisment que nous n'acceptons pas tout l'hritage du pass avec
un sentiment uniforme et religieux de respect. Nous nous sentons tenus, au contraire,
de le soumettre un examen critique ; non pas d'aprs notre sentiment individuel ou
collectif, qui ne saurait avoir qu'une valeur subjective, mais d'aprs la connaissance
scientifique, objective, de la ralit sociale.
Nous sommes donc toujours ramens l'ide du savoir qui affranchit. Mais
n'imaginons pas que cet affranchissement se produise de lui-mme, ni qu'une sorte de
ncessit bienfaisante assure par avance le progrs des sciences. Le spectacle que
nous donne l'histoire de l'humanit est tout autre : nous n'y voyons presque, au contraire, que des socits arrtes dans leur dveloppement, vgtant ou prissant, ou
soumises un ensemble de conditions qui n'a pas permis un progrs dcisif la
connaissance positive de la nature. La Grce seule a fait une radieuse exception, et
nous vivons encore de son esprit. Toutefois, nous n'en vivrons vraiment que s'il est
actif en nous, c'est--dire, que si nous poursuivons la conqute mthodique de tout le
rel par la science. Il nous faudra, il est vrai, vaincre une redoutable force d'inertie.
Pour organiser et pour mener bien l'tude objective de la nature morale , nous
avons nous dlivrer d'habitudes mentales et de prventions que les sicles couls
ont rendues la fois tyranniques et vnrables. Mais cet effort qu'il faut donner, notre
Lucien Lvy-Bruhl (1903), La morale et la science des murs. 180
socit ne s'y drobera pas : d'abord, parce qu'elle le sent ncessaire et que des esprits
vigoureux l'entreprennent dj ; puis, parce que le succs et les progrs interrompus
des sciences de la nature physique lui servent la fois d'exemple et d'encouragement.
You might also like
- AttachmentDocument18 pagesAttachmentCoubera bour Wadi norsiNo ratings yet
- Foucault, Généalogie de L'ethique Travail en CoursDocument19 pagesFoucault, Généalogie de L'ethique Travail en CoursLuis R DavilaNo ratings yet
- MegeMorin - Ethique Et FiliationDocument39 pagesMegeMorin - Ethique Et FiliationaliodormanoleaNo ratings yet
- workingpaperCEPN2015 20Document22 pagesworkingpaperCEPN2015 20H Mour KhalNo ratings yet
- Histoire de la philosophie: Une édition complète de l'Histoire de la philosophie des origines à nos joursFrom EverandHistoire de la philosophie: Une édition complète de l'Histoire de la philosophie des origines à nos joursRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Éthique de la communication appliquée aux relations publiquesFrom EverandÉthique de la communication appliquée aux relations publiquesNo ratings yet
- Naturalité BienDocument32 pagesNaturalité BienLe Comte de BronzeNo ratings yet
- Epistemologie Sciences PoDocument53 pagesEpistemologie Sciences PoRabiou DjamalouNo ratings yet
- Le Paradigme Positiviste Et Le Paradigme InterprétatifDocument15 pagesLe Paradigme Positiviste Et Le Paradigme InterprétatifIssa FofanaNo ratings yet
- Cours Sur Les Origines de La Vie Religieuse DURKHEIM-EmileDocument49 pagesCours Sur Les Origines de La Vie Religieuse DURKHEIM-EmileMohamed Akdime100% (1)
- 1 PBDocument11 pages1 PBNOUANI ChristNo ratings yet
- Sastre - PeggyDocument471 pagesSastre - Peggypindurs1No ratings yet
- Théorie de La ConnaissanceDocument7 pagesThéorie de La ConnaissancePablo LázaroNo ratings yet
- Syllabus Sociologie de La SanteDocument21 pagesSyllabus Sociologie de La Santefallone zannouNo ratings yet
- La Méthodologie Des Sciences Juridiques Et Des Sciences Sociales AgadirDocument20 pagesLa Méthodologie Des Sciences Juridiques Et Des Sciences Sociales AgadirAnass Yio33% (6)
- Methodologie s1Document22 pagesMethodologie s1Bentebbaa AmineNo ratings yet
- L'influence de L'odeur Des Croissants Chauds Sur La Bonté Humaine - Et Autres Questions de Philosophie Morale ExpérimentaleDocument321 pagesL'influence de L'odeur Des Croissants Chauds Sur La Bonté Humaine - Et Autres Questions de Philosophie Morale ExpérimentaleLahouari Fatah100% (2)
- Sommaire 2122 La Periode ModerneDocument14 pagesSommaire 2122 La Periode Modernedjetou33% (3)
- Rapport FinalDocument26 pagesRapport FinalMoussa SowNo ratings yet
- Culture Scientif I QueDocument44 pagesCulture Scientif I QueRiyad 2135oNo ratings yet
- De la démocratie dans les sciences: Epistémologie, éthique et pluralismeFrom EverandDe la démocratie dans les sciences: Epistémologie, éthique et pluralismeNo ratings yet
- II - COURS - 4 (22 Nov 2011) - V2 LumiereDocument61 pagesII - COURS - 4 (22 Nov 2011) - V2 LumiereThieze NganafioNo ratings yet
- PDC - Landry - 102 A23 Landry 1Document8 pagesPDC - Landry - 102 A23 Landry 1Crucye12No ratings yet
- La Question de La Méthode en Science PolitiqueDocument29 pagesLa Question de La Méthode en Science PolitiqueMourad BenslimaniNo ratings yet
- Philosophie Et Ethique 2023Document36 pagesPhilosophie Et Ethique 2023nzaubenedicte47No ratings yet
- Le PerfectionnismeDocument11 pagesLe PerfectionnismeSergio M.No ratings yet
- Le Sujet Ancien D Une Politique Modern. Sur La Subjectivation Et L Ethique Anciennes Dans Les Dits Et Écrits de Michel FoucaultDocument21 pagesLe Sujet Ancien D Une Politique Modern. Sur La Subjectivation Et L Ethique Anciennes Dans Les Dits Et Écrits de Michel FoucaultThiago Vieira Mathias de OliveiraNo ratings yet
- Ali AmisDocument4 pagesAli AmisabdelchafipubgmobileNo ratings yet
- Histoire de La Philosophie - Temps ModernesDocument61 pagesHistoire de La Philosophie - Temps Moderneseris_lashtamNo ratings yet
- Qu Est Ce Que L Ethique Des Vertus - Konstantin BuechlerDocument18 pagesQu Est Ce Que L Ethique Des Vertus - Konstantin BuechlerYves GhiotNo ratings yet
- L3 FASE. Morale Et Éthique Chrétienne. OKDocument43 pagesL3 FASE. Morale Et Éthique Chrétienne. OKmapepehaniel02No ratings yet
- Support Cours Intro SOCIO PR - BOUZIDI2Document110 pagesSupport Cours Intro SOCIO PR - BOUZIDI2Oumaima TahdiNo ratings yet
- Support Ls5 DC 5 2 Epistemologie GeneraleDocument32 pagesSupport Ls5 DC 5 2 Epistemologie GeneralejudemughumalewaNo ratings yet
- Sommaire 2122 Caractere de La SociologieDocument10 pagesSommaire 2122 Caractere de La SociologiedjetouNo ratings yet
- Psychologie Cognitive PDFDocument32 pagesPsychologie Cognitive PDFWilliam AcevedoNo ratings yet
- Cadrage TheoriqueDocument6 pagesCadrage TheoriquehadjarjijiNo ratings yet
- Notes de Cours TCS.2021-2022Document203 pagesNotes de Cours TCS.2021-2022lisaa.bNo ratings yet
- DURKHEIM, Émile - Soiologie Et Sciences SocialesDocument29 pagesDURKHEIM, Émile - Soiologie Et Sciences SocialesjeansegataNo ratings yet
- Les Idéologies Fernand DumontDocument172 pagesLes Idéologies Fernand DumontGuettabyNo ratings yet
- Sociologie Sciences Berthelot-AsDocument17 pagesSociologie Sciences Berthelot-AsYosueNo ratings yet
- Les Fon Ctions Men 00 LVDocument477 pagesLes Fon Ctions Men 00 LVRuy AntonucciNo ratings yet
- Intro Science Politique S1 - CompressedDocument17 pagesIntro Science Politique S1 - CompressedAaa BbbNo ratings yet
- Cours Jan LackiDocument124 pagesCours Jan LackiElmiliani AmdNo ratings yet
- Ethique L1 - Chap 1Document8 pagesEthique L1 - Chap 1PharelleNo ratings yet
- Socio LogieDocument21 pagesSocio LogiesamuelNo ratings yet
- Cours Sur L'éthique Licence 1Document15 pagesCours Sur L'éthique Licence 1moussateckagne205No ratings yet
- L'éthique Médicale Et La Bioéthique-2022Document128 pagesL'éthique Médicale Et La Bioéthique-2022mostadi100% (1)
- Wang Tch'ang-The - La Philosophie Morale de Wang Yang-Ming PDFDocument231 pagesWang Tch'ang-The - La Philosophie Morale de Wang Yang-Ming PDFjfreixooliveiraNo ratings yet
- La Morale JournetDocument22 pagesLa Morale JournetHeriniaina Oliva RazafimanantsoaNo ratings yet
- Martin Coulmont Sociologues ReligionDocument13 pagesMartin Coulmont Sociologues Religionmafinaritra17No ratings yet
- Cours de Méthodes Des Sciences Sociales 2020Document64 pagesCours de Méthodes Des Sciences Sociales 2020Moyza DiopNo ratings yet
- Durkheim - Détermination Du Fait MoralDocument69 pagesDurkheim - Détermination Du Fait Moralmartin686No ratings yet
- Darwin Charles - L'expression Des Émotions Paris 1890Document421 pagesDarwin Charles - L'expression Des Émotions Paris 1890telosgrapheni007No ratings yet
- Marcel DuchampDocument178 pagesMarcel DuchampIsa Lemmyp100% (1)
- Hara Kiri 164Document64 pagesHara Kiri 164Isa Lemmyp100% (2)
- Lucien Lévy-Bruhl (1935) - La Mythologie PrimitiveDocument204 pagesLucien Lévy-Bruhl (1935) - La Mythologie Primitivejafarroger100% (1)
- Car NetsDocument152 pagesCar NetspichonisimaNo ratings yet
- Lucien Lévy-Bruhl - L'expérience Mystique Et Les Symboles Chez Les PrimitifsDocument156 pagesLucien Lévy-Bruhl - L'expérience Mystique Et Les Symboles Chez Les PrimitifszazatoNo ratings yet
- Catalogue DadaDocument164 pagesCatalogue DadaIsa Lemmyp100% (2)
- L'ame PrimitiveDocument222 pagesL'ame PrimitiveJuan Luis LozaNo ratings yet
- Cellini L'artisteDocument15 pagesCellini L'artisteIsa LemmypNo ratings yet
- Testament de SadeDocument2 pagesTestament de SadeIsa LemmypNo ratings yet
- Artaud Sade LacanDocument18 pagesArtaud Sade LacanIsa LemmypNo ratings yet
- Sade Libertinage Et RévolutionDocument12 pagesSade Libertinage Et RévolutionIsa LemmypNo ratings yet
- Apocalypse Saint SimonDocument5 pagesApocalypse Saint SimonIsa LemmypNo ratings yet
- Surnaturel Et NatureDocument293 pagesSurnaturel Et NatureIsa Lemmyp100% (1)
- Lacan Sade KantDocument20 pagesLacan Sade KantIsa LemmypNo ratings yet
- Gracian HerosDocument107 pagesGracian HeroszinelhNo ratings yet
- Autour de Roger CailloisDocument154 pagesAutour de Roger CailloisIsa LemmypNo ratings yet
- Initiation A La Psychologie PDFDocument105 pagesInitiation A La Psychologie PDFPhanieGruwier100% (1)
- L'adepte ContemporainDocument15 pagesL'adepte ContemporainIsa Lemmyp100% (1)
- La Revolution Surrealiste 06 Mars 1926Document35 pagesLa Revolution Surrealiste 06 Mars 1926Isa LemmypNo ratings yet
- La Marquise de SadeDocument6 pagesLa Marquise de SadeIsa LemmypNo ratings yet
- La Revolution Surrealiste 11 Mars 1928Document48 pagesLa Revolution Surrealiste 11 Mars 1928Isa LemmypNo ratings yet
- Le Surrealisme Au Service de La Revolution No3Document49 pagesLe Surrealisme Au Service de La Revolution No3Isa LemmypNo ratings yet
- Genet Ou La Danse Macabre Du Bien Et Du MalDocument18 pagesGenet Ou La Danse Macabre Du Bien Et Du MalIsa LemmypNo ratings yet
- La Revolution Surrealiste 07 Juin 1926Document36 pagesLa Revolution Surrealiste 07 Juin 1926Isa LemmypNo ratings yet
- La Revolution Surrealiste 05 Octobre 1925Document36 pagesLa Revolution Surrealiste 05 Octobre 1925Isa LemmypNo ratings yet
- Car NetsDocument152 pagesCar NetspichonisimaNo ratings yet
- Gilles de Rais MythesDocument3 pagesGilles de Rais MythesIsa LemmypNo ratings yet
- Ravachol Et Les AnarchistesDocument234 pagesRavachol Et Les AnarchistesIsa LemmypNo ratings yet
- Hymnes Et Chansonnettes de L'étangDocument91 pagesHymnes Et Chansonnettes de L'étangkarunamayiNo ratings yet
- Les Blessures Par Arme A FeuDocument23 pagesLes Blessures Par Arme A FeuSoniaNo ratings yet
- 4 Fabrication Des Frittes Rôle Des MP Stratégiques Karine Sarrazy APEV Octobre 2014Document33 pages4 Fabrication Des Frittes Rôle Des MP Stratégiques Karine Sarrazy APEV Octobre 2014mohammedNo ratings yet
- 1862 Levi Fables Et Symboles PDFDocument482 pages1862 Levi Fables Et Symboles PDFPaulo Sequeira RebeloNo ratings yet
- Correction TD5 Analyse1 MIPC 21 22Document13 pagesCorrection TD5 Analyse1 MIPC 21 22Abdessamad AchehrourNo ratings yet
- Etude Des Caractéristiques Microstructurales Et Électriques de La Solution SolideDocument164 pagesEtude Des Caractéristiques Microstructurales Et Électriques de La Solution SolideIloDzairNo ratings yet
- Listedescandidatsconvoqusauxpreuvescrites Techniciens 3 EMEGRADDocument24 pagesListedescandidatsconvoqusauxpreuvescrites Techniciens 3 EMEGRADpopoNo ratings yet
- Chap V MACHINE THERMIQUE - ST - GC - GEDocument19 pagesChap V MACHINE THERMIQUE - ST - GC - GEJean Marc LengeNo ratings yet
- Guide Invest OleicoleDocument18 pagesGuide Invest Oleicoleالسيد تامرNo ratings yet
- Cerballiance Res 20220205 C20205GR0062Document3 pagesCerballiance Res 20220205 C20205GR0062Ba Bou0% (1)
- Epreuve Anova - Ise 2021 2022-1Document2 pagesEpreuve Anova - Ise 2021 2022-1Thinkpad LenovoNo ratings yet
- La Gloire de Mon Père - DossierDocument12 pagesLa Gloire de Mon Père - DossierformazNo ratings yet
- HAMZA - NCIRI Lintelligence (Atramenta - Net)Document10 pagesHAMZA - NCIRI Lintelligence (Atramenta - Net)poupinouNo ratings yet
- Nouvelle Traduction Du Missel RomainDocument31 pagesNouvelle Traduction Du Missel RomainÉric Smith DieudonnéNo ratings yet
- ML330 Français PDFDocument53 pagesML330 Français PDFHugues ThiloNo ratings yet
- Charles Lancelin Méthode de DédoublementDocument516 pagesCharles Lancelin Méthode de DédoublementMunir BazziNo ratings yet
- PDF NGKDocument262 pagesPDF NGKbouani yosriNo ratings yet
- 12 Courbes D'équation en Coordonnées PolairesDocument24 pages12 Courbes D'équation en Coordonnées PolairesTarik ZiadNo ratings yet
- S3_H_-_MENU_NUTRICHALLENGE_xmascut_copieDocument15 pagesS3_H_-_MENU_NUTRICHALLENGE_xmascut_copiesmile-attitude51No ratings yet
- 115 EnigmesDocument21 pages115 EnigmesEloualia AbdassamadNo ratings yet
- AlteonOS-32-6-0-AppWall For Alteon User GuideDocument227 pagesAlteonOS-32-6-0-AppWall For Alteon User GuideViệt Trung LềuNo ratings yet
- Définition Du Centre CommercialDocument10 pagesDéfinition Du Centre CommercialBouafane SoumayaNo ratings yet
- Methode Des 5SDocument4 pagesMethode Des 5Sbotroskam100% (1)
- Ajustement Enregistré AutomatiquementDocument7 pagesAjustement Enregistré Automatiquementkhalil abaabNo ratings yet
- MacroéconomieDocument13 pagesMacroéconomieWIAME BENJEDDINo ratings yet
- 4cf Plui Modif3 RP Annexe 2Document60 pages4cf Plui Modif3 RP Annexe 2BOATENG AUGUSTENo ratings yet
- Série de TD 5Document1 pageSérie de TD 5Hala LALAYMIANo ratings yet
- Projet de Recherche en Science PolitiqueDocument5 pagesProjet de Recherche en Science PolitiqueDylan KramohNo ratings yet
- Stationnement HD WebDocument4 pagesStationnement HD WebMat KNo ratings yet
- Compte-Rendu TP Orga N°1Document14 pagesCompte-Rendu TP Orga N°1dockcannibal88% (8)