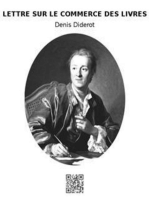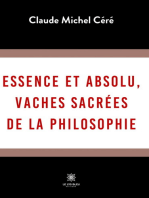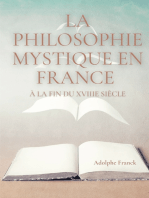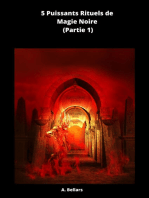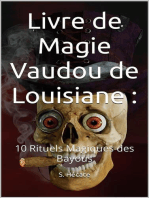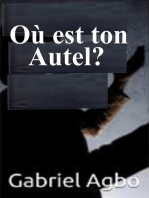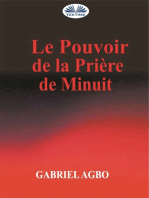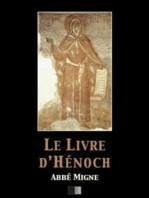Professional Documents
Culture Documents
Comentário Aos Essais de Theodicée PDF
Uploaded by
André BernardesOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Comentário Aos Essais de Theodicée PDF
Uploaded by
André BernardesCopyright:
Available Formats
Leibniz
Essais de Théodicée
Pascal Dupond
Philopsis : Revue numérique
http://www.philopsis.fr
Les articles publiés sur Philopsis sont protégés par le droit d’auteur. Toute
reproduction intégrale ou partielle doit faire l’objet d’une demande
d’autorisation auprès des éditeurs et des auteurs. Vous pouvez citer libre-
ment cet article en en mentionnant l’auteur et la provenance.
Quelques mots, en introduction, sur la situation historique et spiri-
tuelle de l’Europe au moment de la publication des Essais de Théodicée.
Une Espagne déclinante, qui a dû concéder, par le Traité de Westpha-
lie (1648, deux années après la naissance de Leibniz), l’indépendance des
Sept Provinces-Unies (les Pays-Bas).
Une Grande-Bretagne en crise : exécution de Charles 1e en janvier
1649, puis époque de Cromwell, de la chute de la monarchie jusqu’à son ré-
tablissement en 1661.
Une France déchirée par des deux Frondes, entre 1649 et 1653.
Un St Empire romain germanique mal organisé et mal délimité, grou-
pant 360 Etats souverains, avec de nombreux affrontements politiques et re-
ligieux.
Une Europe divisée par la scission et les violences multiples qui ont
suivi l’émergence de la Réforme.
Le point de départ de la Réforme est la protestation contre ce qui a été
appelé le trafic des Indulgences : le moine augustin Martin Luther affiche le
31 octobre 1517 ses « 95 thèses sur la vertu des indulgences » à la porte de
l’église de Wittenberg. Suit une violente riposte de l’Eglise : Luther est ex-
communié en janvier 1521 et mis au ban de l’Empire par l’édit de Worms en
avril 1521. Malgré cela les idées de la Réforme se propagent rapidement en
Allemagne et hors d’Allemagne. A Zurich, le prédicateur Zwingli (1484-
1531) mène un mouvement de Réformation dès 1521. A Strasbourg, le théo-
logien dominicain Martin Bucer (1491-1551) prêche le luthérianisme à partir
de 1523 et parvient à inciter sa ville à rompre avec le catholicisme en 1534.
A Genève, Jean Calvin (1509-1564) organise une église protestante et fait
rapidement de la ville une véritable cité-refuge et capitale spirituelle du pro-
testantisme (fondation d'une académie de pasteurs (1559), production de
www.philopsis.fr
livres protestants à destination de toute l'Europe.... En 1530, la diète du St
Empire romain germanique se réunit à Augsbourg devant l’empereur
Charles-Quint pour arbitrer le conflit entre les partisans et les ennemis de
Luther ; un texte rédigé par Luther est présenté par Melanchthon (1497-
1560) ; cette « confession d’Augsbourg » deviendra le texte de référence du
luthérianisme (auquel Leibniz appartient). Après un certain nombre de con-
flits, la nouvelle religion obtient sa reconnaissance définitive par le compro-
mis d’Augsbourg ou la paix d’Augsbourg, en septembre 1555 (ce compro-
mis stipule que les princes allemands sont libres de choisir leur confession
(catholique ou luthérienne) et la confession officielle de leur territoire, selon
leur conviction).
Malgré la paix d’Augsbourg, les violences, attisées par les rivalités
des Etats européens (sur fond de conflit confessionnel) reprennent au début
du siècle suivant et opposent les Princes allemands entre eux, ainsi que les
Etats européens qui soutiennent les uns ou les autres. C’est ce qu’on appelle
la guerre de Trente ans. Cette guerre dévastatrice pour l’Allemagne (et que
l’on fait commencer en 1618) se prolonge jusqu’à la paix de Westphalie, qui
apporte avec elle une certaine sédation, mais une sédation relative – Leibniz
écrit : « on a bientôt remarqué que dans le fond, cette paix ressemblait à une
espèce de trêve venue d’une lassitude commune ; ce qui fait craindre que ce
feu couvert sous les cendres ne reprenne un jour toute sa force, des étincelles
et même des petites flammes paraissant déjà de temps en temps ».
Les conflits créés par la scission de la Réforme ne sont pas éteints à
l’époque de Leibniz, ni en Allemagne, ni dans le reste de l’Europe. En
France, la révocation de l’Edit de Nantes est prononcée en 1685 : l’Edit de
Nantes (qui a mis fin en 1598 aux guerres de religion – le premier article est
un article d’amnistie -, accorde la liberté de culte aux protestants et leur
donne un certain nombre de places fortes militaires) est aboli: le roi sup-
prime ce qui reste de la tolérance religieuse héritée de Henri IV ; il interdit la
pratique du culte réformé, ordonne la démolition des temples et des écoles
réformées, oblige à baptiser dans la foi catholique tous les enfants à naître,
ordonne aux pasteurs de quitter la France mais interdit cependant aux
simples fidèles d'en faire autant, sous peine de galères.
Bayle est chassé de France par la révocation de l’Edit de Nantes et se
réfugie en Hollande ; Leibniz correspond avec lui à partir de 1687.
En Allemagne même, le catholicisme contre-attaque et regagne cer-
tains territoires en pays luthérien (17 provinces sont arrachées à la Réforme).
Cette situation confuse et conflictuelle explique les efforts de Leibniz
pour unir les Etats au sein de l’Empire, pour réconcilier les confessions entre
elles et même, plus radicalement, pour réconcilier l’esprit humain avec lui-
même.
Le 2e édition du dictionnaire de Bayle est publiée en 1702. . EN 1705-
1706, Leibniz écrit le « Discours de la conformité de la foi et de la raison ».
En janvier-février 1707, il esquisse la Théodicée qui verra le jour en 1710, en
même temps que le texte intitulé Causa dei (Opuscules traduits par Schreck-
er). Dans une lettre d’avril 1709, Leibniz résume ainsi le propos de la Théo-
dicée : « Je suis persuadé que la Religion ne doit rien avoir qui soit contraire
à la Raison… J’entends par Raison non pas la faculté de raisonner, qui peut
être bien et mal employée, mais l’enchaînement des vérités qui ne peut pro-
duire que des vérités, et une vérité ne saurait être contraire à une autre. Il
© Philopsis – Pascal Dupond 2
www.philopsis.fr
nous faudrait des Missionnaires de la Raison en Europe pour prêcher la reli-
gion naturelle sur laquelle le Révélation même est fondée, et sans laquelle la
Révélation sera toujours mal prise ».
Parmi les débats que la pensée de la Réforme éveille ou réactive, plu-
sieurs présentent pour nous une importance particulière parce que Leibniz en
traite dans la Théodicée ou parce qu’ils en constituent l’horizon. On peut en
particulier en mentionner deux.
1/ Le premier serait le débat sur les relations de la foi et de la raison.
Les jugements de Luther sur la raison sont très abrupts (« prostituée du
diable ») : il s’oppose aux scolastiques, aux humanistes et à l’esprit cartésien
du doute méthodique1. D’autres Réformateurs sont beaucoup plus favorables
aux droits de la raison. Bayle, mais aussi Calvin. Calvin et Luther s’opposent
sur l’interprétation de la Cène (que Leibniz évoque au § 18). Calvin, au nom
de la « maxime des philosophes » selon laquelle un corps ne peut se trouver
qu’en un seul lieu à la fois, donne à la sainte Cène un sens allégorique (« la
participation du corps de JC dans la sainte Cène » est réduite « à une simple
représentation de figure »), alors que les évangéliques s’accordent avec Lu-
ther pour admettre une participation réelle, donc un mystère surnaturel.
2/ Le second serait le débat sur la prédestination. Contre une Église
qui lui paraît laxiste et corrompue (la question des indulgences), Luther in-
terprète l'enseignement de l'apôtre Paul à la lumière des théories augusti-
niennes. Il insiste sur le péché originel, et, par suite, sur l'impuissance radi-
cale de l'homme à assurer seul son propre salut ; il professe que le salut vient
de Dieu seul, par le canal d'une foi justifiante. Il se réclame d'Augustin, dont
il retient en particulier l’opposition à Pelage, qui veut minimiser le péché et
donner à l'homme une place trop grande dans l'édification de son salut. Mais
cette position n’est pas universellement acceptée et c’est ainsi que naît en
Hollande la querelle des Remontrants et des Gomaristes2.
1
Néanmoins la position de Luther est vraisemblablement plus nuancée (voir contribu-
tion de Pierre Metzger sur le net) ; en outre Luther a besoin d’une base philosophique pour
l’enseignement et cette base, c’est Mélanchton qui la lui donne, dans une reprise de la tradi-
tion aristotélicienne.
2
Voici la version de cette querelle que donne l’Encyclopédie :
« Luther reprochant à l'Eglise romaine qu'elle étoit tombée dans le Pélagianisme, fit ce
qu'on a toûjours fait en pareilles matieres, & se jetta dans l'extrémité opposée; il établit sur les
matieres de la grace & [p. 734] de la prédestination, une doctrine rigide & incompatible avec
les droits du libre arbitre & la bonté de Dieu. Melanchton, esprit doux & modéré, l'engagea à
se relâcher un peu de ses premieres opinions, & depuis les théologiens de la confession
d'Augsbourg marcherent sur les traces de Mélanchton à cet égard. Mais ces adoucissemens
déplurent à Calvin. Ce réformateur, & son disciple Théodore de Beze, soûtinrent le prédesti-
natianisme le plus rigoureux, & ils y ajoûterent la certitude du salut & l'inadmissibilité de la
justice. Leur doctrine étoit reçûe presque universellement en Hollande, lorsqu'Arminius pro-
fesseur dans l'université de Leyde, se déclara contre les maximes enseignées par les églises du
pays, & se forma bientôt un parti nombreux: il trouva un adversaire dans la personne de Go-
mar. Les disputes se multiplierent & se répandirent bientôt dans les colléges des autres villes
& ensuite dans les consistoires & dans les églises. La querelle étoit encore purement ecclé-
siastique, agitée seulement par les ministres de la religion, lorsque les états de Hollande &
West - Frise voulurent s'en mêler; ils ordonnerent en 1608 une conference publique à la Haye
entre Gomar & Arminius, assistés l'un & l'autre des plus habiles gens de leur parti; mais après
avoir bien disputé, on se sépara sans convention & sans accommodement: sur cela on ordonna
que les actes de la conférence seroient supprimés, & qu'on garderoit le silence sur les matieres
contestées… »
© Philopsis – Pascal Dupond 3
www.philopsis.fr
On doit souligner l’importance de l’idée de justice dans la vie et la
pensée de Leibniz. Il accepte de son tuteur l’idée d’une carrière juridique,
étudie la théorie et la pratique du droit, exerce la fonction de juge à la cour
d’appel de Mayence en 1669-1672 puis en 1677-1678 à Hanovre. Ensuite il
reste nominalement juge et c’est comme conseiller intime de justice, à partir
de 1696, qu’il termine sa carrière ; en outre il reçoit le même titre à Berlin en
1700, à Vienne et Pétersbourg en 1712. Il réfléchit toute sa vie sur le droit,
renouvelle les définitions, les classements pédagogiques des droits positifs et
du droit naturel, il cherche à améliorer la procédure judiciaire, défend l’idée
de justice internationale.
En outre il défend la justice divine contre ses négateurs athées ainsi
que contre ceux qui la déforment, soit dans le sens de l’affirmation d’un ar-
bitraire tyrannique dans la création ou la prédestination, soit dans le sens
d’un ritualisme.
Dans l’ordre systématique, l’étude la jurisprudence universelle (la
science du juste) précède l’étude de la justice propre à Dieu et à l’homme.
De la justice comme des autres notions, Dieu ne crée pas l’essence mais il la
fait exister..
A partir de 1671, on voit apparaître l’idée selon laquelle Dieu déter-
mine par son intelligence le meilleur des mondes possibles en le réalisant par
sa volonté ; Dieu est justifié par l’harmonie universelle, digne d’amour et
modèle, pour les esprits, de la charité du sage. A partir de 1676, la doctrine
du choix divin parmi les possibles reçoit une formulation mathématique
grâce au calcul de formis optimis. A partir de 1686, la question de la contin-
gence reçoit un nouvel éclairage par l’infini.
Du point de vue des sources, on relève l’importance de Luther et
Hobbes, lus depuis 1663.
Leibniz est attaché à l’idée de l’univocité de l’être universel, sans
l’atténuer par une pensée de l’analogie : il comprend la différence entre le fi-
ni et l’infini comme une différence de degré. Cette doctrine de l’univocité se
prolonge dans la question de la justice : la justice divine ne fait pas exception
à la notion commune de justice.
Leibniz subordonne la volonté (donc la justice) de Dieu à sa sagesse et
refuse l’idée d’une volonté arbitraire qui se présente chez Ockham, Des-
cartes ou Hobbes, et il retrouve ainsi la pensée des hérétiques Abélard ou
Wyclif, tout en échappant à la condamnation dont ceux-ci furent l’objet en
distinguant nécessité absolue et nécessité hypothétique (Dieu veut le meil-
leur selon une nécessité hypothétique, non absolue ou selon une nécessité
morale).
© Philopsis – Pascal Dupond 4
www.philopsis.fr
Préface
Préface
§ 1-4. La vraie piété consiste dans la lumière et dans la vertu (c’est-à-
dire dans une certaine rectitude la connaissance et de l’agir) ; elle est imitée
par une piété d’extériorité, une dévotion formelle (qui convient au grand
nombre) dans laquelle les « formulaires de la croyance » se substituent à la
lumière de la vérité et les « cérémonies de la pratique » à la vertu. Ambiva-
lence de cette piété d’extériorité : elle rappelle la vraie piété mais aussi
l’étouffe.
Le jugement selon lequel : « … le commun des hommes a mis la dé-
votion dans des formalités » n’est pas nécessairement une condamnation du
formalisme. Leibniz croit aux vertus de la forme ;, et c’est pourquoi il en ap-
pelle, contre l’évidence qui a trompé Descartes, au formalisme aristotélicien
et scolastique [« dans les scories de la scolastique, il y a de l’or »].
Chez les païens, la dévotion formelle ne consiste guère qu’en cérémo-
nies de la pratique ; l’autre dimension de la dévotion formelle est peu déve-
loppée : les païens n’ont pas de théologie, ou ce sont les poètes, comme Ho-
mère qui sont leurs théologiens. En outre, ils ne sont pas non plus bien assu-
rés du statut ou de la signification de leurs dieux : « vrais personnages » ou
« symboles des puissances naturelles » : la personnalisation du divin est ina-
chevée (le numineux de la tragédie est une puissance impersonnelle). Et ils
ont développé une religion des mystères dans laquelle la superstition et le
gouvernement des hommes par les affects sont prédominants. Les sentiments
sur l’âme et sur Dieu restent frustes.
Avec les Hébreux commence la « croyance d’un seul Dieu » et, avec
la croyance monothéiste, une représentation de Dieu qui est pour la première
fois digne de la « souveraine substance » (le paradoxe est que Dieu est ici
désigné par un concept philosophique qui est apparu dans le paganisme). Les
hébreux ont donc initié la « religion naturelle » ou la « théologie naturelle ».
En outre, avec Moïse, le dogme devient loi, c’est-à-dire principe d’une orga-
nisation théologico-politique. L’immortalité de l’âme n’est absente ni de
l’esprit de Moïse, ni de celui de son peuple, mais elle ne fait pas partie des
dogmes qui sont des lois. Avec la prédication du Christ, quelque chose bas-
cule : là où le dogme a force de loi, l’immortalité de l’âme reste de l’ordre
d’une conviction privée (elle passe de main en main), elle n’est pas « autori-
sée d’une manière populaire » (sans doute parce qu’elle affaiblirait l’autorité
théologico-politique) ; au moment où le dogme perd la force de la loi, avec
le Christ, l’immortalité de l’âme passe au premier plan et elle acquiert une
signification juridico-pénale : les âmes immortelles recevront au dernier ju-
gement « le salaire de leurs actions ».
Avec l’enseignement de Jésus-Christ, le religion n’inspire plus seule-
ment, comme dans le judaïsme crainte et vénération ; elle inspire amour et
tendresse. L’amour de Dieu est inspiré par la considération de ses perfec-
tions, dont nous avons les idées dans nos âmes, dont nos âmes sont elles-
mêmes, à leur mesure, participante : l’âme humaine possède quelque puis-
sance, quelque connaissance, quelque bonté et ce qui est à un degré limité en
elle est à un degré illimité en Dieu. L’âme est heureuse quand elle rencontre
dans une œuvre de l’art humain ordre, proportion, harmonie. Or Dieu est à
l’origine de tout ordre, de toute proportion, de toute harmonie.
© Philopsis – Pascal Dupond 5
www.philopsis.fr
La « véritable piété » est donc un amour éclairé de Dieu. L’amour de
Dieu est éclairé quand il s’accompagne d’une juste conception des perfec-
tions divines (« la bonté et la justice du souverain de l’univers » (29), quand
il sait que Dieu est « ordre », « garde la justesse des proportions » et « fait
l’harmonie universelle », c’est-à-dire quand il est éclairé par la raison. La vé-
ritable piété n’est pas contradictoire avec la raison ; au contraire, elle l’exige,
et elle l’exige parce que Dieu est lui-même raison ; la raison est une en
l’homme et en Dieu, même si elle est infiniment plus vaste en Dieu.
Si la véritable piété dépend de la connaissance de Dieu, on ne peut
mieux la favoriser qu’en rectifiant les « erreurs » qui altèrent la piété. Or ces
erreurs consistent soit à souligner la « puissance irrésistible » de Dieu en né-
gligeant sa « bonté suprême » (Dieu est craint et non aimé), soit à prêter à
Dieu un « pouvoir despotique » (arbitraire et incompréhensible) alors qu’il
est en vérité « puissance réglée par la plus parfaite sagesse » (29), volonté
réglée par l’intelligence (Leibniz distingue trois attributs de Dieu : la puis-
sance, l’intelligence ou la sagesse, la bonté ou la volonté).
Les questions qui se prêtent à une fausse compréhension de Dieu sont,
au premier rang, celles qui concernent les notions de liberté, de nécessité et
de destin : faute de comprendre ce qu’est la nécessité et ses différentes fi-
gures, on la confond avec le destin, et elle devient alors incompatible avec
la liberté ; ou plus précisément ce sont les questions sur « la bonté de Dieu,
la liberté de l’homme et l’origine du mal » : faute de comprendre ce qu’est la
nécessité, faute de comprendre qu’elle est parfaitement compatible avec la
liberté, on impute le mal (particulièrement le mal moral) à Dieu (en lui refu-
sant alors la bonté) alors qu’il est en vérité imputable à la liberté humaine ;
en bref, il s’agit de comprendre que 1/ le mal n’est pas contradictoire avec la
bonté de Dieu, 2/ que le mal moral est imputable à la liberté humaine, que 3/
cette imputation est possible dans la mesure où la liberté humaine n’est pas
contradictoire avec la nécessité et avec la toute puissance de Dieu.
La raison pour laquelle l’esprit humain s’est embarrassé et égaré dans
les questions touchant le mal, la liberté et la nécessité, c’est que ces ques-
tions, qui sont théologiques, engagent nécessairement la question de l’infini.
L’infini est le labyrinthe de l’esprit humain : sortir du labyrinthe, c’est af-
fronter la question de l’infini.
Le § 7 évoque deux labyrinthes de l’esprit humain : « la grande ques-
tion du libre et du nécessaire » et « la discussion de la continuité et des indi-
visibles »3.Voir aussi le § 6 du De libertate : « il y a certes deux labyrinthes
de l’esprit humain ; l’un concerne la composition du continu, le second la
nature de la liberté, et ils prennent leur source à ce même infini »4 (RG5
3
Le labyrinthe de la composition du continu et celui de la prédestination communi-
quent par l’infini. Il y a en effet des deux côtés une incommensurabilité : les lignes incom-
mensurables ont « cette imperfection de ne pouvoir être exprimées exactement [Mais] cette
imperfection a été compensée par des avantages bien plus grands, de sorte qu’il a mieux valu
leur donner place » ; de même, avec le péché, il y a un « bien incommensurablement plus
grand que Dieu sait tirer de ce mal ».
4
Note de Lucy Prenant (LP) : « les deux labyrinthes se traversent à l’aide de l’infini :
les infinis mathématiques qui portent sur des continus homogènes sans unités vraies <De la
nature en elle-même> sont artificiels. Mais il y a une infinité actuelle de créatures dans toute
portion de matière. Il y a une infinité de rapports entre les substances et leurs états présents,
passés et futurs. Chaque créature exprime donc l’univers et cette expression n’est intelligible
© Philopsis – Pascal Dupond 6
www.philopsis.fr
331), et également DM6 § X. Les deux problèmes sont symétriques : l’un
concerne la spéculation, l’autre la pratique, et ils trouvent leur source mais
aussi leur résolution dans l’infini. L’un des objets de la Théodicée est de pré-
ciser comment il faut comprendre le nécessaire pour l’accorder avec la liber-
té et la responsabilité humaines et la justice divine.
Comment concilier la nécessité et la liberté ? Si le cours des choses est
nécessaire, toute la sphère de l’agir est frappée ou paraît frappée de vanité.
C’est ce que montre le raisonnement que les anciens appelaient argos logos
(§ 8). L’argos logos7 est un raisonnement fallacieux, un sophisme qui sou-
tient que l’avenir est nécessaire, que ce qui doit arriver arrivera nécessaire-
ment, donc qu’il n’y a pas à se soucier de bien agir, qu’il suffit de suivre la
pente de ce qui fait plaisir ici et maintenant. Cette nécessité de l’avenir est
elle-même conclue soit de raisons théologiques (Dieu prévoit, préétablit et
gouverne tous les événements du monde), soit de raisons cosmologiques
(« tout arrive nécessairement par l’enchaînement des causes »), soit de con-
sidérations relatives à l’essence de la vérité ( la vérité est déterminée dans
toutes les énonciations, portant sur le passé, le présent ou le futur, donc
l’énonciation doit toujours être vraie ou fausse). Les pensées qui affirment la
détermination de l’avenir peuvent mettre l’accent sur l’une ou l’autre de ces
raisons de déterminations : Descartes mettrait plutôt l’accent sur la première,
Spinoza sur la seconde, Leibniz lui-même sur la troisième. Mais elles sont
fondamentalement convergentes : elles concourent à un même centre : s’il y
a une vérité de l’événement futur, c’est que l’événement est prédéterminé
par ses causes et que Dieu l’a préétabli en établissant ces causes.
Comment écarter l’argos logos ? L’argos logos ajointe dans un rap-
port de prémisse à conséquence une proposition « cosmologique » (l’avenir
est déterminé) et une proposition « pratique » (il n’y a pas à se donner de la
peine). On peut récuser la prémisse cosmologique et sa conséquence pratique
ou conserver la prémisse cosmologique et récuser sa conséquence pratique.
D’où les deux solutions : 1/ l’avenir n’est pas déterminé, donc notre façon
d’agir est importante parce qu’elle contribue, à son rang parmi les différentes
causes, à produire cet avenir qui n’est pas déterminé ; 2/ l’avenir est déter-
miné mais cette détermination ne diminue en rien l’importance de l’action.
La première solution est celle d’Aristote. Elle est présentée en Her-
meneia 9.
Si nous comparons les deux premiers alinéas de ce chapitre 9, nous
constatons que la question traitée (dans quels cas peut-on dire que, de deux
propositions, l’une est vraie et l’autre fausse) exige la discrimination des
propositions portant sur les choses passées et présentes et des propositions
portant sur les choses futures.
Dans le cas des propositions portant sur les choses passées et pré-
sentes, « l’affirmation ou la négation……est nécessairement vraie ou
fausse ». Il s’agit d’un corollaire du principe de contradiction : si le même ne
qu’à Dieu : telle est l’originalité de chaque contingent et ce qui permet la liberté de certains
d’entre eux ».
5
Recherches générales sur l’analyse des notions et des vérités (RG), PUF, Epimé-
thée. Dans la suite, on indique la référence RG pour tout texte qui se trouve dans le recueil in-
titulé Recherches générales…
6
Discours de métaphysique (DM).
7
Voir par exemple Cicéron, De fato 28-30, in Long et Sedley, Les philosophes hellé-
nistiques, II, Les Stoïciens, GF Flammarion, p. 390.
© Philopsis – Pascal Dupond 7
www.philopsis.fr
peut pas endosser en même temps et sous le même rapport des prédicats con-
traires, alors Socrate a été ou n’a pas été musicien, il est ou n’est pas musi-
cien. Quand deux propositions (l’une affirmative, l’autre négative) ont même
sujet et même prédicat, alors nécessairement l’une est vraie et l’autre fausse.
Des distinctions sont cependant nécessaires (si l’on fait intervenir la
quantité logique des termes du jugement) : quand deux propositions sont op-
posées par contradiction, comme l’affirmative universelle et la négative par-
ticulière (ou vice versa) ou comme deux propositions singulières (Socrate est
musicien, Socrate n’est pas musicien), nécessairement l’une est vraie et
l’autre fausse ; quand deux propositions sont opposées par contrariété,
comme deux universelles, l’une affirmative et l’autre négative, si l’une est
vraie, l’autre est fausse (elles ne peuvent pas être vraies ensemble), mais que
l’une soit fausse n’implique pas que l’autre soit vraie (elles peuvent être
fausses ensemble) ; quand deux propositions sont opposées par subcontrarié-
té (quelque homme n’est pas blanc/quelque homme est blanc – ce sont des
« propositions portant sur des universels, mais qui ne sont pas prises univer-
sellement), cette nécessité (l’impossibilité qu’elles soient vraies en même
temps) ne joue pas : elles peuvent être vraies en même temps (90).
Tout différent est le cas des propositions portant sur des choses singu-
lières futures <epi de tôn kath ekasta kai mellontôn>. Techniquement, le
mot mellontôn, dans le vocabulaire d’Aristote est employé pour désigner un
futur contingent. Dans le De Generatione et corruptione, Aristote oppose
mellon et esomenon (futur de eimi) ; le second signifie ce qui se produira de
toutes façons, comme lorsque nous disons: l’été ou l’hiver viendra, une
éclipse aura lieu; le premier terme signifie en revanche un futur qui peut se
produire ou non, comme je me promenerai, je naviguerai. Les propositions
portant sur les choses singulières futures sont soit des prédicatives singu-
lières (ceci sera blanc), soit des propositions d’existence datées (il y aura une
bataille navale demain).
Dans le cas des propositions contradictoires portant sur les choses pas-
sées et présentes, je peux dire avec assurance : l’une est vraie, l’autre est
fausse Mais je ne le peux plus concernant les contradictoires portant sur les
choses futures.
La démonstration se fait par les conséquences. Si l’une est vraie et
l’autre fausse, alors « tout découle de la nécessité », il n’y a dans le cosmos,
aucune indétermination, aucune contingence, aucun hasard,8. Si je soutiens
que l’affirmation ou la négation est nécessairement vraie ou fausse pour les
choses futures comme pour les choses passées et présentes, alors tout l’être
est nécessaire.
Aristote refuse cette lecture du monde pour des raisons ontologiques
mais aussi pour des raisons « pratiques » : « en vertu de ce raisonnement, il
n’y aurait plus à délibérer ni à se donner de la peine, dans la croyance que si
nous accomplissons telle action, tel résultat suivra, et que si nous ne
l’accomplissons pas, ce résultat ne suivra pas » (Vrin, p. 99) –Or « ces con-
8
Ce cosmos est celui des Mégariques, socratiques éléatisants qui professaient un né-
cessitarisme absolu. L’Ecole mégarique, fondée par Euclide de Mégare, vers 400 eut pour
principaux représentants Eubulide de Milet, Stilpon de Mégare et Diodore Kronos (contempo-
rain d’Aristote). Cf Mét. thèta, Dans le cosmos des Mégariques, “rien n’est ni ne devient, soit
par l’effet du hasard, soit d’une manière indéterminée……”. Sur Diodore, voir ci-dessous le
commentaire du § 170.
© Philopsis – Pascal Dupond 8
www.philopsis.fr
séquences sont inadmissibles (l’expérience nous montre, en effet, que les
choses futures ont leur principe dans la délibération et dans l’action… » ;
donc il faut reconnaître que le futur n’est pas déterminé et que les proposi-
tions portant sur les événements futurs ne sont, avant l’événement, ni vraies
ni fausses.
La seconde solution est celle des stoïciens.
Les stoïciens pensent que le cosmos est régi par une rigoureuse néces-
sité et que le temps n’est pas créateur [Ciceron De divinatione :
« l’événement futur ne surgit pas brusquement ; l’écoulement du temps, d’un
moment à l’autre, ressemble au déroulement d’un câble qui ne produit rien
de nouveau, mais qui déploie à chaque fois ce qui était auparavant » (I, 56] ;
mais la conviction du destin ne conduit jamais à un désengagement vis-à-vis
de l’action.
Les Stoïciens ont accordé une grande importance à la divination. Ce
qui est à la fois compréhensible et paradoxal ; compréhensible : si l’avenir
était indéterminé, contingent objectivement, la divination serait impossible ;
paradoxal : si tout est déjà joué, s’il n’y a rien à modifier dans le cours des
événements, à quoi bon savoir avant l’heure ? Ce qui rend la divination pos-
sible est en même temps ce qui paraît la rendre vaine.
A cette difficulté, le Stoïcien répond : « Il est faux que la connaissance
des événements futurs ne nous importe en rien, car nous serons davantage
sur nos gardes, si nous l’avons » (Cicéron, De divinatione, I, 38).
Supposons que le devin annonce que des dangers nous menacent ;
nous exerçons notre vigilance, nous recourons à des prières, à des sacrifices
pour détourner ces dangers.
Si nous sommes épargnés, nous ne devons pas en conclure que nos
actes ont changé le cours du destin : notre vigilance, nos prières, nos sacri-
fices, comme le danger menaçant, comme l’issue heureuse, tout est compris
sous la loi du destin. Ces dispositions, ces actions, que nous avons décidées,
que nous disons nôtres, sont des manifestations de la seule et unique causali-
té qui régit l’univers, le Logos universel, exactement comme le danger ou
l’issue heureuse. L’action (qui nous paraît dépendre de nous), et l’issue heu-
reuse (qui paraît n’en pas dépendre) font partie d’une seule et même nécessi-
té, d’un seul et même destin.
Si nous ne sommes pas épargnés, cela ne veut pas dire que la consulta-
tion du devin ou que les précautions prises aient été vaines ; d’abord, en
cherchant à nous protéger, nous avons agi selon notre nature et selon l’ordre
universel. ; et surtout « le service qu’il te rend, dit Cicéron, c’est d’être
l’agent du destin »1. Grâce à la divination, nous n’avons pas été traversés
anonymement par la causalité universelle, nous n’avons pas été l’agent in-
conscient du Logos, nous avons consciemment, délibérément coopéré à
l’accomplissement de la volonté du destin ; et que l’événement soit, en fin de
compte, conforme ou non à ce que nous nous représentons comme notre in-
térêt particulier, ne change rien
La réponse des stoïciens à l’argument paresseux, c’est la doctrine de
la confatalité9.
9
Long et Sedely, op. cit. p. 390 : « Chrysippe blâme ce raisonnement. “Il y a en réali-
té, dit-il, des assertions isolées et des assertions liées ensemble”. Voici une assertion isolée:
“Socrate mourra tel jour”; qu’il ait fait telle chose ou qu’il ne l’ait pas faite, le jour de sa mort
est déterminé. Mais si le destin porte qu’Œdipe naîtra de Laïus, on ne pourra pas dire: “soit
© Philopsis – Pascal Dupond 9
www.philopsis.fr
L’argument paresseux énonce : si tu es malade, ta guérison ou ta mort
sont toujours déjà par avance décidés ; que tu appelles ou que tu n’appelles
pas le médecin, l’issue sera la même, tu guériras si tu dois guérir, tu mourras
si tu dois mourir ; il est donc vain que tu appelles le médecin. On en retrouve
l’esprit dans ce que Leibniz appelle au § 9 le fatum mahumetanum.
Chrysippe objecte que l’argument paresseux commet une faute lo-
gique : il affirme que le conséquent (mourir ou guérir) est nécessaire, mais il
pose l’antécédent (la décision d’appeler ou de ne pas appeler le destin)
comme contingent. Il est donc incohérent. Etre cohérent, c’est reconnaître
que si l’être est nécessaire, c’est tout l’être qui est nécessaire ; le destin est
coextensif à la totalité de l’être ; et si tout l’être est nécessaire, si
l’antécédent n’est pas moins nécessaire que le conséquent, l’agir retrouve
son enjeu : notre « rencontre » avec le destin n’aura pas lieu plus tard, dans
l’avenir, au moment de l’issue, la guérison ou la mort, elle a lieu maintenant,
à chaque instant, dans le présent du choix et de l’agir. L’action, l’action pré-
sente, est le seul lieu d’une rencontre vraie et d’un accord avec le destin.
L’insensé se transporte par anticipation dans le futur et déserte le présent qui
est le temps de l’agir ; il tombe ainsi dans l’argument paresseux ; le sage, lui,
laisse le futur à sa future émergence (bien qu’il ait le souci d’en anticiper
tout ce qui peut l’être) et il accompagne, autant qu’il peut, par ses actes,
l’automanifestation, au fil du temps, de la volonté éternelle du destin. Cet
accompagnement est l’agir.
Le Sage sait que l’acte qu’il accomplira est par avance déterminé et
qu’il n’y a, dans le monde, qu’une seule cause agissante, le Logos universel.
Donc il sait qu’il n’est pas l’agent dernier de l’action qu’il accomplit. De ce
point de vue, il agit comme n’agissant pas ; il accompagne et veut seulement
accompagner la manifestation temporelle de la volonté du Destin. Mais cet
accompagnement n’est pas passif ou attentiste. Si l’enchaînement des évé-
nements du monde est régi par la nécessité universelle, l’enchaînement de
mes actes et de ce qui en résultera l’est aussi, mais cet enchaînement est
soumis, dans la conscience de l’agent, à la forme temporelle de la successivi-
té. La situation temporelle et finie de l’agent fait qu’il ne découvre la volonté
du destin que dans la succession des événements et des actes qu’il accomplit.
Son acte, chacun de ses actes est le révélateur, dans le présent de l’agir, de la
volonté du Destin. Le sage n’est donc pas celui qui sait abstraitement que
l’acte qu’il accomplira est nécessaire; il est celui qui comprend, avant d’agir
et pour agir la nécessité de l’acte qu’il lui est remis d’accomplir; et cette
compréhension pratique, non théorique de la nécessité de son action n’est
rien d’autre que l’obéissance à la raison, le choix de la façon d’agir qui lui
est prescrite par la raison.
Le destin n’exclut pas l’importance de l’action ; au contraire, le destin
bien compris fonde l’importance de l’action.
Nous avons vu qu’il y a deux solutions, celle d’Aristote et celle des
Stoïciens, Leibniz choisit la seconde, tout en retenant de la première l’idée
que Laïus ait eu des rapports avec une femme, soit qu’il n’en ait pas eu”; car l’événement est
lié et confatal ; ainsi le nomme-t-il ; car le destin porte et que Laïus aura des rapports avec sa
femme et qu’il procréera Œdipe. Tous les sophismes de telle espèce sont réfutés de la même
manière. “Que tu aies appelé un médecin ou non, tu guériras”, c’est là un sophisme, car il est
autant dans ton destin d’appeler un médecin que de guérir; ce sont des choses que Chrysippe,
je l’ai dit, appelle confatales ».
© Philopsis – Pascal Dupond 10
www.philopsis.fr
de contingence. Il la retient avec un certain nombre de transformations qui
s’annoncent dans la distinction du fatum stoïcum et du fatum christanum.
Il y a dans la tranquillité stoïcienne une « grandeur » qui n’est pas
étrangère à la tranquillité chrétienne10. Mais la tranquillité chrétienne est,
pour Leibniz, très supérieure, parce qu’elle se fonde sur une connaissance
vraie de Dieu : le stoïcisme est un panthéisme ; le dieu du stoïcisme est un
feu, une puissance impersonnelle diffusée dans la totalité du cosmos ; il ne
peut donc être question d’un rapport de personne à personne, d’une con-
fiance interpersonnelle ; la « patience » est donc « forcée » ; le dieu du chris-
tianisme est une personne, et la foi est une confiance ; le fatum christianum
conduit donc au contentement. En d’autres termes, le fatum stoïcum assure le
bien du tout mais subordonne le bien du singulier au bien du tout, alors que
fatum christianum veille indivisiblement au bien du singulier et au bien du
tout, sans subordination du premier au second : Dieu est un bon maître et
tout ce qui arrive aux créatures raisonnables est juste, non seulement par
rapport au tout mais aussi et surtout par rapport à elles-mêmes.
Pour résumer : le souci de Leibniz est de montrer que la nécessité
cosmologique et l’action humaine ne sont pas incompatibles et que, tout au
contraire, le concept juste de la nécessité cosmologique conduit au concept
juste de l’action humaine. Mais pour y parvenir, on doit d’abord surmonter
l’obstacle dont le fatum mahumetanum est le symbole : la conviction que
tout ce qui est donné à la nécessité est retiré à la liberté et que tout ce qui est
donné à la liberté est retiré à la nécessité. La pensée stoïcienne dessine une
voie pour écarter cet obstacle ; mais cette voie doit être approfondie, parce
que
1/La conviction que le cours des choses est nécessaire, à défaut d’être
une conviction constante, est, chez la plupart des humains, une commodité
que l’on se donne pour se soustraire à la difficulté de la réflexion et du choix
(§ 11) ou bien une sorte de superstition qui accompagne le cours ordinaire de
la vie. Certains ont ainsi confiance en leur « bonne fortune » (§ 12), comme
dans un jeu de hasard ou des gains successifs peuvent donner la confiance
qu’on gagnera à nouveau. Or dans les jeux de hasard, les événements anté-
rieurs n’annoncent rigoureusement rien des événements ultérieurs ; qu’au jeu
de dés le double six soit sorti dix fois successivement n’annonce rigoureu-
sement rien (si du moins nous supposons que les dés ne sont pas pipés) sur
ce qui sortira au onzième coup. Et pourtant le joueur ne peut s’empêcher
d’attendre que la répétition ne se poursuive…]
10
Mathieu. V, 25-33 : « Ne vous mettez point en souci, ni pour votre vie, de ce que
vous mangerez et de ce que vous boirez, ni pour votre corps, de quoi vous vous vêtirez. La vie
n'est-elle pas plus que la nourriture et le corps plus que le vêtement? Regardez les oiseaux du
ciel : ils ne sèment ni ne moissonnent, ils n'amassent rien dans des greniers, et votre Père cé-
leste les nourrit. Ne valez-vous pas bien plus qu'eux? D'ailleurs, qui de vous peut, par ses sou-
cis, ajouter une coudée à sa taille ? Et pourquoi vous mettre en souci du vêtement? Considérez
comment croissent les lis des champs; ils ne travaillent ni ne filent cependant je vous dis que
Salomon même, dans toute sa magnificence, n'était point vêtu comme l'un de ces lis. Si Dieu
revêt de la sorte l'herbe des champs qui est aujourd'hui et qui demain sera jetée au four, com-
bien plutôt ne vous vêtira-t-il pas, vous, ô gens de peu de foi? Ne vous mettez donc point en
souci, et ne dites pas : “Que mangerons-nous, ou que boirons-nous, ou de quoi nous vêtirons-
nous ?”, comme font les païens qui recherchent toutes ces choses, car votre Père céleste sait
que vous en avez besoin. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice et toutes
ces choses vous seront données par-dessus ».
© Philopsis – Pascal Dupond 11
www.philopsis.fr
2/ La conviction que le cours des choses est nécessaire peut favoriser
une sorte d’hédonisme qui ne connaît d’autre règle que « ce qui peut nous
contenter présentement »
3/ Cette conviction peut aussi favoriser la pensée que Dieu est le
« complice » des désordres du monde.
Et la Théodicée n’a pas d’autre but que de montrer pourquoi cette
pensée est fausse.
Leibniz en trace brièvement l’historique.
Cette pensée d’une complicité de dieu avec le mal est présente chez
« …les anciens païens qui attribuaient aux dieux la cause de leur crime »
(c’est la théologie tragique de l’aveuglement11).
Elle paraît devoir se renforcer avec la doctrine chrétienne de la créa-
tion ex nihilo
Et aussi avec certaines spéculations des modernes : « Quelques habiles
gens de notre temps en sont venus jusqu’à ôter toute action aux créatures » ;
DM § VIII : « Il est assez difficile de distinguer les actions de Dieu de celles
des créatures ; car il y en a qui croient que Dieu fait tout, d’autres
s’imaginent qu’il ne fait que conserver la force qu’il a donnée aux créa-
tures… ». Il s’agit de Malebranche. Dans le système de Malebranche, Dieu
qui est sa propre cause est aussi la cause de toutes choses, il est cause uni-
verselle, il rassemble, condense en lui toute causalité, toute « efficace », et
en conséquence, « toutes les causes naturelles ne sont point de véritables
causes mais seulement des causes occasionnelles » [Recherche de la vérité,
VI, II, III]. Voir aussi 15e éclaircissement. Lorsqu’un corps en mouvement
en heurte un autre, comme dans la rencontre de deux boules de billard, c’est
la volonté de Dieu qui, à l’occasion de leur rencontre, met en mouvement le
corps heurté, selon les lois de la communication générale des mouvements
inscrites dans son entendement. La nature ne possède donc par elle-même
aucune efficace [Entretiens sur la métaphysique, IV, II : « Nulle créature
[…] ne peut agir sur une autre par une efficace qui lui soit propre »] ; toute
l’efficace réside en Dieu. L’interaction entre l’âme et le corps relève aussi de
l’occasionnalisme.
Dieu paraît donc bien être la cause du mal, et s’il est la cause du mal,
sa justice et sa bonté disparaissent.
Pour surmonter ces difficultés, plusieurs solutions se présentent, toutes
impossibles au regard de Leibniz.
Bayle réactive le dogme des deux principes ou des deux dieux (Il
s’agit de la gnose de Mani (216-272), dualisme qui admet deux principes, la
Lumière et l’obscurité, le bien et le mal, un dieu et un anti-dieu qui
s’identifie à la matière) ; ce dualisme ne résout pas la difficulté et il est con-
tredit par la raison, pour autant que la raison démontre « l’unité du prin-
cipe ».
Certains refusent à Dieu la connaissance du détail des choses ou des
événements futurs (et sacrifient ainsi l’omniscience à la justice)
D’autres soutiennent que la volonté de Dieu est une volonté arbitraire
et n’est soumise à aucune règle de bonté ou de justice ou bien ils font de sa
justice un autre nom de sa puissance.
11
Voir infra.
.
© Philopsis – Pascal Dupond 12
www.philopsis.fr
Toutes ces conception sont pour Leibniz insoutenables, parce qu’elle
ruinent la justice, parce qu’elle ruinent l’idée d’obligation, l’obligation se
trouvant identifiée à la contrainte. Dieu n’est juste que si sa volonté est diri-
gée par les règles du bien, donc si la volonté divine entre dans l’orbe du
principe de raison.
Mais si la volonté divine est fondée en raison, si Dieu est le bon prin-
cipe, la question revient : comment ce bon principe peut-il permettre le mal ?
« Les philosophes ont considéré les questions de la nécessité, de la li-
berté et de l’origine ». La question de l’origine du mal est au centre des ré-
cits mythiques que l’on appelé « drames de création » (dont fait partie la
gnose de Mani). Elle a été reprise sur un plan philosophique par Platon (Ré-
publique : theos anantios) puis par Plotin. La question de la nécessité et de la
liberté a elle aussi un fond mythique et tragique ; elle a été reprise sur un
plan philosophique par les Mégariques, Aristote et les Stoïciens.
Les théologiens partagent avec les philosophes cet horizon
d’interrogation mais y ajoutent les questions du péché originel, de la grâce et
de la prédestination12.
Le péché originel : si le péché originel s’est transmis aux descendants
d’Adam, le péché dont ils sont l’auteur à leur tour relève-t-il d’une nature
(d’une nécessité) ? relève –t-il d’une liberté ?
Ces questions ont une origine augustinienne. Les deux façons de com-
prendre le péché original se partagent en effet la pensée augustinienne.
Quand il est en lutte avec le manichéisme, St Augustin élabore une vision
« éthique » du mal selon laquelle l’homme est intégralement responsable.
C’est ce qu’il montre dans le De libero arbitrio ou bien dans sa polémique
avec Félix : « S’il y a pénitence, c’est qu’il y a culpabilité, s’il y a culpabili-
té, c’est qu’il y a volonté, s’il y a volonté dans le péché, ce n’est pas une na-
ture qui nous contraint » (Contra Felicem, § 8). Mais, plus tard, dans sa po-
lémique avec Pelage13 il conserve l’expérience hébraïque et chrétienne du
12
Epitre de Paul aux Romains, ch. 9 :
« 11 car, quoique les enfants ne fussent pas encore nés et qu'ils n'eussent fait ni bien ni
mal, -afin que le dessein d'élection de Dieu subsistât, sans dépendre des oeuvres, et par la
seule volonté de celui qui appelle,
12 il fut dit à Rébecca: L'aîné sera assujetti au plus jeune;
13 selon qu'il est écrit : J'ai aimé Jacob Et j'ai haï Ésaü.
14 Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là!
15 Car il dit à Moïse: Je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde, et j'aurai compas-
sion de qui j'ai compassion.
16 Ainsi donc, cela ne dépend ni de celui qui veut, ni de celui qui court, mais de Dieu
qui fait miséricorde.
17 Car l'Écriture dit à Pharaon: Je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puis-
sance, et afin que mon nom soit publié par toute la terre.
18 Ainsi, il fait miséricorde à qui il veut, et il endurcit qui il veut.
19 Tu me diras: Pourquoi blâme-t-il encore? Car qui est-ce qui résiste à sa volonté?
20 O homme, toi plutôt, qui es-tu pour contester avec Dieu? Le vase d'argile dira-t-il
à celui qui l'a formé: Pourquoi m'as-tu fait ainsi?
21 Le potier n'est-il pas maître de l'argile, pour faire avec la même masse un vase
d'honneur et un vase d'un usage vil?
22 Et que dire, si Dieu, voulant montrer sa colère et faire connaître sa puissance, a
supporté avec une grande patience des vases de colère formés pour la perdition,
23 et s'il a voulu faire connaître la richesse de sa gloire envers des vases de miséri-
corde qu'il a d'avance préparés pour la gloire? »
13
On prête à Pélage les propositions suivantes : « La grâce et le secours de Dieu ne
sont point accordés pour chaque acte isolément; mais ils consistent dans le don du libre ar-
© Philopsis – Pascal Dupond 13
www.philopsis.fr
mal au sens d’une déviation de la liberté qui vient de plus loin que de la li-
berté elle-même. D’où la constitution d’une doctrine du péché originel : la
liberté n’est pas un point absolu et indéterminé de décision en faveur du pé-
ché ou contre le péché; il y a comme une nature acquise de la liberté (cf par
ex. Conf. VIII, X, 22-23 qui présente le vouloir comme dissocié, séparé de
lui-même par le péché : « ce n’était donc plus moi qui la produisais, mais le
péché qui habitait en moi, en punition d’un péché plus libre, puisque j’étais
fils d’Adam »).
Le luthérianisme reprend plutôt le second versant.
On lit dans l’article 2 (sur le péché originel) de la Confession
d’Augsbourg :
« Nous enseignons que, par suite de la chute d'Adam, tous les hommes
nés de manière naturelle sont conçus et nés dans le péché ; ce qui veut dire
que, dès le sein de leur mère, ils sont pleins de convoitises mauvaises et de
penchants pervers. Il ne peut y avoir en eux, par nature, ni crainte de Dieu ni
confiance en lui. Ce péché héréditaire et cette corruption innée et contagieuse
est un péché réel, qui assujettit à la damnation et à la colère éternelle de Dieu
tous ceux qui ne sont pas régénérés par le Baptême et par le Saint-Esprit. Par
conséquent, nous rejetons les Pélagiens et autres qui, au mépris de la passion
et du mérite de Christ, rendent bonne la nature humaine par ses forces natu-
relles, en soutenant que le péché originel n'est pas un péché ».
Par conséquent, s’il y a en l’homme un libre arbitre, il ne concerne
que le domaine des choses humaines et il est nul pour le salut. Luther refuse
donc la conception du libre arbitre qu’Érasme a formulée, et selon laquelle il
est « la force de la volonté humaine telle que par elle l'homme puisse s'atta-
cher aux choses qui conduisent au salut éternel ou se détourner de celles-
ci ». Un tel libre arbitre, dit Luther, n'existe pas. Pour lui, le salut ne vient
pas de ce que l’homme se tournerait vers Dieu par un acte de sa volonté,
mais à l’inverse de ce que Dieu saisit l'être humain et change sa volonté. En
sorte qu’un homme qui volontairement et de son plein gré faisait le mal,
maintenant, tout aussi volontairement et de son plein gré, veut et fait ce que
Dieu veut. Luther utilise l'image de la bête de somme, qui selon celui qui la
monte, va de-ci ou de-là ; pour que notre volonté aille là où Dieu veut qu'elle
aille, il faut que ce soit lui qui la mène. C'est Dieu en effet qui choisit de
sauver l'être humain. D’où la question de la prédestination14.
Ce sont toutes ces questions que reprend Leibniz. Si le péché originel
est « la corruption originelle du genre humain », s’il détermine une nature
pécheresse, alors il existe, du moins tant que ne s’exerce pas la grâce divine,
« une nécessité naturelle de péché », et cette nécessité rend la punition du
péché injuste (la punition n’est juste que si le pécheur pouvait ne pas pé-
cher). Le péché n’est punissable que si nous supposons que chaque homme a
reçu une grâce suffisante pour ne pas pécher. Or cette supposition n’est pas
bitre, dans la connaissance de la loi divine et de la doctrine chrétienne. - Le libre arbitre
n'existe pas s'il a besoin du secours de Dieu : chacun possède dans sa volonté le pouvoir de
faire ou de ne pas faire une chose. - La grâce divine nous est attribuée selon nos mérites. - Le
pardon est accordé aux repentants, non en vertu de la grâce et de la miséricorde de Dieu, mais
selon leurs mérites et leurs efforts, quand, par leur pénitence, ils sa sont rendus dignes de par-
don. - La victoire nous vient du libre arbitre, non du secours de Dieu »
(http://www.cosmovisions.com/Pelage.htm)
14
https://www.universalis.fr/encyclopedie/du-serf-arbitre/1-la-question-du-salut/
© Philopsis – Pascal Dupond 14
www.philopsis.fr
« conforme à l’expérience », car si chaque homme a une grâce suffisante, la
diffusion universelle du mal est incompréhensible). Nous sommes dans une
alternative : ou bien nous expliquons la diffusion universelle du mal par
l’existence d’une nature pécheresse transmise par le premier homme, mais le
mal cesse alors d’être punissable ; ou bien nous faisons du péché quelque
chose de punissable (en supposant qu’il y a en chaque homme le pouvoir de
se soustraire au mal), mais c’est alors la diffusion universelle du mal qui de-
vient inexplicable (§ 19).
Les §§ suivants sont des variations sur les mêmes questions
1/ Il y a un grand nombre de réprouvés et peu d’élus. Mais pour quelle
raison les réprouvés sont-ils réprouvés et les élus élus ? On serait tenté de
répondre (et ce serait la réponse pélagienne) : les élus sont élus, les réprou-
vés sont réprouvés en raison de l’usage qu’ils font de leur libre arbitre, c’est-
à-dire par leur mérite ou leur démérite. Mais si aucun homme ne peut
s’attribuer un mérite intrinsèque, si un mérite est en vérité un don de Dieu,
ce n’est pas dans l’homme mais en Dieu que se trouve la raison dernière de
l’élection des uns et de la réprobation des autres, et cette raison, étant in-
compréhensible, ne peut apparaître que comme une décision arbitraire.
2/ La réponse augustinienne n’est d’aucun secours. Selon Augustin, la
culpabilité d’Adam s’est transmise par voie héréditaire à tous ses descen-
dants, elle s’étend ainsi à tout le genre humain et ce serait par « pure bonté »
que Dieu en sauverait quelques uns de la damnation. Leibniz lui adresse
deux objections. A/ l’idée qu’une personne soit punie pour la faute d’une
autre heurte notre conception de la justice ; et c’est pareil pour l’idée selon
laquelle Dieu sauverait les uns plutôt que les autres sans raison. La formule
« pourquoi les uns préférablement aux autres » est une variation du schème
potius quam qui exprime l’exigence d’une raison suffisante. B/ Dieu a prévu
toutes les conséquences du péché d’Adam, c’est-à-dire la corruption de la
masse, et il l’a permise ; donc si la corruption de la masse est la raison de la
damnation de ceux qui en font partie, la raison suffisante de cette damnation
se trouve en dernier ressort dans la volonté divine.
Le § 23 esquisse la solution leibnizienne en distinguant deux nécessi-
tés : la première est la nécessité absolue ; on l’appelle aussi logique, méta-
physique ou géométrique ; l’autre est la nécessité hypothétique que l’on peut
aussi qualifier comme morale.
Cette distinction est antérieure à Leibniz ; on la trouve dans un Lexi-
con theologicum de 1619 :
« On a une nécessité absolue lorsque quelque chose est nécessaire
simplement, par exemple lorsque son opposé inclut une contradiction […] On
a une nécessité ex suppositione lorsqu’une proposition conditionnelle est né-
cessaire bien que l’antécédent et le conséquent soient contingents ».
Dans le second cas, nous avons la nécessité de la conséquence, dans le
premier la nécessité du conséquent ; cette distinction est reprise dans
l’opuscule intitulé « De la contingence » (GF115 p. 320) :
15
GF1 indique le premier tome des opuscules leibniziens (1663-1689) publiés en GF-
Flammarion, GF2, le second tome ((1690-1703) et GF3 le troisième (1703-1716).
© Philopsis – Pascal Dupond 15
www.philopsis.fr
« …et c’est là qu’intervient d’une certaine façon la distinction entre la
nécessité de la conséquence et celle du conséquent. Est nécessaire par la né-
cessité de la conséquence mais non du conséquent, seulement ce qui, de cela
même qu’il est supposé être le meilleur, est nécessaire suivant cette hypo-
thèse, une fois admise l’infaillibilité du choix du meilleur ».
Elle est reprise dans le Discours de Métaphysique (1686) comme la
distinction entre deux formes de consécutions, correspondant à deux sortes
de vérités :
« Je dis que la connexion ou consécution est de deux sortes : l’une est
absolument nécessaire dont le contraire implique contradiction, et cette dé-
duction a lieu dans les vérités éternelles, comme celles de géométrie ; l’autre
n’est nécessaire qu’ex hypothesi et pour ainsi dire par accident mais elle est
contingente en elle-même lorsque le contraire n’implique point. Et cette con-
nexion est fondée non pas sur les idées toutes pures et sur le simple entende-
ment de Dieu mais encore sur ses décrets libres et sur la suite de l’univers »
(§ 13).
Cette connexion du second type caractérise les vérités que Leibniz ap-
pelle parfois « vérités positives » (en se servant d’un terme qui a une signifi-
cation juridique) ou parfois vérités contingentes.
Parmi les vérités dont le contraire implique contradiction se trouvent :
- les vérités logiques (le tout est plus grand que la partie),
- les vérités géométriques (la somme des angles d’un triangle vaut
180°)
- les vérités qui concernent les nombres (2+2 = 4)
- les vérités métaphysiques (il y a une imperfection ontologique néces-
saire dans la créature),
Les vérités absolument nécessaires valent pour tout être, en tant sim-
plement qu’il est possible ; et elles ne sont pas moins nécessaires pour
l’entendement divin que que pour l’entendement humain : pour Dieu comme
pour toute créature raisonnable finie le côté du carré et sa diagonale sont in-
commensurables, et il est impossible « de partager trois écus en deux parties
égales sans fraction », car « Dieu ne saurait trouver des choses absurdes »
(« Dialogue sur la liberté » [1695], in Système nouveau, GF, p. 56-57)
Démontrer une proposition nécessaire, c’est la réduire à une identité
expresse (A = A) qui fait voir clairement que la proposition opposée serait
une contradiction (la preuve d’une vérité nécessaire relève donc du principe
de contradiction).
Soit à démontrer 2+2 = 4
On part des définitions suivantes : 2 = 1+1 (1) ; 3 = 2+1 (2) ; 4 = 3+1
(3)
2+2=4
2+2=3+1 (selon la définition 3)
2+2=(2+1)+1 (selon la définition 2)
2+2=2+(1+1) (selon la règle d’associativité de l’addition)
2+2=2+2 (réduction à l’identité)
Une vérité est nécessaire au sens d’une nécessité hypothétique ou mo-
rale quand son contraire n’implique pas contradiction. En relèvent
1/ les vérités physiques : elles résultent du principe de raison, par
exemple : il y a équivalence entre la cause pleine et l’effet entier, ou bien : la
© Philopsis – Pascal Dupond 16
www.philopsis.fr
nature suit toujours les voies les plus simples (c’est pourquoi « deux poids
égaux placés sur une balance à égale distance du centre et de l’axe sont en
équilibre » (RG 458) ; et Snellius a découvert les lois de la réfraction en sup-
posant que la lumière suit toujours « la voie la plus aisée » pour aller d’un
point à un autre (DM XXII). Les vérités physiques ne sont jamais
qu’hypothétiquement nécessaires :
« Qu’une pierre tende ici vers la bas une fois retiré son support, c’est
une proposition non nécessaire [au sens de la nécessité absolue] mais contin-
gente, et on ne peut démontrer cet événement par la notion de cette pierre à
l’aide des notions universelles qui y interviennent ; c’est pourquoi Dieu seul
le voit de façon parfaite. Lui seul sait en effet s’il ne va pas suspendre par mi-
racle la loi subalterne de la nature qui fait que les corps pesants se meuvent
vers le bas… » (RG 343)
2/ les vérités historiques (qui portent sur des êtres réels, individuels,
existant dans le monde tels que César ou Judas
Les vérités hypothétiquement nécessaires ne sont pas nécessaires en
vertu du principe de contradiction mais en vertu du principe de raison suffi-
sante ; elles ont, dit Leibniz, « une certitude qui dépend du décret supposé
d’une substance libre » (c’est-à-dire le décret de créer le sujet sur lequel
quelque chose est énoncé et l’univers auquel appartient ce sujet, pris avec
tous ses attributs).
A la frontière entre les vérités absolument nécessaires et les vérités
hypothétiquement nécessaires, il y aurait une vérité telle que « Dieu choisit
le meilleur » ; elle apparaît comme une vérité absolument nécessaire quand
on pense qu’il serait contradictoire avec la nature de Dieu que Dieu ne choi-
sisse pas le meilleur ; elle apparaît comme une vérité hypothétiquement né-
cessaire si elle est pensée comme « le premier et le principal des décrets
libres » de Dieu (GF1, p. 318). Leibniz incline vers la 1e lecture (p. 320 :
« …bien que l’on ait accordé qu’il est nécessaire que Dieu choisisse le meil-
leur… »)
Pour résumer : 1/ la vérité est toujours identité ; 2/ toute vérité peut
être prouvée soit selon le principe de contradiction, soit selon le principe de
raison suffisante ; 3/ la preuve des vérités absolument nécessaires est acces-
sible à l’entendement humain ; la preuve des vérités contingentes, au con-
traire, échappe au moins en partie à l’entendement humain (car elles enve-
loppent l’infini) mais n’échappe pas à l’entendement divin [RG 458 : « cette
raison n’échappe pas à une substance omnisciente qui voit tout a priori à
partir de ses propres idées et de ses propres décrets »] ; 4/ la preuve fondée
en raison suffisante n’implique aucune nécessité absolue16.
16
« Que tout soit produit par un destin arrêté est aussi certain que trois fois trois font
neuf. Car le destin consiste en ceci que toutes les choses tiennent entre elles comme une
chaîne et arriveront tout aussi infailliblement , avant qu’elles arrivent, qu’elles sont arrivées
infailliblement, quand elles sont arrivées […]
« On voit […] que tout est mathématique, c’est-à-dire que tout arrive infailliblement
dans le vaste monde tout entier, de telle sorte que, si quelqu’un pouvait avoir une vue suffi-
sante des parties intérieures des choses et en même temps suffisamment de mémoire et de
compréhension, il serait un prophète et verrait le futur dans le présent en quelque sorte comme
dans un miroir.
Car de même qu’il se trouve que les fleurs, comme les animaux eux-mêmes, ont déjà
une formation dans la semence, qui peut certes se modifier quelque peu en vertu d’autres ac-
© Philopsis – Pascal Dupond 17
www.philopsis.fr
Cette distinction permet de comprendre que la volonté et l’action ne
sont, dans les créatures raisonnables et en Dieu ni de l’ordre de la nécessité
absolue ni de l’ordre de l’arbitraire ou de l’indifférence. En effet,
1/ Dieu choisit toujours ce qui est le meilleur ; s’il y a choix du meil-
leur, c’est que a/ ce qui est possible (dans l’entendement de Dieu) et ce qui
est choisi par la volonté de Dieu (c’est-à-dire le réel) ne sont pas coexten-
sifs : le réel est choisi dans le « vaste empire du possible », ce qui suffit à ex-
clure qu’il soit absolument nécessaire ; b/ c’est que ce qui est choisi est choi-
si parce qu’il est le meilleur ; il y a donc une raison du choix de Dieu, ce qui
exclut que la volonté de Dieu soit un décret arbitraire.
2/ Les créatures raisonnables choisissent toujours ce qui leur paraît le
meilleur, ce qui veut dire à nouveau qu’il y a choix, liberté, donc indiffé-
rence, si l’on veut, au sens d’une absence de nécessité absolue, mais non
« indifférence de parfait équilibre ».
Leibniz s’oppose donc ici à la fois à Spinoza et à Descartes (tels du
moins qu’il les comprend)
A Spinoza, Leibniz reproche de penser l’action libre comme une ac-
tion affranchie de contrainte mais non pas comme une action affranchie de
nécessité (ce reproche s’adresse d’ailleurs aussi à sa position initiale sur cette
question : « à l’époque où je considérais que rien ne se fait par hasard ou par
accident […] j’étais peu éloigné de l’opinion de ceux qui jugent que tout est
absolument nécessaire, qu’il suffit que la liberté soit préservée de la con-
trainte bien qu’elle demeure soumise à la nécessité… » (RG 330)17.
A Descartes, Leibniz reproche l’idée de création des vérités éternelles.
Cette doctrine est exposée par exemple dans la lettre à Mersenne du
15 avril 1630 : « les vérités mathématiques, lesquelles vous nommez éter-
nelles, ont été établies de Dieu et en dépendent entièrement aussi bien que
tout le reste des créatures » ; les vérités mathématiques ne sont vraies qu’en
tant que Dieu les a voulues ; Dieu est la cause des possibles et des natures
simples.
Leibniz s’oppose à cette doctrine ; il écrit :
« Il est totalement erroné de faire dépendre les vérités éternelles et la
bonté des choses de la volonté divine, puisque toute volonté suppose le ju-
gement de l’entendement quant à la bonté – sauf à changer les noms pour
transférer tout jugement de l’entendement à la volonté, mais alors on ne pour-
cidents, on peut dire que tout e monde futur est contenu dans le monde présent et complète-
ment préformé, parce qu’aucun accident ne peut venir s’ajouter de l’extérieur, car il n’y a rien
en dehors de lui » (Von dem Verhängnisse)
17
« Proposition 29 : “Dans la nature des choses il n’y a rien de contingent, mais toutes
les choses de par la nécessité de la nature divine sont déterminées à une certaine façon
d’exister et d’opérer”. La démonstration est obscure et abrupte, menée à travers des proposi-
tions précédentes abruptes, obscures et douteuses. La chose dépend de la définition du contin-
gent qu’il n’a donnée nulle part. En ce qui me concerne, je prends avec d’autre le contingent
pour ce dont l’essence n’implique pas l’existence. En ce sens les choses particulières seront
contingentes selon Spinoza lui-même en vertu de la proposition 34. Mais si on prend le con-
tingent à la façon de certains scolastiques, inconnue d’Aristote et des autres hommes et de
l’usage de la vie, pour ce qui arrive d’une manière telle qu’on ne peut rendre raison en aucune
manière du fait qu’il sera arrivé ainsi plutôt qu’autrement, et dont la cause, tous les réquisits
aussi bien à l’intérieur qu’à l’extérieur d’elle-même étant posés, est également disposée à agir
et à ne pas agir, je pense qu’un tel contingent implique contradiction » (Philosophische
Schriften, 148))
© Philopsis – Pascal Dupond 18
www.philopsis.fr
rait même pas dire que la volonté soit cause des vérités, puisqu’il n’y aurait
aucun jugement » (GF 1, p. 291).
Il lui reproche aussi sa conception de l’indifférence.
La doctrine de l’indifférence de la volonté vient des théologiens jé-
suites. Descartes la considère de façon réservée : pour être libres, il n’est pas
nécessaire que nous soyons indifférents à choisir l’un ou l’autre de deux con-
traires (4e Méditation) ; et c’est même l’inverse ; l’indifférence signifie une
imperfection dans la connaissance et non une perfection dans la volonté,
l’indifférence de la volonté est le plus bas degré de la liberté ; mais il admet
aussi que la volonté est « tellement libre de sa nature qu’elle ne peut jamais
être contrainte », qu’elle ne peut être déterminée à rien mais seulement inci-
tée ou disposée à se déterminer de telle ou telle façon, et qu’il y a donc une
indépendance métaphysique de la volonté, toujours libre de donner ou non
son consentement et, en ce sens, indifférente (Principes, I, 41, à Mesland, 2
mai 1644, à Elisabeth, 3 novembre 1645).
Pour Leibniz, il n’y a pas d’indifférence dans la volonté (ou au moins
d’indifférence de parfait équilibre) : il y a toujours dans la volonté des rai-
sons de vouloir ce qu’elle veut, étant admis que ces raisons peuvent être
comme de petites perceptions qui inclinent sans que l’esprit se les représente
explicitement (voir Nouveaux essais II, 1, § 15 p. 96-97 ; II, 21, § 25 p. 155
et § 47, p. 168 ; Théodicée, §§ 45-50 ; « Remarques sur le livre de l’origine
du mal », § 19 ; voir aussi la « Conversation sur la liberté et le destin », avec
la note 6, GF 3, p. 60 et la lettre à Coste, GF 3, p. 141, avec les notes 5 et 6)
Liberté et spontanéité : toutes les substances individuelles ont de la
spontanéité en ce que toutes leurs propriétés sont produites par la loi de leur
essence ; dans les êtres raisonnables, cette spontanéité devient liberté en ce
qu’ils sont capables de délibération et se déterminent selon ce qui leur appa-
raît comme le bien (voir § 291).
Identiquement, le § 24 esquisse la solution leibnizienne concernant la
question du mal : l’ouvrage se propose, répondant ainsi exactement au titre
de théodicée, de concilier la puissance de Dieu (en vertu de laquelle il con-
court à toutes les actions des créatures de telle sorte que tout dépend de lui),
la bonté de Dieu (en vertu de laquelle il ne peut pas être l’auteur du péché) et
la justice de Dieu (en vertu de laquelle il y a une raison de sauver les uns et
de damner les autres).
En conciliant ainsi les attributs de Dieu, la Théodicée permet de ré-
concilier les positions théologiques opposées : chacune est justifiée en son
ordre, chacune est comme une perspective sur le même géométral et si elle
se trompe, ce n’est qu’en raison de sa partialité.
La fin de la Préface retrace le contexte de la rédaction des Essais de
Théodicée, contexte dans lequel le débat avec Bayle joue un rôle important.
L’un des mérites de Bayle est d’aiguiser toutes les difficultés de la théologie,
toutes les oppositions sur lesquelles elle travaille, et en particulier
l’opposition de la foi et de la raison ; il aiguise leur opposition mais ne peut,
à partir de là, parvenir à aucune réconciliation, à aucune unité. Leibniz re-
prend la question pour montrer qu’il y a une théologie naturelle qui est en
accord avec la théologie révélée.
La suite de la Préface sera commentée en même temps que les trois
parties des Essais
© Philopsis – Pascal Dupond 19
www.philopsis.fr
Notes sur le « Discours de la conformité de la foi avec la raison »
§ 1.Deux vérités ne sauraient se contredire. Donc les vérités de foi
sont par principe compatibles avec les vérités rationnelles
La foi est présentée à partir de son objet (la vérité révélée d’une ma-
nière extraordinaire) alors que la raison est présentée à partir de son opéra-
tion (l’enchaînement des vérités, et, entre autres, de celles que l’esprit hu-
main peut atteindre naturellement). Cette présentation rend possible (et
même nécessaire) la rencontre de la foi et de la raison : la raison peut ou
même doit enchaîner les vérités révélées à la foi.
Le rapport de la foi et de la raison est analogue au rapport de
l’expérience et de la raison : la raison « pure et nue » a ses propres vérités,
c’est-à-dire des vérités indépendantes de l’expérience, mais cela n’exclut pas
qu’elle intervienne aussi (comme instance de liaison) dans le domaine des
vérités empiriques, pour les unir entre elles. L’analogie est d’autant plus jus-
tifiée que la foi a quelque chose de comparable à l’expérience, au sens où
elle se fonde sur une expérience et la transmission d’une expérience.
§ 2. Leibniz distingue deux ordres de vérités qu’il appelle ici vérités
éternelles et vérités positives. Cette distinction traverse toute l’œuvre de
Leibniz, et bien que les noms donnés à ces deux ordres de vérité ne soient
pas toujours les mêmes, les définitions sont proches. Les vérités éternelles
sont celles dont la négation enveloppe une contradiction et qui sont, de ce
fait, absolument nécessaires (la négation de la vérité « A est A », c’est-à-dire
« A est non A », enveloppe une contradiction manifeste). Lien entre le né-
cessaire et l’éternel : « il n’y a rien de si éternel que ce qui est nécessaire » [à
Foucher, 1676]. La nécessité est soit logique, soit métaphysique, soit géomé-
trique (« la nature du cercle avec ses propriétés est quelque chose d’existant
et d’éternel », à Foucher, 1676). Les vérités positives sont celles qui ont été
établies comme lois de la nature par la volonté de Dieu. La nécessité qui leur
appartient est une nécessité physique. Nous les connaissons soit par
l’expérience, soit a priori ; nous les discernons a priori quand nous compre-
nons qu’elles sont exigées par la « convenance » ou par « les raisons géné-
rales du bien et de l’ordre », qui les a fait choisir par Dieu. Elles ne sont pas
sans raison, et la raison qui les a fait choisir est le bien ou le plus grand bien.
Relèvent de cette nécessité physique les règles du mouvement et d’autres
lois générales. Dans le Discours de métaphysique (DM), Leibniz prend en
exemple les lois de la réfraction. Dans la mesure où la raison qui les a fait
choisir est le bien, on peut dire que la nécessité qui leur appartient est une
nécessité morale et que, en ce sens, la nécessité physique, dans la mesure où
elle excède la nécessité géométrique, est fondée sur une nécessité morale.
Les raisons générales peuvent être vaincues par des raisons plus
grandes : les raisons générales sont ce que le DM appelle des « maximes su-
balternes »
§ 3. Si les objections que l’on oppose aux vérités de foi avaient rang
de démonstration, on devrait admettre que ce à quoi ces objections
s’opposent est faux. Mais, selon Bayle, il n’y a pas de démonstration contre
les vérités de foi, donc les arguments qui s’y opposent ne sont que vraisem-
blables et n’ont pas de force contre la foi.
§ 4. Ce qui vient d’être dit s’accorde à l’avis des théologiens autant
protestants que catholiques. Un consensus pourrait donc se dessiner autour
© Philopsis – Pascal Dupond 20
www.philopsis.fr
des propositions suivantes. 1/ Lorsque la foi dit s’opposer à la raison, elle ne
s’oppose pas à la raison en tant que « droite et véritable raison » (§ 1), car
une telle opposition est impossible, elle s’oppose à « une prétendue raison
corrompue et abusée par de fausses apparences » (la question est alors de sa-
voir comment il est possible que la raison dévie de son essence). 2/
L’homme peut avoir des pensées vraies au sujet des attributs de Dieu : nous
avons des raisons d’attribuer à Dieu des attributs tels que bonté, justice ou
sagesse ; cette attribution n’implique pas la confusion de Dieu avec une na-
ture finie : l’attribution est vraie aussi longtemps que nous avons la cons-
cience que les attributs de Dieu diffèrent des nôtres parce qu’ils sont « infi-
niment plus parfaits ». 3/ Si des maximes philosophiques sont rejetées en
théologie, il ne peut s’agir que de maximes physiques, qui n’impliquent au-
cune nécessité absolue et qui ont rang de maximes subalternes.
§ 5. On ne peut surmonter l’incompatibilité apparente des vérités de
foi et des vérités de raison qu’en commençant par distinguer les différentes
modalités du rendre raison que Leibniz désigne par les termes : expliquer,
comprendre, prouver, soutenir. Les mystères se prêtent à une explication,
mais ils sont inaccessibles à la compréhension, comme il y a des qualités
sensibles qui sont explicables mais non compréhensibles (la compréhension
serait l’explication parfaite) ; on ne peut en rendre raison par une preuve a
priori ou par raison pure (par une démonstration), mais nous n’en avons pas
moins des motifs d’y croire ou d’y ajouter foi et cela parce que nous avons
des preuves de la vérité de la religion (dont les miracles font partie) ; et nos
motifs de les croire, la certitude morale qui les accompagne autorise à les
soutenir contre des objections qui ne peuvent jamais être démonstratives et
donner une certitude absolue.
§ 6. Leibniz montre que « la question de la conformité de la foi avec la
raison » est inscrite dans l’histoire de la dogmatique chrétienne : le christia-
nisme s’est dit dans la langue de Platon, dans la langue d’Aristote, la théolo-
gie a cherché à se donner la forme de la science. Leibniz appelle de ses vœux
l’auteur qui ferait l’histoire de la scolastique (en séparant l’or et les scories)
jusqu’au rétablissement des belles-lettres (Leibniz pense vraisemblablement
au 16e siècle) et même au delà puisqu’un certain nombre de dogmes sont
postérieurs au Concile de Trente.
§ 7. La grande scission de l’Occident : la Réforme
Les averroïstes italiens combattent la conformité de la foi et de la rai-
son, en faisant valoir que foi et raison divergent sur un point fondamental qui
est l’immortalité de l’âme : la foi chrétienne croit en l’immortalité de l’âme
individuelle alors que la raison (du moins une raison identifiée à Aristote, à
Aristote lu par Averroès) en prouve l’impossibilité. La première prémisse
qui l’établit est la conviction aristotélicienne que le genre humain est éternel.
Si nous supposons que le genre humain comprend un nombre fini
d’individus, cette éternité n’est possible que par le retour cyclique des
mêmes, c’est-à-dire par la métempsychose, qu’Aristote n’admet pas. Si nous
supposons qu’il y a toujours des âmes nouvelles et qu’elles se conservent
éternellement, alors elles forment un ensemble infini, actuellement infini, ce
qu’Aristote à nouveau n’admet pas. Bref, les deux suppositions conduisent
(sous la condition de l’éternité du genre humain) à des conséquences
qu’Aristote refuse. Si Aristote est la raison, c’est donc la raison qui les re-
fuse. On doit alors admettre que l’âme, l’entendement passif individuel, périt
© Philopsis – Pascal Dupond 21
www.philopsis.fr
avec le corps, et que seul demeure l’entendement actif, qui vient du dehors
(Traité de l’âme), qui est commun à tous les hommes et qui n’est donc pas
individuel.
§ 8. Les averroïstes en question sont très mal fondés dans leur argu-
mentation et ce qu’ils avancent sur la non compatibilité de la foi et de la rai-
son est comme nul et non avenu : Aristote n’a pas prouvé que le genre hu-
main est éternel (la prémisse), il n’a pas réfuté la métempsychose (conclu-
sion de la première supposition) ni l’infini actuel (conclusion de la seconde
supposition).
Selon les croyances accompagnant la conviction de la mortalité des
âmes individuelles, il existe une âme universelle, de laquelle naissent et à la-
quelle retournent les âmes individuelles qui est soit une âme sublunaire, soit
Dieu, soit une âme subordonnée et créée.
§ 9. Ceux que Leibniz appelle des « monopsychites » peuvent sans
doute être appelés panthéistes : les stoïciens, les savants de la Perse et des
Etats du Grand Mogol (les religions de l’Inde), les cabalistes et les mys-
tiques, dont Angelus Silesius et Rusbrock (Ruysbroeck).
§ 10. Les quiétistes se rapprochent de cette conviction :
« l’anéantissement de ce qui nous appartient en propre » peut signifier, au
moins chez certains quiétistes, une résorption dans l’âme universelle ou
même une résorption dans le néant.
Le remède à ces convictions erronées est le système de l’harmonie
préétablie. Il fait voir que toutes les âmes, c’est-à-dire toutes les substances,
sont immortelles. Ceux qui croient que les âmes qui ont du sentiment, mais
non la raison, sont mortelles (ce qui serait l’opinion partagée par la plus
grande partie de la scolastique) ou ceux qui croient que seules les âmes ayant
la raison ont aussi du sentiment (ce qui serait la position des cartésiens : les
animaux sont des machines) favorisent le panthéisme : si des âmes capables
de sentiment peuvent périr, il est difficile d’avoir la conviction de
l’immortalité des seules âmes raisonnables.
Le § 11 fait apparaître le concept de « religion naturelle » et annonce
aussi la « réconciliation » de la philosophie corpusculaire avec Platon et
Aristote : la découverte de cette compatibilité n’est rien d’autre que la théo-
rie de la monade.
§ 18. Evocation de quelques querelles théologiques parmi les protes-
tants, au sujet de l’interprétation de la cène, querelles dont l’intérêt est de se
présenter aussi, d’une façon ou d’une autre, comme une querelle entre la foi
et la raison. Calvin, au nom de la « maxime des philosophes » selon laquelle
un corps ne peut se trouver qu’en un seul lieu à la fois, donne à la sainte cène
un sens allégorique (« la participation du corps de Jésus Christ dans la sainte
cène » est réduite « à une simple représentation de figure »), alors que les
évangéliques s’accordent avec Luther pour admettre une participation réelle,
donc un mystère surnaturel.
§ 19. Quel que soit le détail de ces querelles, il est clair qu’elles enga-
gent des questions philosophiques sur le lieu et l’espace. Il existe une
maxime philosophique « qui borne l’existence et la participation des corps à
un seul lieu ». L’une des versions de cette maxime se trouve dans la convic-
tion (lockienne, mais d’abord cartésienne) qu’ « un corps ne peut opérer im-
médiatement sur un autre qu’en le touchant par sa superficie et en le pous-
sant par son mouvement ». Or, observe Leibniz, Locke a abandonné cette
© Philopsis – Pascal Dupond 22
www.philopsis.fr
conviction en lisant Newton : la théorie newtonienne de la gravitation
montre qu’un corps peut agir à distance et de façon instantanée sur plusieurs
autres corps ; si tel est le cas, s’il y a dans la nature quelque chose comme
une opération immédiate, alors on peut admettre qu’un corps peut être pré-
sent à plusieurs corps ensemble, au moins par l’intervention de la toute puis-
sance divine.
§ 20. A l’occasion de la querelle de deux théologiens protestants,
Leibniz énonce un point d’accord entre eux qui paraît bien être le principe
fondamental d’un accord entre la foi et la raison : les vérités de foi ne peu-
vent être contraires aux vérités ayant une nécessité logique ou métaphysique,
mais elles peuvent combattre des maximes dont la nécessité est appelée phy-
sique, « qui n’est fondée que sur les lois que la volonté de Dieu a prescrites à
la nature » et qui ne sont que des maximes subalternes. La question serait
donc de déterminer le statut (logique ? physique ?) de la maxime selon la-
quelle un corps ne peut être présent qu’en un seul lieu.
§ 22. Aucun dogme ne peut contrevenir à la nécessité logique, et le
dogme de la Trinité ne fait pas exception à la règle. Un Dieu en trois per-
sonnes : pour que le principe selon lequel « deux choses qui sont les mêmes
avec une troisième sont les mêmes entre elles » ne soit pas violé par le
dogme de la Trinité, il faut admettre que « le mot Dieu n’a pas la même si-
gnification au commencement et à la fin de cette expression ». Si l’identité
de l’être à lui-même est un principe inviolable, alors la non identité de l’être
à lui-même en peut relever que d’une équivocité, c’est-à-dire du plan séman-
tique.
§ 23. Ce paragraphe important invite à distinguer ce qui est « contre la
raison » (= ce qui contrevient à la nécessité logique, ce qui est contradic-
toire) et ce qui est au-dessus de la raison. Le terme « raison » n’a pas exac-
tement le même sens dans les deux formules. Le premier sens, celui qui se
présente dans la formule « contre la raison » correspond assez bien au sens
que choisit Leibniz et qu’il rappelle à la fin du paragraphe : « l’enchaînement
inviolable des vérités ». Le deuxième sens est lui-même bipolaire, car la rai-
son désigne cette fois la compréhension humaine des choses dans sa limite,
soit historique et factuelle, soit essentielle : une vérité est au dessus de la rai-
son 1/ quand elle est « contraire seulement à ce qu’on a coutume
d’expérimenter ou de comprendre » ; 2/ « quand notre esprit ou même tout
esprit créé ne la saurait comprendre ». Dans le premier cas, la raison hu-
maine est considérée dans son inscription historique et ses limites contin-
gentes ; dans le second cas, elle est considérée dans sa nature et ses limites
essentielles.
§ 24 et 25. Une vérité peut-elle être confrontée à des objections inso-
lubles ? Certains le pensent et prennent en exemple la question de la prédes-
tination en théologie et la question de la composition du continuum en philo-
sophie. Leibniz le nie, si on prend du moins le terme « insoluble » au sens de
« invincible » : si une objection est invincible, c’est qu’elle est démonstrative
contre la thèse à laquelle elle fait objection, et cette thèse est donc réfutée, ce
qui veut dire qu’elle est manifestement fausse.
§ 27. Un esprit médiocre est toujours capable d’examiner une objec-
tion contre la vérité à la condition que celle-ci se présente comme rationnelle
et plus précisément comme démonstrative. Car si elle se veut démonstrative,
elle admet nécessairement la légitimité d’un examen portant sur
© Philopsis – Pascal Dupond 23
www.philopsis.fr
l’enchaînement de ses propositions et sur la validité de ses prémisses. Et si
elle est contraire à la vérité, son défaut apparaîtra nécessairement, soit d’un
côté, soit de l’autre.
§ 28. Les objections rationnelles contre les vérités de la foi qui se veu-
lent non pas démonstratives mais seulement vraisemblables sont plus diffi-
ciles à écarter, car si nous avons une logique de la démonstration (dont
l’impulsion est venue des Seconds analytiques d’Aristote), nous manquons
d’une logique du vraisemblable (comme celle que Aristote esquisse dans ses
Réfutations sophistiques). Mais des objections qui n’ont pas d’autre préten-
tion que celle du vraisemblable peuvent être négligées : les mystères de la foi
sont au delà du vraisemblable, et ce qui est important, c’est seulement
d’établir qu’ils ne sont pas contre les vérités nécessaires.
§ 29. L’écriture récuse t-elle les droits de la raison ? On pourrait le
soutenir, en se souvenant que la première épître aux Corinthiens présente la
croix comme une folie pour les grecs et comme un scandale pour les juifs ;
mais en vérité la raison n’est pas récusée : la foi invoque des motifs de cré-
dibilité devant le tribunal de la raison ; et une fois que la raison a reçu les
motifs de crédibilité de la foi, elle peut lui abandonner sans rien renier de soi
les arguments vraisemblables ; ce qui est invalidé par la foi, c’est la raison
qui construit des arguments vraisemblables et non pas la raison qui construit
des vérités démonstratives. La seconde est la raison selon son essence ; la
première est la raison au sens de la compréhension commune des hommes.
§ 32-33. Quand la pensée s’engage dans une réflexion qui relève de la
théodicée, elle est nécessairement tentée de penser par analogie et de juger
l’imputabilité des actions de Dieu comme on juge l’imputabilité des actions
humaines. Dans le monde humain, on se contente de présomptions, c’est-à-
dire de vérités admises par provision, faute de preuve du contraire. En ma-
tière de théodicée, une présomption construite par analogie ne peut pas suf-
fire : si nous en étions capables « d’une discussion exacte du fait », celle-ci
aboutirait nécessairement à justifier Dieu contre les apparences.
§ 34. Dans le monde humain, une présomption générale de culpabilité
(d’omission) est annulée par certaines circonstances particulières ; en ma-
tière de théodicée, la présomption de culpabilité (au sens où Dieu serait en
faute, en permettant le mal alors qu’il pouvait l’empêcher) peut être annulée
par des « raisons générales » : des maux « locaux » ne sont pas incompa-
tibles avec le plus grand bien du tout ; mieux : ils sont exigés par ou pour le
plus grand bien du tout.
§ 35. La « permission » du mal était indispensable : nous ne pouvons
pas l’établir a priori (c’est-à-dire le démontrer) car cela excède les forces de
l’entendement humain, mais nous le jugeons par l’événement ou a posterio-
ri, et ce « juger » signifie ici « croire », au sens de la foi ; notre foi que la
permission du mal était indispensable résulte de deux prémisses, dont l’une
est un fait : le mal existe, et l’autre déjà une foi : rien n’arrive qui soit con-
traire à la bonté, à la justice, à la sainteté de Dieu ; de ces deux prémisses ré-
sulte notre croyance que la permission du mal est conforme à la bonté, à la
justice, à la sainteté et que, dans cette mesure, elle est indispensable.
Les juristes distinguent la question quid facti et la question quid juris.
En l’espèce, la difficulté n’est pas dans la question quid juris : la justice de
© Philopsis – Pascal Dupond 24
www.philopsis.fr
Dieu n’a pas d’autres règles que la justice des hommes18 ; elle est dans la
question quid facti : « le cas dont il s’agit est tout différent de ceux qui sont
ordinaires parmi les hommes ».
§ 36. On peut imaginer aussi que, parmi les hommes, les « raisons »
(aussi fortes soient elles) d’imputer à quelqu’un une faute soit contrebalan-
cées par la « foi » (fondée sur une connaissance de ses actes et de son carac-
tère) qu’il ne peut pas l’avoir commise. A nouveau, il n’y a là aucune déro-
gation aux règles habituelles de justice, mais seulement une application in-
habituelle des règles habituelles de justice.
§ 37. La « solution » qu’il faut absolument écarter, c’est, pour Leibniz,
celle qui consiste à dire que, le cours du monde allant à l’opposé de notre
concept de la justice, il faut en conclure que la justice selon Dieu n’a aucun
rapport avec la justice selon les hommes, que « ce que nous appelons justice
n’est rien par rapport à Dieu » ou que « la justice est quelque chose
d’arbitraire à son égard ». S’il n’y a, dans la justice de Dieu, rien qui soit
commensurable à notre concept de la justice, nous n’avons plus aucun
moyen de distinguer entre un Dieu bon et un Dieu méchant, entre le vrai dieu
et un faux Dieu. La foi n’est pas la raison mais la foi n’est pas sans raison : il
doit y avoir une raison qui porte la foi vers le Dieu des juifs et des chrétiens
plutôt que vers Zoroastre ou le dieu des manichéens.
§ 38. En matière de Théodicée, la difficulté concerne non le droit mais
le fait. A nouveau, ce qui est en jeu, ce ne sont pas les règles de la justice
mais, si l’on peut dire, l’établissement des faits à subsumer sous les règles de
justice. La foi se prononce contre des apparences qui ont quelque chose de
rationnel, mais elle ne se prononce pas contre la raison, car la raison nous
demande elle-même souvent de renoncer à des apparences qui, à un certain
degré de connaissance, sont rationnelles, par considération d’une expérience
plus précise ou plus étendue. Ainsi ce qui passait pour le conflit de la foi et
de la raison doit plutôt être compris comme la discordance entre une raison
bornée et une raison plus étendue.
§ 39. Bayle forme le projet de montrer que les vérités de la foi ne sa-
vent pas soutenir les attaques de la raison (donc que la raison est opposée à
la foi et lui adresse des objections insurmontables) mais que, loin de lui
nuire, cela la conforte plutôt, en attestant que la raison ne peut rien contre
elle et qu’elle est inexpugnable « dans le cœur des fidèles ». Leibniz est tout
à fait opposé à cette orientation « apologétique » : la raison ne peut pas être
opposé à la foi, et si la raison (entendons : « la droite et véritable raison », la
raison pensée en son essence) dirigeait contre un article de foi une objection
insurmontable, c’est la foi qui devrait céder à la raison, car il s’agirait, en
l’espèce, d’une foi illusoire. La raison ne peut accepter que les enfants mou-
18
« Il s’agit donc de trouver cette raison formelle, c’est-à-dire le pourquoi de cet attri-
but [la justice] ou cette notion qui doit nous apprendre en quoi consiste la justice et ce que les
hommes entendent en appelant une action juste ou injuste. Et il faut que cette raison formelle
soit commune à Dieu et à l’homme. Autrement on aurait tort de vouloir attribuer sans équi-
voque le même attribut à l’un et à l’autre. Ce sont là les règles fondamentales du raisonne-
ment et du discours » (« Méditation sur la notion commune de justice », 1702).
« Quand on dit que les voyes de Dieu ne sont pas nos voyes […], il ne faut pas en-
tendre comme s’il avait d’autres idées que nous de la bonté et de la justice, il a les mêmes
idées que nous, et nous le savons de lui comme celles des grandeurs et des nombres, mais
nous n’entendons pas comment il les applique, parce que nous ne sommes pas informés du
fait dont la trop grande étendue passe notre compréhension ».
© Philopsis – Pascal Dupond 25
www.philopsis.fr
rant avant d’avoir été baptisés soient damnés ou que soient damnés des
adultes « qui auraient manqué des lumières nécessaires pour obtenir le sa-
lut », et par conséquent une foi qui irait, sur ce point à l’encontre de la raison
doit être considérée comme « une chimère de l’esprit humain » (on retrouve
ici la question de la transmission héréditaire du péché du premier homme et
l’opposition de deux conceptions de la culpabilité : la culpabilité
d’appartenance et la culpabilité de volonté ou d’action. Dans l’histoire des
peuples, la culpabilité est d’abord collective (par exemple la malédiction qui
frappe les Atrides se transmet de génération en génération) ; et la singulari-
sation de la culpabilité n’apparaît que dans une phase seconde, une phase de
rationalisation de la responsabilité. On voit que Leibniz refuse une damna-
tion qui serait entièrement déconnectée de tout mal agir et qui serait la puni-
tion infligée à une nature et non pas à des actes.
§ 40. Aucun article de foi ne peut être soutenu contre la véritable rai-
son. Mais la foi est fondée à récuser les raisons apparentes. La difficulté est
de distinguer la véritable raison et les raisons apparentes. Cette distinction
n’est accessible qu’à celui qui est capable de « recherches exactes ». Les
autres, tous ceux qui, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent se con-
sacrer à de telles recherches peuvent sans scrupule présumer que leurs objec-
tions à la foi chrétienne relèvent des « raisons apparentes » ou d’une curiosi-
té à laquelle ils peuvent ou même doivent renoncer. Suivent des recomman-
dations de pédagogie apologétique : il est sage est de protéger les hommes
des objections qui pourraient devenir un poison pour leur foi ou de ne le leur
présenter qu’avec l’antidote de ce poison. Le tribunal de la raison n’est pas
aussi public qu’il le sera un siècle plus tard, chez Kant.
§ 41. Il est permis de présenter ce que la foi donne à croire comme in-
compréhensible ou contraire aux apparences (car l’incompréhensibilité ne
constitue pas une objection rationnelle à l’acquiescement, non plus que
l’opposition aux apparences), mais non pas comme insoutenable, car ce qui
est insoutenable, c’est ce qui est purement et simplement refusé par la raison.
§ 42. La prétendue opposition de la foi et de la raison se résout en vé-
rité en opposition entre de « fausses raisons » et « des raisons solides et su-
périeures ». L’esprit humain forme un concept rationnel de Dieu, et la raison
construit « des démonstrations qui nous assurent de la perfection infinie de
ses attributs ». Les raisons solides qui soutiennent la foi triomphent des rai-
sons apparentes qui la combattent.
§ 43. Nouvelle raison de penser que le prétendu conflit de la foi et de
la raison est un conflit de la raison avec elle-même : les « difficultés » ou les
objections qui sont opposées à la foi ne concernent pas seulement, ne con-
cernent même pas d’abord le Dieu de la théologie révélée, elles concernent
d’abord le Dieu de la théologie naturelle, c’est-à-dire le Dieu de la raison.
On peut renoncer à tout ce qui, de la théologie chrétienne révélée, excède la
théologie naturelle : la sainte Ecriture, le péché originel, la grâce de Dieu en
Jésus-Christ, la damnation : l’essentiel des difficultés demeure, car elles
s’adressent au Dieu de la raison : comment un principe unique (donc un
principe qui n’a pas eu à composer avec un principe antagoniste) a t-il pu
admettre le mal (on peut ici sous-entendre : physique), permettre le mal mo-
ral et désaccorder assez le mal physique et le mal moral pour que les mé-
chants soient heureux et les bons malheureux ?
© Philopsis – Pascal Dupond 26
www.philopsis.fr
§ 44. Il y a une théologie naturelle indépendante de toute théologie ré-
vélée : la raison nous apprend démonstrativement qu’il y a un principe
unique de toutes choses et que ce principe est parfaitement bon et sage. A
partir de là, toutes les difficultés à propos du mal disparaissent. Nous ne
pouvons pas « voir » a priori ou par les causes que le mal est impliqué
« dans le plan le plus digne d’être choisi », mais nous le croyons dès le mo-
ment où nous constatons que le mal existe : puisqu’il y a un Dieu bon et
sage, le mal fait nécessairement partie du meilleur monde possible.
§ 45. La foi (sans doute faut-il entendre ici une foi rationnelle, qui,
après s’être assurée démonstrativement de l’existence d’un principe unique
et bon, croit que le mal fait partie du meilleur plan) est « un excellent exer-
cice des vertus chrétiennes ». Donc l’exercice de la raison, loin d’être opposé
à la vie chrétienne, la favorise.
§ 50. Les § 46-47-48-49 présentent diverses autorités qui ont pensé
que la raison devait être sacrifiée. Réponse de Leibniz : la foi chrétienne ne
peut pas être opposée à la raison. Quand Tertullien dit : « credibile est quia
ineptum » ou bien « certum est quia impossibile », l’absurde et l’impossible
doivent être compris comme absurdité apparente et impossibilité apparente.
§ 51-52. Origène pensait que la raison sert de fondement au christia-
nisme et que la vérité du christianisme peut être établir par voie purement ra-
tionnelle. Mais venir au christianisme par la raison est une voie longue et qui
ne convient qu’à un petit nombre. Pour la plupart des hommes, la voie
courte de la foi (qui suffit à réformer les mœurs) est suffisante.
§ 54. Les mystères peuvent recevoir une explication, mais une expli-
cation imparfaite. De même que nous n’avons pas de notion adéquate des
qualités sensibles, nous avons des mystères une « intelligence analogique ».
§ 55. Nous ne pouvons parler des mystères de la religion qu’en en
nous servant de « notions communes » telles que « bon », « mauvais », ou
« union ». Nous comprenons ce qu’est l’union quand nous parlons de
l’union d’un corps avec un autre corps ou d’un substance avec son accident
ou de l’âme avec le corps. Notre compréhension de ce qu’est l’union dans
les domaines relevant de la philosophie naturelle nous permet d’avoir, par
analogie, la compréhension de ce que nous disons quand nous parlons de
l’union du Verbe divin avec la nature humaine.
§ 57-58. Distinction entre les trois actes de la raison que sont « com-
prendre », « prouver » et « répondre aux objections ». Bayle met sur le
même « l’incompréhensibilité d’un dogme » et « l’insolubilité des objections
qui le combattent ». Or il s’agit, pour Leibniz, de considérations tout à fait
différentes : si un dogme est l’objet d’objections insolubles, cela veut dire
qu’il est réfuté.
§ 59. Comprendre signifie, au sens le plus précis : rendre raison par la
cause efficiente. Comprendre les dogmes, ce serait en rendre raison par la
cause efficiente. Cette tâche excède la portée de l’entendement humain, mais
cela n’exclut pas qu’il y ait, sans les comprendre, à les soutenir contre les
adversaires.
§ 61. Si les mystères (comme le reconnaît Bayle) sont conformes à
« la raison suprême et universelle », ils ne peuvent pas être opposés à la rai-
son humaine, car la raison humaine n’est qu’une portion de la raison univer-
selle, et « elle ne diffère de celle qui est en Dieu que comme une goutte
d’eau diffère de l’Océan ou plutôt comme le fini de l’infini ». Donc ce qui
© Philopsis – Pascal Dupond 27
www.philopsis.fr
s’oppose en l’homme aux mystères, ce n’est pas la raison, c’est la corrup-
tion.
§ 62. Leibniz admet, comme tout chrétien, qu’il y ait de la corruption
dans la nature humaine, mais il n’admet pas que la raison soit considérée
comme corrompue en tant que raison ou que l’exercice de la raison en tant
que telle soit une manifestation de la corruption. La raison est par essence
droite et dire qu’elle est corrompue, cela veut dire qu’elle est « mêlée de pré-
jugés et de passions ». Qui plus est, la raison est toujours capable de discri-
miner en elle ce qui relève de la droite raison et ce qui relève de la raison
corrompue, c’est-à-dire de la raison mêlée aux préjugés et aux passions. Pour
opérer cette discrimination, il suffit à la raison de « procéder par ordre ».
§ 63. Examen d’une remarque de Bayle, selon laquelle il n’y aurait
pas à distinguer, en matière de religion, ce qui est au dessus de la raison et ce
qui est contraire à la raison ( = si la raison est comprise comme la raison
universelle, les mystères ne sont ni au dessus de la raison, ni contre elle ; et
si la raison est comprise au sens de la raison humaine, ils sont à fois au des-
sus d’elle et opposés à elle). La réponse de Leibniz a pour principe de refuser
non pas la distinction entre la raison divine et la raison humaine, mais la fa-
çon dont Bayle la comprend. La raison humaine, au sens strict de
« l’enchaînement des vérités que nous connaissons par la lumière naturelle »
est une partie de la raison divine. Les mystères peuvent être au dessus de ce
système de vérités enchaînées, mais ils ne peuvent pas s’y opposer.
§ 64. Bayle fait une analogie entre la vue sensible et la raison. Vue
avec nos yeux humains, la tour carrée éloignée nous apparaît ronde, alors
même qu’il y a incompatibilité entre le rond et le carré, et notre vision ne
peut rien faire pour dépasser l’apparence ; de même, vue avec les yeux de
notre raison humaine, les mystères de la foi nous apparaissent contraires à la
raison, et nous avons beau nous dire qu’il ne sont pas opposés à la raison
universelle, nous ne pouvons rien faire pour dépasser l’apparence. Leibniz
objecte à l’analogie que 1/ la sensibilité est imparfaite, c’est-à-dire faillible,
alors que la faculté de raisonner ne l’est pas, du moins « lorsqu’elle fait son
devoir » ; 2/ la nature même de la vision implique qu’elle puisse générer de
« fausses apparitions » qui nous trompent : la vision est perspectiviste ; le
cercle peut apparaître selon l’angle de vue, comme une ellipse, une parabole,
une hyperbole ou même comme une droite (quand les yeux sont à la hauteur
du plan du cercle), alors que la raison ne l’est pas : son champ est limité,
mais elle se porte d’emblée au géométral des choses.
§ 65 [à commenter]. Les erreurs commises à l’occasion des percep-
tions sensorielles ne viennent pas des sens extérieurs, qui nous donnent exac-
tement ce qu’ils doivent nous donner selon la constitution des choses (ils
doivent nous donner une ligne quand les yeux sont sur le même plan que le
cercle), elles ne viennent pas non plus du raisonnement que nous construi-
sons au sujet de ses données sensorielles, « lorsqu’il est exact et conforme
aux règles de l’art de raisonner », elles viennent de ce que Leibniz appelle
« sens interne », c’est-à-dire une faculté de consécution s’exerçant sur les
perceptions, qui imite le raisonnement mais qui n’est pas le raisonnement, et
dont les bêtes ne sont pas moins pourvues que les hommes. Lorsque
l’entendement fait des consécutions sur les perceptions en suivant les règles
de l’art de raisonner, l’erreur est impossible. Quand il fait des consécutions
en se fiant au sens interne (comme Galilée jugeant que Saturne avait deux
© Philopsis – Pascal Dupond 28
www.philopsis.fr
anses, ou comme nous tous, quand nous devons agir promptement), il y a
risque d’erreur. Le sens interne fait des consécutions selon le probable, en
présumant que « les phénomènes que nous avons trouvés liés souvent le sont
toujours ». Si par raison, on entend une faculté de raisonner bien ou mal,
sans distinction entre une déduction rigoureuse et un argument probable,
alors on peut dire que la raison est trompeuse, comme on le dit couramment
des sens. Mais si on appelle raison la faculté de raisonner selon l’art de rai-
sonner, alors la raison n’est pas trompeuse. C’est le sens interne qui est
trompeur, qu’il s’exerce sur les données sensorielles immédiates ou sur de
données plus complexes où interviennent des idées de la raison.
§ 69. La phrase : « il met tout le genre humain et même toutes les
créatures raisonnables dans le même cas » paraît se rapporter à la fin du § 41
des Principes de la philosophie : « ce que nous savons être incompréhensible
de sa nature ». Ce que Leibniz reproche à Descartes, c’est d’avoir présenté
l’incompatibilité entre la prescience divine et la liberté humaine dans des
termes tels que leur accord devient impossible, sauf à alléguer la puissance
insondable de Dieu qui est au delà de notre compréhension ; il présente le
problème dans des termes tels que la raison humaine ne peut pas apercevoir
l’ombre de l’esquisse d’une solution, de telle sorte qu’elle n’a pas d’autre is-
sue que de s’en tenir d’une part à ce qui est certain (le témoignage intérieur
de notre libre arbitre) et d’abandonner la pensée, d’autre part, devant
l’incompréhensible. Leibniz objecte : 1/ si on suit Descartes, la contradiction
est éclatante, et on est conduit à admettre qu’il y a de la contradiction entre
les vérités, « ce qui est de la dernière absurdité » ; 2/ la pensée n’a pas à
abandonner la partie devant l’infini : nous ne pouvons pas comprendre
l’infini, mais il y a des démonstrations sur l’infini ; l’infinité de Dieu ne nous
dispense donc pas de chercher une solution ; 3/ la conception cartésienne de
la liberté est fausse : Descartes pense la liberté comme indifférence, mais il
n’y a pas de liberté d’indifférence ; la volonté incline toujours d’un côté plu-
tôt que d’un autre et c’est cette inclination (qui détermine l’action, mais qui
ne la rend pas nécessaire), que Dieu voit de toute éternité.
On retiendra du § 73 que Leibniz distingue, contre Bayle, « avoir une
idée de quelque chose » et « comprendre quelque chose » (comprendre une
chose, ce n’est pas seulement en avoir une idée ou quelques idées, c’est avoir
des idées claires, distinctes, adéquates de tout ce qui entre dans la chose).
Nous pouvons avoir une idée des objets de la religion sans les comprendre,
comme nous pouvons avoir une idée des choses de la nature sans les com-
prendre (nous ne comprenons pas la nature de la lumière, mais cela ne nous
empêche pas de construire une optique où il y a des démonstrations).
© Philopsis – Pascal Dupond 29
www.philopsis.fr
Essais sur la bonté de Dieu, la liberté de l’homme et l’origine
du mal
Première partie
Leibniz distribue cette première partie en deux moments :
Les §§ 1-75 étudient, comme le dit le début du § 76 les difficultés
« communes à la théologie naturelle et à la révélée ».
Les §§ 76-106 étudient un point qui touche à la révélation : l’élection,
la réprobation, l’économie de la grâce
§ 1. Leibniz rappelle d’abord le résultat du « Discours » : l’opposition
de la foi et de la raison (thème récurrent de la foi chrétienne, de Paul à Lu-
ther) a été surmontée ; la raison et la foi ne sont pas ennemies ; elles ne sont
pas non plus enfermées dans deux territoires sans communication ; la raison
peut servir à la foi, la lumière naturelle et la lumière révélée s’accordent sur
ce qu’elles nous enseignent « de Dieu et de l’homme par rapport au mal ».
Cet accord est fondé sur les propositions suivantes :
1/ Les vérités de foi ne peuvent pas être contraires à celles des vérités
de raison qui ont une nécessité logique ou métaphysique ; aucun dogme ne
peut contrevenir à la nécessité logique ou métaphysique, car ce qui enve-
loppe contradiction ou, comme dit Leibniz, ce qui est « contre la raison » est
manifestement faux. Le dogme de la Trinité ne fait pas exception à cette
règle : il est impossible d’admettre qu’il pourrait être vrai et pourtant contre-
venir à la raison ; nous devons donc le comprendre de telle sorte qu’il n’ait
rien de contraire à la raison ; si la proposition : « deux choses qui sont les
mêmes avec une troisième sont les mêmes entre elles » a le statut d’une véri-
té logique (« Discours », § 22), alors la Trinité doit nécessairement s’y ac-
corder ; donc quand on parle d’un Dieu en trois personnes, « le mot Dieu n’a
pas la même signification au commencement et à la fin de cette expression ».
Leibniz donne une solution sémantique à une difficulté à laquelle Hegel
donnera une solution ontologique : la Trinité est le symbole de la vie de
l’Absolu.
2/ Les vérités de foi sont au dessus des vérités de raison au sens de
« ce qu’on a coutume d’expérimenter ou de comprendre » (Discours, § 23).
Ainsi les vérités de foi peuvent être contraires à celles des vérités de raison
qui ont une nécessité simplement physique, comme les lois que Dieu a don-
nées à la nature, car ces lois de la nature ne sont que des maximes subal-
ternes qui peuvent être contredites par des décrets particuliers de Dieu.
Il faut donc distinguer ce qui est « contre la raison » et ce qui est « au
dessus de la raison », en observant que le terme de « raison » n’a pas exac-
tement le même sens dans les deux formules ; ce qui est contre la raison
s’oppose à « l’enchaînement inviolable des vérités » (ou à la possibilité
même de l’exercice de la raison) et est par là même absurde ; ce qui est au
dessus de la raison est au dessus de la compréhension humaine des choses,
qui a certes des limites essentielles, mais qui est aussi inscrite dans une his-
toire : ce qui est au dessus de la compréhension d’une époque n’est pas né-
cessairement au dessus de la compréhension d’une autre (les mathématiques
de l’infini donnent la résolution de problèmes jusqu’alors insolubles)
3/ Les vérités de foi qui, sans être contre la raison, sont au dessus de la
raison ont elles-mêmes leur raison ; la foi invoque des motifs de crédibilité
© Philopsis – Pascal Dupond 30
www.philopsis.fr
devant la raison, et dès lors que la raison a reçu les motifs de crédibilité de la
foi, elle peut lui abandonner, sans rien renier de soi, les arguments vraisem-
blables. Ce qui est invalidé par la foi, c’est la raison qui construit des argu-
ments vraisemblables et non pas la raison qui construit des vérités démons-
tratives.
4/ Les objections que la raison adresse à la théologie révélée
s’adressent d’abord à la théologie naturelle ; donc le débat de la foi et de la
raison est aussi et d’abord un débat de la raison avec elle-même (ce thème
annonce Kant).
Si, donc, les droits de la foi et les droits de la raison ne sont pas con-
tradictoires, la raison peut servir à la foi, la lumière naturelle et la lumière
révélée peuvent affronter ensemble les difficultés relatives au mal. Difficul-
tés qui sont de deux ordres.
Les unes concernent la puissance de Dieu ; la liberté est la condition
de l’imputabilité des actions ; or la liberté humaine paraît incompatible avec
la toute-puissance divine : si Dieu est tout-puissant, la liberté humaine paraît
impossible, et si elle est impossible, l’imputabilité disparaît.
Les autres concernent la bonté, la sainteté, la justice divine : si la li-
berté humaine est compatible avec la toute puissance divine, alors il faut
admettre que Dieu prend part, à la fois physiquement (par son opération) et
moralement (par sa volonté) au mal physique (la souffrance) et au mal mo-
ral (le mal agir) des hommes et cela en cette vie et au delà de cette vie (les
damnés sont voués à des souffrances éternelles) et dans « l’ordre de la na-
ture » comme dans l’ordre de la grâce (les maux se font voir dans l’ordre de
la nature, au sens où il y a dans l’homme une faillibilité naturelle, et dans
l’ordre de la grâce, au sens où Dieu accorde aux uns et refuse aux autres son
concours au salut)..
§ 2. Ce paragraphe reprend la première difficulté. Le dogme commun
des philosophes est que « la vérité des futurs contingents est déterminée ».
Ils adoptent donc une position anti-aristotélicienne : la contingence est sub-
jective, non objective. La conviction que la vérité des futurs contingents est
déterminée est exigée par 1/ la représentation que les philosophes ont de
Dieu en ère de christianité : omniscient et tout puisant ; non seulement la
prescience de Dieu implique logiquement que l’avenir soit certain et déter-
miné, mais c’est sa volonté et sa puissance qui le déterminent ; 2/ le principe
de causalité : « rien ne saurait arriver sans qu’il y ait une cause disposée
comme il faut à produire l’effet » (le principe de causalité est une variation
du principe de raison, car « la cause n’est pas autre chose que la raison ré-
elle » (24 thèses métaphysiques, RG 467) ; ce principe s’applique à tous les
événements du monde, dont l’action volontaire fait partie ; et s’il s’applique
à l’action volontaire, l’imputation des actions devient impossible et il n’y a
plus de justice divine ou humaine.
Ce « dogme commun » est celui de Descartes, qui réunit l’expérience
intime de la liberté et l’assurance de la Providence, mais sans parvenir à les
concilier (il a « tranché le nœud gordien », comme le dit le § 293 ; voir Des-
cartes, Principes, §§ 39-41 et lettre à Elisabeth, janvier 1646). C’est aussi ce-
lui de Spinoza qui abandonne le libre arbitre au nom de son incompatibilité
avec la détermination des choses.
§ 3. Ce paragraphe reprend la seconde difficulté.
© Philopsis – Pascal Dupond 31
www.philopsis.fr
Supposons que les actions soient imputables parce qu’il y a une liberté
humaine ; Dieu n’est pas pour autant affranchi de la responsabilité du mal au
double sens d’une responsabilité physique (Dieu est la cause de la substance
de l’acte dans le péché) et d’une responsabilité morale (Dieu omniscient n’a
pas pu ne pas savoir, il a donc voulu le péché en connaissance de cause).
On peut répondre à la difficulté en supposant que Dieu prête son con-
cours aux résolutions (mauvaises) pour leur donner leur suite mais sans in-
tervenir dans la décision elle-même ; mais la solution n’est pas bonne :
d’abord l’idée d’un concours de Dieu à la réalisation d’une mauvaise résolu-
tion n’est pas satisfaisante ; ensuite Dieu n’est pas moins la cause de la mau-
vaise inclination de la volonté que de la volonté elle-même et de la puissance
de réaliser ce qu’elle a décrété ; la mauvaise inclination n’aurait pas pu naître
sans son concours. Dieu paraît donc produire indifféremment le bien et le
mal.
Et cette difficulté s’accroît dans la métaphysique des modernes : chez
Descartes, il n’est plus question d’une création unique (pendant les six
jours…) mais d’une création continuée. C’est donc constamment que la na-
ture humaine est créée et recréée pécheresse. Et avec Malebranche et la doc-
trine des causes occasionnelles, la difficulté est encore plus embarrassante.
§ 4. Admettons que le concours de Dieu au mal ne soit qu’un concours
général (il n’a pas voulu le péché de Judas, mais il a créé en l’homme une
volonté libre pour le bien et le mal. Admettons même que Dieu n’ait pas
concouru au mal ; la difficulté n’est en rien diminuée ; Dieu savait que les
premiers hommes dans les circonstances où il les avaient placés pécheraient
et il ne l’a pas empêché, il l’a permis. Et ce mal que Dieu a permis est
d’autant plus accusateur qu’il se présente comme une sorte de corruption de
la nature humaine par le péché originel, une corruption qui produit en chaque
homme comme une nécessité de pécher (et rend vaine la liberté) et introduit
dans le monde une confusion telle qu’aucune Providence ne paraît le gou-
verner (les malheurs frappent indifféremment les bons et les mauvais, la mé-
chanceté règne et les bons sont opprimés).
La difficulté s’accroît si l’on considère la vie à venir : les réprouvés
sont le plus grand nombre, les élus sont le petit nombre, et ce qui départage
les uns et les autres, c’est une « élection sans raison ».
L’élection est sans raison : depuis le péché, « nous sommes morts à
toutes les bonnes œuvres » ; donc l’homme ne peut contribuer à son salut ; il
reçoit de Dieu ce qui justifie son élection (les bonnes actions ou la foi vive
qui sauve) en même temps que l’élection. L’élection aurait une raison si les
hommes pouvaient contribuer à leur salut et mériter ce qui leur est donné ;
mais si l’homme ne contribue en rien de soi à son salut, s’il a reçu de Dieu
son pouvoir de contribuer à son salut, alors l’arbitraire revient dans toute sa
force : « il faut toujours revenir à dire que Dieu est « la dernière raison du sa-
lut… »
§ 5. Toutes les difficultés soulevées par Bayle tournent autour du fait
que nous nous représentons le partage entre les élus et les réprouvés comme
tout à fait arbitraire. En effet 1/ tous les hommes sont frappés d’une corrup-
tion à laquelle leur volonté n’a pas de part puisqu’elle leur a été transmise
par voie héréditaire, mais qui ne les voue pas moins à la damnation éter-
nelle ; 2/ les contingences historiques ou géographiques font que le plus
grand nombre des hommes sont privés de la révélation, du baptême, des sa-
© Philopsis – Pascal Dupond 32
www.philopsis.fr
crements, c’est-à-dire « des secours nécessaires pour se retirer de ce gouffre
du péché » ; ils sont donc voués au malheur éternel, alors qu’ils ne sont pas
plus méchants que les élus ou du moins certains d’entre eux.
§ 6. Présentation du but de l’ouvrage : il s’agit de faire connaître les
perfections de Dieu capables de susciter la vraie piété qui n’est pas seule-
ment crainte mais aussi amour. Parmi les perfections, celle qui sera particu-
lièrement mise en évidence est la justice : Dieu n’est pas un prince absolu
ayant un pouvoir despotique.
§ 7. La première thèse métaphysique que Leibniz formule pour ac-
complir le but qu’il se propose est une thèse sur Dieu : « Dieu est la première
raison des choses ». Cette thèse ne porte ni sur l’existence de Dieu (car elle
est admise par les interlocuteurs que Leibniz veut combattre ou convaincre),
ni sur la nature de Dieu considérée intrinsèquement (comme dans le premier
paragraphe du DM : « Dieu est un être absolument parfait ») mais sur le rap-
port de Dieu avec l’être, tout l’être, l’être en tant que tel (on è on) (les choses
= tout ce qui peut prétendre au rang de « quelque chose », en quelque moda-
lité d’être que ce soit ; le concept de « chose » paraît bien être ici un concept
ontologique absolument universel). Aussitôt apparaît une sorte de division ;
première branche de la division : « celles qui sont bornées… » ; l’autre
branche de la division (qui n’est pas explicitement mentionnée comme telle),
c’est Dieu même, l’ens en tant qu’infinitum. Dieu est la première raison 1/
des choses bornées, de l’ens finitum, et 2/ de l’ens infinitum, Dieu même.
Mais ce n’est pas exactement de la même façon que Dieu est première raison
de l’ens finitum et de l’ens infinitum : dans un cas, la raison est extérieure,
dans l’autre, elle est intérieure (De l’origine radicale des choses, § 2 ; le
texte latin est traduit par Schrecker dans les « Opuscules philosophiques
choisis » [OPC])
« Tout ce que nous voyons et expérimentons… ». Soit les deux termes
sont en quelque sorte redondants. Soit Leibniz distingue expérience externe
et expérience interne. Soit il distingue mouvement et existence (ce qui peut
conduire à cette 3e lecture, c’est un texte de 1666 où Leibniz montre qu’il y a
deux voies de la remontée vers Dieu : à partir du mouvement, ou bien à par-
tir de l’existence (voir Belaval, Leibniz, Initiation à sa philosophie, p. 43 :
nous ne pouvons former aucun concept de l’existence sinon en identifiant
exister et être senti ; or le sentir correspondant à cet « être senti » ne peut pas
être celui d’un sujet fini et contingent, car un tel sentir ne peut pas fonder
l’existence de ce qui existe ; c’est donc le sentir d’un esprit infaillible :
« J’en conclus : que l’existence des choses consiste à être sentie par un esprit
infaillible, dont nous ne sommes que les effluves, c’est-à-dire par Dieu ».
Quoi qu’il en soit, l’argument s’oriente vers la question de l’existence
du corps, c’est-à-dire ce qui présente mouvement et figure : il n’y a rien,
dans l’espace, le temps et la matière (qui sont comme le tissu des corps), qui
donne la raison pour laquelle ces corps existent plutôt que non, pourquoi ils
sont ainsi plutôt qu’autrement. Les corps sont contingents, ils n’ont pas de
raison intrinsèque ; et cette contingence des corps, Leibniz l’étend à
l’assemblage entier des choses : aucune des choses que nous voyons et expé-
rimentons n’a sa raison en soi ; toutes sont contingentes ; et comme elles
sont liées, assemblées entre elles, comme elles forment par leur assemblage
un « monde », le monde est contingent (= il pourrait ne pas être ou il pourrait
© Philopsis – Pascal Dupond 33
www.philopsis.fr
être autre ; il n’a pas en lui-même la raison de son existence et de son être
tel)
Pourquoi Leibniz, parlant de la contingence des choses bornées, met-il
l’accent sur la contingence des figures et des mouvements ? Cela peut éton-
ner pour deux raisons, celle que nous venons de voir (il restreint l’ampleur
de la question) et une seconde : les corps considérés dans leur figure et leur
mouvement, c’est la res extensa cartésienne ; Leibniz n’accepte pas entière-
ment cette conception de la matière, elle lui paraît incomplète ; pour Leibniz,
les corps ne doivent pas leur réalité à l’étendue mais à des « forces » qui s’y
expriment ; mais cela ne diminue pas pour lui la validité de l’argument : si
l’on adopte les principes de la physique nouvelle, cartésienne, on doit recon-
naître que les choses mobiles et étendues n’ont pas la raison de leur exis-
tence en elles-mêmes; elles sont certes des phénomènes, mais des phéno-
mènes réels, elles exigent donc une raison suffisante et cette raison suffisante
ne se trouvant pas en elles ne peut être que Dieu.
Cette argumentation est pour la première fois présentée dans une étude
de 1669 intitulée Confessio naturae contra atheistas. La matière occupe de
l’espace, chaque corps a une grandeur et une figure ; le principe de raison
suffisante exige que l’on se demande pourquoi il a cette grandeur et cette fi-
gure. Deux réponses sont possibles, qui vont au même résultat : 1/ il a cette
grandeur et cette figure en raison d’une action mécanique ; mais la question
revient : pourquoi, avant cette action mécanique avait-il telle grandeur et
telle figure ; on invoque alors une seconde action mécanique, puis une troi-
sième, on est engagé dans une régression à l’infini ; et la raison suffisante
manque ; 2/ il a cette grandeur et cette figure de toute éternité ; à nouveau la
question revient ; on doit se demander pourquoi il a de toute éternité telle
grandeur et telle figure plutôt que toute autre. L’éternité d’une chose ou
d’une propriété n’en donne pas la raison suffisante.
Elle est reprise dans les textes tardifs
De l’origine radicale des choses (1697) : une explication mécaniste
est suffisante pour expliquer le passage d’un état du monde au suivant, mais
elle est incapable d’expliquer la série tout entière.
Considérations sur les principes de vie et sur les natures plastiques
(1705) : « Cette maxime aussi qu’il n’y a point de mouvement qui n’ait son
origine d’un autre mouvement suivant les règles mécaniques nous mène au
premier moteur encore, parce que la matière étant indifférente en elle-même
à tout mouvement et au repos, et possédant pourtant toujours le mouvement
avec toute sa force et direction, il ne peut y avoir été mis que par l’auteur
même de la matière » (GF 3, p. 97)
Principes de la nature et de la grâce (1714) : la matière étant indiffé-
rente en elle-même au mouvement et au repos, la raison d’un mouvement ne
peut se trouver que dans un mouvement antérieur, et ainsi indéfiniment, de
telle sorte que la raison suffisante des événements du monde ne peut se trou-
ver que hors de la série (GF 3, p. 228-229).
Deux remarques historiques.
1/ Aristote est le premier philosophe à avoir donné un concept expli-
cite de la contingence. En EN, V, 10, 1134 b 31, il parle « des choses qui ont
la possibilité d’être autrement qu’elles ne sont <to endechomenon allôs
echein> ; en Génération des animaux, II, 1, 731 b 25, il présente le contin-
© Philopsis – Pascal Dupond 34
www.philopsis.fr
gent comme ce qui peut être ou ne pas être <to endechomenon kai einai kai
mè einaï> : le contingent participe en quelque sorte de l’être et du néant.
2/ Ce passage rappelle une preuve de l’existence de Dieu connue sous
le nom de preuve a contingentia mundi. C’est la 3e voie thomiste :
« La troisième voie se prend du possible et du nécessaire, et la voici.
Parmi les choses, nous en trouvons qui peuvent être et ne pas être : la preuve,
c'est que certaines choses naissent et disparaissent, et par conséquent ont la
possibilité d’exister et de ne pas exister. Mais il est impossible que tout ce qui
est de telle nature existe toujours ; car ce qui peut ne pas exister, n’existe pas
à un certain moment. Si donc tout peut ne pas exister, à un moment donné
rien n’a existé. Or, si c’était vrai, maintenant encore rien n’existerait; car ce
qui n’existe pas ne commence à exister que par quelque chose qui existe.
Donc, s’il n’y a eu aucun être, il a été impossible que rien commence d'exis-
ter, et ainsi, aujourd'hui, il n'y aurait rien, ce qu'on voit être faux. Donc, tous
les êtres ne sont pas uniquement possibles, et il y a du nécessaire dans les
choses. Or, tout ce qui est nécessaire, ou bien tire sa nécessité d'ailleurs, ou
bien non. Et il n'est pas possible d'aller à l'infini dans la série des nécessaires
ayant une cause de leur nécessité, pas plus qu’il ne l'est quand il s'agit des
causes efficientes comme on l'a prouvé. On est donc contraint de supposer
quelque chose qui soit nécessaire par soi-même, ne prenant pas ailleurs la
cause de sa nécessité, mais fournissant leur cause de nécessité aux autres né-
cessaires » (Somme théologique, I, quest. II, art. 3)
Le centre de l’argument tient dans la proposition : si toutes les choses
sont contingentes, il y a eu un temps où rien n’existait dans le monde. Tho-
mas se place ici dans l’hypothèse des adversaires qu’il combat, celle de
l’éternité du monde qui semble dispenser du recours à Dieu. Il argumente
donc ainsi : si le monde est éternel, alors un temps infini s’est déjà écoulé,
donc la possibilité de l’inexistence du continent s’est déjà réalisée ; donc rien
n’existe aujourd’hui ; ce que nous voyons évidemment être faux ; donc il
faut admettre une existence nécessaire car ce qui est nécessaire est éternel.
Différence par rapport à Leibniz : D’abord il n’est pas question chez
Leibniz d’une preuve de l’existence de Dieu (il s’agit de montrer que Dieu
est la première raison, ce qui n’est pas la même chose) ; ensuite la contin-
gence qui intervient dans la preuve thomiste est une contingence empirique
(celle des choses qui naissent et meurent), alors que la contingence qui inter-
vient chez Leibniz est une contingence logique = ce dont le contraire est pos-
sible ; symétriquement la nécessité qui s’oppose à la contingence est chez
Thomas la nécessité de l’éternel, alors qu’elle est chez Leibniz la nécessité
de ce dont le contraire est contradictoire ; chez Thomas, la temporalité est un
chaînon essentiel ; elle ne l’est pas chez Leibniz : dans un monde sans deve-
nir, la preuve par la contingence resterait possible (De l’origine radicale des
choses, § 2, OPC ou , LP p. 338 et sv.).
L’idée de raison est au centre du dispositif dans lequel Leibniz cons-
truit le concept de Dieu (et elle intervient par conséquent aussi dans la
preuve de l’existence de Dieu : « Aio Dei existentiam non posse demonstra-
ri, sine hoc principio nihil est sine ratione » (Textes inédits d’après les ma-
nuscrits de la bibliothèque provinciale de Hanovre, par Gaston Grua [GG],
p. 268)
© Philopsis – Pascal Dupond 35
www.philopsis.fr
Raison signifie « fondement » (Grund). Depuis son origine grecque, la
philosophie est recherche des causes premières et des principes premiers
(principe s’entendant au double sens de ce à partir de quoi il y a être et con-
naissance). Chez Leibniz, la recherche des causes et des principes, devient la
recherche de la raison suffisante ou de la raison déterminante. Cette re-
cherche est absolument universelle (nihil est sine ratione) et s’applique aux
choses nécessaires et immuables comme aux choses contingentes ; ce qui
donne la raison suffisante des choses nécessaires, c’est la nécessité inhérente
à leur essence ; ce qui donne la raison des choses contingentes, c’est leur
liaison et leur dépendance par rapport à quelque chose de nécessaire, c’est-à-
dire Dieu.
Sur le Principe de raison suffisante voir aussi « 24 Thèses métaphy-
siques » ainsi que le texte (sans titre) qui lui fait suite dans les RG : « le
principe fondamental du raisonnement est que rien n’est sans raison ou, s’il
faut l’expliquer de manière plus distincte, qu’il n’existe aucune vérité qui ne
soit soutenue par une raison ». Voir aussi PNG § 7, TH § 44
Dieu est « la première raison des choses » en tant qu’il est « la subs-
tance qui porte la raison de son existence avec elle… »
Le concept de substance vient de la philosophie grecque et en particu-
lier d’Aristote : l’ousia est la première des catégories de l’être ; elle se distri-
bue en deux significations : ousia protè et ousia deutera ; Ousia deutera =
essence ; ousia protè = « ce qui n’est ni affirmé d’un sujet ni ans un sujet »
(Cat 5).
Descartes en donne une définition différente que Leibniz critique (voir
« Réflexions sur la partie générale des principes de Descartes » (1691-
1692 ?), LP p. 287 et sv.
Leibniz revient à la définition aristotélicienne tout en considérant
qu’elle est seulement nominale (DM VIII : « Il est bien vrai que lorsque plu-
sieurs prédicats s’attribuent à un même sujet et que ce sujet ne s’attribue à
aucun autre, on l’appelle substance individuelle ; mais cela n’est pas assez et
une telle explication n’est que nominale. Il faut donc considérer ce que c’est
que d’être attribué véritablement à un certain sujet »). Ce faisant, on passe de
la définition nominale à la définition réelle. Dans toute proposition vraie,
praedicatum inest subjecto. ; or, comme Leibniz le dit à Arnauld, « il faut
toujours qu’il y ait quelque fondement de la connexion des termes d’une
proposition, qui se doit trouver dans leur notion » ; ce fondement, ce n’est
rien d’autre que la nature même de la substance ; comme le dit la suite du §
VIII du DM, « la nature d’une substance individuelle ou d’un être complet
est d’avoir une notion si accomplie qu’elle soit suffisante à en faire déduire
tous les prédicats du sujet à qui cette notion est attribuée » ; dans le langage
de l’efficience : « toute substance simple doit être la véritable cause immé-
diate de toutes ses actions et passions internes » (TH § 400)
Leibniz pense qu’un emploi univoque du concept de substance est
possible. On doit définir la substance comme « un être capable d’action »
(PNG § 1 ; De la réforme de la philosophie et de la notion de substance, LP
324). Parmi les êtres capables d’action, Dieu est « la substance simple primi-
tive » ; les substances créées sont « les substances dérivatives » ; la première
est pure action ; les secondes sont action et passion (la passion est l’inverse
de l’action, mais ontologiquement elle dérive, comme l’action de la lex se-
riae de la substance).
© Philopsis – Pascal Dupond 36
www.philopsis.fr
« La substance qui porte la raison de son existence avec elle », c’est la
substance qui est « par soi » ; il s’agit de l’aséité divine.
On distingue habituellement deux figures de l’aséité.
Selon la doctrine de l’aséité négative, Dieu n’a pas de cause et n’a pas
besoin de cause. C’est la position thomiste qui se fonde sur deux raisons : la
simplicité absolue de Dieu (qui rend impossible toute distinction et en parti-
culier la distinction de l’essence et de l’existence) et l’impossibilité (pour
quelque être que ce soit) de se produire lui-même ; Dieu ne peut donc être
cause de soi, il ne peut se produire lui-même
Selon la doctrine de l’aséité positive, Dieu est causa sui. On la ren-
contre chez Descartes.
Dans les Réponses aux quatrièmes objections, Descartes explique
pourquoi on peut dire : « Dieu fait en quelque façon la même chose à l’égard
de soi-même que la cause efficiente à l’égard de son effet » (éd. Alquié,
tome II, p. 677).
Arnauld contestant cette proposition, Descartes doit préciser comment
il l’entend.
1/ Il attire l’attention sur la formule « en quelque façon » (Dieu n’est
pas cause efficiente de soi-même ; la catégorie de cause efficiente ne lui
convient que par analogie, analogie qui est rendue nécessaire par
l’imperfection de l’esprit humain : nous ne pouvons pas nous représenter la
sui causalité divine autrement que par analogie avec une cause efficiente).
2/ Il souligne que le principe de la causalité efficiente est un principe
universel d’interrogation des choses [« il n’y a aucune chose dont on ne
puisse rechercher la cause efficiente »], mais que toutes les choses ne répon-
dent pas identiquement à cet universel principe d’interrogation : ou la chose
« répond » qu’elle a besoin d’une cause efficiente, ou elle répond qu’elle
n’en a pas besoin et, dans ce cas, elle doit dire pourquoi elle n’en a pas be-
soin.
3/ Quand on dit que Dieu est cause de soi-même, on ne veut pas dire
que Dieu a besoin d’une cause efficiente et que cette cause efficiente est lui-
même ; on veut dire que Dieu n’a pas besoin de cause efficiente, et que la
cause ou la raison pour laquelle il n’a pas besoin de cause efficiente est qu’il
a une « inépuisable puissance » et qu’en vertu de cette inépuisable puissance,
il est cause de soi ou par soi.
4/ La raison pour laquelle une chose n’a pas besoin de cause peut être
positive ou négative. Quand cette raison est négative, il est impossible
d’apporter une raison tirée de la nature de la chose pour laquelle elle n’aurait
pas besoin de cause efficiente.
Dans l’espace de la pensée cartésienne, il n’y a aucune place pour des
choses qui seraient soustraites à la causalité efficiente, donc qui seraient par
soi, mais sans raison positive, tirée de leur nature. En revanche, dans la phi-
losophie antique, il en existe : ce sont les atomes de l’épicurisme, ce sont
aussi, du côté d’Aristote, les formes, la forme de l’homme ou la forme du
chêne, qui sont au principe des générations naturelles (si l’homme engendre
l’homme, si le chêne engendre le chêne, c’est parce qu’une même forme,
inengendrée, se transmet de génération en génération). Pourquoi l’atome et
la forme sont-ils soustraits à l’interrogation causale, pourquoi sont-ils « par
soi » ? Tout simplement parce que leur rôle est d’être la cause ultime, la
cause en deçà de laquelle il est impossible de remonter, d’être la butée qui
© Philopsis – Pascal Dupond 37
www.philopsis.fr
met un terme au questionnement : il n’y a pas de sens à vouloir rendre raison
de ce qui rend raison (exactement comme, pour Aristote, il n’y a pas de sens
à chercher à démontrer le principe de contradiction, puisqu’il est au principe
de toute démonstration). Epicure dit que l’atome est éternel, Aristote dit que
la forme est inengendrée, le devenir ne « mord » pas sur eux ; ils sont « par
soi », mais cet être par soi n’est pas une expression de leur nature, c’est sim-
plement la traduction ontologique du rôle qui leur est dévolu de rendre rai-
son du devenir : ce qui rend raison du devenir ne peut être soumis au deve-
nir.
[La philosophie moderne est d’ailleurs soumise à la même con-
trainte de soustraire au devenir ce qui rend raison du devenir. Mais cela
conduit à un tout autre résultat : chez un Descartes, chez un Kant, ce qui est
soustrait au devenir et permet de penser le devenir, ce n’est pas un opérateur
qui serait immanent au devenir, plongé dans le devenir, comme l’atome,
c’est un opérateur qui est d’un tout autre genre d’être que ce qui existe dans
le devenir : les lois de la nature, l’entendement qui les pense, divin ou hu-
main : tout, dans la res extensa, est plongé dans le devenir sauf les lois de la
nature].
Conséquence : quand on attribue à Dieu une aséité négative, on risque
de confondre cette aséité avec celle des choses finies. D’où l’importance de
penser en Dieu une aséité positive.
De toute chose, nous demandons quelle est la cause efficiente pour-
quoi elle existe. Et si une chose n’a pas besoin de cause efficiente, c’est sa
nature même qui doit être la raison pour laquelle elle n’a pas besoin de cause
efficiente. Que doit être la nature d’un être donnant la raison pour laquelle il
n’ a pas besoin de cause efficiente ? Cette nature doit être « puissance iné-
puisable ». La nature comme puissance, c’est ce qu’Aristote appelle la cause
formelle. Donc Descartes va reprendre ce concept de cause formelle, qui lui
permet de bien marquer la frontière entre la sui causalité divine et la causali-
té efficiente à laquelle sont soumises les choses finies, mais en même temps
il va en modifier le fonctionnement : la cause formelle ou l’essence selon son
usage traditionnel, aristotélicien est cause par soi négativement ; mais là où
l’essence est une essence immense ou une puissance inépuisable , l’être qui
est par soi en vertu de cette essence est par soi positivement.
Le cheminement de Descartes est subtil. Pour penser l’être par soi de
Dieu, il joue la cause formelle contre la cause efficiente et la cause efficiente
contre la cause formelle : il commence par jouer la cause formelle contre la
cause efficiente « proprement dite » (et il dit : je conçois la sui causalité di-
vine comme une causalité formelle, c’est-à-dire « une raison prise de
l’essence »), mais comme la cause formelle est cause par soi négativement,
alors que Descartes cherche à penser une cause par soi positive, il joue dans
un second moment la cause efficiente contre la cause formelle et il dit : en
Dieu, la cause formelle, « pour cela même qu’en Dieu l’existence n’est point
distinguée de l’essence, a un très grand rapport avec la cause efficiente, et
partant peut être appelée quasi cause efficiente ». Il ne dit pas : la sui causali-
té divine est efficiente (car ce serait contradictoire avec ce qu’il vient de
montrer) mais il dit : la sui causalité divine est analogue à une cause effi-
ciente ; la sui causalité divine est une causalité efficiente à la limite ; elle est
à la causalité efficiente ce qu’est le concept de la plus grande ligne circulaire
© Philopsis – Pascal Dupond 38
www.philopsis.fr
au concept de la ligne droite ou le concept d’un polygone rectiligne ayant un
nombre indéfini de côtés au concept du cercle.
D’où la preuve de l’existence de Dieu : « la cause efficiente est le
premier et principal moyen … que nous ayons pour prouver l’existence de
Dieu » (681).
Leibniz reprend de Descartes l’idée d’une aséité positive, mais en
abandonnant ce qui pourrait ressembler à une quasi cause efficiente, il inflé-
chit l’aséité divine dans le sens d’une causalité logique.
Il pose en principe que tout possible enveloppe une exigence
d’existence proportionnelle à sa quantité d’essence ou à son degré de perfec-
tion (De originatione § 4)19 et existe s’il n’est pas empêché par la prétention
d’un autre possible incompatible. Dans les êtres qui ne sont pas Dieu,
l’essence enveloppe une existence virtuelle et cette existence virtuelle est
une existence actuelle pour tous les êtres appartenant au meilleur des mondes
possibles. Dieu est une essence absolument parfaite (DM § 1), cette essence
enveloppe une exigence infinie d’existence et par suite Dieu existe nécessai-
rement en raison de son essence ; être absolument parfait, être par soi, être
nécessaire sont inséparables – GG 212 : « Deus est Ens de cujus essentia est
existentia » ; GG 302 : « In Deo existentia non differt ab Essentia, vel, quod
idem est, Deo essentiale est existere. Unde Deus est Ens necessarium ».
Pour conclure ce point on pourrait dire que chez Leibniz la preuve a
posteriori (ou par les effets) et la preuve a priori (ou par l’essence) sont in-
séparables. Les choses du monde n’ont pas en elles-mêmes leur raison suffi-
sante ; donc en considérant les choses du monde, la pensée est nécessaire-
ment conduite vers une substance qui aurait en elle sa raison suffisante ;
cette substance est une nature absolument parfaite, enveloppant une exigence
infinie d’existence, donc existant d’une existence nécessaire et éternelle (et
nous retrouvons là l’esprit de la preuve ontologique)
Dieu a trois attributs : intelligence, volonté, puissance.
L’ordre dans lequel ils sont présentés est significatif.
La première présentation des attributs de Dieu se fait dans la continui-
té du mouvement qui est la remontée du contingent au nécessaire ; ce
monde est contingent = une infinité d’autres mondes sont également pos-
sibles, parmi lesquels Dieu devait déterminer celui qu’il allait créer ; or des
mondes possibles qui sont comparés entre eux en vue du choix du meilleur
ne peuvent exister que dans l’entendement de Dieu ; Dieu est donc entende-
ment (qui pense et compare les mondes possibles), volonté (qui choisit le
meilleur) ; puissance qui le crée. Quand Dieu est pensé du point de vue de
son rapport au monde contingent, les attributs sont présentés dans l’ordre
19
« … le principe d’Existence est l’Essence des choses. Il est certain que toute es-
sence ou réalité exige l’existence, de même que tout effort (conatus) exige le mouvement ou
lé réalisation, à moins, bien entendu, que quelque chose ne l’empêche. Et tout possible im-
plique non pas seulement la possibilité, mais également l’effort pour exister en acte, non pas
comme si les choses qui ne sont pas avaient un conatus, mais parce que c’est ce que deman-
dent les idées des essences qui existent en acte en Dieu, après que Dieu a décrété librement de
choisir ce qui est le plus parfait. Par conséquent, de même que dans la balance chaque poids
produit un effort obstiné sur son plateau en proportion de sa lourdeur et exige la descente,
d’une manière telle, cependant, que ce qui l’emporte est le plus lourd, de même toute chose
aspire à l’existence en proportion de sa perfection » (GG, 324)
« Mais les choses possibles n’ayant point d’existence n’ont point de puissance <pour
se faire exister>, et par conséquent, il faut chercher le choix et la cause de leur existence dans
un être dont l’existence est <déjà fixe et par conséquent> nécessaire elle-même » (GG, 286)
© Philopsis – Pascal Dupond 39
www.philopsis.fr
suivant : entendement, volonté, puissance. Quand Dieu est pensé intrinsè-
quement ou absolument, l’ordre de présentation des attributs est différent :
Dieu est puissance, sagesse et volonté, principe de son être et de tout être,
principe de l’être en tant qu’être vrai, principe de l’être en tant qu’être bon
(voir GG 13920.
Ces trois attributs correspondent sans doute dans l’esprit de Leibniz
aux trois personnes de la Trinité, puisqu’il en fait mention au § 150. Mais de
nombreux passages présentent les trois « primordialités » sans référence à la
Trinité. Par exemple, Monadologie, § 48. Ce paragraphe montre la corres-
pondance entre les attributs de la monade suprême et ceux de la monade
créée : Puissance/Connaissance/Volonté – sujet ou base/faculté percep-
tive/faculté appétitive).
En distinguant ces trois attributs de Dieu, Leibniz entend prendre dis-
tance par rapport à Descartes et Spinoza
Descartes a pensé que les attributs de Dieu ne sont différents que du
point de vue l’homme, c’est-à-dire d’une différence de raison raisonnante (à
Mesland, 2 mai 1644 : « … c’est par une seule action, toute simple et toute
pure qu’il entend, veut et fait tout » (AT, IV, 119, Alquié, III). Entendement,
volonté, action sont absolument un. D’où l’idée, présentée dans les 6e Ré-
ponses, que ce que Dieu a créé est bon non pas en raison de son essence,
mais en raison du choix de Dieu21 (6e réponses : « Parce qu’il s’est déterminé
à faire les choses qui sont au monde, pour cette raison, comme il est dit dans
la Genèse, elles sont très bonnes ; c’est-à-dire que la raison de leur bonté dé-
pend de ce qu’il les a ainsi voulu faire »). Voir aussi PP I, 23.
Spinoza a purement et simplement refusé d’attribuer à Dieu un enten-
dement et une volonté, en considérant qu’il s’agit d’attributs anthropo-
morphes (voir TH § 173).
20
Je serais plutôt pour ceux qui reconnaissant en Dieu comme en tout autre esprit trois
formalités : force, connaissance et volonté. Car toute action d’un esprit demande posse, scire,
velle. L’essence primitive de toute substance consiste dans la force ; c’est cette force en Dieu
qui fait que Dieu est nécessairement et que tout ce qui est en doit émaner. Ensuite vient la lu-
mière ou sagesse, qui comprend toutes les idées possibles et toutes les vérités éternelles. Le
dernier complément est l’amour ou la volonté, qui choisit parmi les possibles ce qui est le
meilleur, et c’est là l’origine des vérités contingentes ou du monde actuel. Ainsi la volonté
naît lorsque la force est déterminée par la lumière » (A Morell, septembre 1698)
Dieu : « Ens necessarium non nisi unicum est. Ens necessarium in se omnium rerum
requisita continere. Ens necessarium agere in se ipsum sive cogitare. Nihil enim aliud cogitare
quam se sentire. Ens necessarium agere per simplicissima… »
Unicité de Dieu et trois personnes : on ne trouve pas dans la nature « une substance
absolue qui en contienne plusieurs respectives. Cependant, pour rendre ces notions plus aisées
par quelque chose d’approchant, je ne trouve rien dans les créatures de plus propre à illustrer
ce sujet que la réflexion des esprits quand un même esprit est son propre objet immédiat, et
agit sur soi-même en pensant à soi-même et à ce qu’il fait, car le redoublement donne une
image ou ombre de deux substances respectives dans une même substance absolue […] Je
n’ose pourtant porter la comparaison assez loin et je n’entreprends point d’avancer que la dif-
férence qui est entre les trois personnes divines n’est plus grande que celle qui est entre ce qui
entend et ce qui est entendu, lorsqu’un esprit fini pense à soi, d’autant que ce qui est modal,
accidentel, imparfait et mutable en nous, est réel, essentiel, achevé et immuable en Dieu »
21
De même que ce qui est vrai serait vrai non pas en raison de son essence mais en
raison de la volonté divine. Pour Leibniz, les vérités éternelles « ont leur fondement dans
l’être éternel de Dieu même mais non pas dans ses libres décrets. Sinon on devrait dire en fin
de compte, si toutes les vérités naissent de la volonté libre de Dieu, que la vérité de
l’existence divine serait un effet [une œuvre] <eine Werckung> de la libre volonté divine, ce
qui est absurdissime » (GG p. 433)
© Philopsis – Pascal Dupond 40
www.philopsis.fr
Au jugement de Leibniz, ces deux options ne sont pas si différentes et
aboutissent un peu au même résultat. La position cartésienne aboutit 1/ soit
au spinozisme (et l’indistinction du bien et du mal) : « Un tel entendement
<celui que Descartes attribue à Dieu> n’est qu’une chimère, et par consé-
quent il faudra concevoir Dieu à la façon de Spinoza comme un être qui n’a
point d’entendement ni de volonté mais qui produit tout indifféremment, bon
et mauvais » (à Philippi, janvier 1680)22 ; 2/ soit, à tout le moins, à une idée
fausse de Dieu (Dieu, maître absolu qui choisit ce qu’il choisit arbitraire-
ment, sans qu’il y ait rien à comprendre des raisons pour lesquelles il choisit
ce qu’il choisit) ; les conséquences de cette idée fausse de Dieu sont présen-
tées aux §§ 175-177.
Leibniz, reprenant une thèse aristotélicienne classique (EN III, 5,
112b31) pense qu’il n’y a pas de volonté sans délibération et sans motifs de
vouloir ; un acte libre est un acte délibéré ; Dieu ne peut agir librement et
avec sagesse que si sa volonté est réglée par son entendement ; de ce point
de vue, on pourrait parler d’une priorité de l’entendement sur la volonté, au
sens d’une priorité de nature, non pas d’une priorité chronologique, ainsi que
le précise TH § 225). La distinction entre les facultés est de raison raisonnée.
Et la distinction de l’entendement et de la volonté a une importance particu-
lière, pour la question du mal (TH § 20,149, 380) (comme le dit TH § 380,
Dieu n’est pas l’auteur de son propre entendement, Dieu n’est pas cause des
essences, et c’est pourquoi il permet le mal sans en être la cause).
Mais cette distinction n’implique aucune séparation ; il est impossible
de dire que l’entendement de Dieu détermine sa volonté: c’est Dieu qui
pense, non son entendement, c’est lui qui veut et non sa volonté ; même si
les facultés sont des êtres réels, elles ne sont pas, précisent les NE (II, XXI,
6, p. 147) des « agents réels » (en appelant l’entendement de Dieu « sa-
gesse » = science du bien, Leibniz donne à entendre qu’elle n’est pas sépa-
rable d’une volonté qui veut le meilleur et d’une puissance qui le réalise).
« Et cette cause intelligente doit être infinie de toutes les manières et
absolument parfaite ».
Il y a dans nos âmes trois perfections : puissance, entendement, volon-
té. Ce sont aussi les perfections de Dieu : comme le dit la Préface (§ 4), « les
perfections de Dieu sont celles de nos âmes, mis il les possède sans bornes ;
il est un océan dont nous n’avons reçu que des gouttes » (Leibniz reprend le
principe scotiste de l’univocité de l’être : Tout est uniforme au degré près)
Ce qui caractérise une perfection, c’est qu’elle est capable du dernier
degré ; le nombre et la figure ne sont pas des perfection parce qu’ils ne sont
pas susceptibles du dernier degré. En revanche la science est une perfection
parce que l’omniscience n’implique pas contradiction ; de même la puis-
sance est une perfection parce que la toute puissance n’implique pas contra-
diction ; de même encore la liberté ou bien (§ 117) l’amour de la vertu ou la
haine du vice
22
Voir aussi lettre à Malebranche, juin 1679 : « Le Dieu ou l’être tout parfait de Des-
cartes n’est pas un Dieu comme on se l’imagine ou comme on le souhaite, c’est-à-dire juste et
sage et faisant tout pour le bien des créatures autant qu’il est possible, mais plutôt c’est
quelque chose d’approchant du Dieu de Spinoza, savoir le principe des choses et une certaine
souveraine puissance appelée Nature primitive, qui met tout en action, fait tout ce qui est fai-
sable, qui n’a point de volonté ni d’entendement, puisque, selon Descartes, il n’a pas le bien
pour objet de la volonté, ni le vrai pour objet de l’entendement ».
© Philopsis – Pascal Dupond 41
www.philopsis.fr
Dieu est le dernier ou le souverain degré de toutes les perfections, qui
sont en lui infinies.
Ce souverain degré ne doit pas être compris comme le terme d’un
progrès quantitatif, comme si c’était en ajoutant des connaissances aux con-
naissances, de la puissance à la puissance, qu’on pouvait atteindre
l’omniscience ou la toute puissance. Le souverain degré n’est pas quantita-
tif : c’est une essence (telle que la connaissance ou la puissance) considérée
dans sa positivité, abstraction faite de toute limitation ; et s’il y a des diffé-
rences de degré au dessous de ce souverain degré, elles doivent être com-
prises comme des différences de participation à cette essence simple et abso-
lue. Voir NE II, 17 : « Le vrai infini n’est que dans l’absolu qui est antérieur
à toute composition et n’est point formé par l’addition des parties ». C’est
l’idée de l’absolu qui nous donne le vrai concept de l’infini.
Ces perfections sont compatibles entre elles23 : voir lettre à Elisabeth
de 1678 (LP p. 127, GF 1, p. 149) et Monadologie § 45, et elles se détermi-
nent l’une l’autre (TH 117)
§ 8. « Or cette suprême sagesse […] n’a pu manquer de choisir le
meilleur… ». Le monde est non seulement bon, mais le meilleur
Voir TH §§ 193-20324 ; DM § III.
La doctrine du choix du meilleur a de nombreux antécédents, depuis
Platon (Timée, 30a : « il n’est pas permis au meilleur de faire autre chose
que le plus beau »), les Stoïciens (Cicéron, De natura deorum II, 7) et Plotin
(Ennéades, III, II, 13).
La position inverse se trouve chez Duns Scot (« Deus potest meliora
facere intensive et extensive, accidentaliter et substantialiter »), chez Ar-
nauld (selon TH § 203) chez Malebranche (Recherche de la vérité, dernier
éclaircissement, § 40 : « s’il n’avait en vue que l’excellence de ses ouvrages,
auquel se déterminerait-il pour s’honorer parfaitement, lui qui en peut faire
de plus parfaits les uns que les autres »), chez Bayle, chez Fontenelle25.
Dans DM III, trois arguments sont mentionnés en faveur de l’idée se-
lon laquelle Dieu aurait pu mieux faire : il y a beaucoup de désordres dans le
monde (le monde n’est pas bon, et on peut facilement, comme Alphonse X,
en concevoir un meilleur…) ; la loi de perfection n’a pas de limite, il peut
23
Unité et multiplicité : Voir NE IV, III, p. 333. Dans les monades, la faculté, c’est la
puissance primitive considérée dans son rapport à la diversité des objets auxquels elle peut
s’appliquer, c’est l’être substantiel envisagé sous l’angle de la relation. De même en Dieu : les
attributs divins ne sont que des aspects de l’acte pur.
24
TH 227 : « …l’on ne donne point de borne à la puissance de Dieu, puisqu’on re-
connaît qu’elle s’étend ad maximum, ad omnia, à tout ce qui n’implique aucune contradic-
tion ; et l’on n’en donne point à sa bonté, puisqu’elle va au meilleur, ad optimum ».
25
« Pour concevoir ce que Dieu peut produire hors de lui, il faut se le représenter
comme voyant des degrés infinis de perfection au dessous de la sienne. En quelque degré
qu’il s’arrête, il en trouve d’infini en remontant vers lui, et en descendant au dessous de lui.
Ainsi il ne peut fixer son ouvrage à aucun degré qui n’ait une infériorité infinie à son égard.
Tous ces divers degrés sont plus ou moins élevés les uns à l’égard des autres ; mais tous sont
infiniment inférieurs à l’être suprême. Ainsi ont se trompe manifestement quand on veut
s’imaginer que l’être infiniment parfait se doit à lui-même, pour la conservation de sa perfec-
tion et de son ordre, de donner à son ouvrage le plus grand ordre et la plus haute perfection
qu’il peut lui donner. Il est certain tout au contraire que Dieu ne peut jamais fixer aucun ou-
vrage à un certain degré de perfection sans l’avoir pu mettre à un autre degré supérieur
d’ordre et de perfection, en remontant toujours vers l’infini, qui est lui-même… » (Fénelon,
Lettres sur la religion)
© Philopsis – Pascal Dupond 42
www.philopsis.fr
toujours y avoir du plus parfait ; si Dieu est obligé de faire le meilleur, il
n’est pas libre. Dans ce passage de la TH, Leibniz ne mentionne aucun des
arguments avancés en faveur de la thèse qu’il combat.
Il en explicite seulement la conséquence : certains on pensé honorer
Dieu en soutenant qu’il aurait pu faire une infinité de mondes meilleurs que
le nôtre, mais c’est exactement l’inverse, ils ruinent l’idée de Dieu : faire
moins bien qu’on ne peut, c’est manquer soit à la sagesse (en ne discernant
pas ce qui est le meilleur), soit à la bonté (en discernant le meilleur mais en
s’abstenant de la choisir) ; le résultat est le même : si Dieu ne choisit pas le
meilleur, il attente à sa propre perfection, il s’anéantit pour ainsi dire lui-
même (La cause de Dieu [CD] § 67 : « il n’y aurait plus de Dieu, il n’y au-
rait plus rien… »)
Puis il présente la réponse, qui comporte trois moments : a/ le principe
de raison (§ 8) ; b/ l’unité ou l’individualité numérique du monde (§ 9)26 ; c/
le meilleur devant être nécessairement supposé, sinon prouvé (ce qui, pour
des êtres finis est impossible), la philosophie doit faire comprendre pourquoi
notre expérience est en désaccord avec une conviction fondée dans la foi et
comment ce désaccord peut se résoudre.
La première réponse invoque donc le principe de raison.
Le principe de raison exige que, Dieu ayant décrété de créer un monde
pour manifester sa gloire, il y ait une raison de choisir l’un plutôt que
n’importe quel autre, et une raison qui est puisée dans la nature même de ce-
lui qui est choisi : cette raison ne peut être que la considération du meilleur.
Mais pour que le principe de raison s’applique, encore faut-il qu’il y
ait un et un seul meilleur. Supposons que x mondes soient tous à égalité de
rang les meilleurs ; le choix de l’un plutôt que l’autre ne peut être
qu’arbitraire.
Le détour par les mathématiques est destiné à résoudre la difficulté.
Leibniz compare le discernement du meilleur monde à la résolution d’un
problème comportant une solution déterminée.
Leibniz distingue les problèmes qui ont une solution déterminée et
ceux qui n’en ont pas.
Le problème dont l’énoncé serait : « créer une sphère matérielle » (TH
196) n’est pas déterminé, une infinité de solutions sont possibles sans qu’il
y ait aucune raison de choisir l’une plutôt que l’autre.
Parmi les problèmes qui ont une solution déterminée, il y a deux cas
de figure.
Il y a ceux dont la solution déterminée est donnée par le principe de la
détermination maximale. Ainsi le problème « tirer d’un point donné une
ligne droite jusqu’à une autre ligne droite donnée » est un problème dont la
solution (= la ligne perpendiculaire) est donnée par la détermination maxi-
male : 1/ la perpendiculaire est unique (alors que les sécantes non perpendi-
culaires sont infinies) ; 2/ elle résout le problème en se conformant à un
principe d’économie : la perpendiculaire est la plus courte de toutes les
droites sécantes ; 3/ elle se conforme à un principe d’harmonie, les deux
angles sont déterminés par leur égalité. De cet ordre serait également le pro-
blème de la création d’un triangle : c’est l’équilatéral qui se produit, car c’est
le seul qui donne une réponse déterminée aux conditions (tous les triangles
26
Sur le monde comme totalité et les difficultés qui en résultent, voir NE II, 13, p.
126 : « L’univers ne saurait passer pour un tout ».
© Philopsis – Pascal Dupond 43
www.philopsis.fr
équilatéraux sont semblables, mais non pas tous les triangles isocèles ou a
fortiori tous les triangles quelconques ; d’autres exemples sont donnés dans
Sur les secrets admirables de la nature, GF 1 p. 290, addition.
Il y a ceux dont la solution déterminée est donnée par le principe du
maximum et du minimum. Soit S la surface d’un triangle dont le périmètre
(a+b+c) est une grandeur invariante ; calculer les longueurs respectives de a,
b, c pour que la surface S soit maximale. Ou bien déterminer quelle forme
prendra une goutte d’huile plongée dans l’eau pour parvenir à l’équilibre
avec les forces de tension superficielles, c’est-à-dire pour avoir une surface
minimale pour son volume invariant. Ou bien remplir avec des jetons, en
suivant une règle invariable, le plus grand nombre de cases vides (De rerum
originatione radicali, § 3, LP, p. 339- on trouve en ligne une traduction de
ce texte).
La création du monde est un problème déterminé de cet ordre. Dieu
calcule la composition de compossibles dans laquelle le maximum d’effet est
obtenu avec le minimum de dépense, et c’est ce que Leibniz appelle opti-
mum. Si cet optimum n’était pas déterminable par le calcul, il n’y aurait pas
de raison de créer ce monde plutôt que n’importe quel autre, il n’y aurait pas
de monde.
§ 9. Leibniz souligne que l’ « adversaire » qui objecte le péché et les
souffrances à la bonté du monde en vérité ne pense pas au monde, il ne con-
sidère pas le monde dans sa complétude, il le considère distributivement,
dans ses parties, il considère une partie du monde et l’imperfection qui s’y
trouve et de cette imperfection de la partie il conclut à l’imperfection de
l’ensemble.
Or cette conclusion n’est pas acceptable : de l’imperfection de la par-
tie à l’imperfection du tout, la conséquence n’est pas bonne.
Leibniz donne deux arguments.
Dans le § 9, il souligne la solidarité des êtres dont l’univers est
l’assemblage et l’unité. Changer un être serait changer le monde entier ;
donner à un être particulier une plus grande perfection (ce qui est possible),
ce serait modifier l’ensemble : « rien ne peut être changé dans l’univers (non
plus que dans un nombre) sauf son essence ». Soit un nombre, par exemple
1000 ; si l’on ajoute ou supprime une seule unité, le nombre n’est pas un peu
modifié (au sens où l’on pourrait dire que si l’on soustrait un euro à une
somme de 1000 euros, le pouvoir d’achat de cette somme n’en est que peu
altéré…), il l’est entièrement, essentiellement, ce n’est tout simplement pas
le même nombre. Identiquement, modifions un seul événement du monde,
comme tout s’y tient, c’est un tout autre monde qui est donné. Une modifica-
tion du monde ne peut être que la substitution d’un monde à un autre. Or si
Dieu choisit par sa volonté antécédente le plus grand bien de chaque créa-
ture, il choisit par sa volonté conséquente un monde, le meilleur monde.
Chaque créature possible est un postulant à l’existence à proportion de sa
quantité de réalité, d’essence ou de perfection, sa perfection lui donne un
droit à exister. Mais toutes les essences ne sont pas possibles ensemble, elles
ne sont pas compossibles, elles se contredisent les unes les autres, il y a donc
comme un combat idéal entre les essences, et c’est l’ensemble des compos-
sibles où se réalise le plus de réalité ou de perfection qui l’emporte
Dans le § 195, Leibniz montre qu’on ne peut pas parler du monde
dans les mêmes termes que des êtres particuliers. Il est vrai qu’il n’y a pas de
© Philopsis – Pascal Dupond 44
www.philopsis.fr
créature ou de substance particulière parfaite. Mais ce qui est vrai d’un être
particulier n’est pas vrai de l’univers, ce qui est vrai du fini n’est pas vrai
de l’infini.
On remarquera enfin que le monde est présenté comme une totalité,
Or
1/ le monde est infini ;
2/ étant infini, il n’est pas dénombrable au sens où la multiplicité qu’il
comprend ne peut être exprimée par aucun nombre ; il n’y a pas de nombre
infini au sens d’un nombre qui serait un tout ; un nombre n’est infini qu’en
puissance, au sens où il peut toujours être indéfiniment augmenté ; comme le
disent les NE, il n’y a pas d’infini catégorématique (au sens d’une multitude
composée d’une infinité nombrable de parties) ; il n’y a d’infini que synca-
tégorématique, au sens d’une multiplicité indénombrable (infini en puis-
sance) ;
3/ si le monde n’est pas une multiplicité dénombrable, il ne peut être
en rigueur de termes une totalité ; comme le dit NE, II, XIII : « l’univers
même ne saurait passer pour un tout comme j’ai montré ailleurs »).
§ 10. Nous devons juger que ce monde est le meilleur, non pas au sens
où nous pourrions le comparer aux autres possibles et juger a priori qu’il est
le meilleur (car nous ne pouvons pas nous représenter des infinis et les com-
parer ensemble), mais au sens où, la raison d’une existence se trouvant tou-
jours dans la quantité d’essence ou de perfection qui y est réalisée,
l’existence de notre monde est la preuve a posteriori qu’il est le meilleur. Ce
paragraphe doit être rapproché du § 35 du « Discours de la conformité… »
(La « permission » du mal était indispensable : nous ne pouvons pas l’établir
a priori (cad le démontrer) car cela excède les forces de l’entendement hu-
main, mais nous le jugeons par l’événement ou a posteriori, et ce « juger »
signifie ici « croire », au sens de la foi ; notre foi que la permission du mal
était indispensable résulte de deux prémisses, dont l’une est un fait : le mal
existe, et l’autre déjà une foi : rien n’arrive qui soit contraire à la bonté, à la
justice, à la sainteté de Dieu ; de ces deux prémisses résulte notre croyance
que la permission du mal est conforme à la bonté, à la justice, à la sainteté et
que, dans cette mesure, elle est indispensable). D’une manière générale, en
matière de vérité contingente, les preuves a posteriori se substituent aux
preuves a priori, qui nos sont inaccessibles.
§ 11. Le cardinal Sfondrate soutient que l’état des enfants morts sans
baptême est préférable au « règne des cieux », au sens où l’absence de péché
(de mal) serait préférable à la rédemption des péchés (à la compensation du
mal par un bien). La raison de ce jugement serait que le mal ne peut être
autorisé comme moyen d’un bien. Cet avis, ajoute Leibniz a été justement
critiqué. Ce qui est condamnable dans l’agir humain ne l’est pas dans l’agir
divin. Comment le comprendre ? Où est la différence ?
Le réponse constante de Leibniz est la suivante : les juristes distin-
guent la question quid facti et la question quid juris ; en matière de Théodi-
cée la question à résoudre, ce n’est pas la question quid juris ?, c’est la ques-
tion quid facti ? la justice de Dieu n’a pas d’autres règles que la justice des
hommes ; mais si les règles sont les mêmes, les cas auxquels les règles doi-
vent s’appliquer ne sont pas le même ; comme le dit « Discours », § 37, « le
cas dont il s’agit est tout différent de ceux qui sont ordinaires parmi les
hommes ».
© Philopsis – Pascal Dupond 45
www.philopsis.fr
En matière de Théodicée, la « solution » qu’il faut absolument écarter,
c’est, pour Leibniz, celle qui consiste à dire que, le cours du monde ne se
conformant pas à notre concept de la justice il faut en conclure que la justice
selon Dieu n’a aucun rapport avec la justice selon les hommes, que « ce que
nous appelons justice n’est rien par rapport à Dieu » ou que « la justice est
quelque chose d’arbitraire à son égard ». S’il n’y a, dans la justice de Dieu,
rien qui soit commensurable à notre concept de la justice, nous n’avons plus
aucun moyen de distinguer en Dieu bonté et méchanceté, entre le vrai dieu et
un faux Dieu. La foi n’est pas la raison mais la foi n’est pas sans raison : il
doit y avoir une raison qui porte la foi vers le Dieu des juifs et des chrétiens
plutôt que vers Zoroastre ou le dieu des manichéens.
Si donc la différence se trouve dans le fait et non dans le droit, en quoi
consiste-t-elle ?,
L’entendement de Dieu va à toute la suite des choses qui sont pour lui
comme simultanées ; le mal que Dieu permet n’est donc pas un moyen, il fait
simplement partie de la dépense nécessaire à la création du meilleur. En re-
vanche, l’action humaine se distribue en différents moments, les moyens et
les fins sont distincts, et c’est alors très légitimement que l’ont peut dire : la
fin ne justifie pas les moyens
§ 12. « On s’est servi de tout temps… » Commence ici une série de ré-
flexions apparentées à ce que Aristote appelle « endoxa » . Ces réflexions se
poursuivent jusqu’au § 20 où on entre dans des réflexions plus spéculatives.
Une première série d’endoxa justifie les maux par la nature de la sen-
sibilité : la satisfaction des sens ou la satisfaction esthétique exige des con-
trastes entre valeurs opposées (cette position n’est d’ailleurs pas universel-
lement reçue : ce qui caractérise chez Platon le plaisir intellectuel, c’est qu’il
n’est jamais mêlé de souffrance). Leibniz se réfère au domaine de la peinture
(ombres et couleurs) et au domaine de la musique (dissonance et harmonie) ;
voir De rerum originatione § 13, édition LP p. 343 et Vrin (Opuscules philo-
sophiques choisis), p. 90 : « les plus grands compositeurs entremêlent très
souvent les accords de dissonances, pour exciter et pour inquiéter l’auditeur
qui, anxieux du dénouement, éprouve d’autant plus de joie lorsque tout
rentre dans l’ordre » ; voir aussi NE II, XXI, § 36 : « …je trouve que
l’inquiétude est essentielle à la félicité des créatures… », et Conversation
avec Sténon, GF 1 p. 124
Leibniz définit l’harmonie comme « la diversité compensée par
l’unité » : « Or l’harmonie est précisément cela : une certaine simplicité dans
la multitude, en quoi consistent aussi la beauté et le plaisir » (RG p. 30)
§ 13. Une autre série d’endoxa souligne une sorte de distorsion de
notre perception des biens et des maux. Nous pensons que les biens ne com-
pensent pas les maux. Mais ce jugement est erroné et ne vient que de notre
sur-attention aux maux et de notre sous-attention aux biens : comme nous
sommes ordinairement dans une condition heureuse, nous prêtons attention à
sa rupture mais non pas à sa continuation ; l’habitude du bien être endort la
sensibilité au bien. Il en va de même avec la santé et la maladie. Si nous
étions malades dans le cours ordinaire de la vie, l’état temporaire de santé
passerait pour un grand bien ; mais comme nous sommes ordinairement en
bonne santé, le bien de la santé passe inaperçu et il faut le contraste d’une
maladie pour que nous en retrouvions la conscience. Or la seconde situation
© Philopsis – Pascal Dupond 46
www.philopsis.fr
est préférable à la première, même si la jouissance de la santé, en un sens,
s’y fait moins sentir.
La réflexion (qui suppose l’exercice de la raison et l’émergence d’un
moi) doit donc suppléer à la sensibilité. Sur la réflexion, voir Monad § 30 :
« c’est aussi par la connaissance des vérités nécessaires et par leurs abstrac-
tions que nous sommes élevés aux actes réflexifs, qui nous font penser à ce
qui s’appelle moi et à considérer que ceci et cela est en nous… »
§ 14. Le « mécanisme des animaux » : Leibniz ne pense pas que les
animaux et en particulier l’homme soient des machines, au même sens que
les machines artificielles construites par les hommes : comme le dit le § 64
de la Monadologie, les machines construites par Dieu sont encore machines
dans leurs moindres parties, à l’infini.
« si capables de se maintenir … » : le vivant est pourvu d’une force
formatrice capable de réparer l’organisme.
Complexité et fragilité vont ensemble. Vouloir supprimer de l’ordre
universel un être aussi fragile que l’homme, ce serait supprimer toutes les
aptitudes dont cette fragilité est le prix.
Le principe de continuité exige qu’il n’y ait pas de vacuum forma-
rum27 : il y a dans l’être tous les degrés de perfection concevables, sans au-
cune solution de continuité.
§ 15. Au sujet de « la fausseté des vertus humaines », on pensera à La
Rochefoucauld : « L'amour-propre est l'amour de soi-même, et de toutes
choses pour soi ; il rend les hommes idolâtres d'eux-mêmes, et les rendrait
les tyrans des autres si la fortune leur en donnait les moyens ; il ne se repose
jamais hors de soi, et ne s'arrête dans les sujets étrangers que comme les
abeilles sur les fleurs, pour en tirer ce qui lui est propre. Rien n'est si impé-
tueux que ses désirs, rien de si caché que ses desseins, rien de si habile que
ses conduites ; ses souplesses ne se peuvent représenter, ses transformations
passent celles des métamorphoses, et ses raffinements ceux de la chimie. On
ne peut sonder la profondeur, ni percer les ténèbres de ses abîmes » (pre-
mière des Maximes).
§ 18. Leibniz évoque ici une construction cosmologico-théologique
(une « théologie astronomique ») qui pourrait avoir été proposée par un ad-
mirateur de la philosophie de Leibniz, qu’il dit ne pas approuver mais qui lui
paraît assez « plaisante » pour qu’il en fasse une présentation détail-
lée…Cette construction est inspirée par la cabbale (la cabbale est une tradi-
tion ésotérique juive ; l’un de ses monuments est le Zohar, le Livre de la
splendeur, écrit par Moïse de Léon (1286). On y voit apparaître non seule-
ment la figure traditionnelle de Lucifer (l’archange Heylel, Isaïe, 14, 12, qui
s’est révolté contre Dieu et a été déchu par Dieu), mais aussi celle de l’Adam
Cadmon, Messie éternel, « premier né de toute créature » qui est venu en ce
globe sous la figure historique de Jésus Christ. Qu’est-ce qui intéresse Leib-
niz dans cette construction gnostique ? Il n’est pas sûr que le « Prince de ce
monde » soit une grandeur qu’une théodicée philosophique puisse intégrer et
Leibniz traite de la question du mal sans référence à Lucifer… Ce qu’il re-
tient de cette construction, c’est peut-être l’idée que toutes les créatures sont
destinées à être sauvées, c’est sans doute d’abord l’idée d’une harmonie
entre le règne de la nature (la cosmologie) et le règne de la grâce (la révéla-
tion et la destination des âmes après cette vie (c’est ainsi que la fumée des
27
Voir https://www.uni-muenster.de/Leibniz/meieroeser/Vacuum_formarum.pdf
© Philopsis – Pascal Dupond 47
www.philopsis.fr
feux de l’apocalypse devient la queue d’une comète…). Mais Leibniz re-
marque en fin de compte que la raison ne trouve pas son compte dans une
gnose de ce genre et que les connaissances astronomiques auraient plutôt
tendance à la contredire : « il ne paraît pas qu’il y ait un endroit principal
dans l’univers connu qui mérite préférablement aux autres d’être le siège de
l’aîné des créatures »
§ 19. Ce renversement du cosmos fini des anciens et de
l’anthropomorphisme qui l’accompagnait donne une nouvelle raison de ne
pas juger de l’univers par ce que nous, hommes, en percevons. Pour les An-
ciens, l’univers se résumait quasiment à notre terre (qui passait pour en être
le centre). Or ce que nous savons aujourd’hui, précise Leibniz, c’est qu’il y a
une incommensurabilité entre ce que nous percevons de l’univers (une gran-
deur finie) et ce qu’est l’univers (infini) ; « notre terre est peu de choses par
rapport aux choses visibles… » ; nous nous focalisons sur nos maux, nous en
faisons une objection à la bonté de la création, mais ces maux sont ceux d’un
presque néant, et « il se peut que tous les maux ne soient aussi qu’un presque
rien en comparaison des biens qui sont dans l’univers ».
La question serait de savoir si le mal qui est fait à une personne, qui
lèse la personne comme telle, peut entrer dans un calcul de maximis et mini-
mis et valoir comme un presque rien au regard de la somme des biens dans
l’univers (c’est la question qui est posée, mutatis mutandis, par J. Rawls à
l’utilitarisme : à supposer que le fonctionnement social ait pour finalité de
procurer le plus de bonheur possible au plus grand nombre des sociétaires,
est-il permis de traiter injustement un petit nombre en vue du plus grand
bonheur du plus grand nombre ?)
Infinité de l’univers signifie : 1/ il n’y a pas de borne temporelle de
l’univers (TH 195 : « …se devant étendre par toute l’éternité future ») ; 2/ il
comprend « une infinité de choses », plus qu’on n’en pourra jamais nombrer
(Leibniz parle de « nombre innombrable » : c’est quasiment une contradic-
tion dans les termes, mais une contradiction qui a une signification philoso-
phique ; quand nous pensons une multiplicité, notre esprit est porté à lui at-
tribuer un nombre, car c’est de cette façon que notre esprit peut la penser et
la dominer ; mais si la multitude est infinie, on ne peut lui faire correspondre
aucun nombre, puisque un nombre infini est une contradiction ; on doit donc
pour exprimer l’infini nier dans le prédicat ce qui est dit dans le sujet) ; voir
aussi lettre à Arnauld (9 octobre 1687) : « je tiens que le nombre des âmes ,
ou au moins des formes, est infini, et que, la matière étant divisible sans fin,
on n’y peut assigner aucune partie si petite où il n’y ait dedans des corps
animés… »
Quant à l’idée d’une incommensurabilité entre l’univers et ce que
nous pouvons en percevoir, elle vient des mathématiques. L’idée
d’incommensurabilité est née avec la découverte grecque des grandeurs irra-
tionnelles. Elle se développe avec le calcul différentiel.
Leibniz est l’inventeur du calcul différentiel, qui porte sur les diffé-
rences infiniment petites (dX) entre deux valeurs d’une variable X. X et dX
sont homogènes : la variable et sa différence sont de même espèce, de même
genre ou nature. Ce qui justifie qu’on leur applique les mêmes opérations ;
mais X et dX sont incomparables au sens où elles ne sont pas du même ordre
de grandeur [reprenant Euclide, Leibniz précise que « seules sont compa-
rables des grandeurs homogènes dont le produit de l’une par un nombre fini
© Philopsis – Pascal Dupond 48
www.philopsis.fr
peut surpasser l’autre], ce qui fait que X + dX est la même chose que X [« on
demande qu’on puisse prendre indifféremment l’une pour l’autre deux quan-
tités qui ne diffèrent entre elles que d’une quantité infiniment petite ou (ce
qui est la même chose) qu’une quantité qui n’est augmentée ou diminuée que
d’une autre, infiniment moindre qu’elle, puisse être considérée comme de-
meurant la même »].
§ 20. Inflexion de la question du mal. Les analyses précédentes ont
pris le tour d’arguments ad hominem (ou, pour reprendre une formule de
Kant, kath’anthrôpon) : la question du mal a été en quelque sorte dissoute
par des analyses montrant qu’elle ne doit sa substance qu’à une sorte
d’illusion de la finitude ; la solution a donc été cherchée a parte subjecti,
l’homme est invité à faire disparaître la question du mal en changeant sa
compréhension des choses. Mais cette perspective ne peut pas être défini-
tive : prise à la lettre, elle aboutirait à faire disparaître la différence entre le
bien et le mal (comme le 18e siècle accuse Spinoza de l’avoir fait). Or cette
différence est pour Leibniz essentielle en ce qu’elle est la condition de toute
discrimination juridique et morale entre le permis et le défendu, entre la
louange et le blâme. Donc après le mouvement de dissolution du mal se des-
sine un mouvement inverse de rétablissement de la réalité du mal, mais sous
certaines conditions qu’il faut à présent préciser.
Les textes à rapprocher de ce paragraphe sont : TH 30,153, 377 et sv,
Monadologie, § 47 (les monades sont des « fulgurations » « bornées par la
réceptivité de la créature à laquelle il est essentiel d’être limitée », avec réfé-
rence à TH 383-391, 395, 398), PNG, § 9, Dialogue sur la liberté.
« On demande d’abord d’où vient le mal… »
L’interrogation sur l’origine du mal est mythique avant d’être philo-
sophique. Elle est la trame de tous les “drames de création” où est mis en
scène l’affrontement d’un principe du bien et d’un principe du mal, elle est
aussi la trame de la grande tragédie grecque et de sa théologie de
l’aveuglement (le divin comme puissance de salut et de perdition). La philo-
sophie est une réponse, une réplique à la théologie tragique de
l’aveuglement, et c’est sans doute avec Platon que la philosophie devient
théodicée [Rép X 617 e : theos anantios (le dieu n’est pas responsable). Et
depuis Platon aussi, la question du mal reste une question-limite : elle est à la
frontière de la philosophie et de l’esprit de la religion (à la frontière de la
dialectique et du mythe, à la frontière du savoir et de l’opinion droite ou de
la foi). La raison de cette situation est que la question du mal ébranle la phi-
losophie au cœur même de ce qui en est le projet fondamental ou la possibi-
lité : le “rendre raison”, logon didonai ; si ce qui rend raison, par excellence,
c’est le bien, comment rendre raison de ce qui échappe par principe à la prise
du rendre raison ? La solution ne peut consister qu’à réintégrer le mal à
l’économie du bien, à montrer que le mal est exigé par le bien.
« Les anciens attribuaient la cause du mal à la matière… ».
Platon. Le Timée présente une cosmogonie qui montre que les choses
relèvent d’une double causalité : la causalité (lumineuse) des formes noé-
tiques et la causalité (ténébreuse) de la place (chôra), la causalité de
l’Intelligence et la causalité de la Nécessité. Le monde est ordonné ; cet
ordre appelle un principe d'ordre ; ce principe d'ordre est double : c'est l'idée
et sa causalité exemplaire (ou formelle) et c'est le démiurge et sa causalité
ouvrière. Entre la causalité ouvrière et la causalité exemplaire intervient ce
© Philopsis – Pascal Dupond 49
www.philopsis.fr
que Platon appelle le regard du démiurge. Entre la causalité ouvrière et le
sensible qualifié et ordonné en monde intervient un genre d'être que Platon
appelle chôra ou « place », qui est une « nourrice » ou une « matrice » du ré-
el. Que peut-on savoir de la chôra ? Comme elle reçoit l’imitation des
formes, de toutes les formes, elle ne doit avoir elle-même aucune forme. Si
en effet, elle avait une forme propre, elle recevrait mal l'empreinte des
genres opposés à cette forme propre ; elle doit donc être amorphe, comme
une cire molle et lisse, elle est sans qualification, sans détermination, inqua-
lifiable, indéterminable ; elle ne se donne à penser que via negationis : « la
mère et le réceptacle n'est, devons-nous dire, ni terre, ni air, ni feu, ni eau, ni
rien qui soit fait de ces corps, ni de quoi ces corps eux-mêmes soient
faits… ». C'est une sorte d'être « invisible et amorphe », « qui reçoit tout »,
sans donner aucune qualification au corps qu'il reçoit, « qui participe d'une
façon très embarrassante de l'intelligible », qui est capable de recevoir les
imitations des êtres éternels mais, ajoute Platon, « d'une manière dure à ex-
primer et merveilleuse ». Ce second principe des êtres se laisse persuader
par l’intelligence, mais dans une certaine mesure seulement (48a) et c’est
pourquoi il subsiste un irréductible écart entre le Monde visible et le Bien.
Aristote. Le concept de matière intervient dans l’analyse du change-
ment : « tout ce qui arrive à l’existence naît d’un contraire et d’un sujet subs-
trat et la même chose se passe dans la corruption : il faut un sujet-substrat et
il y a, sous l’action d’un contraire, passage à son contraire » (Physique, I, 6,
189 a 30). La matière est l’invariant sous-jacent au passage d’un contraire à
un autre.
Quels sont les caractères de la matière ?
Soit une statue. Nous pouvons la concevoir comme un composé (su-
nolon) de matière (le marbre) et de forme (la forme qui la qualifie comme
statue d’Aphrodite). Supprimons par la pensée la forme que l’artiste a sculp-
tée ; la statue perd ce qui la détermine comme une statue d’Aphrodite ou
d’Apollon, c’est-à-dire comme un tode ti; il reste quelque chose qui était le
réceptacle des déterminations et qui, à présent, en est privé par la pensée : la
matière. La matière résultant d’un acte de l’esprit qui fait abstraction des dé-
terminations, il est clair que son caractère fondamental est l’indétermination,
au moins du point de vue des caractères dont on fait abstraction. Cette abs-
traction est une opération de la pensée mais ce n’est pas une fiction. La sta-
tue peut être cassée de telle sorte qu’il n’y aura plus rien à reconnaître en elle
que du marbre.
Cette opération, peut intervenir aussi au sujet des naturalia, animaux,
plantes, corps simples. Nous pouvons aussi les considérer comme composés
d’un substrat indéterminé et de déterminations, puis enlever les détermina-
tions par la pensée. Celles-ci constituent toutes ensemble la forme, le résidu
résistant à l’abstraction est la matière. On peut ainsi la définir comme ce qui,
par soi, n’est ni qualité, ni quantité, ni aucune des autres déterminations de
l’être.
Et comme la procédure par laquelle Aristote construit l’idée de ma-
tière est une analyse intellectuelle du réel, elle peut s’étendre au delà des
frontières des êtres naturels ou des êtres artificiels que la poièsis édifie à par-
tir des êtres naturels. L’étendue peut ainsi être comprise comme la matière
où se tracent et s’individualisent les figures, et dans la définition, le genre
peut être compris comme matière et les différences comme formes. On par-
© Philopsis – Pascal Dupond 50
www.philopsis.fr
lera des lettres comme d’une matière pour les syllabes ou des parties du rai-
sonnement comme d’une matière dont la forme serait l’articulation. Voir
Physique, II, 3, 195 a 1
Conséquences :
1/ Quand on descend « physiquement » dans l’échelle de la détermina-
tion, on va jusqu’à l’élément, mais non au-delà. L’élément est lui aussi un
composé de forme et de matière. Si donc on parle de « matière première »,
ce ne peut être que par une analyse intellectuelle (non physique) et en vertu
d’une analogie: ce que l’airain est à la statue, ce que le bois est au lit, voilà
ce qu’est la matière première par rapport à l’élément, premier composé de
forme et de mantière.
2/ Matière et puissance sont des concepts corrélatifs. Si en effet la ma-
tière “résulte” d’un acte d’abstraction; elle n’est pas un in-déterminé absolu
ni un non-être absolu ; elle est seulement ce qui n’est pas déterminé par les
prédicats dont on a décidé de faire abstraction, mais dont on a d’abord cons-
taté la présence dans le composé qui est le point de départ de l’acte
d’abstraction.; ainsi, la matière de la statue, c’est le composé sans la forme,
c’est ce qui reste, quand, du composé, on ôte la forme par la pensée ; donc la
matière est puissance; le bois est en puissance la statue qu’on y sculptera; la
matière a ainsi une signification négative (elle n’est ni…ni…), mais aussi
positive, puisqu’elle est capable du composé qui en sortira.
« Mais nous qui dérivons tout de Dieu… » : cette dérivation doit être
comprise au sens de la création ex nihilo - en un double sens : non ex deo
(contre l’émanatisme ; le monde n’est pas une émanation nécessaire de la
nature divine) et non ex materia (contre les Anciens mais aussi contre la
Gnose ; Cause de Dieu, § 4 : tout ce qui n’est pas Dieu est dépendant de
Dieu ; même si on suppose la matière éternelle, elle reste contingente en tant
qu’elle n’a pas la raison de son existence en elle-même ; Dieu en est donc
l’auteur : « Dieu seul est au dessus de toute matière puisqu’il en est
l’auteur » [Considérations sur les principes de vie…, GF 3) ; en outre si le
monde dérive de Dieu, Dieu n’est pas l’âme du monde : non est anima mun-
di sed autor (à Des Bosses, 16 octobre 1706 ; voir aussi lettre à Hartsœcker,
GF 3 p. 176 : « il n’est pas permis de dire que l’Univers est comme un ani-
mal plein de vie et d’intelligence : car on serait porté à croire après cela que
Dieu est l’âme de cet animal, au lieu que Dieu est Intelligentia supramunda-
na, qui est la cause du monde… »). Dieu crée un monde contingent par un
acte de liberté, impliquant entendement et volonté
On ne peut donc pas reprendre à la lettre la cosmologie du Timée ; on
doit la transposer, la réinterpréter, en conservant ce qui en est le noyau,
c’est-à-dire l’idée de nécessité. Cette transposition consiste à substituer à la
matière platonicienne une « nature idéale de la créature… ». Idéal signifie :
existant dans l’entendement de Dieu. Dieu ne peut rien créer par sa volonté
sans penser d’abord (au sens d’une priorité de nature) en son entendement
l’essence ou la nature de ce qu’il crée, et en particulier, en cette essence, ce
qui appartient à toute créature en tant que telle, sa condition de créature. Or à
la condition même de créature appartient nécessairement, en tant qu’elle
n’est pas Dieu, une imperfection, originale, en tant qu’elle tient à son origine
même. L’idée de Leibniz est donc que les possibles sont antérieurs de nature
à l’acte créateur de la volonté, que toute créature possible est nécessairement
finie, que Dieu ne change rien de sa nature en la créant. Et c’est cette limita-
© Philopsis – Pascal Dupond 51
www.philopsis.fr
tion de son essence qui a pour conséquence son imperfection quand elle
existe28. Cette imperfection (qui est la source du mal) est antérieure au décret
de création et lui impose ses conditions dans la mesure où les vérités éter-
nelles sont indépendantes de la volonté de Dieu et s’imposent à elle.
L’imperfection de la créature est, comme dit Leibniz un « objet interne » :
objet, elle est dans une sorte de distance et de résistance vis-à-vis de Dieu
(elle est essentielle et nécessaire), interne, elle ne constitue pas une limita-
tion externe de la puissance divine : en produisant une créature imparfaite,
Dieu ne fait que se conformer, si l’on peut dire, à sa propre pensée.
Cette situation est illustrée par de multiples analogies mathématiques.
Dieu ne peut créer des nombres sans conformer sa volonté aux nécessités lé-
gales inhérentes à l’essence même du nombre ; créant des nombres, il crée
l’incommensurabilité de l’unité avec la racine de 2 ; créant des figures géo-
métriques, il crée la diagonale du carré incommensurable avec le côté du car-
ré : la limitation est aussi essentielle à la créature que l’incommensurabilité
de la diagonale et du côté est essentielle au carré.
« Cette région est la cause idéale du mal, aussi bien que du bien… ».
Le souci de Leibniz est ici de montrer en quel sens bien et mal ont et n’ont
pas, une même cause.
Bien et mal ont la même cause au sens d’une cause idéale : la constitu-
tion essentielle de ce monde que Dieu pense et crée.
Bien et mal n’ont pas la même cause au sens où le bien a une cause ef-
ficiente, tandis que le mal a une cause déficiente, ce terme désignant la limite
de l’opération de la cause efficiente. S’il existe une créature, cette créature
est essentiellement limitée ; donc Dieu, en faisant exister une créature, est la
cause matérielle de sa limitation (sans créature, pas de limitation de la créa-
ture, donc pas de mal) ; mais il n’est pas la cause formelle de sa limitation :
la cause formelle de sa limitation se trouve dans son essence même de créa-
ture, dans la limitation que cette essence implique.
Le mal n’est pas un principe positif mais une privation (voir aussi §
153 et 378)
Leibniz dit ainsi dans le Dialogue sur le liberté : la cause déficiente du
mal, c’est le néant.
La façon dont est introduite dans cet opuscule l’idée de Néant est si-
gnificative. Il y a deux interlocuteurs, A et B ; A dit à B : « pour rendre rai-
son du péché, il faudrait une cause infinie capable de contrebalancer
l’influence de la bonté divine » ; et B répond : cette cause infinie, c’est le
Néant. Deux remarques
1/ Leibniz ne parle pas d’une cause infinie s’opposant à la toute-
puissance, mais d’une cause infinie s’opposant à la bonté. La toute puissance
ad extra, c’est la puissance créatrice de Dieu, c’est-à-dire la puissance de
donner l’existence à ce qu’il conçoit comme possible et comme bon ; or rien
ne peut limiter cette puissance : ce qui pourrait la limiter, ce serait quelque
28
« Toute perfection <des créatures> découle immédiatement de Dieu [comme être,
force, réalité, grandeur, savoir, vouloir]
Les défauts [imperfections] adhérents découlent des créatures elles-mêmes et de leurs
bornes ou non plus ultra, que la limitation [finitude] amène avec soi [comme les limites de
l’être, la résistance à la force, la passivité dans le cas de la réalité, la réduction forcée de la
grandeur, l’obscurité dans le cas du savoir, le fléchissement dans le cas du vouloir » (Grua
147).
© Philopsis – Pascal Dupond 52
www.philopsis.fr
chose qui aurait une existence indépendante de l’existence de Dieu (mani-
chéisme) ; or pour un chrétien, cela est totalement exclu : avant la création,
rien n’existe que Dieu et après la création rien n’existe que par Dieu. En re-
vanche, quelque chose peut s’opposer à la volonté ou à la bonté de Dieu sans
que cela implique une limitation de Dieu : c’est l’essence même des choses
qui limite la volonté.
2/ Ce concept du néant permet à Leibniz de penser une cause limita-
tive de la bonté divine a/ qui ait « des attributs communs avec Dieu » (infini-
té, éternité) et soit par conséquent, en son ordre, l’égal de la nature divine et
puisse ainsi la limiter ; b/ mais ne soit opérante ou efficiente qu’à travers
l’action divine, non intrinsèquement, de telle sorte que Dieu ait l’initiative de
la cause qui limite sa bonté : c’est parce que Dieu crée des êtres que le Néant
peut quelque chose, c’est-à-dire limiter la perfection de la créature ; le néant
n’est opérant que par la médiation de l’être qu’il limite (et dont Dieu est le
seul principe).
Le concept leibnizien du Néant a une origine néo-testamentaire (ex ni-
hilo). Leibniz évoque également les platoniciens (il pense sans doute à Plo-
tin, Ennéades, I, 8 : « Le mal existe en ce qui n’est pas, il est en quelque
sorte la forme du non-être »).
Ce concept du néant permet également à Leibniz de s’opposer
(comme tous les Pères de l’Eglise) à la gnose de Mani (216-272). La gnose
professe un dualisme qui admet deux principes, la Lumière et l’Obscurité, le
Bien et le Mal, un Dieu et un Anti-dieu, identifié à la matière. Ce dualisme
est incompatible avec l’idée que Dieu est le seul principe et que ce principe
est générateur du monde. Il a été combattu par Augustin29, et Leibniz le re-
fuse tout autant. Mais il le refuse en lui faisant droit : L’Obscurité que visait
Mani est en vérité le Néant éternel et infini.
Mais comment le Néant, qui n’est rien, peut-il entrer dans la composi-
tion des choses ? comment peut-il produire ou au moins contribuer à la pro-
duction de quelque chose ?
Leibniz recourt à des analogies mathématiques. 1/ « les zéro joints aux
unités font des nombres différents ». Ils ne font des nombres différents que
s’ils sont joints à l’unité : unum autem necessarium ; le un est nécessaire
pour que le zéro soit producteur de nombre ; le néant n’est « efficient » que
« dans » l’être qu’il limite. 2/ Il appartient à l’essence du cercle d’avoir un
diamètre d’une longueur déterminée, celle-ci et non une autre plus ample, ou
bien d’avoir les propriétés du cercle, et non celles de l’ovale ou du losange.
Omnis determinatio est negatio. Tout être déterminé est limité, et cette limite
est bivalente, positive et négative, elle lui donne son essence ou son identité
distincte (le péras du Philèbe), mais le prive aussi d’une infinité de perfec-
tions30.
29
Confessions, VII, 12 et VII 16. Voir p. 50, où ces textes sont cités.
30
Pour trouver des antécédents de cette problématique, on peut remonter
1/ à la dialectique des grands genres de l’être du Sophiste. Le Sophiste reconnaît
contre Parménide qu’il y a une idée du non-être (idea tou mè ontos), dont le fondement onto-
logique est le genre de l’Autre : « autant de fois sont les autres, autant de fois l’être n’est pas »
(257 a), ce qui signifie : autant de fois est ce qui est autre que l’être, autant de fois l’être n’est
pas. Tout ce qui est autre que l’être (tout en participant à l’être pour être autre que l’être) par-
ticipe de l’idée du non-être. Cette participation à l’idée du non-être est positive et créatrice,
puisqu’elle permet à chaque idée de participer du genre de l’être sans l’être (et d’avoir ainsi
son identité distincte). On doit donc reconnaître au non-être une sorte de causalité, mais une
© Philopsis – Pascal Dupond 53
www.philopsis.fr
§ 21. Le premier moment, dans la construction de la Théodicée con-
siste à remonter du mal visible (les maux dont nous souffrons et qui nous
font douter de la toute-puissance ou de la bonté de Dieu : souffrance et pé-
ché) vers la condition qui le rend possible, condition qui nous est d’abord
cachée et que nous ne pouvons découvrir que par réflexion : le mal métaphy-
sique.
« Le mal métaphysique consiste dans la simple imperfection… » : la
question est de savoir si le mal métaphysique est identifiable à l’imperfection
originale de la créature dont parle le paragraphe précédent. Le § 29 de la
« Cause de Dieu » (CD) invite à les identifier purement et simplement (mais
une nuance est possible : l’imperfection de la créature est qualifiable comme
mal là surtout où elle opère comme la condition du mal physique et du mal
moral ; ainsi dans une créature ayant une volonté libre, l’imperfection inhé-
rente à la créature devient le mal métaphysique de peccabilité, lequel est la
condition du mal moral de péché ; si l’on retient cette lecture, on dira qu’il y
a dans tout monde possible une imperfection originale et que cette imperfec-
tion devient un mal dans quelques uns d’entre eux, à savoir dans ceux où il y
a des créatures capables de bien et de mal physiques, de bien et de mal mo-
ral.
Quel est le rapport entre le bien et le mal au sens métaphysique, phy-
sique et moral ?
Selon CD 29, le bien métaphysique (la perfection) et le mal métaphy-
sique (l’imperfection) peuvent se dire de tout être, qu’il ait ou non de
l’intelligence
Selon CD 30, le bien physique est le plaisir et aussi, selon TH 251, la
santé, même si elle ne procure pas un plaisir conscient ; et le mal physique
est la douleur, les maladies ; ils se rapportent aux substances intelligentes. La
douleur consiste dans le passage à une moindre perfection ou à une percep-
tion plus confuse ; elle correspond à une diminution de l’action et à un ac-
croissement de la passion. Le plaisir consiste, à l’inverse, dans le passage à
une perception plus articulée, plus claire et distincte ; il correspond à une
diminution de la passion et à un accroissement de l’action (DM XV31). Là où
il y a plaisir et douleur, il y a donc une variation de perfection et une certaine
conscience de cette variation : « Le plaisir est un sentiment de perfection et
la douleur un sentiment d’imperfection, pourvu qu’il soit assez notable pour
faire qu’on puisse s’en apercevoir » (NE, II, 21)
Le bien moral et le mal moral sont les actions vertueuses et les actions
vicieuses des créatures intelligentes, c’est-à-dire le bien et le mal accomplis
librement. Le bien moral consiste à tendre vers Dieu ; le mal moral consiste
à préférer la créature au Créateur (Dialogue sur la liberté, p. 53 : « Ainsi
causalité seconde, dérivée. L’efficace du non-être est en vérité l’efficace de l’Autre dans la
dialectique des grands genres de l’être
2/ à l’atomisme. Il y a deux principes de tout ce qui existe, l’atome et le vide. Le vide,
considéré en lui-même, n’est “rien”, tout l’être est dans l’atome qui est seul “quelque chose”,
qui a seul des propriétés. Mais qu’il ne soit rien au sens où il est autre que le “quelque chose”
ne l’empêche pas d’être principe d’être : il est principe d’être dans la mesure où il offre
l’espace (diastèma) où ont lieu le déplacement et la composition des atomes, il permet ainsi
aux atomes de produire les êtres visibles de notre monde ; associé à l’Etre, il a vraiment rang
de principe.
31
« Aussi tiens-je que toute action d’une substance qui a de la perception emporte
quelque volupté et toute passion quelque douleur et vice versa ».
© Philopsis – Pascal Dupond 54
www.philopsis.fr
faute d’attention, le premier homme a pu se détourner du souverain bien et
se borner à quelque créature, et par là il est tombé dans le péché… » ; CD
73). De la peccabilité (mal métaphysique), l’homme passe au péché (qui
transforme la possibilité du mal en inclination – CD 80), et le péché habituel
fait de l’inclination une habitude (CD 93)
On remarque que Leibniz lie le mal physique et le mal moral (CD 32 :
« le mal physique dérive ordinairement du mal moral ») : le mal physique est
l’effet du mal moral (ou du mal de coulpe) chez celui qui en est victime (TH
26) ; et chez celui qui en est l’auteur et il est le moyen de la punition et de
l’amendement du coupable.
§ 22. S’il y a du mal dans notre monde et si rien n’échappe à la volon-
té de Dieu, il paraît nécessaire de penser que Dieu a voulu le mal. Comment
entendre cette volonté du mal pour qu’elle ne contredise pas à la nature de
Dieu ? La réponse de Leibniz consiste dans les propositions suivantes :
1/ Dieu a la volonté qu’il existe des créatures ; il ne veut leur imper-
fection qu’en tant qu’elle est impliquée dans leur essence de créature.
2/ Dieu ne veut pas d’une manière absolue le mal physique ; il ne le
veut que relativement à ce dont il ne peut pas être séparé, à ce dont il est le
corrélat, c’est-à-dire le mal moral.
3/ Et Dieu ne veut pas du tout le mal moral, il « ne veut que [le] per-
mettre à titre de sine qua non ou de nécessité hypothétique qui le lie avec le
meilleur. C’est pourquoi la volonté conséquente de Dieu qui a le péché pour
objet n’est que permissive » (§ 25).
Pour penser cette « permission », il est nécessaire de penser l’essence
de la volonté.
Sur cette question on peut compléter TH 22 par le chapitre II, XXI des
NE.
Dans ce ch., Leibniz inscrit sa réflexion dans les concepts aristotéli-
ciens de puissance, d’acte et de mouvement, mais il en modifie le fonction-
nement
Chez Aristote, comme le rappelle Leibniz, la puissance (potentia, du-
namis) est l’opposé de l’acte (l’être en puissance est un être inachevé : le
bloc de marbre n’est pas la statue qu’il deviendra, il ne l’est qu’en puis-
sance ; l’être en acte est achevé, parfait, il a accompli toutes les possibilités
inhérentes à son essence) ; or Leibniz atténue ou même efface cette opposi-
tion.
Il commence par rappeler la signification aristotélicienne des termes
en question :
Puissance = possibilité du changement
Mouvement = Changement = « acte ou peut-être actuation » de ce qui
est en puissance
Changement = action dans un sujet et passion dans un autre
Donc deux puissances : puissance active et puissance passive, faculté
et réceptivité.
Puis il précise : « il est vrai que la puissance active est prise quelque-
fois dans un sens plus parfait… » : puissance active = faculté et tendance =
force.
La force se prend elle-même en deux sens :
Force = entéléchie quand elle est comprise au sens de « forces agis-
santes primitives », c’est-à-dire au sens de ce qui est, en tout être, la source
© Philopsis – Pascal Dupond 55
www.philopsis.fr
permanente de ses actions temporaires ou au sens de la puissance qui consti-
tue, en chaque substance, sa nature ou son essence (ce qui qualifie la subs-
tance comme substance, c’est qu’elle est un être réel, c’est-à-dire un être
agissant continuellement).
Force = effort quand elle est prise au sens des forces dérivatives, c’est-
à-dire au sens de la façon dont s’exerce à chaque instant, en fonction des
rapports harmoniques entre les substances, la force essentielle des subs-
tances ; cet effort est appelé conatus, élément infinitésimal de la tendance à
l’action
Sur la différence entre force primitive et force dérivative, voir TH §
87, « De la réforme de la philosophie première », LP p. 322-325, « De la na-
ture en elle-même », LP p. 345-351, « De la nature du corps », GF 2, 177-
178, à de Volder, 21 janvier 1704 [« la force dérivative, c’est l’état présent
en tant qu’il tend au suivant ou enveloppe d’avance le suivant, en tant que
tout ce qui est présent est gros du futur. Mais la chose permanente elle-
même, en tant qu’elle enveloppe tous les cas, a une force primitive, de telle
sorte que la force primitive est comme la loi de la série et la force dérivative
comme la détermination qui assigne un terme quelconque dans la série »] ; à
de Volder 30 juin 1704
Ces distinctions sont mises en œuvre dans la question de la volonté.
Dans la créature, la volonté est soit puissance active ou faculté, soit
activité ; cette activité est elle-même soit effort (conatus) soit action
La volonté comme faculté correspond à ce que la dynamique appelle
force primitive ; elle est le pouvoir d’agir conformément aux représentations
du bien et du mal (elle n’est donc pas une puissance nue, elle est inclinée
vers ce que l’entendement représente comme bon) ; elle est une forme de la
faculté appétitive : elle est ce que devient dans un être capable d’intelligence
et de réflexion l’appétit insensible des simples monades32.
Cette faculté est une force qui produit les volitions successives, c’est-
à-dire « l’effort ou la tendance (conatus) d’aller vers ce qu’on trouve bon et
contre ce qu’on trouve mauvais » (NE II, XXI, 146).
Si une volition (conatus) ne rencontre aucun obstacle, elle produit une
action ; si elle entre en composition avec d’autres volitions ou conatus, le ré-
sultat peut se représenter sous la forme géométrique d’un parallélogramme
des forces : le conatus qui produit l’action est la résultante de la composition
des conatus opérant simultanément.
L’action peut être considérée comme interne et comme externe : in-
terne, elle est décision ; externe, elle l’accomplissement de l’action.
Nous retrouvons une analyse analogue dans TH 22 (voir aussi CD 24-
27).
Leibniz commence par définir la volonté « dans le sens général » :
toute volonté consiste dans une inclination au bien et il n’y a pas de diffé-
rence sur ce point entre la volonté humaine et la volonté divine. Volonté
humaine et volonté divine se distinguent comme le fini et l’infini : on ne
32
« C’est pourquoi j’estime qu’il y a dans tout corps un certain sens ou appétit ou en-
core une âme et que par conséquent attribuer au seul homme la forme substantielle et la per-
ception ou l’âme est aussi ridicule que de croire que toutes les choses ont été faites à cause de
l’homme et que la terre est le centre de l’univers » (Cogitationes de Physica Nova Instauranda
-1678-1682).
© Philopsis – Pascal Dupond 56
www.philopsis.fr
peut pas distinguer dans la volonté divine une puissance ou faculté et
l’exercice de cette faculté ; la volonté divine est en acte ; on ne peut pas non
plus distinguer en Dieu action interne et action externe ; la volonté divine
diffère de la volonté humaine à raison de ses objets] ; mais ces différences
n’excluent pas une nature commune (absolue en Dieu et limitée en
l’homme) : absence d’« indifférence » et distinction entre volonté antécé-
dente et volonté conséquente.
Chez les scolastiques, la volonté antécédente de Dieu est la volonté du
salut universel (Paul, I Tim. 2, 4 : « J’exhorte donc avant toutes choses à
faire des prières… cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur, qui
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de
la vérité »), tandis que la volonté conséquente est celle salut de quelques uns
parce que la justice demande le châtiment des pécheurs (CD 24). Cette dis-
tinction a parfois été comprise comme antithèse du signe et du bon plaisir
(Dieu déclare qu’il veut sauver tous les hommes mais a la volonté cachée de
n’en sauver que quelques uns). Cette lecture se trouve chez Luther, pour au-
tant qu’il distingue le Dieu révélé qui veut le salut de tous et le Dieu caché
qui veut la mort du pécheur. Cette lecture est pour Leibniz absolument im-
possible.
La façon dont Leibniz comprend ces termes s’appuie, selon CD 24,
sur Thomas et Scot.
La volonté antécédente (dite aussi préalable en CD 24) est la « volon-
té détachée » : il y a plusieurs biens (de ce point de vue, Leibniz serait du cô-
té d’Aristote contre Platon) et même une infinité de biens et chacun de ces
biens est l’objet (ou l’objet possible) d’une inclination ; la volonté antécé-
dente est l’inclination vers chaque bien considéré isolément.
La volonté humaine antécédente, c’est la volition ou l’inclination qui
porte la volonté vers tout ce qui lui apparaît comme utile ou agréable ou bon
moralement ; la volonté conséquente (ou qui décide et agit), c’est la compo-
sition de ces inclinations ; lorsque, dans un être raisonnable ces inclinations
et leur objet sont conscients, la composition devient délibération et décision
(action interne), puis accomplissement (action externe).
La volonté divine antécédente, c’est l’inclination à tout bien ; enclin à
tout bien, Dieu est enclin à donner à toute créature toute la perfection dont
elle est capable, et aux esprits, toute la perfection des esprits ; il est donc en-
clin à sauver tous les hommes et à exclure le péché ; il a l’inclination à ex-
clure du monde non pas sans doute le mal métaphysique (qui n’est qu’un
autre nom de la limitation du créé), car aucune volonté ne peut vouloir ce qui
est contradictoire, mais le mal moral. Et cette volonté est efficace puisqu’elle
est la volonté de Dieu, elle est une volonté infinie (qui est acte, non pas puis-
sance ou faculté), mais considérée dans son rapport à un bien particulier,
proportionnée à ce bien particulier et ayant par conséquent un degré
d’inclination proportionné au degré de perfection du bien considéré (CD 27).
Si la volonté antécédente produit un effet, elle ne produit pas son plein
effet, elle ne va pas « au dernier effort ». Deux remarques. 1/ la notion de
conatus vient de la physique ; le conatus est, dans son acception technique,
un élément infinitésimal de la tendance à l’action ; on peut ici comprendre le
conatus comme le degré de la tendance à l’action ; 2/ ce qui empêche la vo-
lonté antécédente de produire son plein effet, ce n’est rien qui soit extérieur à
la volonté, c’est la limitation que reçoivent les inclinations de la volonté di-
© Philopsis – Pascal Dupond 57
www.philopsis.fr
vine à raison de leur multiplicité ou de l’incompossibilité de leurs objets. Il
y a une compétition des possibles ou des inclinations qui leur correspondent
et la volonté conséquente ou décrétoire résulte du concours de toutes les vo-
lontés antécédentes. Cette volonté décrétoire est pleine ou absolue.
La volonté conséquente résulte du conflit des volontés antécédentes
comme le mouvement composé résulte de toutes les tendances qui concou-
rent dans un même mobile. Ce qui justifie cette analogie, c’est l’harmonie
entre les lois des mouvements des corps et les lois des perceptions et des ap-
pétitions des âmes ; la « force » du physicien, l’appétit dans les substances
simples ou monades, la volonté (c’est-à-dire la forme que présente l’appétit
dans les êtres raisonnables) ne sont pas identifiables mais relèvent d’une
constitution de l’être commune à l’âme et au corps et que désignent les con-
cepts de puissance, d’effort, de tendance et d’action. Leibniz cherche à cons-
truire un concept de l’être qui dépasse le dualisme cartésien.
Et c’est pourquoi dans le De rerum originatione, Leibniz présente le
choix du meilleur monde en termes de « mathématique divine » ou de « mé-
canique métaphysique » (§ 6). Le mécanisme métaphysique des essences qui
réalise le maximum d’essence ou de perfection dit en termes dynamiques ce
que les termes de volonté antécédente et conséquente disent en termes inten-
tionnels.
§ 23. Ce qui rend possible et nécessaire la distinction du bien et du
meilleur, c’est le fait que, dans l’ens creatum, le bien se dise au pluriel ; « le
bien », ce sont les biens considérés distributivement ; « le meilleur », ce sont
les biens considérés dans leur composition.
Dieu ne veut point du tout le mal moral : il ne veut que le permettre, il
autorise que la créature agisse mal.
Il ne veut point d’une manière absolue le mal physique : il ne le veut
que conditionnellement. Et c’est pourquoi il n’y a pas de prédestination ab-
solue à la damnation.
Cette proposition annonce les réflexions de Leibniz sur la « destina-
tion » des § 79-84.
Au § 81, Leibniz précise les distinctions conceptuelles qui lui parais-
sent nécessaires dans cette question : mal physique/mal moral ; destina-
tion/prédestination ; destination absolue/respective).
- Une destination au mal moral est à exclure (la notion serait une vraie
contradiction dans les termes, puisqu’elle nierait et affirmerait en même
temps la liberté humaine) ; il ne peut donc y avoir destination qu’au mal
physique
- Parler d’une prédestination à la damnation (le plus grand mal phy-
sique), c’est parler d’une « destination absolue », c’est-à-dire incondition-
nelle, déliée de toute condition de bonnes ou mauvaises actions ; par diffé-
rence, une destination à la damnation est conditionnelle. Leibniz admet la
seconde : les damnés sont damnés à cause de leurs fautes (car ils sont connus
ou prévus impénitents) ; donc ils sont conditionnellement destinés à la dam-
nation ; mais ils n’y sont pas prédestinés, au sens d’une réprobation absolue
ou inconditionnelle, indépendante de leur liberté et de leur impénitence fi-
nale.
Puis au § 82, il relit les querelles théologiques à l’aide de ces distinc-
tions
© Philopsis – Pascal Dupond 58
www.philopsis.fr
Les supralapsaires sont les partisans d’une prédestination au sens
strict : Dieu a voulu manifester sa miséricorde et sa justice ; pour manifester
sa miséricorde il devait créer des élus à sauver ; pour manifester sa justice, il
devait créer des réprouvés à damner ; il y avait donc des élus et des réprou-
vés, « avant toute considération du péché originel » (d’où le terme supralap-
saire, qui signifie que la chute <lapsus> (des réprouvés) est décrétée avant le
péché ; mais pour que cette discrimination d’élus et de réprouvés ne soit pas
purement arbitraire, Dieu a dû également permettre le péché, puis il a exercé
sa miséricorde en envoyant aux uns les grâces qui font entrer dans la péni-
tence et il a exercé sa justice en punissant ceux et celles à qui ces grâces ont
été refusées ; et ainsi il a pu frapper le pécheur impénitent et élever le pé-
cheur repenti. Dans le scénario des supralapsaires, le décret de punir pré-
cède la connaissance de l’existence future du péché – sans doute au sens
d’une précédence logique : le péché est « pour » l’impénitence qui est
« pour » la de punition des réprouvés
Les infralapsaires écrivent un scénario inverse : ce qui vient d’abord,
ce n’est pas la volonté de punir ou de pardonner, mais le péché ; Dieu a per-
mis le péché ; et comme tous pèchent en Adam, tous méritent la damnation ;
mais quelques uns « ont été sauvés gratuitement [sans que leurs actes en
soient la cause] par le mérite de Jésus-Christ. L’ordre des termes s’inverse :
ce n’est plus la séquence : punition, donc péché ; c’est la séquence : péché
donc punition ; c’est le péché qui est la cause de la punition. Tous sont pé-
cheurs ; à certains, Dieu envoie sa grâce, ils sont par cette grâce prédestinés
à l’élection ; ils font pénitence et ils sont sauvés ; aux autres, Dieu n’envoie
pas sa grâce, ils ne sont pas prédestinés à l’élection ; mais cela n’implique
pas qu’ils soient prédestinés à la damnation : Dieu sait par avance qu’ils ne
feront pas pénitence (faute de la grâce qui leur est refusée) et qu’ils seront
damnés en raison du péché (donc en raison de l’usage qu’ils font de leur li-
berté) ; la damnation résulte du péché (et de la justice de Dieu) mais non pas
de la volonté divine de damner.
C’est, précise Leibniz, la position la plus commune parmi les réformés
et c’est celle dont il est lui-même le plus proche ; s’il subsiste des différends
parmi les infralapsaires, ils ne sont que de langage : si certains infralapsaires
parlent d’une prédestination à la damnation, cette destination reste condi-
tionnelle : ce n’est pas Dieu qui les destine à la damnation, ce sont eux qui se
destinent ou c’est le péché et leur non repentance qui les destine à la damna-
tion.
Qu’est-ce qui destine, symétriquement, les élus à l’élection ? Si
l’élection est absolue, la volonté qui la décrète est sans raison ; si elle est re-
lative ou conditionnelle, la volonté qui la décrète a des raisons d’agir comme
elle le fait : prévoyant la foi vive, elle agit en raison de cette foi vive qu’elle
prévoit ; la foi vive entre dans la raison de l’élection. Les luthériens (à la
suite de Mélanchton, qui suit sur ce point la position du jeune Augustin) sont
du second parti : « il leur paraît que la prévision de la cause est aussi la cause
de la prévision de l’effet » : la prévision de la foi vive est la cause de la pré-
vision de l’élection ; l’ordre causal des prévisions dans l’entendement de
Dieu est identique à l’ordre causal (et chronologique) des événements hu-
mains (la prévision de la foi vive est la cause de la prévision de l’élection
comme la foi vive est la cause de l’élection). Les réformés (les calvinistes
Sohn et Zanchi, mais aussi le jésuite Bellarmin) sont du premier parti : ils
© Philopsis – Pascal Dupond 59
www.philopsis.fr
remarquent que dans l’ordre de l’action, il y a toujours à la fois une causalité
descendante (ou efficiente) et ascendante (ou finale) : la maison produit le
loyer et le loyer produit la maison (la représentation du loyer à percevoir est
la cause finale de la construction de la maison). C’est cette double causalité
qui s’exerce ici, comme s’il y avait une double scène : sur l’une, correspon-
dant à l’ordre chronologique et causal des événements humains, la foi vive
produit l’élection comme une cause produit son effet ; sur l’autre, corres-
pondant à la vie divine, le rapport s’inverse : la foi vive suit l’élection. Pour
les luthériens, la foi vive est première : l’intention de Dieu est de rendre
l’homme fidèle, et l’élection est la conséquence de la fidélité ; pour les ré-
formés, c’est la salvation qui est première : l’intention de Dieu est de sauver
tel ou tel et la fidélité n’en est que le moyen.
Enfin le § 84 montre que la querelle peut être dépassée ; on peut pro-
poser une nouvelle « formule de concorde » (note 55 : charte de réunification
des diverses tendances luthériennes, 1580), qui fera disparaître tous les diffé-
rends : la volonté divine n’est pas distributive (si ce n’est à titre de volonté
antécédente), la volonté conséquente ou efficace va à l’ensemble ; ce ne sont
pas les parties qui sont cause de l’ensemble, c’est l’ensemble qui est cause
des parties ; donc les décrets de Dieu sont simultanés non seulement par rap-
port au temps mais encore logiquement et il n’y a pas d’ordre entre eux :
« J’ai trouvé avec St Augustin, Thomas d’Aquin et Luther que Dieu est la
dernière raison des choses et que ceux qui parlent des bonnes qualités pré-
vues, soit foi soit œuvres de la charité, comme cause des décrets favorables
de Dieu disent la vérité mais qu’ils ne disent pas assez parce que ces mêmes
bonnes qualités étant encore des dons de Dieu, dépendent d’autres décrets
dont le dernier motif ne peut être enfin que le bon plaisir de Dieu, lequel
n’est pas tyrannique ni sans raison mais qui a pour objet cet abîme et cette
profondeur de richesses dont parle St Paul, c’est-à-dire l’harmonie et la per-
fection de l’univers » (1695)].
Il y a donc bien une double scène. Sur notre scène humaine, quand
nous nous représentons la suite des choses que Dieu a décrété de créer, nous
nous la représentons sous la forme d’une histoire ; et dans cet histoire,
l’ordre des épisodes est décisif, puisque c’est cet ordre qui détermine le sens
de l’histoire. Sur la scène divine, en revanche, tout est simultané, l’historicité
s’évanouit dans la simultanéité.
Les querelles théologiques naissent des différentes façons de lire en
mode historique les actions de Dieu. La solution que Leibniz propose pour
les dépasser, c’est une mise hors jeu de l’historicité ; Leibniz distingue vo-
lonté antécédente et volonté conséquente ; mais le passage du divers (les épi-
sodes) à la composition du divers (l’histoire) n’est plus « historique », elle
serait plutôt « dynamique », selon le schème du parallélogramme des forces.
[Retour au § 23] Dieu veut le mal physique à titre de peine. Comme
peine, le mal est dû à la coulpe [punition exigée par la justice], il sert à
l’amendement du coupable et comme exemple. Mais Dieu ne veut pas le
mal physique au seul titre de peine ; il le veut aussi « comme un moyen
propre à une fin », c’est-à-dire comme ingrédient du meilleur des mondes, et
cela à deux titres : le mal sert à goûter le bien en raison de la structure bipo-
laire de la sensibilité ; le mal contribue à une plus grande perfection de celui
qui le souffre : « Amen, amen, je vous le dis : si le grain de blé tombé en
terre ne meurt pas, il reste seul ; mais s'il meurt, il donne beaucoup de fruit.
© Philopsis – Pascal Dupond 60
www.philopsis.fr
Celui qui aime sa vie la perd ; celui qui s'en détache la garde pour la vie
éternelle… » (Jean 12 , 24-26). 33.
§ 24. On distinguera les deux formules : « objet suffisant » et « objet
légitime ». Un mal peut produire un bien ou empêcher un autre mal. Cette
capacité du mal ne fait pas du mal un objet suffisant de la volonté divine (le
mal n’est un objet suffisant de la volonté divine que quand il entre dans la
formule du meilleur) ; et elle ne fait pas du mal un objet légitime de la volon-
té de la créature (le mal est permis seulement lorsqu’on manque en
l’empêchant à un « devoir indispensable » : le mal consistant à ne pas sépa-
rer deux soldats qui s’entretuent est permis à leur officier s’il doit manquer
en les séparant à une obligation inconditionnelle ou absolue (garder son
poste) ; aucun calcul d’avantages et d’inconvénients ne peut ici intervenir.
§ 25. Une reine [à qui Leibniz pense t-il ?] ne doit pas commettre ni
permette un mal moral (un crime) pour obtenir un bien physique (le salut de
l’Etat). La raison donnée n’est pas proprement morale (au sens où le bien
moral devrait inconditionnellement prévaloir sur le bien physique) mais
pragmatique : la cause risque de ne pas produire le résultat qu’on en attend
et même de produire un résultat inverse : un crime « politique » tendant à
écarter un danger est plus dangereux que ce danger.
Si une volonté humaine peut permettre un mal moral (qu’elle pourrait
empêcher, si certaines raisons ne s’y opposaient), c’est toujours au nom d’un
devoir et non par un calcul de maximis et minimis.
Avec Dieu nous sommes à la fois dans le même cas de figure et dans
un cas de figure tout différent : Dieu ne permet pas le mal en raison d’un
« devoir indispensable » mais en raison de ce qu’il « se doit » ou « doit à sa
sagesse, à sa bonté, à sa perfection » ; un devoir au sens étroit suppose deux
instances : celle qui oblige et celle qui est obligée, et une contrainte (Kant)
que la première exerce sur la seconde ; et cette dualité est présente même
dans le devoir envers soi-même ; en Dieu, le substitut du devoir est la rela-
33
Bref excursus pour tenter de donner sens à cette parole énigmatique. Dans le sillage
de Denis Vasse. Et de E. Lévinas. On peut lire la souffrance comme l’abandon de la toute-
puissance imaginaire de l’ego et la naissance de la socialité. La souffrance signe notre impuis-
sance, mais précisément pour cette raison elle peut nous délivrer de l’idole de l’ego, de sa
puissance, de sa suffisance, elle peut nous délivrer des idoles et nous ouvrir un passage de
l’imaginaire au symbolique : en brisant notre fantasme de puissance, elle nous livre à la Pa-
role qui est le fondement non imaginaire de notre être. Quand elle est comprise ainsi, « la
souffrance, alors, ne nous empêche pas d’être homme. C’est bien plutôt le contraire : nous ne
pouvons pas l’être sans elle, non qu’elle soit désirable en elle-même, mais parce qu’elle ja-
lonne le chemin de notre ex-sistence à nous-mêmes. De manière secrète, cachée, mystique, la
souffrance indique une ouverture à l’Autre, la blessure même de la soif et de l’amour au cœur
du corps et non plus dans la projection du même » (Denis Vasse, Le poids du réel, la souf-
france, Seuil). La souffrance nous délivre du fantasme de la puissance, de la projection du
même et elle crée ainsi un lien entre les humains qui serait impossible sans elle. La souffrance
est un isolement absolu, mais du fond de cet isolement, celui qui souffre appelle. Et si cet ap-
pel reçoit réponse, est écouté, alors naît ce que Levinas appelle la socialit (é et qui est atten-
tion à la souffrance de l’autre, hospitalité donnée à sa souffrance. La souffrance est le seuil
d’une relation inter-humaine éthique, elle rend possible la conscience que ce qui arrive aux
autres me regarde, que j’en suis, d’une façon ou d’une autre, responsable. La convivialité est
belle, mais peut-être la socialité est-elle plus haute que la convivialité (l’une entre dans
l’universel en neutralisant le pouvoir séparateur de la singularité, l’autre entre dans l’universel
en radicalisant et en renversant en son contraire le pouvoir séparateur de la singularité).
© Philopsis – Pascal Dupond 61
www.philopsis.fr
tion « réflexive » que désigne la forme pronominale34. Une expression de
cette relation réflexive serait la distinction des pouvoirs ou des perfections
de Dieu, mais sans multiplicité : c’est la distinction entre l’entendement qui
conçoit une diversité infinie de mondes possibles et la volonté qui choisit le
meilleur.
Sur la volonté permissive, voir CD 28. La volonté permissive con-
cerne les actes d’autrui, et ce qui est proprement voulu ou décidé en elle, ce
n’est pas l’acte lui-même (le péché) mais la permission de l’acte : quand
l’officier laisse les deux soldats se battre, l’objet de sa volonté, ce qu’il dé-
cide, ce n’est pas qu’ils se battent, c’est de les laisser se battre parce que son
devoir l’empêche d’aller les séparer.
§ 26. Ce qui qualifie le mal moral comme un mal, c’est d’abord une
certaine qualité du vouloir (« une mauvaise volonté »), mais c’est aussi, c’est
surtout (« … n’est un si grand mal que parce que…) les maux physiques que
ce mauvais vouloir produit en proportion de sa puissance d’agir et en propor-
tion de la raison opérant en cette puissance d’agir. La raison est nécessaire-
ment impliquée dans le mal moral au sens où elle donne à la volonté mau-
vaise des fins que seul un être de raison peut se proposer (jouir de faire souf-
frir et de détruire) et une extension indéfinie de la puissance d’agir.
§ 27. Le concours physique de Dieu avec la créature peut être compris
de deux façons.
Les uns pensent que le concours physique est « général et médiat » :
Dieu conserve les créatures (au sens où, comme le disent les lignes sui-
vantes, il empêche ou écarte les causes étrangères qui pourraient les dé-
truire), mais sans intervenir dans leurs actions (« il les laisse faire et ne fait
que les conserver sans les aider dans leurs actions ») ; « quelques modernes
y inclinent » - dont Descartes. La physique permet d’établir, selon Descartes,
que Dieu assure la conservation de la même quantité de mouvement (mv),
mais en laissant aux créatures le pouvoir de modifier la direction de ce mou-
vement (PP, II, §§ 36-44 ; PA § 34 et 41-44). Dans ses « Remarques sur les
Principes de Descartes », Leibniz critique (au § 36) la formule cartésienne de
conservation (ce n’est pas la quantité de mouvement qui se conserve mais la
quantité de force) et montre que la direction est incluse dans la détermina-
tion des choses : « … la même direction ou détermination subsiste toujours
en somme dans la nature » (à Arnauld, 30 avril 1687, éd. G Le Roy, p. 162).
Le recours qu’offrait la solution cartésienne pour penser la possibilité de la
liberté doit être abandonné.
34
Leibniz écrit au sujet de la réflexion en Dieu : « … Ens necessarium agere in se ip-
sum sive cogitare. Nihil enim aliud cogitare quam se sentire. Ens necessarium agere per sim-
plicissima… » -
Et il ajoute, au sujet de l’unicité de Dieu dans les trois personnes : on ne trouve pas
dans la nature « une substance absolue qui en contienne plusieurs respectives. Cependant,
pour rendre ces notions plus aisées par quelque chose d’approchant, je ne trouve rien dans les
créatures de plus propre à illustrer ce sujet que la réflexion des esprits quand un même esprit
est son propre objet immédiat, et agit sur soi-même en pensant à soi-même et à ce qu’il fait,
car le redoublement donne une image ou ombre de deux substances respectives dans une
même substance absolue […] Je n’ose pourtant porter la comparaison assez loin et je
n’entreprends point d’avancer que la différence qui est entre les trois personnes divines n’est
plus grande que celle qui est entre ce qui entend et ce qui est entendu, lorsqu’un esprit fini
pense à soi, d’autant que ce qui est modal, accidentel, imparfait et mutable en nous, est réel,
essentiel, achevé et immuable en Dieu ».
© Philopsis – Pascal Dupond 62
www.philopsis.fr
Cette façon de penser le concours de Dieu est pour Leibniz impos-
sible : « l’action de Dieu conservant doit avoir du rapport à ce qui est con-
servé » (voir aussi même lettre à Arnauld : « [le] concours ordinaire [de Dieu
à la conservation de la créature] ne consiste que dans la conservation de la
substance même, conformément à son état précédent et aux changements
qu’il porte ») ; la raison, c’est que les abstractions ou les généralités ne font
pas partie des êtres réels, c’est-à-dire des substances individuelles. Il faut
donc, sur ce point, du moins, suivre Malebranche et admettre que « la con-
servation d’un homme debout est différente de la conservation d’un homme
assis » (Entretiens métaphysiques, VII), au sens où, chacun étant une incom-
parable singularité, la conservation de l’un est un acte entièrement différent
de la conservation de l’autre (sans que la communauté spécifique tempère
vraiment cette différence).
Leibniz en donne deux raisons, l’une plutôt kath’ anthrôpon, l’autre
plutôt kath’ alètheian. La première : « nous sommes obligés nous-mêmes
quelquefois de nourrir ce que nous conservons » [Dieu nous conserve non
comme un avare conserve son argent ou comme un nostalgique conserve une
relique, mais comme un père ou une mère conservent leur enfant] ; la se-
conde : les créatures sont dépendantes (selon la formule thomiste,
l’existence, en elles, ne prend jamais racine) ; elles demandent donc une
création continuée : de la substance et de ses prédicats, qui sont inséparables,
sauf logiquement.
Passage à compléter par la Conversation avec Sténon, GF 1 p. 128-
129, avec cette proposition qui résume de façon éclatante la position de
Leibniz :
« Il suffira de dire d’emblée dès le début que Dieu en vérité produit
l’acte, même si c’est l’homme qui agit »
§ 28. Cela ne conduit à aucune difficulté, concernant le concours mo-
ral ou physique.
Concours moral : oui, il faut reconnaître que Dieu crée l’homme pé-
chant au moment où il pèche comme il l’a créé innocent avant le péché ; car
c’est une seule et même volonté ; Dieu n’agit pas par décisions détachées
(ses volontés antécédentes sont détachées mais n’ont pas le caractère de la
décision ; sa volonté conséquente, qui décrète, veut le tout), il agit selon des
règles, qui ne sont rien d’autre que l’unité de sa volonté dans la diversité in-
finie de ses effets ; et toutes ces règles se rassemblent dans l’unique règle du
meilleur.
§ 29. Le concours physique de Dieu au mal n’est pas positif, mais pri-
vatif : « le mal est privation de l’être, au lieu que l’action de Dieu va au posi-
tif ». Le concept de privation a été formé par Aristote35. L’idée que le mal est
35
« Le mot privation s’emploie, en un premier sens, pour dire d’une chose qu’elle n’a
pas les qualités qui lui seraient naturelles. Il y a aussi privation même quand la nature n’a pas
voulu qu’elle eût cette qualité ; et c’est ainsi qu’on peut dire d’une plante qu’elle est privée de
la vue. E, un autre sens, privation signifie que la chose n’a pas la qualité qu’elle devrait avoir,
soit qu’elle-même, ou au moins son genre, dût posséder cette qualité. Par exemple on dit d’un
homme aveugle qu’il est privé de la vue tout autrement qu’on ne le dit de la taupe ; car, pour
la taupe, c’est le genre qui est frappé de cette privation, pour l’homme, c’est l’individu pris en
lui seul… » (Métaphysique, Delta, 22, Tricot, I, p. 306La traduction citée est celle de Pascale
D. Nau).
© Philopsis – Pascal Dupond 63
www.philopsis.fr
une privation d’être ou de bien et non un être ou une substance est constante
chez les Pères de l’Eglise, grecs et latins.
Origène : « Certum namque est malum bono carere » (De principiis) ;
Athanase : « Certains grecs, s’égarant hors de la route et ne connais-
sant pas le Christ ont affirmé que le mal existait comme une substance <hy-
postasis> et en soi. Dès lors ils ont erré de deux manières : ou bien ils ont nié
que le Démiurge fût l’auteur de tous les êtres – il ne pourrait être en effet
Seigneur de tous les êtres, si le mal avait en soi, comme ils l’assurent, une
ousia ; ou bien, pour le déclarer auteur de toutes choses, ils ont dû nécessai-
rement concéder qu’il l’était aussi du mal » (Discours contre les Gentils).
Basile : « Ne va pas supposer que Dieu est cause de l’existence du
mal, ni t’imaginer que le mal a une subsistance <hypostasis> propre. La per-
versité ne subsiste pas comme si elle était quelque chose de vivant ; on ne
mettra jamais devant les yeux sa substance <ousia> comme existant vrai-
ment. Car le mal est la privation du bien <steresis gar agathou esti to ka-
kon> ».
Ambroise : « Dieu est l’auteur de tous les biens ; et tout ce qui est
vient de lui, sans aucun doute. En lui, nul mal ; et tant que notre esprit de-
meure en lui, il ignore la mal. Mais, pour l’âme qui ne demeure pas en Dieu,
elle est l’auteur de ses propres maux ; c’est pourquoi elle pèche » (De Isaac
et anima, vers 387).
Augustin, Confessions, VII, 12 : « Et il me parut évident que ce n’est
qu’en tant que bonnes, que les choses se corrompent. Que si elles étaient de
souveraine ou de nulle bonté, elles ne pourraient se corrompre. Souveraine-
ment bonnes, elles seraient incorruptibles; nullement bonnes, que laisse-
raient-elles à corrompre? Car la corruption nuit, et ne saurait nuire sans dimi-
nuer le bien. Donc, ou la corruption n’est point nuisible, ce qui ne se peut, ou,
ce qui est indubitable, tout ce qui se corrompt est privé d’un bien. Etre privé
de tout bien, c’est le néant. Etre, et ne plus pouvoir se corrompre, serait un
état meilleur : la permanence dans l’incorruptibilité. Or, quoi de plus extra-
vagant que de prétendre que la perte de tout bien améliore? Donc la privation
de tout bien anéantit. Donc, ce qui est, tant qu’il est, est bon. Donc, tout ce
qui est, est bon. Et ce mal, dont je cherchais partout l’origine, n’est pas une
substance; s’il était substance, il serait un bien. Car, ou il serait incorruptible,
et sa bonté serait grande, ou il serait corruptible, ce qui ne se peut sans bonté.
Ainsi je le vis clairement : vous n’avez rien fait que de bon, et il n’est
absolument aucune substance que vous n’ayez faite; et vous n’avez pas doué
toutes choses d’une égale bonté, c’est pourquoi elles sont toutes; chacune en
effet est bonne, et toutes ensemble sont très-bonnes, car notre Dieu a fait tout
très-bon (Gen. I ; Eccl. XXXIX, 21) ».
Voir aussi VII 16 : « Et je sentis par expérience qu’il ne faut pas
s’étonner que le pain, agréable à l’organe sain, afflige le palais blessé, et
qu’aux yeux malades soit odieuse la lumière si aimable à l’œil pur. Et votre
justice déplaît aux hommes d’iniquité : comment donc pourraient leur plaire
et la vipère et le vermisseau, créés par vous toutefois dans une bonté conve-
nable à l’ordre inférieur avec lequel les impies ont d’autant plus d’affinité,
qu’ils vous sont moins semblables, comme les bons tendent d’autant plus à
l’ordre supérieur qu’ils sont plus semblables à vous. J’ai cherché ce que c’est
que le mal et j’ai trouvé que ce n’est pas une substance, mais la perversité
d’une volonté qui se détourne de la souveraine substance ».
§ 30. Pour justifier ce qu’il avance (dans le droit fil d’une longue tra-
dition), Leibniz va recourir à une analogie : l’inertie des corps est une image
et un échantillon de la limitation originale des créatures.
© Philopsis – Pascal Dupond 64
www.philopsis.fr
La notion d’inertie n’est pas sans équivoque.
Chez Kepler, elle désignerait une tendance au repos (la matière ré-
pugne au mouvement)
Chez Descartes, ce que nous appelons inertie paraît correspondre à
deux formulations différentes (qui ne sont cependant pas deux concepts dif-
férents).
La première est celle que formule PP, II, 37 :
« La première loi de la nature : que chaque chose demeure en l’état
qu’elle est pendant que rien ne la change » […] « chaque chose en particulier
continue d’être en même état autant qu’il se peut, et [jamais] elle ne le
change que par la rencontre des autres ».
On la retrouve dans le « premier axiome du mouvement » des Princi-
pia mathematica :
« Tout corps reste en état de repos ou en mouvement uniforme en
ligne droite sauf s’il est obligé de modifier son état sous l’influence de forces
agissant sur lui »
Et également dans la 2e loi de la mécanique des Premiers principes
métaphysiques de la science de la nature de Kant :
« Tout changement dans la matière a une cause externe (chaque corps
persévère dans son état de repos ou de mouvement en conservant même di-
rection et même vitesse, quand une cause externe ne l’oblige pas à abandon-
ner cet état ».
La seconde est celle que formulent la lettre à Debeaune du 30 avril
1639 et la lettre à Silhon de mars ou avril 1648 (à Newcastle selon AT) :
« plus un corps contient de matière, plus il a d’inertie naturelle ».
Leibniz invite parfois à distinguer les deux formulations de l’inertie,
comme dans la proposition suivante :
« … mais une chose est de garder son état jusqu'à ce qu'il y ait
quelque chose qui mette en mouvement, ce que fait aussi ce qui est par soi
indifférent au mouvement ou au repos, autre chose, et qui implique beaucoup
plus est de n'être pas indifférent au mouvement mais d'avoir une force et
comme une inclination à garder son état et par là de résister à ce qui meut
[…] j'ai reconnu que la matière avait été créée par Dieu d'une façon telle qu'il
a inclus en elle une certaine résistance au mouvement, et, en un mot, une ré-
sistance par laquelle le corps s'oppose de lui-même au mouvement, et ainsi le
corps au repos a de l'aversion pour tout mouvement, tandis que le corps en
mouvement en a pour un mouvement plus grand, quand, dans les deux cas, il
s'agit du choc, bien sûr, de telle sorte qu'il diminue la poussée de l'autre » (à
de Volder, 3 avril 1699)
« Garder son état », c’est l’inertie telle qu’elle se définit en PP, II, 37.
« Avoir une force et comme une inclination à garder son état », c’est l’inertie
au sens des deux lettres de Descartes et au sens que Leibniz souligne dans le
passage ci-dessus). Parfois, les deux formulations se réunissent comme dans
le De ipsa natura, Schrecker, § 11 (Sur le second sens de l’inertie, voir aussi
© Philopsis – Pascal Dupond 65
www.philopsis.fr
« Extrait d’une lettre de M. Leibniz sur la question si l’essence des corps
consiste dans l’étendue » (1691), GF 2, p. 35).
Leibniz prend l’exemple de bateaux diversement chargés descendant
le courant, fait observable qu’il présente comme une attestation expérimen-
tale de l’inertie en tant que propriété fondamentale de la matière. La force de
gravitation étant la même pour tous, elle n’explique pas la différence de leur
vitesse. Mais elle fait que leurs poids sont différents en fonction de la densité
de la masse qu’ils transportent, et c’est cette différence qui cause celle des
vitesses.
Le commentaire de l’exemple est une sorte de reformulation du prin-
cipe d’inertie : « la matière est portée originairement à la tardivité ou à la
privation de la vitesse, non pas pour la diminuer par soi-même quand elle a
déjà reçu cette vitesse, car ce serait agir, mais pour modérer par sa réceptivi-
té l’effet de l’impression qu’elle doit recevoir ». Le cas observable
s’explique en effet très bien si l’on admet qu’il y a dans la matière « une es-
pèce de répugnance à être mue », que la physique moderne appelle l’inertie.
Le principe d’inertie, tel qu’il est repris ici, dénie bien à la matière,
toute capacité active, puisqu’il pose qu’un corps en repos ou en mouvement
reste en repos ou poursuit son mouvement avec même direction et même vi-
tesse si aucune cause extérieure ne vient le mettre en mouvement ou modi-
fier son mouvement.
Leibniz confirme sa présentation par un deuxième exemple de nature
plus proprement expérimentale : « il faut employer deux fois plus de force
pour donner une même vitesse à un corps de la même matière, mais deux
fois plus grand » − ce qu’on peut vérifier en laboratoire, mesures à l’appui.
Reste à établir l’analogie entre ces cas physiques et le concours phy-
sique de Dieu au mal.
Dans les deux cas considérés, il y a un principe actif (le courant ou la
force), dont l’effet se trouve diversifié non pas par un autre principe actif,
mais par la réceptivité de la matière à l’action dudit principe : « le courant
est la cause du mouvement du bateau, mais non pas de son retardement ».
À l’inertie de la matière correspond l’imperfection de la créature qui
consiste simplement à ne pas être incréée. On peut donc opérer une transpo-
sition métaphysique de la théorie physique : « Dieu est la cause du matériel
du mal, qui consiste dans le positif, et non pas du formel, qui consiste dans la
privation. (...) Et Dieu est aussi peu la cause du péché que le courant de la ri-
vière est la cause du retardement du bateau ».
La fin du § comporte une allusion évangélique qui donne à penser que
l’inertie matérielle est un aspect majeur de l’imperfection des créatures, en
qui « la chair » oppose une résistance à l’activité de « l’esprit ».
§ 32. Et c’est pourquoi on n’est pas obligé de dire que « Dieu est le
seul acteur », comme Malebranche. Ou plutôt on peut le dire mais dans un
sens qui n’est pas exactement celui de Malebranche : au sens où l’action, en
Dieu n’est pas mêlée de passion. Or cela n’implique pas que la créature soit
privée d’action. Leibniz l’établit en rappelant, comme dans DM 8, que tout
être réel est une substance qui produit ses modifications à partir de son
propre fond. Ces modifications sont soit passions (passage à une moindre
perfection), soit actions, passage à une plus grande perfection (DM XV)36.
36
Il y a en fait une très grande proximité entre la conception de Leibniz et celle de
Malebranche, car ils excluent l’un et l’autre une définition de l’action comme influence phy-
© Philopsis – Pascal Dupond 66
www.philopsis.fr
Le Discours de métaphysique pense l’action et la passion en référence
au concept d’expression ; une chose est dite active ou passive en proportion
du degré de distinction dans sa manière d’exprimer elle-même et le monde :
« Lorsqu'il arrive un changement dont plusieurs substances sont affec-
tées (comme en effet tout changement les touche toutes), je crois qu’on peut
dire que celle qui immédiatement par là passe à un plus grand degré de per-
fection ou à une expression plus parfaite, exerce sa puissance, et agit, et celle
qui passe à un moindre degré fait connaître sa faiblesse et pâtit ».
Les modifications privatives sont de deux espèces : certaines passions,
bien que fondées dans la spontanéité de la créature (qui tire tout de son
propre fond) ont leur raison dans une autre substance (ainsi quand l’action
en A est « cause » de la passion en B) ; dans ce cas, on dira qu’il s’agit d’une
co-variance dans les perfections que Dieu a communiquées aux créatures ;
d’autres sont fondées dans la spontanéité de la créature mais ont en outre
leur raison dans la créature, qui diminue d’elle-même sa perfection ; dans ce
cas le passage à une moindre perfection n’est pas seulement spontané, il est
libre.
La condition de ce paradoxal libre passage à une moindre perfection,
c’est qu’il y ait une distinction réelle entre la substance et ses modifications.
D’où la distance par rapport à Descartes : du point de vue cartésien, la
distinction entre la substances et ses modes peut être dite modale (la figure
par rapport à la substance étendue) ou formelle (l’attribut de l’étendue par
rapport à la substance étendue) mais il n’y a de distinction réelle qu’entre
substances (§§ 60-62 des Principes).
Le souci de Leibniz est d’accentuer l’écart entre la substance et ses
modifications. Les modifications d’une substance ne sont intelligibles que
quand elles sont « contextualisées », c’est-à-dire comprises comme des inte-
ractions idéales entre substances selon l’harmonie préétablie. Les modifica-
tions de chaque substance conspirent avec celles des autres, leur intelligibili-
té est « interactive » ; ce qui est passion dans l’une est action dans l’autre et
inversement. Cette situation de « conspiration » pourrait conduire à effacer
ou minorer la responsabilité des esprits vis-à-vis de leurs actes (la responsa-
bilité des actes serait en quelque sorte diluée dans l’interaction). Pour écarter
ce « risque », Leibniz dit ceci : oui, l’intelligibilité des modifications de la
substance relève d’un contexte interactif, mais la substance et ses modifica-
tions ne sont pas identifiables, il y a entre la substance et ses modifications,
une distinction réelle ; que les modifications soient « relationnelles » (par
l’harmonie préétablie) n’empêche pas que la substance les produise à partir
de son propre fonds (NE, I, I ,1 : « Toutes pensées et actions de notre âme
viennent de son propre fonds »), qu’elle en soit le sujet et qu’elle en soit par
conséquent, si elle est un esprit, responsable (la substance n’est pas réduc-
sique d’une substance créée sur une autre substance créée : l’apparence de cette influence
n’est pour Malebranche que la manifestation phénoménale de la correspondance que Dieu
établit entre des événements physiques ou psychiques, chacun n’étant pour Dieu qu’une occa-
sion d’exercer sa causalité. Leibniz n’enseigne pas vraiment autre chose, si ce n’est qu’il
substitue l’harmonie préétablie à l’interventionnisme qu’il prête au Dieu de Malebranche.
Mais le mouvement physique et la causalité motrice n’ont pour lui aussi qu’une réalité phé-
noménale.
© Philopsis – Pascal Dupond 67
www.philopsis.fr
tible à la totalité de ses modifications puisqu’elle est le principe un de leur
production. Voir aussi DM VIII. Leibniz dit : il est assez difficile de distin-
guer les actions de Dieu de celles des créatures ; on pourrait ajouter : il est
assez difficile de démêler, dans les actions des créatures, ce qui revient à
l’une et ce qui revient à l’autre ; pour écarter cette confusion, Leibniz énonce
une proposition qui a une portée logique, ontologique et morale : « les ac-
tions sont le fait des substances », il n’y a pas d’action sans agent produisant
son action.
Cette hypothèse de lecture peut être confirmée par les §§ 390-391.
Dieu, précise Leibniz, « produit [l’]essence [de la créature] avant ses acci-
dents, sa nature avant ses opérations… », et c’est pourquoi « la créature peut
être la vraie cause du péché » ; et le § 391 réaffirme la distinction réelle entre
la pensée ou la volition et la substance qui les produit.
« Le mal est donc comme les ténèbres… ». Image immémoriale, déjà
présente dans les mythes fondateurs comme dans les paroles initiales de la
philosophie. La lumière est une émanation du bien et permet à l’entendement
de le reconnaître ; les ténèbres sont l’image de l’aveuglement. Leibniz dis-
tingue trois modalités de l’aveuglement : l’ignorance, l’erreur et la malice ;
l’ignorance du vrai est l’origine de l’erreur comme l’ignorance du bien est
l’origine de la malice (le premier terme a, par rapport aux deux autres, le sta-
tut de condition, comme, mutatis mutandis, le mal métaphysique par rapport
au mal physique et au mal moral) ; l’ignorance du vrai devient erreur quand
l’esprit prend les apparences du vrai (qui sont le vrai relativement à une cer-
taine perspective, secundum quid) pour le vrai pur et simple (aplôs, simplici-
ter) et ne va pas plus loin ; l’ignorance du bien devient malice quand l’esprit
renverse l’ordre des biens, se porte vers des biens inférieurs comme s’ils
étaient supérieurs et se détourne des biens supérieurs. On voit donc que 1/
c’est le vrai de rang inférieur qui détourne du vrai de rang supérieur,
comme c’est le bien de rang inférieur qui détourne du bien de rang supé-
rieur ; 2/ le cas de l’erreur est le modèle d’intelligibilité du cas de la faute
(pour Descartes, c’est la faute qui fait comprendre l’erreur, pour Leibniz,
c’est l’erreur qui fait comprendre la faute : l’indistinction (la confusion) que
la perspective impose à la perception du vrai fait comprendre l’indistinction
que la perspective impose à la volonté du bien) ; 3/ le cas de l’erreur et le cas
de la faute, bien que distincts, communiquent : il n’est pas de perception qui
ne soit aussi appétition (l’entendement et la volonté ne sont pas séparables) ;
la perception tend par essence vers une plus grande distinction comme la vo-
lonté tend par essence vers un plus grand bien et un entendement qui « ne va
pas plus loin » dans l’ordre du vrai est aussi une volonté qui « ne va pas plus
loin » dans l’ordre du bien ; 4/ la malice ou la mauvaise volonté peut se
comprendre soit au sens d’un péché véniel soit au sens d’un péché mortel.
Le premier cas concerne la situation où on prend un bien inférieur pour un
bien supérieur, parce qu’on n’a pas une vue distincte des biens et de leur hié-
rarchie ; voir à ce sujet NE II, XXI, § 31 qui montre que le clair et le distinct
peuvent être en raison inverse : « les pensées confuses souvent se font sentir
clairement mais nos pensées distinctes ne sont claires ordinairement qu’en
puissance », p. 159). Le second cas est celui d’une volonté qui veut le péché,
qui hait Dieu et le Bien public. Le péché est toujours d’abord véniel : « nul
ne se fait mauvais volontairement, sinon il le serait avant de l’être devenu »
(« Conversation avec Sténon », GF 1 p. 124) ; mais la privation tend à des
© Philopsis – Pascal Dupond 68
www.philopsis.fr
privations nouvelles (en vertu d’un mouvement où la privation dans
l’entendement et la privation dans la volonté se relancent l’une l’autre ; et
ainsi le péché véniel peut devenir péché mortel par une sorte de sédimenta-
tion qui finit par aliéner la volonté à elle-même.
§ 33. La privation qu’est le mal est mise au compte de la passivité de
la créature. Dans la mesure où la volonté ne pèche qu’en visant un certain
bien, elle peut être mise, ainsi que le bien qu’elle vise et obtient, au compte
de la volonté divine : même en péchant, la volonté créée participe de la bonté
divine, mais défaille à mesure de sa passivité, soit de son manque d’activité.
§ 34. Pour que le mal agir relève d’une volonté mauvaise et soit ainsi
imputable à son auteur, il est nécessaire que s’y rencontrent la spontanéité et
la délibération et le choix, qui sont les deux composants de la liberté ou de
l’empire sur nos actions.
Leibniz se réfère à Aristote, EN, III, 1 à 4. Aristote distingue plusieurs
catégories d’actes du point de vue de leur rapport à la volonté :
- les actes involontaires au sens où ils sont forcés ou contraints (« …
si, par exemple on est emporté quelque part, soit par le vent, soit par des
gens qui vous tiennent en leur pouvoir »),
- les actes non volontaires au sens où ils sont accomplis par ignorance
(« dans l’ignorance des particularités de l’acte, c’est-à-dire de ses circons-
tances et de son objet ») et qui sont qualifiables comme involontaires quand
l’auteur en éprouve de l’affliction et du repentir (les actes accomplis dans
l’ignorance [par exemple de ce qui est avantageux ou non à l’agent]
n’entrent pas dans la même catégorie : ils sont volontaires),
- les actes volontaires, au sens où leur principe « réside dans l’agent
lui-même connaissant les circonstances particulières au sein desquelles son
action se produit » (c’est ce que Leibniz appelle spontanéité), et, parmi les
actes volontaires, Aristote distingue ceux qui sont accomplis par choix et qui
relèvent de la raison délibérative (il y aurait ainsi deux catégories d’actions
volontaires : celles qui sont simplement spontanées et que présentent les
animaux, les enfants et tous ceux qui agissent impulsivement et celles qui
sont à la fois spontanées et délibérées et choisies).
Reprenant les catégories aristotéliciennes, Leibniz distingue deux
conditions de la liberté : la 1e est qu’on ne nous force pas (spontanéité), la 2e
qu’on ne nous empêche pas d’avoir l’esprit libre (délibération) ; lorsqu’il y a
spontanéité sans délibération, la liberté disparaît, comme lorsque l’agent a bu
un breuvage qui lui ôte le jugement ou bien quand il est devenu fou. Mais
Leibniz ne s’engage pas ici dans une évaluation fine des degrés de responsa-
bilité dans les actes des êtres raisonnables. Dans les NE (II, XXI, § 8), il
ajoute que « on n’a point l’esprit libre quand il est occupé d’une grande pas-
sion car on ne peut point alors vouloir comme il faut, c’est-à-dire avec la dé-
libération qui est requise ».
La contingence est la condition nécessaire de la liberté mais non pas
sa condition suffisante : « il y a de la contingence dans mille actions de la
nature » : partout où la raison de ce qui a lieu (le bien ou le meilleur), est non
pas le principe de contradiction mais le principe de raison suffisante (c’est-à-
dire la volonté divine du meilleur)37 ; il y a liberté dans la spontanéité d’un
37
Leibniz se garde bien d’opposer d’un côté une supposée nécessité des processus na-
turels, et d’autre part la contingence que la liberté suppose. Cette dernière n’est possible que
parce qu’« il y a de la contingence dans mille actions de la nature ». Le Specimen scientiae
© Philopsis – Pascal Dupond 69
www.philopsis.fr
esprit créé quand la raison de ce qui a lieu se trouve en lui et dans sa volonté
du bien.
§ 35. La liberté ne consiste pas dans l’indifférence. Sur l’indifférence,
voir NE II, 1, § 15 p. 96-97 ; II, 21, § 25 p. 155 et § 47, p. 168, « Conversa-
tion sur la liberté et le destin, GF 3, p. 49, lettre à Coste, GF 3, p. 142-143 (et
les passages de la TH cités en GF 3 p. 60). L’indifférence se prend en deux
sens qui d’ailleurs se complètent : soit au sens de l’équilibre, soit au sens du
pouvoir de vouloir « non pas seulement ce qui plaît le plus mais encore tout
le contraire ». Leibniz traite ici de la 1e qu’il considère purement et simple-
ment comme fausse (la seconde doit être réinterprétée dans le sens de la
suspension du jugement38). L’indifférence d’équilibre est écartée par des ar-
guments logiques, métaphysiques et par l’expérience. Argument logique : la
liberté d’indifférence est auto-contradictoire (Supposons une inclination
égale pour A, B, C. l’inclination pour non A (qui rassemble B et C) est né-
cessairement double de l’inclination pour A, il n’y a donc pas indifférence).
Argument métaphysique : 1/ le principe des indiscernables (§ 49 ; voir aussi
Monadologie § 8 et NE, II, 27) ; un monde qui serait symétrique de par et
d’autre d’une ligne ou d’un plan (« tiré par le milieu de l’âne ») est une chi-
mère en raison du principe des indiscernables (Monadologie, § 8 et NE, II,
27) ; 2/ l’implication du prédicat dans la notion du sujet : l’esprit maintenant
n’est pas indifférent à sa notion perpétuelle » (RG p. 345) ; à relier à la théo-
rie des petites perceptions.
§§ 36-58. Liberté et détermination
generalis enseigne : « Toutes les actions des substances singulières sont contingentes. Car on
peut montrer qu’en cas que les choses se fissent autrement, il n’y aurait aucune contradiction
pour cela » (Gerhardt VII, p.110). Ce que nous appelons la nécessité naturelle n’est jamais
qu’une nécessité conditionnelle et non pas absolue, et elle est en cela même une forme de
contingence. La liberté de l’action volontaire n’est en fait rien d’autre que la conscience de
cette contingence, et par là même la conscience d’exercer une causalité qui n’est ni nécessité
ni nécessitante. On peut donc définir la liberté comme « une spontanéité jointe à
l’intelligence » (ibid., p.109), de sorte que, en l’absence d’intelligence, il n’y a pas de juge-
ment, et par suite pas de liberté alors même qu’il y a une contingence (MNL).
38
« Contra indifferentiam » : « L’esprit possède non seulement la faculté d’élire ceci
ou cela, mais également celle de suspendre son jugement. Il ne peut exister aucune apparence
du bien (si l’on excepte le souverain bien) qui soit si évidente que l’esprit ne puisse, s’il le
veut, à l’occasion d’une délibération, suspendre son jugement avant la décision ultime, ce qui
a lieu lorsque d’autres pensées s’offrent à lui et qu’il s’y accroche sans délibération, ou bien
lorsque, dans la délibération, il conclut qu’il doit davantage examiner certaines questions. Si
l’esprit ne se détourne pas de sa délibération, alors on peut savoir avec certitude ce qu’il choi-
sira : il est en effet certain qu’il choisira ce qui lui apparaîtra comme le meilleur, car il
n’existe aucun exemple du contraire. Mais qu’est-ce qui nous permet d’affirmer qu’il ne s’en
détournera pas ? ».
On retrouve la question de la suspension du jugement dans l’opuscule sans titre donné
par RG aux pages 339 et suivantes, particulièrement p. 344 : « Mais les substances libres ou
intelligentes ont quelque chose en plus et de plus admirable [que les corps], à l’imitation pour
ainsi dire de Dieu, qui fait qu’elles ne sont astreintes à aucune loi subalterne déterminée de
l’univers, mais qu’elles agissent spontanément à partir de leur seule puissance propre par une
sorte de miracle privé, et interrompent au vu d’une cause finale le lien et le cours des causes
efficientes sur leur volonté […] Et bien que ceci uniquement soit très véritable, que l’esprit ne
choisit jamais ce qui lui paraît le plus mauvais dans ce qui se présente à lui, toutefois il ne
choisit pas toujours ce qui lui paraît le meilleur, parce qu’il peut ajourner et suspendre le ju-
gement jusqu’à une délibération ultérieure en détournant l’âme vers d’autres pensées. Lequel
arrivera ne peut être assigné suffisamment par aucun indice ni par aucune loi prédéfinie… »
© Philopsis – Pascal Dupond 70
www.philopsis.fr
§ 36. « Les philosophes conviennent aujourd’hui… » (voir §§ 169 et
sv)
On voit apparaître dans ce § la difficile question, née avec le chapitre
9 de l’Hermeneia, du rapport entre la vérité d’une proposition et la modalité
ontologique de son objet.
Aristote soutient deux choses : 1/ concernant les événements futurs,
vérité dans la connaissance et nécessité dans l’être sont inséparables : si une
proposition visant un événement avenir est aujourd’hui vraie (ou fausse), si
sa vérité ou sa fausseté est déterminée avant l’événement, alors l’événement
en question est nécessaire ; il y a donc une sorte de parallélisme entre la
constitution de la connaissance (une proposition portant sur un événement
futur est aujourd’hui vraie ou fausse ou bien elle n’est ni vraie ni fausse) et la
constitution de l’être (l’événement est nécessaire ou l’événement est contin-
gent) (ôsper oi logoi, ôsper ta pragmata) ; 2/ il y a des raisons de penser que
certains événements futurs (ceux en particulier au milieu desquels nous
avons à agir) sont contingents (ils peuvent arriver ou ne pas arriver) et cela
implique que les propositions qui les énoncent n’ont pas avant l’heure de vé-
rité déterminée.
Les modernes dissocient la question de la vérité (dans la connais-
sance) et la question de la nécessité et de la contingence dans l’être. Ils sou-
tiennent que Dieu a une prescience, une pré-connaissance vraie au sujet
d’événements futurs qui sont pourtant contingents.
Leibniz apporte à la discussion le concept de détermination, qui est
d’origine mathématique, comme le montre par exemple la « Conversation
sur la liberté et le destin » (GF 3, p. 48) : tout est déterminé dans l’être
comme dans la vérité, mais cette détermination n’implique aucune nécessité
(voir aussi « De libertate, » GF 1 p. 330 : une vérité contingente est parfai-
tement déterminée, mais elle ne peut pas être démontrée : elle admet, pour sa
résolution un progrès à l’infini)
Vérité déterminée au sujet d’un événement futur signifie : la vérité de
la proposition visant cet événement est indifférente au temps39 : s’il est vrai
aujourd’hui que j’écris, il était vrai cent ans auparavant qu’aujourd’hui
j’écrirais et il sera vrai cent ans plus tard que j’aurai écrit (on admet sans dif-
ficulté cette intemporalité du vrai au sujet du passé, comme Descartes dans
la 3e Méditation : « … ou que quelque jour il soit vrai que je n’aie jamais été,
étant vrai maintenant que je suis » ; Leibniz soutient qu’on doit l’admettre
aussi au sujet du futur).
Contingence de l’événement signifie : l’événement peut être ou ne pas
être ; et pour pouvoir ainsi être ou ne pas être, il doit « surgir », passer du
non être à l’être (seul ce qui passe du non être à l’être est capable d’être ou
de ne pas être) et il doit donc être soumis au temps (en tant que condition du
passage du non être à l’être ou de l’être au non être).
La vérité est d’essence parménidienne : l’être est, le non être n’est
pas ; l’événement est d’essence héraclitéenne : le non être passe dans l’être
39
Aristote disait dans la Métaphysique que « l’être en puissance a beaucoup de la na-
ture de l’indéterminé », parce que c’est seulement à l’être actuel que s’applique le principe de
contradiction : sa discussion sur les futurs contingents le conduisait à exclure qu’il puisse faire
l’objet d’une vérité déterminée avant qu’ils se soient effectivement produits. L’affirmation
leibnizienne renverse cette position aristotélicienne : l’affirmation de l’événement futur est
déjà vraie à l’exclusion de son opposée avant l’événement lui-même.
© Philopsis – Pascal Dupond 71
www.philopsis.fr
comme l’être passe dans le non être. D’où la difficulté suivante : comment
ces deux plans peuvent-ils se correspondre (vérité comme adaquatio) et être
cependant aussi différents ?
Cette difficulté, c’est celle que Leibniz formule dans un passage diffi-
cile du « De la liberté » (GF 1, p. 328) : « si la notion du prédicat est conte-
nue pour un temps donné dans celle du sujet, comment sans contradiction et
impossibilité le prédicat peut-il alors quitter le sujet et celui-ci conserver sa
notion » ; je comprends ainsi : le prédicat « franchir le Rubicon » est, pour le
sujet César, essentiel et supra-temporel en ce qui concerne la vérité de la
proposition mais accidentel et contingent en ce qui concerne
l’événement, car le prédicat « franchir le Rubicon » n’appartient au sujet Cé-
sar, du point de vue de l’événement, que dans un moment précis de la ligne
du temps : il surgit dans l’être, et puis il disparaît… Comment accorder la
temporalité de l’événement et la supra-temporalité de la proposition vraie sur
l’événement40 ?
C’est à la résolution de cette difficulté que les §§ suivants sont consa-
crés, (voir § XIII du DM)
§ 37. Flux et reflux dans l’articulation des deux plans qui sont tantôt
plutôt ajointés, tantôt plutôt séparés.
1/ « Cette détermination vient de la nature même de la vérité… ». La
détermination de la vérité est fondée dans l’essence de la vérité (praedica-
tum inest subjecto) et cela n’a aucune incidence sur le plan de l’être : la véri-
té a sa propre nature, elle relève d’un autre ordre que celui des événements et
ne saurait donc nuire à la liberté.
2/ « … mais il y a d’autres déterminations qu’on prend d’ailleurs » :
certains fondent la détermination de la vérité sur la prescience divine, et sou-
tiennent que, sinon la détermination de la vérité, du moins la prescience di-
vine qui la fonde est « contraire à la liberté ». Leibniz esquisse ici une
double réponse.
La première se présente comme une concession limitée. Oui, si Dieu
prévoit que j’écrirai demain, comme Dieu est infaillible, cela ne peut man-
quer de se produire ; mais précise aussitôt Leibniz, il s’agit d’une nécessité
hypothétique ou conditionnelle (puisqu’elle est soumise à la condition de la
prévision divine) ; et cette nécessité conditionnelle n’exclut pas la contin-
gence de l’événement : un événement nécessaire en tant qu’il est l’objet de la
prescience divine peut être l’effet d’un choix libre (et en ce sens être contin-
gent). La formule « effet d’un choix libre » est équivoque et renvoie à la vo-
lonté de Dieu et à la volonté de l’homme (laquelle est la condition de
l’imputation). Les actions des esprits sont nécessaires (hypothétiquement) en
40
La fin du § comporte des définitions implicites qui précisent la notion de détermina-
tion en la distinguant de celle de certitude. Ce dernier terme a une connotation avant tout psy-
chologique : il qualifie l’état d’une conscience qui connaît le caractère déterminé de la vérité
qu’elle énonce. La détermination peut exister sans que telle ou telle conscience ait une certi-
tude à son sujet : c’est même la plupart du temps le cas, du moins si on considère la connais-
sance humaine, car seule la science divine connaît de façon certaine la totalité des vérités
énonçables. L’idée sous-jacente est que c’est le caractère déterminé de toute vérité en tant que
telle qui permet d’en avoir une connaissance certaine, et qui permet à Dieu d’avoir une certi-
tude intégrale. C’est pourquoi Leibniz trouve un bon sens à l’ignorance courante de la distinc-
tion philosophique entre détermination et certitude : il finit par dénommer la première « certi-
tude objective », parce qu’elle est ce qui rend un objet susceptible d’être connu de façon cer-
taine. On pourrait prolonger le propos en distinguant une certitude objective et une certitude
subjective.
© Philopsis – Pascal Dupond 72
www.philopsis.fr
tant qu’elles sont prévues mais non nécessaires absolument en tant qu’elles
sont voulues par Dieu (ce qui les rend contingentes) et par les agents spiri-
tuels (ce qui les rend imputables).
La seconde réponse revient un peu sur ce qui vient d’être accordé : la
prescience divine, considérée intrinsèquement n’exerce pas sur les événe-
ments une plus grande contrainte que la détermination de la vérité,
puisqu’elle n’en est rien d’autre que la connaissance. Reflux : autonomie des
deux ordres.
§ 38. Deux moments.
Le premier reformule la seconde réponse : la détermination de la véri-
té est la raison de la prescience et non pas la prescience la raison de la dé-
termination de la vérité ; et en cela « la connaissance du futur n’a rien qui ne
soit aussi dans la connaissance du passé et du présent » - entendons : concer-
nant le passé ou le présent, c’est la détermination de la vérité qui en rend
possible la connaissance ; la situation est la même concernant le futur et il
n’est pas question de renverser l’ordre des termes : ce n’est pas la prescience
de l’événement futur qui confère à l’événement une vérité déterminée, c’est
la vérité déterminée de l’événement futur qui en rend la prescience possible.
Le second est une objection : d’accord, ce n’est pas la prescience qui
rend la vérité déterminée, mais c’est la cause de la prescience ou le fonde-
ment de la prescience : il y a détermination de la vérité des événements fu-
turs parce qu’il y a prédétermination des événements futurs dans la nature
des choses (en DM XIII, le passage correspondant est : « on insistera que sa
nature ou forme répond à cette notion, et puisque Dieu lui a imposé ce per-
sonnage, il lui est désormais nécessaire d’y satisfaire ») ; et s’il y a pré-
détermination, alors il n’y a pas de vérité contingente et libre [exprimant une
action libre]
§ 39. Cette difficulté conduit à deux partis théologiques.
Les uns sont des pré-déterminateurs : si Dieu a une science certaine
des futurs contingents, alors il doit y avoir des prédéterminations nécessaires
dans les actions libres.
Les autres, les molinistes [Molina 1536-1600], cherchent à concilier la
prescience divine et la contingence, et à cette fin ils distinguent trois objets
de la science
1/ Les possibles sont l’objet de la science de simple intelligence (il
s’agit ici du possible considéré en soi, au sens de ce qui n’implique aucune
contradiction, abstraction faite de toute actualité et de toute compossibilité).
Leibniz accepte sans réserve ce concept d’une science de simple intelli-
gence : il le présente au § 14 de CD et l’illustre dans le mythe final de la
Théodicée par la figure de Pallas (§ 417). Voir aussi lettre à Jaquelot du 4
septembre 1704, qui montre bien le rôle que joue le concept dans la justifica-
tion de Dieu :
« Ce n’est pas à proprement parler ni la prescience de Dieu, ni son dé-
cret qui détermine la suite des choses, mais la simple intelligence des pos-
sibles dans l’entendement divin, ou l’idée de ce monde pris comme possible
avant le décret de choisir ou créer, de sorte que c’est la propre nature des
choses qui en fait la suite, antérieurement à tout décret. Laquelle Dieu ne veut
que réaliser en trouvant cette possibilité toute faite. Ainsi il ne faut qu’un seul
décret postérieur à cette suite, ne portant que le choix de ce monde possible,
parmi une infinité d’autres ».
© Philopsis – Pascal Dupond 73
www.philopsis.fr
2/ Les événements actuels sont l’objet de la science de vision. A nou-
veau, Leibniz accepte le concept : Dieu a une science de vision ou une pres-
cience de tous les événements présents, passés ou futurs, du monde qu’il a
créé. La science de simple intelligence de notre monde en tant que possible
et la science de vision de notre monde comme réel ne sont en rien différentes
si ce n’est que la seconde implique la connaissance réflexive que Dieu a de
son décret de le créer
3/ Les événements conditionnels sont l’objet de la science moyenne.
Chez les molinistes, la science moyenne est intermédiaire entre la
science de simple intelligence et la science de vision, c’est la connaissance
par laquelle Dieu prévoit la façon dont les hommes agiront librement, si une
certaine condition est réalisée : Dieu sait que si David cherche refuge dans la
ville de Kégila et si Saül en fait le siège, les habitants le livreront, et c’est
pourquoi Dieu le fait savoir par la voix de l’oracle à David, qui prend un
autre parti que celui de se réfugier à Kégila. L’objet de la science moyenne
(en l’espèce la décision libre des habitants de Kégila de livrer David, si Da-
vid cherche refuge en leur ville), ce n’est ni « l’événement pur et absolu »
(puisque, la condition n’étant pas, grâce à l’oracle, satisfaite,
l’événement prévu par la science moyenne (le choix des habitants de Kégi-
la) ne se produira pas, ni le simple possible (puisque l’objet est inséré, si l’on
peut dire, dans le tissu du monde réel).
Le concept de science moyenne est destinée à ouvrir une voie inter-
médiaire entre celle des prédéterminateurs et celle des pélagiens : le salut,
vient toujours d’une grâce que Dieu donne aux uns et non aux autres, mais
cette grâce, disent les molinistes, ne vient pas sans raison (contre les prédé-
terminateurs) ; certes elle ne vient pas récompenser un mérite que l’homme
aurait acquis par ses actes (œuvres ou foi vive) avant la grâce, mais elle va à
une prédisposition à recevoir la grâce : Dieu voit, dit Molina, ce que chaque
cause libre ferait de son plein gré dans chaque circonstance où elle pourrait
se trouver placée, il sait que l’un userait bien de son libre arbitre, l’autre non,
il sait que, s’il donne sa grâce à l’un, celui-ci la refusera, s’il la donne à un
autre, il l’acceptera, et il donne sa grâce à ceux qui ont une prédisposition
naturelle à la recevoir.
§ 41. Leibniz n’accepte pas la science moyenne au sens de Molina et il
la refuse
1/ pour une raison philosophique : un objet de science est nécessaire-
ment déterminé ; les actes contingents et libres n’y font pas exception : ils ne
peuvent être objet de science que si on les suppose « prédéterminés par les
décrets de Dieu » ; la décision des Kégilites n’est objet de science que si elle
est prédéterminée par les décrets de Dieu ; donc les actions libres condition-
nelles ne sont pas dans une autre situation que les actions libres actuelles ; ce
que Leibniz refuse chez les molinistes, c’est l’émergence d’une zone
d’indétermination dans l’être, à l’intersection du possible et du réel ; pour
Leibniz l’être, tout être est déterminé, qu’il soit possible ou actuel et
« notre » monde n’est pas moins déterminé dans son être possible (en tant
qu’objet de l’entendement de Dieu) que dans son être actuel (objet de la vo-
lonté de Dieu) ;
© Philopsis – Pascal Dupond 74
www.philopsis.fr
2/ pour une raison théologique, qu’il ne formule pas en son nom, mais
qu’il reconnaît certainement légitime : les molinistes n’est pas très éloigné
du pélagianisme.
§ 42. Comme toujours, Leibniz ne refuse pas une position sans en re-
tenir quelque chose à travers une réinterprétation. On peut donner à la
science moyenne des molinistes un bon sens. Soit on dira (CD 17) que la
science moyenne est la science des vérités contingentes41 (par contraste avec
la science de simple intelligence qui serait alors, non pas la science des pos-
sibles, mais celle des vérités nécessaires). Soit on dira que parmi l’infinité
des mondes possibles, il y en a un dans lequel David se réfugie à Kégila avec
tout ce qui s’ensuit : Saül fait le siège de la ville dont les habitants lui livrent
librement David ; et puis un autre, tout semblable sauf par l’hypothèse ini-
tiale et tout ce qui lui est lié (David ne se réfugie pas à Kégila, etc…). Il est
possible que David aille à Kégila (avec les conséquences qui en résultent) et
il est possible qu’il n’y aille pas, mais ces deux possibilités ne sont pas inté-
rieures à notre monde (dans lequel elles feraient apparaître un trou
d’indétermination), elles définissent deux mondes, dont l’un est devenu réel.
La conclusion du § reprend le fil des remarques du § 38 : il y a une
prescience des futurs contingents ; Dieu les connaît avec certitude ; le fon-
dement de cette certitude est la nature des choses ; mais cela ne nuit pas à la
liberté.
§ 43. De la position des molinistes, on peut retenir l’indépendance de
nos actions libres par rapport à la prescience divine, de celle des prédétermi-
nateurs, la dépendance des actions libres par rapport à la préordination de
Dieu, laquelle non pas détermine, mais « contribue à déterminer » la volonté
des êtres libres à vouloir ce qu’elle veut ; si Dieu déterminait la volonté des
êtres libres, ils n’auraient pas de volonté propre différente de celle de Dieu et
il n’y aurait pas de liberté ; s’il contribue seulement à la déterminer, c’est
que les créatures ont une volonté propre, qui peut s’opposer à la volonté de
Dieu. Quand la volonté d’un être raisonnable fait un choix, elle est plus in-
clinée à ce choix qu’à tout autre (et c’est pourquoi elle fait ce choix), mais
elle y est inclinée « par soi » et non par Dieu, elle y est inclinée par sa propre
essence, et elle est donc libre et responsable dans ce choix. Cette inclination,
cette détermination n’est pas une nécessité.
C’est pourquoi se propose une comparaison avec l’astrologie, mais
une comparaison bancale : quand on dit que la volonté est inclinée par
l’influence des astres mais sans que cette inclination soit nécessaire ou né-
cessitante, cela veut dire que leur influence est une partie des inclinations
dont la composition aboutit au choix ; quand on dit que la volonté est plus
inclinée au choix qu’elle fait mais sans que cette plus grande inclination soit
nécessitante, on veut dire que son inclination au choix qu’elle fait est déter-
minante mais qu’un autre choix serait possible, c’est-à-dire sans contradic-
tion, donc que le choix est contingent.
§ 44. « …Il y a deux grands principes de nos raisonnements ».
De ces deux principes, il existe différentes formulations.
Principe de contradiction. 1/ TH : « …le principe de contradiction qui
porte que, de deux propositions contradictoires, l’une est vraie, l’autre
fausse » ; 2/ Monadologie (§ 31) : « … celui de la contradiction, en vertu
41
Voir « De la liberté », GF 1 p. 333 : « Et ce que l’on nomme science moyenne n’est
rien d’autre que la science des possibles contingents »
© Philopsis – Pascal Dupond 75
www.philopsis.fr
duquel nous jugeons faux ce qui en enveloppe et vrai ce qui est opposé ou
contradictoire au faux ; 3/ « Sur la caractéristique et la science » (RG 161) :
« J’utilise deux principes dans mes démonstrations : selon le premier est
faux ce qui implique contradiction… » ; 4/ Echantillons de découvertes…,
GF 1, p. 289 : « …il y a deux principes premiers de tous les raisonnements, à
savoir le principe de contradiction : toute proposition identique est vraie et sa
contradictoire est fausse… » ; 5/ NE, IV, II, 1, p. 318-319 ; Leibniz montre
ici qu’il enveloppe deux énonciations vraies : a/ « le vrai et le faux ne sont
point compatibles dans une même proposition » ; b/ « il n’y a point de milieu
entre le vrai et le faux » ; Leibniz souligne aussi son rôle dans la démonstra-
tion : « les conséquences de logique se démontrent par les principes iden-
tiques et les géomètres ont besoin du principe de contradiction dans leurs
démonstrations qui réduisent à l’impossible ».
Principe de raison suffisante. 1/ TH : « l’autre principe est celui de rai-
son déterminante : c’est que jamais rien n’arrive, sans qu’il y ait une cause
ou du moins une raison déterminante, c’est-à-dire quelque chose qui puisse
servir à rendre raison a priori pourquoi cela est existant plutôt que de toute
autre façon… ». 2/ Monadologie : «… et celui de raison suffisante, en vertu
duquel nous considérons qu’aucun fait ne saurait se trouver vrai ou existant,
aucune énonciation véritable, sans qu’il y ait une raison suffisante pourquoi
il en est ainsi et non pas autrement ». 3/ « Sur la caractéristique et la
science » ((RG 161) : « …selon le second on peut rendre raison de toute vé-
rité qui n’est pas immédiate, c’est-à-dire identique, ou, en d’autres termes,
que la notion du prédicat est toujours dans la notion du sujet, que ce soit ex-
pressément ou implicitement, principe qui ne vaut pas moins pour les déno-
minations extrinsèques que pour les intrinsèques, pas moins pour les contin-
gentes que pour les nécessaires ». 4/ « 24 thèses métaphysiques » (RG, p.
467) : « Il y a dans la nature une raison pour laquelle quelque chose existe
plutôt que rien. C’est la conséquence de ce grand principe : rien ne se fait
sans raison… ».
Dans PNG, au § 11 (GF 3, p. 230), Leibniz distingue « principe de la
nécessité » et « principe de convenance ».
La dualité peut aussi s’estomper en faveur de l’unité, comme dans
l’opuscule « Sur la contingence » (GF 1, p. 317 et sv.).
Leibniz commence par distinguer vérités nécessaires et vérités contin-
gentes
Vérités nécessaires = propositions qui peuvent être démontrées par
l’analyse des termes, donc qui sont réductibles en identiques et dépendent du
principe de contradiction (GF 1 p. 317)
Vérités contingentes = propositions qui ne peuvent être ramenées au
principe de contradiction
Puis il ajoute : « il faut qu’il y ait quelque notion commune à
l’existence contingente et à la vérité essentielle » ; ce qui « est commun à
toute vérité », c’est « qu’on puisse toujours rendre raison d’une proposition
non identique, que cette raison est nécessitante pour les propositions néces-
saires et inclinante pour les propositions contingentes » (Id p. 317).
La comparaison de ces textes conduit aux remarques suivantes :
1/ Ce qui exige la distinction des deux principes, c’est la position
d’une différence entre deux ordres de vérité : les vérités nécessaires et les vé-
rités contingentes.
© Philopsis – Pascal Dupond 76
www.philopsis.fr
Parmi les vérités nécessaires, certaines sont indémontrables parce
qu’elles traduisent immédiatement l’axiome de contradiction sous la forme
de l’identité ; ce sont les « vérités primitives de raison » (NE, IV, II, 1 : « les
vérités primitives de raison sont celles que j’appelle d’un nom général iden-
tiques parce qu’il semble qu’elles ne font que répéter la même chose sans
nous rien apprendre »).
Les autres vérités nécessaires sont démontrables, ce qui veut dire ré-
ductibles en propositions identiques (RG p. 340 : « de même qu’on peut
montrer qu’un nombre plus petit est contenu dans un nombre plus grand en
les résolvant tous les deux jusqu’à la plus grande mesure commune, les pro-
positions essentielles, c’est-à-dire les vérités [il faut sous entendre : néces-
saires] sont aussi démontrées par une résolution menée jusqu’aux termes
dont on voit, d’après les définitions qu’ils sont communs aux termes ini-
tiaux ») ; et cette réduction fait voir que le contraire est contradictoire. Voir
aussi RG p. 339 : « Est absolument nécessaire une propositions qui peut être
résolue en identiques, ou dont l’opposé implique contradiction ». Les con-
cepts inhérents aux vérités nécessaires sont des abstraits conçus sub specie
possibilitatis (l’objet du mathématicien, c’est l’idée de la sphère et non pas la
sphère de pierre sur le tombeau d’Archimède).
Les vérités contingentes relèvent du raisonnement (Leibniz parle de
deux principes de nos raisonnements) mais
- leur opposé est possible ;
- elles portent sur des existants :
« Nous découvrons ainsi qu’autres sont les propositions qui se rappor-
tent aux essences, autres celles qui portent sur les existences des choses. Sont
essentielles les propositions qui peuvent être démontrées par la résolution des
termes ; autrement dit qui sont nécessaires, c’est-à-dire virtuellement iden-
tiques, et leur opposé est impossible ou virtuellement contradictoire. Elles
sont aussi des vérités éternelles, et elles ne vaudront pas seulement tant que le
monde subsistera, elles auraient valu également si Dieu avait créé le monde
selon un autre dessein. Mais les propositions existentielles, c’est-à-dire con-
tingentes, en diffèrent entièrement, elles dont la vérité n’est comprise a priori
que par le seul Esprit infini et ne peut être démontrée par aucune résolution.
Telles sont les propositions qui ne sont vraies que pour un certain temps et
qui n’expriment pas seulement ce qui a trait à la possibilité des choses, mais
ce qui existe aussi actuellement… » (RG 341)
- elles sont indémontrables, parce qu’elles ne sont pas réductibles en
identiques ou parce que la résolution va à l’infini ; mais bien qu’elles soient
indémontrables, il y a un fondement de leur vérité, qui est l’inclusion du pré-
dicat dans le sujet (lequel est un être réel et non un abstrait) ; voir RG 340 :
« Dans une vérité contingente, bien que le prédicat soit véritablement
dans le sujet, on ne parvient pourtant jamais à la démonstration, c’est-à-dire à
l’identité, quand bien même la résolution des deux termes serait indéfiniment
poursuivie ; il n’appartient qu’à Dieu seul qui comprend par un seul acte tout
l’infini, de voir complètement comment un terme est dans un autre et de
comprendre a priori la raison parfaite de la contingence. Pour les créatures,
l’expérience a postériori y supplée ».
© Philopsis – Pascal Dupond 77
www.philopsis.fr
Pour résumer : le principe de contradiction fonde la vérité des proposi-
tions nécessaires ou démontrables, au sens où il suffit à en établir la vérité ;
le principe de raison suffisante est le principe des propositions contingentes
au sens où il fonde la vérité de tout ce qui n’est pas démontrable.
On peut donc distinguer « prouver » et « démontrer » ; voir GF 1, p.
321, note 2 : « toute vérité qui n’est pas identique admet une preuve ; on
prouve une vérité nécessaire en montrant que le contraire implique contra-
diction, une vérité contingente en montrant qu’il y a davantage de raison en
faveur de ce qui arrive qu’en faveur de son opposé » ; démontrer, c’est prou-
ver en faisant voir que le contraire implique contradiction ou que la résolu-
tion conduit à une équation identique.
Les vérités nécessaires diffèrent des vérités contingentes comme les
nombres rationnels des nombres sourds :
« Les vérités nécessaires peuvent se résoudre en identiques, comme
les quantités commensurables à une commune mesure, mais dans les contin-
gentes comme dans les nombres sourds, la résolution va à l’infini et n’a ja-
mais de terme » (« Sur les secrets admirables de la nature… », GF 1 p. 289 ;
voir aussi « De la liberté », GF 1 p. 329-330)
2/ Quel est le domaine du principe de raison déterminante ? Selon le §
44, c’est ce qui arrive, ce qui « existe », les « événements » (donc tout ce qui
passe du non être à l’être ou de l’être au non être) D’où sans doute la distinc-
tion entre cause et raison : on cherche la cause de ce qui existe en tant
qu’événement ou en tant que passage du non être à l’être et la raison de ce
qui existe sans être événement (par exemple les lois de la nature, les lois de
la réfraction ou la loi de l’équilibre de poids égaux équidistants du centre du
fléau). Dans la Monadologie (32), Leibniz lui donne pour objet les faits, puis
le rend coextensif à toute énonciation véritable ; si le domaine du principe de
raison suffisante est celui de l’énonciation véritable, il peut inclure les véri-
tés nécessaires, et on dira alors, comme l’opuscule « sur la contingence » que
toute proposition relève d’une raison suffisante, soit nécessitante, soit incli-
nante. Dans le De originatione, même extension large du principe de raison
suffisante : il y a une raison a/ des choses éternelles ; b/ des choses im-
muables ; c/ de la série des choses changeantes (LP, p. 339).
3/ Le principe de raison déterminante est un axiome et un axiome uni-
versel : « on ne donnera jamais un exemple contraire » - « il ne souffre au-
cune exception, autrement sa force serait affaiblie ». Qu’est-ce qui prouve
qu’il ne souffre aucune exception ? il ne peut être question d’une vérification
empirique ; donc ce qui prouve son universalité, c’est sa nécessité a priori,
une nécessité qui ne peut pas être démontrée, puisqu’elle est la condition qui
rend possible qu’il y ait démonstration et en général vérité.
Le principe de raison suffisante est justifié par ce qu’on pourrait appe-
ler sa puissance heuristique (preuve de l’existence de Dieu, découverte des
lois de la nature)
§ 45. « Il ne faut pas s’imaginer avec quelques scolastiques […] que
les futurs contingents libres soient privilégiés » = relèvent d’une « loi pri-
vée » qui feraient exception à la règle générale de la détermination ou de la
raison suffisante.
La liberté n’exige pas l’indétermination ; mais elle exige 1/ que les
raisons inclinantes ne soient pas nécessitantes, autrement dit que le contraire
© Philopsis – Pascal Dupond 78
www.philopsis.fr
de ce qui est choisi soit possible ou qu’il y ait d’autres choix possibles que
celui qui est fait ; 2/ que ces raison inclinantes soient internes à l’esprit, au
sens où l’esprit incliné à agir par elles agit non par une cause étrangère mais
par soi et se détermine en vue d’un bien ou en vue de ce qu’il se représente
comme tel.
§ 46. L’idée de liberté d’indifférence est valable si elle veut dire que le
choix, dans l’être raisonnable, n’est pas nécessité par ses inclinations, mais
elle est fausse si elle signifie une indifférence d’équilibre, c’est-à-dire une
absence d’inclination : il n’y a jamais d’état de non inclination dans la volon-
té, la volonté est constamment mue ou portée de ce côté ci ou de ce côté là
par une infinité de grandes et de petites inclinations dont on ne connaît que
la résultante. Dans les êtres raisonnables, cette composition de petites incli-
nations agit comme une cause finale (bien que cette finalité s’inscrive elle
aussi dans une causalité « descendante » : la créature est « prédéterminée par
son état précédent ») : elle nous fait apparaître comme un bien un certain
mouvement, une certaine action à accomplir, vers laquelle nous nous portons
librement.
« Une cause ne saurait agir sans avoir une disposition à l’action … » :
l’action de la cause, la production de son effet est un événement qui exige
une raison suffisante ; cette raison suffisante se trouve soit dans la constitu-
tion « intérieure » de la cause, soit dans l’action d’une cause étrangère qui
détermine la première à la causalité.
Distance entre Spinoza et Leibniz : chez Spinoza, il y a là deux cas de
figure différents, et dont la différence est l’enjeu de l’éthique : ou bien je suis
déterminé à agir par l’ordre des rencontres, dont mon essence n’est pas la
cause adéquate, ou bien je suis déterminé à agir par ma propre essence ou
bien par ce qui est commun entre mon essence et celle des corps qui sont en
interaction avec le mien, et la sagesse est le passage de l’hétéro-
détermination à l’auto-détermination ; chez Leibniz, il n’y a pas à la rigueur
d’hétéro-détermination : tout ce qui survient à un être réel lui vient de son
propre fonds, spontanément, comme l’auto-développement temporel de sa
lex seriae, et cet auto-développement, dans les esprits, devient une causalité
par liberté.
§ 48. L’embarras des molinistes, leur difficulté à penser le passage de
l’indifférence (la pure et simple non détermination) à la détermination de la
volonté vient, pour Leibniz, de ce qu’ils manquent au principe de raison suf-
fisante.
Certains disent : c’est le privilège (la loi privée, particulière) de la
cause libre d’être capable de se déterminer ; Leibniz le refuse : « Je soutiens
qu’une puissance de se déterminer sans aucune cause , ou sans aucune racine
de la détermination, implique contradiction, comme l’implique une relation
sans fondement » (au P. Des Bosses) et même Leibniz se moque (« le privi-
lège d’être chimérique »), mais sa moquerie ne porte que si l’on valide la
portée universelle du principe de raison suffisante ; et dans cette moquerie, il
y a peut-être quelque chose qui se retourne contre Leibniz : une cause libre
pourrait bien être une chimère au sens où elle participe de l’être et du néant
(mais pour donner un sens à cette chimère, il faudrait renoncer à la convic-
tion (ou au préjugé ?) que partage Leibniz avec beaucoup d’autres, selon le-
quel le néant n’est rien… (Merleau-Ponty).
© Philopsis – Pascal Dupond 79
www.philopsis.fr
D’autres cherchent un moyen terme entre non détermination et déter-
mination et parlent d’une détermination virtuelle ; mais Leibniz refuse cette
solution : entre l’être et le néant, il n’y a pas de moyen terme ; si la détermi-
nation virtuelle est du côté de l’être, on demande comment elle a pu surgir
dans l’être à partir du néant ; et la difficulté est reportée plus loin. Bref,
comme Leibniz le dit dans le De originatione (§ 3), « la raison d’une exis-
tence ne saurait venir que d’une existence » ; le principe de raison suffisante
l’exige ; mais il se pourrait que donner satisfaction, en ce domaine, au prin-
cipe de raison suffisante, ce soit renoncer à la liberté…
§ 49. « … la question est sur l’impossible, à moins que Dieu ne pro-
duise la chose exprès ». Impossible signifie ici non pas intrinsèquement con-
tradictoire, car, en ce cas, Dieu ne pourrait pas produire la chose exprès,
mais plutôt contradictoire avec la perfection de l’univers. Un univers mi par-
ti aurait moitié moins de variété ou de richesse.
§ 50. Leibniz fait référence aux Principes de Descartes, 1e partie, 39 et
rejoint ici la critique spinoziste du libre arbitre cartésien. « Nous ne pouvons
pas sentir proprement notre indépendance », parce qu’une expérience portant
sur un objet négatif est une contradiction ; donc ce que nous appelons indé-
pendance, ce n’est rien d’autre que notre non perception des petites percep-
tions dont dépend notre choix ; si la pierre qui dévale la montagne était
consciente, elle aurait le sentiment d’être libre ; si l’aiguille aimantée était
consciente, elle pourrait penser que c’est de son plein gré qu’elle se tourne
vers le nord. Concession à Spinoza. Mais concession limitée : il n’est pas
question de s’en tenir à la conception spinoziste de la causalité ; on doit plu-
tôt revenir à Aristote : si la nature est un principe immanent de mouvement,
ce n’est pas seulement mais c’est surtout dans l’être raisonnable qui est « son
propre principe naturel par rapport à ses actions ».
§ 51. LE poursuit ici sa critique du faux concept de l’auto-
détermination. Quand nous voulons, l’objet du vouloir n’est pas une volition,
mais un mouvement, une action. En d’autres termes, on n’échappera pas à la
contrainte du principe de raison suffisante en disant que, dans le choix, la vo-
lonté se porte vers elle-même et veut sa volition, car 1/ cette façon de dire le
choix n’est pas conforme à la façon dont il se présente à notre conscience, 2/
c’est une fausse solution ; si on demande : d’où vient que la volonté veuille
sa volition ? on est engagé dans une régression à l’infini : elle veut sa voli-
tion parce qu’elle veut vouloir sa volition, et cela parce qu’elle veut vouloir
vouloir sa volition, etc.
§ 52. Paragraphe de récapitulation et de conclusion.
1/ Les futurs contingents sont déterminés (ce que Leibniz appelle futu-
rition), et ce principe de détermination vaut pour la totalité des êtres,
l’homme n’y fait pas exception. Cette futurition n’exclut pas la contingence
et la liberté, qui demandent, non pas que les événements soient indéterminés,
mai qu’ils ne soient pas nécessaires.
2/ L’homme est libre par son âme qui est un automate spirituel, la li-
berté est un automatisme spirituel. Le terme automate (auto-maô : se précipi-
ter de soi-même) renvoie à l’idée de mouvement spontané ; toutes les subs-
tances ou monades sont des automates au sens où toutes leurs actions et pas-
sions viennent de leur propre fond, sont produites par l’auto-développement
de leur essence et sont donc des prédicats inclus dans leur notion. Monado-
logie définit au § 18 la substance comme un « automate incorporel » ; au §
© Philopsis – Pascal Dupond 80
www.philopsis.fr
64, l’être vivant est présenté comme un automate naturel, dont les automates
artificiels sont des imitations très imparfaites ; la spiritualité de l’âme hu-
maine ne consiste pas seulement dans la non corporéité, elle consiste en ca-
pacités spécifiques (Voir Système nouveau, GF 2, p. 68 ; opuscule de mai
1702, GF 2, p. 177 ; PNG, § 14, GF 3, p. 231). L’idée d’automate spirituel
est reprise en TH III, § 403.
§ 53. Les contingents sont hypothétiquement nécessaires, nécessaires
sous la condition de la prévision et de la résolution de Dieu (« après la pré-
vision de Dieu ou après sa résolution, rien ne saurait être changé… ») ; les
actions libres le sont aussi, par rapport à Dieu ; mais, par rapport à l’agent
libre, on peut dire qu’elles ne le sont pas, au sens où la liaison causale ne fait
qu’incliner ; certes cette inclination vaut détermination, mais elle ne vaut dé-
termination qu’en vertu de « quelque chose de dehors » (« la maxime même
que l’inclination prévalente réussit toujours »). Le souci de Leibniz est de
focaliser l’attention sur ce moment d’inclination qui fonde la liberté et la
responsabilité.
§ 54. Les miracles et tout ce qui est censé y contribuer de la part de la
créature (comme la prière de l’aveugle-né : « Seigneur, fais que je voie ! »)
sont inclus dans l’ordre de ce monde, monde possible ou monde créé et exis-
tant. Dans notre monde en tant que possible, la prière est cause idéale ou la
condition idéale de son effet, la grâce de Dieu ; dans notre monde en tant que
créé, elle en est la cause réelle, non pas qu’elle agisse isolément sur la volon-
té du créateur : elle n’agit que comme élément différentiel du meilleur des
mondes possibles. Les miracles ne font pas exception à l’ordre de la nature,
ils ne dérogent qu’aux maximes subalternes de la nature (DM § 7)
§ 55. Doctrine stoïcienne des confatalia
Il n’y a pas d’incompatibilité entre la volonté et la causalité ; la volon-
té a besoin d’une cause pour pouvoir s’exercer, et c’est cette conception qui
libère du fatalisme, plutôt que la conception opposée de l’indifférence (début
du § 59).
« …qui ne doit pas être entendu de la réprobation, mais de la commi-
nation… ». Dieu ne change pas d’avis à la rigueur ; si cela a du sens de dire
que Dieu change d’avis si l’homme change d’avis, c’est kath’anthropon, au
regard de l’homme, avant l’action et comme une incitation à bien agir, et non
pas kath’aletheian ou au regard de Dieu, comme si Dieu se laissait sur-
prendre par l’homme et changeait d’avis après l’avoir vu agir.
Cette vérité kath’anthropon n’est d’ailleurs nullement négligeable :
elle définit notre situation ; nous ignorons si nous sommes prédestinés au sa-
lut ou non, donc nous n’avons qu’à agir comme nous le ferions si nous
l’étions ; l’homme ne peut pas se séparer de sa vie se faisant, il ne peut pas
prendre vis-à-vis d’elle une position de surplomb, il s’annonce donc à lui-
même ce qu’il est ou sera dans l’action, et l’ignorance de sa destination lui
est salutaire, car cela revient à dire qu’elle lui est confiée (Kant retrouvera
une idée analogue dans le primat de la raison pratique).
§ 57. Même idée au sujet du « terme péremptoire », c’est-à-dire du
terme après lequel le repentir n’est plus possible. Il est fixé dans les décrets
de Dieu, mais nous ne pouvons ni, ce qui est encore plus important, ne de-
© Philopsis – Pascal Dupond 81
www.philopsis.fr
vons le déterminer, car ce serait usurper un pouvoir qui n’est pas le nôtre et
ne pas estimer assez haut la liberté humaine42.
§ 59. Leibniz s’objecte une nouvelle difficulté, afin de montrer
l’aptitude de son système à y répondre.
La question est : comment ce qui permet d’échapper au fatalisme −
le fait que la volition soit hypothétiquement déterminée par l’apparence du
meilleur − peut-il ne pas supprimer la « spontanéité » de l’action ? Ou :
comment celle-ci peut-elle venir à la fois du sujet et des causes qui
l’expliquent ?
Pour établir que les actions volontaires sont dépendantes de leurs
causes et que cette dépendance est parfaitement compatible avec la liberté,
Leibniz doit préciser quelles sont les causes qui agissent sur la détermination
de la volonté sans contredire sa liberté. Sa thèse est que ce sont des causes
internes à l’agent considéré en tant qu’esprit et que par conséquent elles ne
relèvent ni de l’influence physique des autres créatures, ni de l’influence
physique du corps sur l’âme.
Sur l’harmonie préétablie, lire Système nouveau, GF 2, 72-75 + éclair-
cissements ; Considérations…, GF 3, 94-97.
« Les philosophes de l’Ecole croyaient… » (voir aussi GF 3, 94 : « les
péripatéticiens ont cru que les âmes avaient de l’influence sur les corps… » :
cette lecture est à la lettre fausse ; l’hylémorphisme, selon lequel l’âme est la
forme du corps, exclut une influence physique entre âme et corps.
« … depuis qu’on a bien considéré … ». La position cartésienne est
paradoxale ; Descartes soutient que l’âme n’est rien d’autre que res cogitans,
le corps rien d’autre que res extensa, donc qu’ils diffèrent toto genere (du
moins quand ils sont pensés selon leur notion primitive respective) et que
pourtant ils ont sont unis (ce dont nous avons une idée claire, à défaut d’être
distincte, dans la 3e notion primitive) ; Descartes disjoint les deux proposi-
tions que Leibniz présente comme inséparables. Mais les post-cartésiens cri-
tiquent la position cartésienne : si âme et corps diffèrent toto genere, toute
communication physique entre âme et corps est exclue. C’est la position de
Spinoza (Préface de la 5e partie de l’Ethique : « et certes n’y ayant aucune
commune mesure entre la volonté et le mouvement, il n’y aucune comparai-
son entre la puissance ou les forces de l’âme et celles du corps ») et c’est
aussi celle de Malebranche. Leibniz est d’accord avec la critique (bien que la
solution qu’il propose soit toute différente) : l’âme ne peut rien changer au
« degré de vitesse » et à la « ligne de direction » des mouvements du corps
comme le corps ne peut rien changer aux pensées de l’âme. Et on ne saurait
non plus invoquer une propriété inconnue de l’âme qui rendrait possible
l’influence physique (comme le suggère Elisabeth), car « rien ne nous [est]
mieux connue que l’âme » (cette proposition ne doit pas étonner chez un au-
42
On ne peut que penser ici à la célèbre formule ignatienne : « Haec prima sit agen-
dorum regula : sic Deo fide, quasi rerum successus omnis a te, nihil a Deo penderet ; ita ta-
men iis operam admove, quasi tu nihil, Deus omnia solus sit facturus » (MNL) [« Que la
première règle des hommes d’action soit la suivante : confie-toi à Dieu, comme si tout le
déroulement heureux des choses dépendait de toi, et aucunement de Dieu ; pourtant, applique
toute ton attention à ces choses (c.à.d. aux moyens), comme si tu ne faisais rien, et que Dieu
seul fît tout »].
».
© Philopsis – Pascal Dupond 82
www.philopsis.fr
teur qui pourtant admet qu’il y a des perceptions inconscientes : l’âme est
nécessairement consciente de sa nature représentative ou perceptive, bien
qu’elle ne soit pas consciente de toutes ses perceptions).
Mais si on refuse l’idée d’une communication physique (influence ré-
elle), on doit conserver l’idée d’une communication métaphysique : si l’âme
et le corps n’ont rien de commun, ne communiquent pas, l’unité de la per-
sonne disparaît (suppôt = suppositum = upokeimenon).
Pour penser cette communication, il faut renoncer aux prémisses car-
tésiennes et en particulier à l’identification du corps à la res extensa ou à ce
que Leibniz appelle « masse corporelle ».
§ 60. Leibniz fait valoir que Descartes a manqué à ses propres prin-
cipes en admettant, pour rendre compte du mouvement volontaire, d’une in-
fluence de l’âme sur les mouvements corporels.
Certes, Descartes avait vu la difficulté et avait cherché à y échapper
en restreignant le pouvoir de l’âme pour le rendre compatible avec les prin-
cipes de sa physique. Parmi ceux-ci il y avait une affirmation en fait erronée,
et dont Leibniz rappellera ensuite la réfutation : le principe de conservation
de la quantité de mouvement (soit du produit mv de la masse par la vitesse).
Descartes affirmait, par exemple dans les Passions de l’âme, que l’âme ne
modifie en rien la quantité du mouvement, mais seulement sa direction, opé-
ration qui s’effectue selon lui dans la trop fameuse glande pinéale, dont Spi-
noza se moque vivement au début de la 5ème partie de son Éthique.
À cette pseudo-explication, Leibniz oppose que tous les change-
ments de direction observables dans les mouvements corporels ont pour
cause l’influence mécanique de certains corps, telles les parties du harna-
chement d’un cheval. Pour rester fidèle à lui-même, Descartes aurait dû ad-
mettre que l’âme ne peut pas plus réorienter le mouvement d’un corps
qu’elle ne peut lui donner un surcroît de force : « outre que l’influence phy-
sique de l’une de ces substances sur l’autre est inexplicable, j’ai considéré
que, sans un dérangement entier des lois de la nature, l’âme ne pouvait agir
physiquement sur le corps » (§ 61). Cf. Spinoza, Éthique, III, prop. II). Ce
qui chez Descartes permettait de soustraire l’âme à l’influence du corps et de
sauver sa liberté a pour rançon que le corps doit être lui aussi soustrait au
pouvoir de l’âme, sauf à introduire une contradiction dans l’explication phy-
sique du monde corporel.
§ 61. « …deux vérités importantes sur ce sujet… » = deux décou-
vertes récentes qui constituent des réfutations de la mécanique cartésienne.
1/ Il n’y a pas conservation de la quantité de mouvement, mais con-
servation de la force ; voir DM 17 et TH § 345
Le texte de référence pour la formule cartésienne de conservation est
PP II, 3643. Descartes établit dans l’article 4 que la matière n’est rien d’autre
que substance étendue ; puis il établit dans l’article 25 que le mouvement est
le transport d’une partie de la matière d’un lieu dans un autre ; puis il établit
43
Brunschvicg écrit : « L’originalité de la physique cartésienne, qui la rendait incom-
parable à l’œuvre de ses émules, et qui contraignait un Leibniz au même aveu d’admiration
qu’un Pascal, c’est d’avoir considéré l’univers tout entier comme un système conservatif,
d’avoir osé en faire tenir l’équation en une formule simple : le mouvement – que mesure le
produit de la quantité de volume (ou masse) par la vitesse – demeure dans le monde en
somme constante » (L’expérience humaine…, p. 206)
© Philopsis – Pascal Dupond 83
www.philopsis.fr
dans le § 36 que la quantité de mouvement d’un mobile est égale au produit
de la vitesse par la grandeur de ce mobile ou masse (m . v) et « que Dieu est
la première cause du mouvement, et qu’il en conserve toujours une égale
quantité en l’univers » ; cette quantité de mouvement peut se trouver répartie
de façon variable entre les différents corps qui composent l’univers, mais à
l’échelle de l’ensemble de l’univers, et en raison de l’immutabilité divine,
elle se conserve.
Leibniz reconnaît avoir d’abord suivi Descartes, mais reconnu ensuite
« en quoi consiste la faute » : C’est la force qui se conserve et non pas la
quantité de mouvement, et ce qui le prouve, c’est, comme dit DM 17, non
seulement la raison (« il est bien raisonnable que la même force se con-
serve » : il est conforme à la sagesse de Dieu qu’il y ait égalité entre cause et
effet) mais c’est aussi l’expérience ou les faits (« …quand on prend garde
aux phénomènes »)
Sur la réfutation de Descartes, voir :
- Réplique à l’abbé Conti sous forme de lette à Bayle :
« En cas qu’on suppose que toute la force d’un corps de quatre livres,
dont la vitesse (qu’il a par exemple en allant dans un plan horizontal, de
quelque manière qu’il l’ait acquise) est un degré doit être donnée à un corps
d’une livre, celui-ci recevra non pas une vitesse de quatre degrés suivant le
principe cartésien, mais de deux degrés seulement, parce qu’ainsi les corps
ou poids seront en raison réciproque des hauteurs auxquels ils peuvent mon-
ter en vertu des vitesses qu’ils ont ; or ces hauteurs sont comme le carré des
vitesses. Et si le corps de quatre livres avec sa vitesse d’un degré, qu’il a
dans un plan horizontal, allant s’engager par rencontre au bout d’un pendule
ou fil perpendiculaire, monte à une hauteur d’un pied, celui d’une livre aura
une vitesse de deux degrés afin de pouvoir (en cas d’un pareil engagement)
monter jusqu’à quatre pieds. Car il faut la même force pour élever quatre
livres à un pied et une livre à quatre pieds. Mais si ce corps d’une livre devait
recevoir quatre degrés de vitesse, suivant Descartes, il pourrait monter à la
hauteur de seize pieds. Et par conséquent la même force qui pouvait élever
quatre livres à un pied, transférés sur une livre, le pourrait élever à seize
pieds. Ce qui est impossible ; car l’effet est quadruple, ainsi on aurait gagné
et tiré de rien le triple de la force qu’il y avait auparavant ».
- DM 17 : réfutation par Leibniz (par raisonnement expérimental sous
forme d’expérience imaginaire)44
Conclusion : 1/ « Quoi qu’i se trompe dans sa physique en posant pour
fondement la conservation de la même quantité de mouvement, [Descartes] a
donné occasion par là à la découverte de la vérité, qui est la conservation de
la même quantité de force, qu’on sait être différente du mouvement ».
44
Le raisonnement de Leibniz s’appuie sur deux hypothèses (acquis scientifiques an-
térieurs). 1/ L’énergie cinétique acquise par un corps dans le mouvement de chute suffit à le
faire remonter jusqu’à l’altitude initiale. C’est ce que montre le pendule. Cette proposition a
été établie par Huygens dès 1669. 2/ La force est proportionnelle au produit de la masse par le
déplacement : il faut une force égale pour élever un corps de 1 livre à 4 toises que pour élever
un corps de 4 livres à 1 toise ; cette proposition est énoncée par Descartes en 1637. Pour la
déduction détaillée, on se reportera au commentaire de ce § 17 par Michel Nodé-Langlois
(Commentaire du Discours de métaphysique).
.
© Philopsis – Pascal Dupond 84
www.philopsis.fr
2/ La formule cartésienne de conservation n’est vraie qu’à titre de cas
particulier, dans la statique :
« Ce qui a contribué le plus à confondre la force avec la quantité de
mouvement, est l’abus de la doctrine statique. Car on trouve dans la statique
que deux corps sont en équilibre lorsque, en vertu de leur situation, leurs vi-
tesses sont réciproques à leurs masses, ou quand ils ont la même quantité de
mouvement… Cela, dis-je, arrive seulement dans le cas de la force morte, ou
du mouvement infiniment petit que j’ai coutume d’appeler sollicitation, qui a
lieu lorsqu’un corps pesant tâche à commencer le mouvement, et n’a pas en-
core conçu aucune impétuosité ; et cela arrive justement quand les corps sont
dans l’équilibre et, tâchant de descendre, s’empêchent mutuellement. Mais
quand un corps pesant a fait du progrès en descendant librement, et a conçu
de l’impétuosité ou de la force vive, alors les hauteurs auxquels ce corps
pourrait arriver ne sont point proportionnelles aux vitesses mais comme les
carrés des vitesses »
La deuxième découverte invoquée contre Descartes est celle de la
conservation de la direction globale des mouvements corporels, qui apparaît
comme une généralisation de la loi de composition déjà mentionnée à la fin
du § 22.
Conséquence : Leibniz souligne l’impasse cartésienne. Descartes pen-
sait 1/ que l’essence de l’âme est différente toto genere de celle du corps, 2/
que cette différence garantit (métaphysiquement) sa liberté malgré l’union
factuelle au corps, 3/ qu’elle peut changer la direction des mouvements qui
se font dans le corps, à défaut de changer la quantité de force ; or 1/
l’indépendance essentielle et l’union factuelle donnent à l’âme une situation
contradictoire : « la volonté est tellement libre de sa nature, qu’elle ne peut
jamais être contrainte » (PA 41), mais « souvent l’indisposition qui est dans
le corps empêche que la volonté ne soit libre » (à Elisabeth, 1e septembre
1645) ; 2/ ce qui soustrait l’âme à l’influence du corps ne peut manquer,
comme le souligne Spinoza, de soustraire le corps à l’influence de l’âme ; 3/
l’âme ne peut pas plus changer la direction des mouvements que la quantité
de force.
Refus aussi de la solution de Malebranche : la théorie des causes occa-
sionnelles (« Dieu s’emploie tout exprès pour remuer les corps comme l’âme
le veut, et pour donner des perceptions à l’âme comme le corps le de-
mande ») « introduit des miracles perpétuels… ». Malebranche et Leibniz
n’acceptent pas plus l’un que l’autre qu’il y ait des miracles perpétuels dans
le cours de la nature, mais ils n’ont pas exactement la même idée du miracle.
Pour Malebranche, le miracle est une exception à l’ordre général, il requiert
une volonté particulière de Dieu. Or comme Dieu a établi des lois générales
de correspondance entre les états de l’âme et les phénomènes corporels, il ne
fait aucun miracle lorsqu’il fait correspondre une sensation à l’excitation
d’un organe sensoriel. Pour Leibniz, le miracle n’est pas une exception à
l’ordre général, car il n’y a aucune exception à l’ordre. Il y a donc miracle à
chaque fois qu’un phénomène excède les maximes subalternes de la nature,
c’est-à-dire se produit sous l’effet d’une action qui dépasse les forces de la
nature (voir la lettre à Hartsœcker, GF 3, p. 173 : « la volonté de Dieu opère
par miracle, toutes les fois qu’on ne saurait rendre raison de cette volonté et
de son effet par la nature des objets »). L’intervention divine telle que Male-
© Philopsis – Pascal Dupond 85
www.philopsis.fr
branche la comprend est donc, pour Leibniz, miraculeuse, même si elle est
parfaitement régulière : il s’agit d’un miracle perpétuel.
§ 62. Le principe de « l’harmonie en général » est celui de l’unité de
tout le divers : le monde est infiniment multiple et pourtant il est unité.
Le principe de la préformation est celui qui correspond, sur le plan de
l’être, à l’axiome praedicatum inest subjecto : tout moment ultérieur du de-
venir d’une substance est inscrit dans ses phases antérieures ; toute
l’humanité est préformée dans la semence d’Adam, tout le devenir du monde
est préformé dans l’instant initial de sa création.
Le principe de l’harmonie préétablie est celui de l’accord de toutes les
substances entre elles (ce qui survient à l’une est toujours dans un rapport
réglé avec ce qui survient à toutes les autres), et celui de l’accord entre les
ordres ou les plans de l’être : la nature et la grâce, les décrets de Dieu et les
actions humaines, entre les parties de la matière (qui ne sont métaphysique-
ment parlant que des monades)
L’harmonie préétablie entre l’âme et le corps en est une application
particulière. Elle se présente comme une correspondance entre deux séries
co-variantes : psychique et physique. Cette correspondance n’exclut pas la
prééminence d’une série sur l’autre : « Dieu a créé l’âme d’abord… ». On ne
doit pas imaginer ici une antériorité chronologique ; il s’agit d’une antériori-
té de raison : âme et corps sont inséparables ; ce qui a lieu dans l’âme dans
l’ordre des causes finales correspond exactement à ce qui a lieu dans le corps
dans l’ordre des causes efficientes ; mais le 1e ordre est la raison du 2e. Cette
antériorité logique des causes finales sur les causes efficientes rappelle en
outre que l’ordre dans lequel s’exerce la première (les substances et leurs
perceptions et appétitions) est plus réel que celui où s’exerce la seconde (les
corps qui ne sont, dans leur essence et leurs relations que des phénomènes
bien fondés), il est même en un sens seul réel45.
45
On a affaire ici à une sorte de parallélisme psychophysiologique très semblable à
celui qu’enseigne Spinoza dans la 3ème partie de l’Éthique. Ce parallélisme a toutefois une si-
gnification essentiellement différente de celui de Spinoza. Ce dernier tient en effet pour illu-
soire toute idée de détermination téléologique : l’âme est comme le corps déterminée selon
l’ordre d’une pure efficience dépourvue de finalité. Le parallélisme leibnizien consiste, lui, à
penser la coïncidence exacte du mécanisme corporel et de la finalité psychique : « Les âmes
agissent selon les lois des causes finales par appétitions, fins et moyens. Les corps agissent se-
lon les lois des causes efficientes ou des mouvements. Et ces deux règnes, celui des causes ef-
ficientes et celui des causes finales sont harmoniques entre eux » (Monadologie, § 79). Or la
téléologie psychique a évidemment une priorité ontologique, car elle concerne non seulement
l’âme, mais toute substance, que son appétit fait tendre et conspirer à la réalisation de l’ordre
du monde. En revanche, les mouvements corporels et leur explication mécanique sont seule-
ment d’ordre phénoménal et non pas substantiel. Le parallélisme leibnizien fait ainsi coexister
une ontologie de la substance, qui est une métaphysique de l’immatériel, et une physique mé-
caniste, et en outre il subordonne la seconde à la première. Ainsi, dans le Discours de méta-
physique, il reproche à Descartes d’avoir voulu éliminer les formes substantielles − « natures
incorporelles » (§ 22), comme les monades leibniziennes −, mais il précise que « ces formes
ne changent rien dans les phénomènes et ne doivent pas être employées pour expliquer les ef-
fets particuliers » (§ 10). Au § 18, il précise : « quoique tous les phénomènes particuliers de la
nature se puissent expliquer mathématiquement ou mécaniquement par ceux qui les enten-
dent, (...) néanmoins les principes généraux de la nature corporelle et de la mécanique même
sont plutôt métaphysiques que géométriques, et appartiennent plutôt à quelques formes ou na-
tures indivisibles comme causes des apparences qu’à la masse corporelle ou étendue ». Les
« principes généraux » dont il s’agit ici sont ceux de la métaphysique leibnizienne, sous ses
deux aspects d’ontologie monadologique et de théisme créationniste. Et l’expression « causes
des apparences » ne signifie aucunement que les substances simples − « natures indivisibles »
© Philopsis – Pascal Dupond 86
www.philopsis.fr
On observera l’entrée en jeu du concept d’image, qui est manifeste-
ment médiateur entre l’ordre des pensées et de leur enchaînement selon les
causes finales et l’ordre des impressions et de leur enchaînement selon les
causes efficientes. Car même s’il n’y a qu’une causalité idéale entre l’âme et
le corps, il n’en faut pas moins rendre raison du phénomène de leur intersec-
tion dans la sensibilité et le mouvement volontaire ; et c’est le phénomène de
cette intersection que Leibniz appelle « image » (quand Leibniz parle
d’impressions des corps sur nos organes, le terme, qui est équivoque doit
s’entendre au sens matériel).
§ 63. L’harmonie préétablie entre l’âme et le corps (et la compatibilité
de la liberté avec le mécanisme corporel) sont illustrés par une fiction qui est
reprise d’un théologien protestant dont le nom est mentionné au § 79 du Dis-
cours comme celui d’un adversaire de Bayle. La fiction met en scène un
maître, un être omniscient qui sait tout des ordres que ce maître donnera le
lendemain à son valet, et ce valet qui n’est pas un être libre mais un auto-
mate programmé pour répondre parfaitement aux ordres que lui donne son
maître : Dieu, l’âme, le corps. L’âme est responsable des actes que le corps
accomplit, elle en est la raison, comme le maître est responsable des actes de
son valet, bien qu’elle n’en soit pas la cause réelle, comme le maître n’est
pas la cause réelle des actes de son valet automate.
§ 64. Implications morales de l’indépendance ontologique de l’âme :
le pouvoir indirect de l’âme sur ses passions
Ethique à Nicomaque, III, 7. Les passions sont involontaires mais ne
sont pas pour autant soustraites à notre responsabilité car l’âme peut acquérir
des habitudes, les vertus morales qui modèrent les passions. Le pouvoir de
l’âme sur ses passions est donc indirect : l’âme se donne, avant que la pas-
sion ne surgisse, la disposition qui en limitera les effets. Ce pouvoir est le
pouvoir d’une partie de l’âme sur elle-même : le pouvoir d’une partie de la
partie rationnelle de l’âme (la volonté comme appétit rationnel) sur une par-
tie de la partie non rationnelle de l’âme (l’affectivité) qui, à la différence de
la partie végétative, peut soit obéir, soit résister à la raison.
Chez Descartes, situation toute différente : la passion n’est pas « intra-
psychique » ; elle est une modalité de la relation entre l’âme et le corps ;
lorsqu’une passion se produit dans l’âme, l’agent est le corps. D’où la cri-
tique d’Aristote à l’art 47 : « ce n’est qu’en la répugnance, qui est entre les
mouvements que le corps par ses esprits, et l’âme par sa volonté, tendent à
exciter en même temps dans la glande, que consistent tous les combats qu’on
a coutume d’imaginer entre la partie inférieure de l’âme, qu’on nomme sen-
sitive, et la supérieure qui est raisonnable : ou bien entre les appétits naturels
et la volonté ». L’a. 48 indique quelles sont les « armes » propres à l’âme qui
la rendent capable d’acquérir « un pouvoir absolu sur ses passions » (titre de
l’a. 50). Il s’agit, comme dans le stoïcisme, de la rectification des opinions :
« Ce que je nomme ses propres armes, sont des jugements fermes et déter-
minés touchant la connaissance du bien et du mal, suivant lesquels elle a ré-
solu de conduire les actions de sa vie ». Et l’a. 50 retrouve le rôle qu’Aristote
donnait à « l’habitude », ici pensée comme une transformation des disposi-
tions naturelles.
− influent sur les phénomènes physiques, mais plutôt qu’elles sont le fondement de leur appa-
rence phénoménale, c'est-à-dire de leur perception par l’âme (MNL).
© Philopsis – Pascal Dupond 87
www.philopsis.fr
En résumé, Descartes pense que l’âme est indépendante du corps
substantiellement, qu’elle en est cependant dépendante dans la vie, tout en
pouvant s’en affranchir par la maîtrise des passions.
Leibniz renchérit sur Descartes dans le sens de l’indépendance : l’âme
est absolument indépendante du corps. Dès lors il n’est plus question de
comprendre la passion au sens d’une causalité réelle du corps sur l’âme. Ce
refus de la conception cartésienne de la passion reconduit Leibniz vers Aris-
tote et vers l’idée d’une passion intrapsychique mais avec quelque chose de
nouveau qui est l’intervention de l’idée d’inconscient.
« Tout ce qui arrive à l’âme dépend d’elle… » : c’est la spontanéité ;
« … mais il ne dépend pas toujours de sa volonté, ce serait trop ».
Leibniz ne comprend la volonté ni comme Descartes ni comme Spinoza.
La volonté n’est pas ce que Descartes pensait, c’est-à-dire une puis-
sance infinie ou indifférente de se déterminer en faveur de tel ou tel motif
que l’entendement lui présente ; la volonté n’est pas une faculté qui serait
comme en surplomb par rapport à ses propres motifs ; voit à ce sujet les
« Remarques sur le livre de l’origine du mal, § 16 : « on veut que la volonté
soit seule active et souveraine… »).
La volonté n’est pas non plus un nom générique pour désigner les
volitions particulières qui seraient seules véritablement réelles (voir lettre II
de Spinoza à Oldenburg, GF p. 124-125 : « … si bien que l’impossibilité est
la même de concevoir la volonté comme la cause d’une volition déterminée
et l’humanité comme la cause de Pierre ou de Paul »), car cela rend la liberté
impossible.
Pour Leibniz la volonté est le pouvoir de former des volitions parti-
culières, des appétitions naissant de la perception d’un bien et d’un mal. Voir
analyses exposées précédemment46. Leibniz ne distingue pas comme Des-
cartes entendement et volonté : les facultés ne sont pas des « agents réels »
(NE, II, 21, § 6) - « Ce ne sont pas les facultés ou qualités qui agissent, mais
les substances par les facultés » (Id) ; entendement et volonté sont deux as-
pects complémentaires et étroitement solidaires d’une causalité unique, celle
de la substance intelligente [« omnis autem actio animi est cogitatio, nam et
velle nihil aliud est quam cogitare rei bonitatem », Eléments de droit natu-
rel]. Ce qui arrive à l’âme ne dépend pas de sa volonté lorsque ce n’est pas
une action proprement dite, c’est-à-dire un événement relevant de sa délibé-
ration et de son choix.
« Il n’est pas même toujours connu de son entendement » cette pro-
position est la raison de la précédente et en même temps elle en élargit le
champ ; l’entendement est la faculté des perceptions distinctes ou apercep-
tions ; quand l’âme n’a pas de perceptions distinctes, quand ses perceptions
ne relèvent pas de l’entendement, comme dans un évanouissement, elle ne
peut pas non plus exercer sa volonté.
46
Dans la créature, la volonté est soit puissance active ou faculté, soit activité ; cette
activité est elle-même soit effort (conatus) soit action. La volonté comme faculté correspond à
ce que la dynamique appelle force primitive ; elle est le pouvoir d’agir conformément aux re-
présentations du bien et du mal (elle n’est donc pas une puissance nue, elle est inclinée vers ce
que l’entendement représente comme bon) ; elle est une forme de la faculté appétitive : elle
est ce que devient dans un être capable d’intelligence et de réflexion l’appétit insensible des
simples monades. Cette faculté est une force qui produit les volitions successives, c’est-à-dire
« l’effort ou la tendance (conatus) d’aller vers ce qu’on trouve bon et contre ce qu’on trouve
mauvais » (NE II, XXI, 146).
© Philopsis – Pascal Dupond 88
www.philopsis.fr
Il y a dans l’âme des perceptions distinctes et des perceptions con-
fuses (voir NE, Préface, p. 38-39, voir aussi Monad. §§ 14 et 15), lesquelles
peuvent être soit des petites perceptions inconscientes, soit un assemblage de
petites perceptions que l’âme ne peut pas apercevoir distinctement ; quand
l’âme est sous l’empire des perceptions confuses, elle est en situation de pas-
sion ou d’esclavage, au sens où elle est incapable de choisir de façon délibé-
rée et réfléchie.
Le pouvoir de l’âme sur elle-même est indirect : elle peut modifier in-
directement ses perceptions indistinctes et même ses perceptions distinctes.
§ 65. Voir aussi TH III, § 288. Double condition de la liberté : la spon-
tanéité et l’intelligence, capable de discerner le bien et le mal moral. La li-
berté est impliquée dans l’essence des créatures raisonnables possibles et la
création ne fait qu’actualiser cette liberté ; il y a dans l’entendement de Dieu
un Sextus possible qui est (librement) méchant et si ce Sextus méchant ap-
partient au meilleur des mondes, il entre dans l’existence et y est librement
méchant ; la création divine n’est pas responsable de cette méchanceté (TH,
III, § 416)
« l’âme dépend en quelque manière du corps et des impressions des
sens… ».
L’âme est une expression finie de l’univers entier, elle connaît tout
mais confusément (PNG § 13 : « chaque âme connaît l’infini, connaît tout
mais confusément »), elle « concentre » (TH III, § 403) l’univers entier sous
un point de vue limité et cette limitation, cette confusion engendrent l’espace
et le temps. Ce point de vue limité est celui qui lui est assigné par son corps.
Tous les êtres réels de la nature sont des organismes. Là où il y a or-
ganisme, il y a (selon Monadologie, § 63) un « corps appartenant à une mo-
nade qui en est l’entéléchie ou l’âme ; certains sont simplement des vivants,
d’autres sont des animaux, d’autres enfin sont des esprits (PNG § 4 et TH I,
§ 90) ; ils se distribuent sur une échelle de perfection, mais leur constitution
est la même : corps et entéléchie : il n’y a pas de corps sans entéléchie ou
d’entéléchie sans corps ; et cela vaut aussi pour les anges, qui ont un corps
plus subtil que le nôtre (voir TH II, § 124 : « il n’y a point d’esprit créé qui
soit entièrement détaché de la matière » et NE, Préface, p. 42 ). Les orga-
nismes, quel que soit leur rang, sont tous constitués d’une infinité
d’organismes qui sont eux-mêmes constitués d’une infinité d’organismes, et
ainsi à l’infini (Monadologie, § 70, § 64 ainsi que « Considérations sur les
principes de vie », GF 3, p. 99 ; les créatures affranchies de la matière « se-
raient détachées en même temps de la liaison universelle, et comme des dé-
serteurs de l’ordre général », Id, p. 102).
Chaque monade exprime l’univers entier mais exprime d’abord son
organisme subordonné (Monadologie, § 62), et ce point de vue sur l’univers
qui lui est assigné par son corps constitue sa finitude ; l’un des signes de
cette finitude, c’est qu’il n’y a pas de pensée distincte qui n’ait un sillage de
pensées confuses, et que même nos pensées les plus élevées enveloppent
quelque chose qui est de l’ordre de la sensation (NE, II, 1, § 23, p 99 : « les
pensées répondent toujours à quelque sensation »), bien que les idées qui se
présentent dans ces pensées puissent être elles, absolument pures et indépen-
dantes des sens (NE, II, 1, § 2, p. 92) ; Leibniz montre aussi qu’il y a tou-
jours des images correspondant aux pensées, même aux pensées les plus abs-
traites (« Réponse aux remarques critiques sur l’harmonie préétablie », GF 2,
© Philopsis – Pascal Dupond 89
www.philopsis.fr
p. 300 : « il y a toujours dans l’imagination des caractères qui répondent aux
pensées les plus abstraites, témoins l’arithmétique et l’algèbre »).
Dire que « l’âme dépend du corps et des impressions des sens »,
c’est donc dire que le corps qui lui est assigné est son point de vue limité sur
le tout ; la causalité entre âme et corps est idéale, non réelle ou transitive : les
événements de l’âme correspondent dans l’ordre des causes finales aux évé-
nements du corps dans l’ordre des causes efficientes. En vertu de l’harmonie
préétablie, ce qui a lieu dans une substance est réglé sur ce qui a lieu en
toutes les autres, et cela vaut aussi pour la relation de l’âme et du corps : pas-
sion et action sont des termes corrélatifs ; l’âme agit sur le corps quand elle
passe à une perfection plus grande, le corps agit sur l’âme quand elle passe à
une moindre perfection.
§ 67. Leibniz a établi qu’il y a prédétermination des événements du
monde et que cela implique qu’il y ait aussi « dépendance » « dans les ac-
tions volontaires ». Il a établi aussi que cette dépendance ne s’oppose pas à
la liberté de l’action. C’est ce thème de l’action et de sa dépendance qui est
ici repris mais sous un angle différent, puisqu’il s’agit à présent, non plus de
la liberté, mais de la justice, de la légitimité des récompenses et des châti-
ments
On attendrait que les arguments établissant la légitimité des récom-
penses et des châtiments ne soient pas différents des arguments établissant la
liberté de l’action (dans le sillage de Thomas d’Aquin : « L’homme possède
un libre arbitre ; autrement les conseils, les exhortations, les préceptes, les
défenses, les récompenses et les châtiments seraient vains » (Somme de
Théologie, Ia, q.83, a.1). Or ce n’est pas ce chemin qui suit Leibniz : il
énonce paradoxalement que les récompenses et les châtiments sont légitimes
même si l’on suppose une nécessité absolue… (il mentionne Hobbes, Spino-
za, et, avant eux Thomas Bradwardine, prélat anglais anti-pélagien du XIVe
siècle, qui inspira Wyclef, et, à travers lui, Luther : chez les uns et les autres,
la volonté humaine apparaît entièrement déterminée, soit par l’absolue toute-
puissance de la volonté divine, soit par une nécessité inhérente aux choses).
Pourquoi ce souci d’établir la légitimité de la récompense et du châ-
timent en régime de nécessité absolue ? Deux raisons sont données : « il faut
toujours rendre témoignage à la vérité et ne point imputer à un dogme ce qui
ne s’ensuit point » : la nécessité absolue ne déligitime pas la sanction ; et en
plus « ces arguments prouvent trop, puisqu’ils prouveraient autant contre la
nécessité hypothétique et justifieraient le sophisme paresseux » : si les argu-
ments déligitimant la punition en régime de nécessité absolue étaient solides,
ils seraient aussi opposables à Leibniz, une nécessité hypothétique ne ren-
drait pas moins vaine et injuste les punitions. Sur la question de la liberté, la
distinction entre la nécessité hypothétique et la nécessité absolue est déci-
sive, mais elle cesse de l’être sur la question du châtiment ; la légitimité du
châtiment ne dépend pas de la liberté de l’agent. Et c’est ce que montre la
construction de l’argumentation dans les §§ suivants. L’idée directrice est
que, comme l’ensemble du droit, le châtiment est fondé sur l’utilité com-
mune et n’a pas besoin d’une justification métaphysique de la liberté.
Premier moment : il est permis de tuer le furieux (le fou dangereux,
qui est homme par son essence mais qui n’actualise plus cette essence
puisqu’il a « perdu la raison ») et l’animal venimeux si cela est nécessaire
pour s’en défendre ; on est bien ici dans le domaine du droit (puisqu’il s’agit
© Philopsis – Pascal Dupond 90
www.philopsis.fr
du permis et du défendu), mais sans qu’il s’agisse de châtiment, puisqu’il
n’y a pas de faute). Le permis l’est en tant que nécessaire (nécessaire =
l’utile qui ne peut être obtenu par aucune autre voie)
2e moment : [il est permis] de donner des punitions et des récom-
penses aux bêtes parce que cela est utile pour les dresser. Le permis l’est en
tant qu’utile
3e moment : [il serait permis] d’infliger aux bêtes une peine capitale
si cela pouvait servir à dissuader les congénères. Même cas de figure qu’en
2, si ce n’est qu’on est passé du côté de la superstition
4e moment : il est permis de donner aux hommes des récompenses et
des châtiments parce que, comme l’expérience le prouve, cela fait avancer le
bien et empêche le mal. L’argument stoïcien des confatalia, déjà repris
contre l’argument paresseux est à nouveau mis en œuvre : que la nécessité
soit comprise comme absolue, comme chez les stoïciens ou comme hypothé-
tique comme chez Leibniz, il s’agit en tous les cas d’une nécessité ration-
nelle, qui exige une liaison rationnelle entre cause et effet : un événement
nécessaire ne l’est jamais que sous la condition de la cause qui le produit ;
pour agir sur les événements, il faut agir sur leurs causes ; l’expérience de
l’efficacité des châtiments en assure la légitimité.
Cette légitimité est donc indépendante de la liberté et de la responsa-
bilité.
Le § 73 apporte cependant une inflexion : la justice vindicative, à la
différence de la justice corrective, suppose la liberté du coupable. Passage de
la justice comme correction à la justice comme vengeance : « le Seigneur est
juste juge ; nous ressentirons les maux que nous avons faits, et nous les res-
sentirons à pleine mesure. Rien n’échappe à sa mémoire. L’ordre des choses,
l’harmonie universelle, et cette espèce de nécessité qui veut que tout soit re-
dressé, demandent vengeance à Dieu ».
Qu’est-ce qui distingue les deux formes de justice ? La justice cor-
rective vise à l’amendement et à la réparation ; la peine a rang de moyen et
non de fin ; elle est donc subordonnée à sa fin et limitée par elle ; la justice
vindicative (qui frappe la volonté méchante plutôt que l’action) obéit à un
principe de convenance ; la peine y devient sa propre fin et s’étend en dehors
des limites de l’utilité commune (la faute et la sanction s’infinitisent). Elle
est mise en œuvre par la justice humaine et par la justice divine, mais
d’abord et surtout par la justice divine (puisqu’elle ne s’exerce dans la jus-
tice humaine que par délégation). La raison en est que seul Dieu sonde les
reins et les cœurs, connaît, au delà de l’action visible, le degré invisible de
malice de la volonté mauvaise et peut par conséquent frapper avec justice la
méchanceté dans les mauvaises actions. On pressent cependant un embarras :
si la peine ne reçoit plus sa mesure de sa fin, elle devient infinie ; peut-elle
encore être juste ? peut-elle être justement infinie ? la réponse serait que, si
le damné ne cesse pas de souffrir, c’est parce qu’il ne cesse pas de pécher,
c’est-à-dire qu’il subit (en raison de l’harmonie entre les causes efficientes et
les causes finales) les peines non seulement de ses péchés passés mais aussi
de ses péchés toujours renaissants : nul n’est malheureux définitivement que
par sa propre volonté et la vie future ne fixe pas seulement les effet de la vie
présente mais multiplie les actes de même direction (bonne ou mauvaise).
Voir aussi § 133 : « …je répondis autrefois à un ami qui m’objecta la dis-
proportion qu’il y a entre une peine éternelle et un crime borné qu’il n’y a
© Philopsis – Pascal Dupond 91
www.philopsis.fr
point d’injustice quand la continuation de la peine n’est qu’une suite de la
continuation du péché »
Pour résumer, deux idées : 1/ Vertu et bonheur sont inséparables :
« Dieu fait que pour être heureux, il suffit d’être vertueux » (à King, § 18) ;
2/ sans liberté, il peut y avoir une justice corrective mais non pas une justice
vindicative.
§ 76. Passage de théologie naturelle à théologie révélée : « l’élection
ou la réprobation des hommes avec l’économie ou l’emploi de la grâce di-
vine par rapport à ces actes de la miséricorde ou de la justice de Dieu ».
On pourrait considérer qu’on sort ici de l’ordre proprement philoso-
phique, et passer outre, si le but avoué de Leibniz n’était pas précisément de
montrer comment la philosophie − sa philosophie − est propre à apporter une
solution aux controverses théologiques.
Parmi les débats de la Réforme que recueille Leibniz, deux sont par-
ticulièrement importants :
1/ Le débat sur les relations de la foi et de la raison. Les jugements
de Luther sur la raison sont très abrupts (« prostituée du diable ») : il
s’oppose aux scolastiques, aux humanistes et à l’esprit cartésien du doute
méthodique47 . D’autres Réformateurs sont beaucoup plus favorables aux
droits de la raison, comme Calvin. Calvin et Luther s’opposent sur
l’interprétation de la Cène (que Leibniz évoque au § 18) : Calvin, au nom de
la « maxime des philosophes » selon laquelle un corps ne peut se trouver
qu’en un seul lieu à la fois, donne à la sainte cène un sens allégorique (« la
participation du corps de JC dans la sainte cène » est réduite « à une simple
représentation de figure »), alors que les évangéliques s’accordent avec Lu-
ther pour admettre une participation réelle, donc un mystère surnaturel.
Leibniz minimise l’opposition : l’opposition fondamentale ne se fait
pas entre la foi révélée et la raison mais entre « les vraies raisons de la théo-
logie naturelle », qui s’accordent avec la foi révélée et « les fausses raisons
des apparences humaines »
2/ Le débat sur la prédestination. Luther affirme l'impuissance radi-
cale de l'homme à assumer seul son propre salut ; il se réclame d'Augustin,
dont il retient en particulier l’opposition à Pelage, qui minimise le premier
péché et donner à l'homme une place fondamentale dans l'édification de son
salut. Cette position est reprise par Calvin ; cette doctrine de la prédestina-
tion absolue est combattue par Arminius et défendue par Gomar. D’où la
querelle des partisans d’Arminius (les remontrants) et de Gomar (les Goma-
ristes ou contre-remontrants). Voir sur cette question GF 2 note 9 p. 134
Les seconds (contre-remontrants), commente Leibniz, considèrent
Dieu d’une manière plus métaphysique (les décrets de Dieu sont ordonnés à
sa gloire et à la manifestation de ses attributs), les premiers (remontrants) le
considèrent d’une manière plus morale (les décrets de Dieu ont un égard par-
ticulier pour les « mouvements volontaires des substances intelligentes »).
Opposition, pense Leibniz, aisée à surmonter : Dieu est un grand ar-
chitecte qui a égard à tout, « tout ce qui doit entrer dans ce bâtiment », mais
aussi un bon et grand prince, qui « pense à rendre ses sujets heureux » et les
47
Néanmoins la position de Luther est vraisemblablement plus nuancée (voir contri-
bution de Pierre Metzger sur le net) ; en outre Luther a besoin d’une base philosophique pour
l’enseignement et cette base, c’est Mélanchton qui la lui donne, dans une reprise de la tradi-
tion aristotélicienne.
© Philopsis – Pascal Dupond 92
www.philopsis.fr
rend heureux à proportion de leurs actions (§ 79 : « Dieu a eu de grandes et
de justes raisons… ».
§ 80. Même situation concernant la querelle des universalistes et des
particularistes : Dieu veut sauver tous les hommes par sa volonté antécédente
mais n’en sauve que quelques uns par sa volonté conséquente
Le § 81 mentionne une « question plus réelle », celle de savoir si la
« destination » des créatures « est absolue ou respective », c'est-à-dire si elle
dépend d’un décret arbitraire de Dieu ou si elle est relative aux œuvres des
créatures. On sait que Leibniz récuse la conception absolutiste.
Cette question est à la source de la controverse, mentionnée au § 82,
entre « supralapsaires » et « infralapsaires ». Les premiers peuvent être
considérés comme des absolutistes extrémistes, puisque « le décret de punir
précède, selon eux, la connaissance de l’existence future du péché », qu’il
s’agisse du premier péché d’Adam ou de tous les péchés ultérieurs : ces pé-
chés ne seraient que la vérification a posteriori de la destination à la puni-
tion. Les seconds affirment que Dieu a seulement créé l’homme peccable, et
que seul le péché effectif peut le motiver à punir, et à le faire en toute justice,
la grâce − ou la miséricorde − consistant a tirer un petit nombre d’élus de la
massa damnata, dont parle s. Augustin.
Le § 84 fait valoir que cette controverse peut recevoir une solution qui
relève de la réflexion philosophique : car cette « question (...) revient à bien
concevoir l’ordre qui est entre les décrets de Dieu ». Il faut entendre par là
un ordre logique de priorité − qu'est-ce que Dieu veut avant tout, et qu'est-ce
qu’il veut en conséquence de cela ? −, plutôt qu’un ordre chronologique : « à
le bien prendre, tous les décrets de Dieu (...) sont simultanés, non seulement
par rapport au temps, en quoi tout le monde convient, mais encore in signo
rationis, ou dans l’ordre de la nature ». Cette simultanéité des décrets divins
résulte de l’absolue simplicité et de l’éternité de la substance divine : on ne
peut faire entre eux qu’une distinction de raison, nécessaire à notre propre
manière de penser. Ce qui permet de concevoir que les décrets divins puis-
sent être considérés comme multiples tout en ne faisant qu’un, c’est la notion
de monde et du meilleur des mondes : chaque monde est une « suite », c'est-
à-dire une totalité dont les éléments sont intégralement enchaînés les uns aux
autres. Ainsi « tout est lié dans chaque suite », et ce que Dieu « prononce re-
garde toute la suite à la fois, dont il ne fait que décerner l’existence ». On
voit que la notion de monde en tant qu’unité systématique prend ici une va-
leur métaphysique, car c’est elle qui permet de concevoir humainement
l’unité simple du vouloir divin : « il n’y aurait qu’un seul décret total qui est
celui de créer un tel monde ; et ce décret total comprend également tous les
décrets particuliers, sans qu’il y ait de l’ordre entre eux », car cet ordre sup-
poserait la distinction réelle des décrets.
Enfin, le § 85 présente la controverse de auxiliis comme la plus
« importante », celle qui porte sur « la dispensation des moyens et des cir-
constances qui contribuent au salut et à la damnation ». Leibniz la présente
comme la source d’une série de « difficultés », dont la solution, exposée dans
les §§ qui suivent, fait appel à des considérations proprement philosophiques
(MNL).
§ 86. Dans la dogmatique chrétienne, la grâce est dite nécessaire au
salut à cause du péché originel, qui est celui d’Adam et Eve, mais aussi de
toute l’humanité après eux : tout homme naît en état de péché, alors même
© Philopsis – Pascal Dupond 93
www.philopsis.fr
qu’il n’a encore commis aucun péché actuel. Autrement dit : tout homme
naît privé de la grâce sans laquelle il ne pourrait éviter de pécher volontaire-
ment. Or cette privation laisse soupçonner « de l’injustice en Dieu », puisque
c’est elle qui expose l’homme au péché par lequel il risque de se damner.
Cet état natif de péché qu’est le péché originel est présenté ici
comme une infection de « l’âme », et l’explication de cette infection est la
source d’une controverse qui met en jeu trois thèses philosophiques sur
« l’origine de l’âme même ».
1/ La préexistence – c’est la position des platoniciens (le mythe
d’Er) et d’Origène : les âmes des hommes qui naissent viennent d’un autre
monde et d’une autre vie, et elles entrent dans leur nouvelle destinée par un
choix qui dépend de leur vie antérieure ; passage de l’âme par des enve-
loppes corporelles successives. Innocence de Dieu.
Origène a vécu de 185 à 253 (voir GF 3 note 16 p. 135)
2/ La traduction (tradux = le sarment qu’on fait passer d’une vigne à
l’autre pour opérer une greffe) : l’âme des enfants est engendrée de l’âme ou
des âmes de ceux « dont <à partir desquels> le corps est engendré ; donc
double génération, de l’âme et du corps ; l’âme hérite par génération d’un
état de péché contracté par l’humanité depuis son origine
3/ La création : l’âme de celui qui naît est créée par Dieu, mais cette
opinion « reçoit le plus de difficulté par rapport au péché originel », car il
s’agit de comprendre pourquoi l’âme est créée par Dieu infectée de péché
§ 87. La question de l’origine de l’âme fait partie d’une question plus
vaste et proprement philosophique, qui est celle de l’origine des formes. En
revenant de l’origine de l’âme à l’origine de la forme, Leibniz rappelle la fi-
liation aristotélicienne de sa doctrine.
Forme = principe interne ou immanent d’action
Un principe d’action est soit substantiel, inséparable de l’être dans le-
quel il agit, constituant son essence (l’humanité en Socrate), soit accidentel,
c’est-à-dire séparable et contingent (le courage de Socrate ou toute autre ver-
tu acquise par exercice)
Ce qui est principe substantiel d’action dans un organisme est appelée
âme.
L’âme dans la mesure où elle est principe d’action et actualise (ou
achève) les puissances de la matière qu’elle informe fait partie de ce
qu’Aristote appelle entéléchie (ou acte en latin).
Aristote distingue deux façons d’être entéléchie ou acte, qu’il appelle
première et seconde.
L’entéléchie première est permanente (soit, s’il s’agit de la forme
substantielle, tout à fait permanente, soit, s’il s’agit de la forme qualitative,
permanente pour un temps) : Callias est homme et médecin, qu’il veille ou
qu’il dorme)
L’entéléchie seconde est successive et inscrite dans le temps : Callias
n’actualise pas à chaque instant les pouvoirs inhérents à son humanité ou à
son art de médecin : quand il dort, son âme n’agit pas, au sens de l’acte se-
cond, ni comme âme raisonnable, ni comme âme de médecin).
« J’ai montré ailleurs que la notion de l’entéléchie n’est pas entière-
ment à mépriser… ». Leibniz réinterprète ici l’entelecheïa (en pensant sans
© Philopsis – Pascal Dupond 94
www.philopsis.fr
doute à l’energeïa d’Aristote) dans le sens d’un dynamisme (voir commen-
taire du § 22 et NE II, XXI48).
L’entéléchie (s.e. première), dit TH 87, « porte avec elle non seule-
ment une simple faculté active, mais aussi ce qu’on peut appeler force, ef-
fort, conatus… » ; les NE disent parallèlement : « il est vrai que la puissance
active est prise quelquefois en un sens plus parfait… » : non pas comme une
simple faculté mais comme une tendance à agir, c’est-à-dire une force ;
l’entéléchie première d’Aristote devient la « force agissante primitive »
L’entéléchie seconde devient la force dérivative, c’est-à-dire la façon
dont s’exerce à chaque instant, en fonction des rapports harmoniques entre
les substances, la force primitive
§ 88. L’origine des formes substantielles
« Les philosophes se sont fort tourmentés… » : pour Aristote lui-
même, il n’y a pas de problème ; ni la matière ni la forme ne sont engen-
drées, seul le composé est engendré (il n’y a donc pas à s’interroger sur
l’origine des formes) ; la forme substantielle que nous appelons « humanité »
est une et la même dans la multiplicité des individus qu’elle informe, et ces
individus sont différents non pas en vertu de la forme informante mais en
raison de la matière informée. Mais en terre chrétienne, l’indifférence aristo-
télicienne à l’origine des formes n’est plus possible : le monde n’est pas
éternel et l’individuation des êtres est formelle et non matérielle. Le pro-
blème de l’origine des formes doit donc être affronté.
La première solution est celle de la comproduction ; Leibniz juge que
c’est une solution verbale : qu’elle soit produite en même temps que le com-
posé ne dit rien sur sa propre origine.
La seconde est celle de l’éduction : les formes sont tirées de la puis-
sance (passive) de la matière. Cette solution reçoit une certaine crédibilité de
la comparaison avec la sculpture : la statue est tirée de la puissance du bloc
de marbre. Mais c’est une fausse solution pour le présent problème : une
forme substantielle n’est pas une limitation mais un principe organisateur ;
or si la matière limitée peut être la raison de sa limite, la matière organisée
ne peut pas être la raison de son organisation ; en ce cas, ce n’est pas la ma-
tière (limitée) qui est la raison de la forme (la limite), mais la forme (organi-
sante) qui est la raison de la matière (organisée).
La 3e suppose que les âmes sont produites par Dieu et envoyées sur
terre dans le moment où les corps sont produits naturellement ; il y aurait
donc la conjonction, quand un homme naît, d’une production naturelle et
d’une production surnaturelle.
La 4e suppose que les formes sont tirées de la puissance active de la
cause efficiente ; si cette cause efficiente est Dieu, on revient au cas n° 3 ; si
c’est celle des géniteurs, on revient à ce que le § 86 appelle traduction : les
âmes sont engendrées par les géniteurs en même temps que les corps.
§ 89. Aucune de ces quatre solutions n’est recevable en ce qui con-
cerne le problème de l’âme : la 1e, parce qu’elle est verbale, la 3e (qui n’est
48
« De la réforme de la philosophie première », LP 322-325, « De la nature en elle-
même », LP 345-351, à de Volder, 21 janvier 1704 [« la force dérivative, c’est l’état présent
en tant qu’il tend au suivant ou enveloppe d’avance le suivant, en tant que tout ce qui est pré-
sent est gros du futur. Mais la chose permanente elle-même, en tant qu’elle enveloppe tous les
cas, a une force primitive, de telle sorte que la force primitive est comme la loi de la série et la
force dérivative comme la détermination qui assigne un terme quelconque dans la série »] ; à
de Volder 30 juin 1704.
© Philopsis – Pascal Dupond 95
www.philopsis.fr
pas explicitement discutée) sans doute parce qu’elle donne trop au miracle et
pas assez au déroulement naturel des choses (cependant Leibniz en retiendra
quelque chose puisqu’il admet une transcréation miraculeuse) ; la 2e
(l’éduction) et la 4e (la traduction) parce qu’elles ne répondent pas aux don-
nées du problème ; l’éduction n’y répond pas pour la raison mentionnée ci
dessus : elle rend compte des modifications de la substance (par exemple
d’une variation de limite) mais non pas d’un pouvoir organisateur ; quant à
la raison de refuser la traduction, elle n’est pas explicitée ; on peut conjectu-
rer qu’elle s’énoncerait ainsi : la doctrine de la traduction attribue à la causa-
lité efficiente (§ 88) d’une forme le pouvoir de créer une autre forme, elle
prête à une créature un pouvoir dont nous n’avons aucun concept : notre
seule idée de la production est celle d’une information ou d’une composition
de matière et de forme ; or cette idée n’apporte aucune intelligibilité, elle n’a
aucun usage là où il s’agit de rendre compte de l’émergence d’une forme, en
tant que véritable unité (c’est en ce sens qu’il faut comprendre la formule :
« l’origine d’une substance » ; il ne s’agit pas de l’origine du composé, mais
de l’origine de la forme qui fait du composé ce qu’il est)
Reste une seule solution, celle dont Leibniz disait auparavant qu’elle
est enseignée dans la plupart des écoles chrétiennes : la création. Reste à
concevoir cette création de façon juste. « Quelques uns ont cru que les
formes étaient envoyées du ciel, et même crées exprès, lorsque les corps sont
produits ». La position de Leibniz est différente : les âmes ont été créées en
même temps que le monde et leur simplicité les rend indestructibles.
On résiste à cette solution, pense Leibniz, parce qu’elle paraît donner
une trop haute valeur à l’âme des bêtes ou aux autres formes primitives in-
formant les êtres naturels, elle paraît effacer la distance, la dénivellation,
entre les êtres raisonnables (réputés immortels) et les autres. Or il suffit, pour
que cette résistance disparaisse, de dissiper la confusion qui en est respon-
sable, de distinguer entre l’indestructible et l’immortel : toutes les formes
sont indestructibles mais seules les âmes raisonnables sont immortelles :
elles ont le sentiment réflexif interne de ce qu’elles sont, elles ont conscience
d’être une personne identique, un moi justiciable d’imputation, de récom-
pense et de blâme, et c’est cette permanence, cette indestructibilité de
l’identité personnelle qui constitue proprement l’immortalité.
Aristote était parfaitement conséquent en soutenant que ce qui rend
raison de la génération ne peut pas relever soi-même de la génération (donc
que la matière et la forme sont inengendrées) ou que ce qui rend raison de
l’unité du composé ne peut pas être soi-même composé. Et c’est cette « con-
séquence » aristotélicienne qu’il faut retrouver : l’indivisibilité des formes
implique l’indestructibilité comme elle implique l’ingénérabilité. Nier
l’indestructibilité de l’indivisible, c’est, contre sa propre intention, porter un
grand préjudice à la doctrine de l’immortalité de l’âme humaine.
§ 90. On doit donc distinguer deux types de « génération » et de « des-
truction » entièrement différents. Le premier est un véritable passage du non
être à l’être (une création) ou un passage inverse de l’être au non être (une
annihilation) ; ce passage est en dehors de l’ordre naturel : c’est la création
du monde et des substances simples qui y sont distribuées ou c’est la créa-
tion de l’âme raisonnable venant animer un corps humain quand il naît ; c’est
aussi la reversio ad nihil, l’inverse de la création. Le second est un passage
de l’être à l’être, soit au sens d’un développement ou d’une augmentation,
© Philopsis – Pascal Dupond 96
www.philopsis.fr
soit au sens d’un enveloppement ou d’une diminution ; ce passage appartient
à l’ordre naturel (et il est donc soumis au principe de la connaissance natu-
relle : rien ne naît de rien, rien ne retourne au néant) ; c’est la naissance et la
mort ; quand nous constatons la formation d’un animal, cette formation ne
doit pas être comprise comme l’apparition d’une nouvelle forme, ce n’est
que l’amplification du champ d’action de quelque chose de préformé, d’une
forme ingénérée. La création du monde est celle d’une multitude
d’organismes dans lesquels âme informante et corps informé sont pour tou-
jours inséparables ; ce corps informé est à géométrie variable ; dans la géné-
ration, il s’amplifie en intégrant de nouveaux composants monadiques et les
pouvoirs de l’âme s’accroissent à proportion ; dans la destruction, il perd les
composants qu’il avait acquis en naissant et redevient invisible, et l’âme
perd à proportion ses pouvoirs (voir NE II, XXVII, p. 199).
§ 91. Tout organisme qui naît existe dans ses géniteurs avant sa nais-
sance et l’homme ne fait pas exception à cette loi : tout le genre humain est
contenu dans la semence d’Adam. Ou plutôt, précise Leibniz, ce qui est con-
tenu dans la semence d’Adam, ce sont les âmes sensitives ou animales de
tous ses descendants ; Leibniz pense en effet, reprenant une position tho-
miste, que l’âme raisonnable ne vient à l’embryon qu’à une certaine étape de
sa croissance. Cette émergence de l’âme raisonnable dans l’âme animale
peut être comprise comme un processus naturel ou comme un événement
surnaturel, une transcréation.
Au § 91, Leibniz dit préférer la seconde solution, l’explication par le
surnaturel et présente la 1e comme difficile à concevoir ; au § 397, il paraît
préférer l’explication naturelle.
Les deux positions ne sont pas contradictoires : l’explication naturelle
qui est refusée au § 91 (la transformation purement naturelle d’une âme sen-
sitive en âme rationnelle) n’est pas identique à celle qui est acceptée au §
397 : l’âme rationnelle serait en puissance dès l’origine dans l’âme sensitive
et ne s’actualiserait qu’au moment de la conception ou au moment de la ges-
tation ; cette orientation se retrouve dans les Considérations sur les principes
de vie (GF 3, 111-112) et dans la lettre à des Bosses du 8 septembre 1709.
Néanmoins Leibniz prend sur la question deux points de vue diffé-
rents. Quand Leibniz parle en philosophe de la nature, il préfère une solution
naturelle (non pas celle du § 91 mais celle du § 397 : la préformation de la
raison) ; quand il parle en philosophe chrétien, méditant l’Ecriture et ce
qu’elle lui apprend du péché et de la grâce, il penche vers l’autre solution,
celle de la transcréation ; et ses raisons sont alors surtout théologiques : si on
admet que l’âme raisonnable de tous les humains est préformée dans la se-
mence du premier homme, elle participe de la corruption de l’homme, et la
corruption originelle de tout homme est une corruption morale, puisqu’elle
affecte aussi dans l’homme le principe du discernement du bien et du choix
libre ; si en revanche l’âme raisonnable échappe à la préformation, la corrup-
tion originelle qui atteint l’âme l’atteint « physiquement ou animalement » et
perd donc sa qualification morale ; et la raison, peut alors apparaître comme
un instrument naturel du salut.
Sur cette question, voir le « Système nouveau… », GF, 1, 67, à Ar-
nauld, nov. déc 1686 (éd. Vrin, p. 145), à Foucher : « Cependant je tiens que
les Esprits, tels que le nôtre, sont créés dans le temps et exemptés de ces ré-
© Philopsis – Pascal Dupond 97
www.philopsis.fr
volutions après la mort, car ils ont un rapport tout particulier au souverain
être, un rapport, dis-je qu’ils doivent conserver ».
Pour conclure : le péché originel n’est, dans les descendants d’Adam
qu’une corruptibilité, une faillibilité, la possibilité du péché plutôt que
l’inclination à pécher. Cette faillibilité peut être comprise rationnellement :
elle relève de l’animalité de l’homme, elle résulte des limitations qui sont
mises dans l’âme par son union au corps. Pour que cette faillibilité devienne
péché actuel, l’homme doit être en état d’exercer la raison, il doit être deve-
nu capable de reconnaître les biens inhérents à l’exercice de la raison et de
les préférer à ceux de l’animalité, et il doit, malgré cela, préférer un bien in-
férieur (animal) à un bien supérieur (rationnel).
§§ 92-98. Questions théologiques consécutives à la doctrine du péché
originel
1/ Que deviennent ceux qui meurent avant d’avoir reçu le baptême et
qui n’ont commis aucun péché ? Les avis sont partagés parmi les Père de
l’Eglise et parmi les théologiens. Certains (comme St Augustin) les destinent
à la damnation (au motif sans doute que, sans baptême le péché est inévi-
table et qu’une faute inévitable mais non commise (faute de temps pour la
commettre…) n’est pas très différente d’une faute effectivement commise ;
mutatis mutandis on pourrait dire qu’une tentative de meurtre qui serait allée
jusqu’au meurtre si le cours des événements n’avait pas perturbé l’action est
aussi punissable que le meurtre) ; d’autres les envoient dans les limbes où ils
vivent sans souffrance mais privés de la béatitude réservée aux élus, d’autres
les destinent à une béatitude naturelle. Leibniz refuse le premier parti, qui est
« d’une dureté des plus choquantes » : « ce serait damner en effet des inno-
cents » et ne choisit pas entre les autres : le parti le plus raisonnable est de
s’en remettre au jugement et à la clémence du créateur
2/ Est-il juste que soient damnés des hommes qui sont parvenus à
l’âge de la discrétion et qui ont péché parce qu’ils n’ont pas reçu la grâce né-
cessaire « pour s’arrêter sur le penchant du précipice » ? Leibniz fait la sup-
position que tout homme reçoit la grâce suffisante à son salut et que ceux qui
n’ont pas la connaissance de Jésus Christ ont pu recevoir un secours qui nous
est inconnu.
Il est raisonnable de supposer qu’aujourd’hui « une connaissance de
Jésus Christ selon la chair est nécessaire au salut », mais en ajoutant que
cette connaissance ne se manifeste pas nécessairement par une profession de
foi explicite : au moment de la mort, celui qui sera sauvé peut entrer dans
une foi qui lui a manqué pendant sa vie.
§§ 99 et sv. Questions théologiques (suite) On suppose que tous les
hommes reçoivent une grâce suffisante pour le salut et on se demande pour-
quoi Dieu, qui tient entre ses mains le cœur des rois, « refuse » à certains la
volonté qui les aurait sauvés. Comment entendre ce « refus » de la volonté
qui les aurait sauvés ?
Ce que Leibniz exclut, c’est que ce refus soit une « anti-grâce » con-
sistant à endurcir délibérément le cœur du méchant ; ce qui apparaît comme
un refus doit s’entendre plutôt comme l’influence des circonstances qui in-
clinent l’un au bien, l’autre au mal : celui qui est destiné au salut rencontre
un enchaînement de circonstances où s’accroît sa volonté du bien, celui qui
va à la damnation rencontre un enchaînement de circonstances qui
l’éloignent du bien.
© Philopsis – Pascal Dupond 98
www.philopsis.fr
Leibniz illustre ce rôle des circonstances par des exemples, dont celui
de la conversion de St Augustin, rapportée dans les Confessions, VIII, 12.
Faut-il en conclure que ce sont les circonstances qui décident, à natu-
rel égal, du salut de l’un et de la damnation de l’autre ? C’est ce que donne à
entendre la fiction des deux jumeaux polonais : ils sont jumeaux, on suppose
donc qu’ils ont une même nature ; mais des circonstances où n’intervient en
rien leur volonté conduisent l’un à la damnation, l’autre au salut ; scandale :
ce seraient les circonstances qui décideraient du salut des âmes ?…
Le défenseur de la science moyenne tente d’échapper au scandale en
retrouvant la part de la nature : celui qui se perd dans certaines circonstances
n’est pas perdu par elles ; il se serait perdu dans des circonstances tout
autres, et c’est ce que Dieu a prévu.
Mais Leibniz n’accepte pas cette solution, qui donne trop à la nature
de l’homme et pas assez à la grâce divine : Dieu peut vaincre le plus grand
fond de malice.
Il n’accepte pas non plus que l’on réponde que Dieu n’est obligé à
rien, car cela manque encore au principe de raison suffisante.
La position de Leibniz se construit autour des propositions suivantes :
1/ Il y a des raisons qui empêchent Dieu de faire sentir toute sa bonté à
tous : le mal moral et le châtiment qui le frappe font partie du meilleur des
mondes.
2/ Donc « il faut qu’il y ait du choix », c’est-à-dire une discrimination
des élus et des damnés.
3/ Cette discrimination ne doit pas être sans raison (faute de raison le
choix de Dieu serait celui d’un despote).
4/ La raison de l’élection ou de la réprobation ne peut pas être étran-
gère à la nature de la créature (« la considération de l’objet, c’est-à-dire du
naturel de l’homme y entre ») mais ne peut pas non plus s’y réduire, car cela
reviendrait à supposer que la nature suffit au salut.
Si une concession à Pélage (à la doctrine selon laquelle l’homme con-
tribue lui-même à son salut) est nécessaire (pour que la volonté divine ne soit
pas arbitraire), elle doit être aussi limitée que possible ; on supposera
donc que Dieu envoie sa grâce à ceux qu’il prévoit moins résister, mais on
ne fera pas de cette supposition une règle, afin que nul ne se désespère et que
nul ne se glorifie.
Mais la solution de Leibniz est différente : 1/ elle est plutôt anti-
pélagienne et reprend les positions augustiniennes et luthériennes : lé péché
originel aurait corrompu tous les hommes, de telle sorte qu’aucun n’aurait un
bon naturel : « peut-être que dans le fond tous les hommes sont également
mauvais et par conséquent hors d’état de se distinguer eux-mêmes par leurs
bonnes ou leurs mauvaises actions » ; 2/ à ce point de vue « quantitatif »,
Leibniz superpose une estimation qualitative : les hommes sont tous diffé-
rents selon leurs dispositions naturelles, ils ne sont pas tous portés vers les
mêmes biens ou les mêmes maux, et se trouvent en outre dans des situations
différentes : leurs actions résultent indivisiblement de leurs dispositions na-
turelles et des circonstances de leur vie, ainsi que des « impressions de la
grâce interne que Dieu y joint » ; et on ne peut pas départager ces trois
sources de l’action (ni établir entre elles des relations de causalité), car elles
sont harmoniques entre elles. Chaque vecteur appelle les autres pour compo-
ser avec eux un élément différentiel du meilleur tout
© Philopsis – Pascal Dupond 99
www.philopsis.fr
On observe que Leibniz donne à une question théologique une réponse
qui laisse une part assez réduite à la théologie.
Leibniz admet, certes, qu’il y a un plan général de l’univers et que la
grâce intervient nécessairement dans la salut ; mais finalement, que dit-il : ce
qui rend un homme vertueux ou non, c’est le rapport entre son naturel et les
circonstances qu’il rencontre ; ceux qui rencontrent les circonstances les plus
favorables à leur (bon) naturel deviendront les meilleurs, mais parfois un
moins bon naturel réussit mieux dans des circonstances favorables qu’un
meilleur naturel dans des circonstances moins favorables. C’est une re-
marque qui est inspirée de l’observation de la vie et qui relève de la sagesse
du monde et non pas une thèse sur Dieu et son rapport à la créature. Nous ne
connaissons pas les voies de Dieu qui dépassent notre entendement, nous ne
sommes pas non plus de son conseil ; nous devons donc vivre à notre
échelle, avec nos connaissances et les règles pratiques qui nous ont été con-
fiées et non pas sonder imprudemment les règles de la sagesse divine.
© Philopsis – Pascal Dupond 100
www.philopsis.fr
Deuxième partie
Dialogue avec Bayle qui rappelle le dialogue avec Locke des Nou-
veaux Essais : dans un cas et dans l’autre, il s’agit de défendre les droits de
la raison.
Locke est empiriste et Leibniz veut établir que l’empirisme est impos-
sible ; Bayle se propose de « battre en ruine ceux qui soutiennent qu’il n’y a
rien dans la foi qu’on ne puisse accorder avec la raison » (§ 107), c’est-à-dire
ceux qui soutiennent la convergence de la foi et de la raison ; et Leibniz veut
établir qu’il n’y a rien d’incompatible entre ce que la foi révélée et la raison
enseignent (§ 108).
Les §§ 109 et 110 énoncent sur Dieu des propositions qui sont de
l’ordre de la théologie rationnelle (c’est-à-dire des propositions que la raison
peut établir par elle-même sans l’assistance de la foi) et ne se prêtent donc
pas au constat (et à la résolution) d’une contradiction entre la foi et la raison.
L’histoire d’Adam et du premier péché (§ 111) est dans une situation
différente : c’est une donnée irréductible à la raison au sens où la raison ne
peut pas l’établir à partir d’elle-même, mais non pas au sens où elle serait
opposée à la raison (ou même rationnellement incompréhensible) : la raison
peut l’admettre sans difficulté, à la condition que le franc arbitre soit entendu
comme il faut (il n’est pas une liberté d’indifférence).
Néanmoins la lecture rationnelle du récit de la Genèse exige, comme
le montre le § 112, la rectification des interprétations qui attribuent à Dieu
une volonté arbitraire.
1/ La défense initiale et la punition qui suit ne relèvent pas de deux
volontés détachées et également arbitraires, il y a une connexion entre elles :
les suites nuisibles de l’action défendue sont contenues en elles analytique-
ment et l’interdiction divine n’avait pas d’autre raison que de protéger
l’homme des conséquences en l’écartant des prémisses ; Dieu à interdit à
Adam de manger du fruit de l’arbre comme on interdit à l’enfant de toucher
aux couteaux et les misères d’Adam sont celles de l’enfant qui s’est coupé.
Si le défendu n’est rien d’autre que le nuisible, on comprend qu’il y ait
une connexion entre la désobéissance et les misères qui suivent ; reste à
comprendre pourquoi le mal généré par la désobéissance n’est pas seulement
un mal de peine (par ses conséquences) mais aussi un mal de coulpe (intrin-
sèquement) ; on peut supposer que le mal de coulpe est dans la séparation,
dont l’homme a l’initiative, entre volonté humaine et volonté divine et dans
l’inclination à réitérer cette séparation.
2/ Parmi les éléments constituant la punition, il y a l’inclination à de
nouveaux péchés ; Leibniz précise que cette inclination, c ‘est-à-dire la cor-
ruption, ne résulte pas d’une volonté expresse (punitive) de Dieu (comme si
la punition du rebelle consistait à le rendre encore plus rebelle), elle est à
nouveau une conséquence de la première faute, analytiquement contenue en
elle. La transmission de la corruption originelle d’Adam à ses descendants
est analogue (elle présente quelque chose d’approchant) à la transmission hé-
réditaire de certains caractères ou de certaines prédispositions corporels des
parents aux enfants : c’est l’effet d’une loi de la nature mais non pas l’effet
d’une volonté de Dieu
L’esprit de cette discussion consiste à rappeler que si Dieu est législa-
teur, il est aussi architecte, et que là où il y a une volonté de Dieu, il y a aussi
© Philopsis – Pascal Dupond 101
www.philopsis.fr
une sagesse, que le règne de la nature et le règne de la grâce sont harmo-
niques, donc que le premier peut nous aider à entendre le second, ce qui nous
incline à recevoir les vérités de foi sous l’angle de la raison.
§ 113. On remarque à nouveau l’abstention de Leibniz (« nous
n’avons point besoin de ces opinions… ») sur des questions qui n’importent
pas au salut mais qui montrent en revanche que les théologiens ont souvent
la prétention d’être du conseil de Dieu. On pourrait dire que la vraie vocation
de la théologie est d’être pratique plutôt que spéculative : elle doit faire en-
tendre à chacun qu’il a reçu une grâce suffisante à son salut, s’il est de bonne
volonté.
§ 114. Une exégèse juste des enseignements de la foi doit éviter autant
que possible les « manières de parler humaines » qui conduisent aux inter-
prétations fallacieuses. La critique de l’anthropomorphisme est une exigence
commune à toute connaissance, qu’elle soit purement rationnelle ou révé-
lée/rationnelle. Peut-on cependant vraiment l’éviter en théologie ? C’est une
question aussi ancienne que la théologie et qui apparaît dans les réflexions
du Pseudo-Denys, de Thomas d’Aquin (la question de l’analogie) comme
dans celles de Kant (voir en particulier CFJ § 90). Comment parler de Dieu ?
peut-on parler de Dieu sans l’inclure dans l’horizon de la compréhension
humaine ? En refusant l’anthropomorphisme, on dira que « Dieu ne saurait
souffrir ni chagrin, ni douleur, ni incommodité », mais en revenant bon gré
mal gré à l’anthropomorphisme, on dira qu’« il est toujours parfaitement
content et à son aise ».
Pourquoi Dieu repousse t-il le mal moral plus que tout autre mal ? Se-
lon le § 21, le mal moral, c’est le péché ; donc le mal moral, même s’il se
joue aussi dans la relation de l’homme à l’homme, se joue d’abord dans la
relation de l’homme à Dieu : le péché, c’est la désobéissance à un comman-
dement divin. On peut donc entendre que si Dieu repousse le mal de coulpe
plus que tout autre, c’est parce que le mal de coulpe éloigne plus que tout
autre l’homme de Dieu (c’est même, par excellence, l’éloignement de Dieu)
« Il est vrai que Dieu pourrait produire dans chaque âme humaine
toutes les pensées qu’il approuve, mais ce serait agir par miracle, plus que
son plan, le mieux conçu qu’il soit possible ne le porte ». 1/ Une créature rai-
sonnable ne pourrait échapper au mal moral qu’en échappant à sa nature ; si
elle est, par sa nature de créature, limitée (le mal métaphysique), cette limite
doit se porter aussi dans l’usage des facultés qui font d’elle un esprit, la con-
duire à méconnaître la véritable hiérarchie des biens, lui faire préférer des
biens inférieurs à des biens supérieurs ; elle est donc faillible. Si Dieu remé-
diait à cette faillibilité en produisant dans chaque âme « toutes les pensées
qu’il approuve », il agirait alors par miracle (non pas contre la nature mais
contre la nature de l’homme) ; 2/ ce recours à une sorte de miracle perpétuel
(que Leibniz reproche à Malebranche) ne serait pas conforme au meilleur
plan (comment le savons nous ? si nous savons que le meilleur existe, ce
n’est pas pare que nous savons qu’il est le meilleur (une partie, même si elle
est pars totalis, ne peut pas juger de la totalité), c’est parce que nous savons
qu’il existe et que Dieu fait exister le meilleur). Mais que Dieu ne soustraie
pas la créature à sa faillibilité par miracle ne veut pas dire qu’il lui refuse ses
secours : la grâce rend l’homme capable de remédier aux défaillances de sa
nature.
© Philopsis – Pascal Dupond 102
www.philopsis.fr
§ 117. « Dieu fait le meilleur qui soit possible… ». Leibniz en donne
une sorte de preuve par l’absurde. Supposons que l’exercice de sa bonté soit
borné ; il y a trois explications possibles de cette limitation : 1/ soit la bonté
de Dieu est limitée (il manque de bonne volonté, il n’a pas la volonté du
meilleur) ; 2/ soit la sagesse de Dieu est limitée (il ne connaît pas le meilleur
ou les moyens de le produire) ; soit la puissance de Dieu est limitée (il con-
naît le meilleur et les moyens de l’obtenir mais n’a pas la force nécessaire
pour les mettre en œuvre). Or aucune de ces trois hypothèses n’est accep-
table ; donc Dieu fait le meilleur qui soit possible.
Le meilleur qui soit possible signifie le « meilleur dans le tout » ; Dieu
veut chaque bien infiniment (à proportion du sujet) et finiment ou limitati-
vement (à proportion de l’objet) ; il veut ou aime chaque bien relativement,
c’est-à-dire en proportion du bien qu’il enveloppe ; mais sa volonté ou son
amour du meilleur dans le tout sont absolument infinis.
§ 118. « … le règne de la nature doit servir au règne de la grâce… ».
Leibniz appelle grâce le don gratuit d’un certain degré de perfection
que Dieu fait aux hommes pour porter remède au mal qui est inscrit dans
leur nature en raison de son imperfection originale et en raison de la corrup-
tion héritée d’Adam.
Parmi les dons qui remédient au mal, certains sont ordinaires (on pen-
sera à la grâce efficace et suffisante, c’est-à-dire à la grâce qui est donnée à
tous les hommes et qui suffit en soi pour obtenir le salut, mais dont l’effet est
subordonné à la condition du consentement de la volonté humaine), d’autres
sont extraordinaires (ce serait la grâce absolument efficace qui produit effec-
tivement le salut, soit en agissant directement, soit en suscitant des circons-
tances favorables) (voir DM fin du § 30)
La distinction du règne de la nature et du règne de la grâce peut donc
prendre deux sens. Ou bien il s’agit de distinguer, parmi les créatures, celles
qui ne sont pas des esprits et qui relèvent de la nature et celles qui sont des
esprits et qui relèvent de la grâce ; soit il s’agit de distinguer, dans les créa-
tures qui sont des esprits, ce qu’elles tiennent de leur nature et ce qu’elles re-
çoivent de Dieu pour remédier à la corruption de leur nature.
Dans le § 118, il s’agit plutôt de la première distinction.
Leibniz reproche à Bayle de subordonner le règne de la nature à celui
de la grâce au sens où le premier aurait rang de moyen et le second de fin.
Leibniz accorde qu’il y a entre la nature et la grâce une différence de
rang (correspondant à la différence entre les créatures non raisonnables et les
esprits) mais substitue à l’idée d’une subordination de la nature à la grâce
l’idée d’une harmonie entre la nature et la grâce : ce qui est « fin » de la vo-
lonté divine, c’est le tout (règne de la nature et règne de la grâce ensemble)
et non pas la partie (le seul règne de la grâce) ; l’ordre de la nature reçoit
toute la perfection qu’il doit avoir pour que le tout ait la plus haute perfec-
tion. Si le règne de la grâce trouve sa limite en ce qui est dû à l’ordre de la
nature, c’est au sens où il trouve sa limite en ce qui est dû au tout.
On remarque en outre que le commentaire de Leibniz ne se situe pas
exactement sur le même plan que la remarque de Bayle : Bayle fait du bon-
heur ou de la félicité des créatures intelligentes la fin de la création ; Leibniz
substitue à la question du bonheur la question de la perfection et montre que
la fin de la création est la perfection du tout et non pas la seule félicité ni
même la seule perfection des créatures raisonnables : le mal moral sera per-
© Philopsis – Pascal Dupond 103
www.philopsis.fr
mis s’il ne peut être évité qu’au prix du renversement de tout l’ordre de la
nature. Comparer avec ce qui est dit dans l’opuscule sur « les secrets admi-
rables de la nature » (1688), GF 1 p. 299, dont l’orientation est un peu diffé-
rente : « …il est manifeste que les esprits sont la partie la plus importante de
l’univers, et que toutes choses sont été établies pour eux ».
Toutes les créatures sont donc rassemblées sous l’horizon commun de
leur perfection ou de leur prix : toutes les perfections ont leur prix et sont
donc comparables, la perfection de l’une peut compenser l’imperfection de
l’autre. Kant distingue dans les Fondements de la métaphysique des mœurs
ce qui a un prix et ce qui a une dignité : les choses [ = tout ce qui est dépour-
vu de raison] ont un prix au sens où elles sont des moyens pour les fins
qu’un être libre se propose et en dernier ressort pour la fin qu’il est à lui-
même ; les êtres libres ou les personnes ont une dignité au sens où elles sont
des fins intrinsèquement, par leur nature même, et cette dignité les soustrait à
l’ordre du prix ; prix et dignité sont deux « perfections » ou deux « ordres »
incommensurables entre lesquels ne peut venir aucune comparaison, aucune
compensation ; la différence entre le raisonnable et le non raisonnable intro-
duit une sorte de fracture dans l’être. L’orientation de Leibniz est différente :
toutes les perfections des créatures ont un prix au sens où elles contribuent à
leur rang à la perfection du tout ; et aucune perfection n’a, dans une créature,
un prix infini au sens où elle serait incommensurable aux autres et ferait en
quelque sorte disparaître dans le néant la contribution des autres à la perfec-
tion du tout.
§ 119. La question de la félicité est reprise et à nouveau, non pas écar-
tée mais resituée dans un ensemble plus vaste : c’est un des buts de Dieu
mais ce « n’est pas tout son but ni même son dernier but » ; le malheur de
quelques uns peut être la condition sine qua non d’autres biens plus grands.
Leibniz reprend la distinction entre volonté antécédente et volonté consé-
quente mais introduit la médiation de la volonté moyenne, intermédiaire
entre la volonté antécédente et la volonté conséquente. La volonté moyenne
se porte à des combinaisons partielles et la volonté conséquente à la combi-
naison totale. Dieu veut par sa volonté antécédente donner la raison à
quelques unes des créatures parce que c’est un grand bien et il veut écarter
d’elles tout le mal que peut produire le mauvais usage de cette raison. Si le
bien et le mal sont inséparables dans l’usage de la raison, et si le bien
l’emporte sur le mal dans la vie des créatures raisonnables, Dieu veut leur
donner la raison par une volonté moyenne. Et si le mal l’emporte sur le bien,
Dieu peut encore vouloir leur donner la raison si cela est exigé par la perfec-
tion du tout, et cette volonté, qui est décrétoire, est la volonté finale
§ 120. « S’il n’y avait que des esprits… » Dieu a donné le franc ar-
bitre aux créatures raisonnables que l’on appelle « esprits » mais sans les
soustraire pour autant à la loi universelle d’incarnation (il n’y a pas de corps
sans entéléchie ou d’entéléchie sans corps ; et cela vaut aussi pour les anges,
qui ont un corps plus subtil que le nôtre) ; et c’est cette incarnation qui leur
assigne leur point de vue sur le tout qui les lie au tout (des créatures affran-
chies de matière « seraient détachées en même temps de la liaison univer-
selle, et comme des déserteurs de l’ordre général », « Considérations sur mes
principes de vie… », GF 3, p. 102). Donc s’il n’y avait que des esprits, cad
des êtres détachés de toute matière, « ils seraient sans la liaison néces-
saire… », ils ne seraient pas unis avec toutes les autres créatures en un
© Philopsis – Pascal Dupond 104
www.philopsis.fr
monde. Ce qui permet aux esprits de s’unir en un monde, c’est donc aussi ce
qui les établit dans la faillibilité, dans la possibilité de pécher.
Si on objecte que Dieu aurait pu donner à tous les esprits ce qu’il n’a
donné qu’à certains d’entre eux, on répondra que le tout, qui veut la variété
en aurait été moins parfait.
§ 122. « Au reste on n’a aucun sujet de se plaindre de ce qu’on ne
parvient ordinairement au salut que par bien des souffrances et en portant la
croix de Jésus Christ… ». La croix du peut-elle relever d’une théologie ra-
tionnelle ? N’appartient-elle pas plutôt à la théologie révélée ?
§ 124. Dieu a permis le vice. On en conclut que son affection pour la
vertu n’est pas la plus grande qu’on puisse concevoir.
Leibniz répond : la conclusion, qui est fausse, est tirée d’une considé-
ration erronée et des choses créées et de la nature de Dieu. Cette considéra-
tion erronée consiste à dissocier ce qui est en vérité uni : le genre humain est
séparé de l’univers dont il n’est qu’une partie comme les perfections de Dieu
sont considérées isolément.
Nous nous étonnons que Dieu ait créé l’homme faillible, alors qu’il
pouvait le créer constamment vertueux. Leibniz répond : nous isolons le
genre humain de l’univers, nous supposons par fiction qu’il est le seul objet
de la volonté divine ; nous séparons la puissance de Dieu et la sagesse de
Dieu. L’étonnement, l’embarras vient d’une pensée abstraite, c’est-à-dire
d’une pensée qui sépare par fiction ce qui, dans l’être, est uni. Ce qui est re-
quis pour échapper aux fausses interrogations de ce genre, c’est une inver-
sion de la manière de penser. On s’obnubile sur une possibilité non réalisée :
un homme purement vertueux. Le remède est de revenir au réel : l’homme
réel est un homme faillible ; Dieu a donc permis le vice ; il a permis le vice
parce que l’ordre de l’univers exigeait l’homme faillible ou parce que
l’homme faillible fait partie du meilleur des mondes possibles. Il n’était pas
possible à Dieu (en vertu des vérités éternelles49 que connaît sa sagesse) de
créer par sa puissance un monde meilleur que celui dans lequel existent ces
homme faillibles que nous sommes ; donc il n’était pas permis à Dieu de
créer par sa volonté un autre monde que celui dans lequel nous sommes ces
hommes faillibles. La puissance de Dieu est liée par sa sagesse, mais ce lien
ne doit pas être compris comme une contrainte ; la création du meilleur
monde est certes nécessaire, mais cette nécessité n’est pas absolue (au sens
où une autre création serait contradictoire), elle est hypothétique, au sens où
elle n’est nécessaire que sous la condition de la volonté du plus grand bien,
et cette nécessité se confond avec la liberté.
Nous avons la certitude rationnelle que, à l’échelle du tout, s’il n’y
avait que vertu, ou s’il n’y avait que des créatures raisonnables, il y aurait
moins de bien. Mais quel est le statut de cette certitude ? Relève t-elle d’une
confiance en ce que nous ne voyons pas (selon la formule luthérienne) ou
peut-elle entrer aussi dans la lumière de la compréhension rationnelle ?
Leibniz s’y essaie sous plusieurs perspectives
1/ La perfection de l’univers exige de la variété : la répétition de
l’identique, même du plus haut prix, n’accroît pas la richesse, elle est plutôt
signe de pauvreté. Midas perd la vie, perd le monde au moment où tout ce
qu’il touche se change en or
49
Nombreuses occurrences de ce terme, par exemple TH, II, 149.
© Philopsis – Pascal Dupond 105
www.philopsis.fr
2/ Cette exigence de variété nous fait comprendre que la nature ait eu
besoin d’animaux, de plantes, de corps inanimés, c’est-à-dire d’une multi-
tude de créatures « non raisonnables » s’ordonnant en une multitude de de-
grés de perfection différents.
3/ L’être raisonnable est au dessus de l’être non raisonnable mais il
n’en est pas délié, le second a son rôle à jouer dans la vie du premier.
a. Il joue un rôle comme objet de connaissance : les êtres qui ne sont
pas des esprits donnent aux esprits l’occasion de s’émerveiller de la création
et d’aimer le créateur, et ils fournissent aussi tout simplement un objet à la
pensée.
La créature se distingue de Dieu en ce qu’elle a des pensées confuses,
qui constituent ce qu’on appelle les sens ou la sensibilité, et avec cette sensi-
bilité lui est aussi donnée la représentation de la matière et du mouvement
(« aussitôt qu’il y a un mélange de pensées confuses, voilà les sens, voilà la
matière… »). Matière et mouvement font partie des phénomènes bien fon-
dés ; ils sont une certaine manière, une manière confuse (que l’on appelle
sensibilité) de se représenter les liaison des choses, à savoir comme ordre des
coexistants (l’étendue) et ordre des successifs (la durée). Sur cette représen-
tation confuse se greffent les concepts mathématiques qui accroissent la pré-
cision et l’efficience de la connaissance sensible, sans soustraire pourtant son
objet à son statut de phénomène bien fondé50.
50
[Quelques remarques sur la conception leibnizienne de l’espace et du temps.
« Le temps et l'espace marquent des possibilités au-delà de la supposition des exis-
tences. Le temps et l'espace sont de la nature des vérités éternelles qui regardent également le
possible et l'existant » (NE, II, XIV, p. 129) – « L'espace n'est rien d'autre que l'ordre de
l'existence simultanée des possibles, de même que le temps est l'ordre de l'existence succes-
sive des possibles » (lettre à de Volder, 30 juin 1704) – « Pour moi, j'ai marqué plus d'une fois
que je tenais l'espace comme quelque chose de purement relatif, comme le temps ; pour un
ordre des coexistences, comme le temps est un ordre des successions… » - « L’espace est
quelque chose d'uniforme absolument ; et sans les choses y placées, un point de l'espace ne
diffère absolument en rien d'un autre point de l'espace. Or il suit de cela (supposé que l'espace
soit quelque chose en lui-même outre l'ordre des corps entre eux) qu'il est impossible qu'il y
ait une raison pourquoi Dieu gardant les mêmes situations des corps entre eux, ait placé les
corps dans l'espace ainsi et non pas autrement ; et pourquoi tout n'a pas été pris au rebours,
par un échange de l'orient et de l'occident » (à Clarke, 25 février 1716) » - « On dit que
l’espace ne dépend point de la situation des corps. Je réponds qu'il est vrai qu'il ne dépend
point d'une telle ou telle situation des corps ; mais il est cet ordre qui fait que les corps sont si-
tuables, et par lequel ils ont une situation entre eux en existant ensemble, comme le temps est
cet ordre par rapport à leur position successive. Mais s'il n'y avait point de créatures, l'espace
et le temps ne seraient que dans les idées de Dieu » (à Clarke, 2 juin 1716)
Sur la question de l’espace et du temps, la position de Leibniz est diamétralement op-
posée à celle de Newton et des newtoniens. Ceux-ci affirment qu'il y a un espace et un temps
absolu; Leibniz soutient que l'espace et le temps n'ont pas d'existence en soi et ne sont rien
qu'un certain ordre entre les choses, soit, concernant l'espace, entre les choses coexistantes,
soit, concernant le temps entre les choses successives.
De cette définition, on doit souligner deux aspects
1. La notion d'ordre - on la retrouve dans les différents textes qui traitent de l'espace
et du temps : 3e écrit de Leibniz contre Clarke (p. 53) ou NE, II, XIII, p. 125; il y a ordre là
où il y a une pluralité d'éléments dont la situation respective est commandée par une règle.
Leibniz écrit dans un Résumé de métaphysique de 1697 (§ 15) : « Le fait d'être distinctement
accessible à la pensée est signe d'ordre pour la chose pensée et de pour l'être qui la pense.
L'ordre n'est en effet rien d'autre qu'une relation distincte dans une pluralité. Et il y a confu-
sion lorsqu'on a affaire à une pluralité, mais qu'il manque une raison pour distinguer les
termes les uns des autres ».
2. L'articulation subtile entre la possibilité et l'existence ; on la trouve dans la lettre à
de Volder, mais aussi dans les NE (texte cité: le temps « est un rapport, un ordre, non seule-
ment entre les existants, mais encore entre les possibles comme s'ils existaient. Mais sa vérité
et réalité est fondée en Dieu comme toutes les vérités éternelles »). Cette proposition montre
© Philopsis – Pascal Dupond 106
www.philopsis.fr
b. Et cette matière, que l’être raisonnable se représente dans sa sensi-
bilité, elle n’est pas seulement hors de lui, elle appartient à sa propre consti-
tution ; l’esprit se représente comme matière, comme corps organique
l’ensemble des monades dont il est la forme substantielle, ou les relations
d’expression qui les lient les unes aux autres et aux corps extérieurs. Pour un
esprit fini, la matière n’est jamais seulement en position d’obstance, il la
contient dans sa propre profondeur et comme la face inconsciente de son
identité.
On remarque enfin que Leibniz distingue « créature raisonnable » et
« esprit créé ». La créature raisonnable (l’homme ?) fait partie des esprits
créés, mais il existe des esprits créés supérieurs à l’homme, et la perfection
des corps est en proportion de celle des esprits (selon la règle de l’harmonie).
§ 136. Quelques remarques sur le « dieu méchant » de la tragédie.
La tragédie est une mise en scène du deinon, l’étrange, l’inquiétant, le
formidable, le terrible (la meilleure traduction consisterait p-ê: à rendre dei-
non par formidable, où se lit une oscillation entre l’admirable et le mons-
trueux).
L’issue tragique qui attend Antigone est terrible (au v. 96, Antigone
répond à Ismène qui tente de la dissuader de poursuivre l’irréalisable:
« Laisse-moi, avec ma témérité, souffrir le terrible. Je ne souffrirai jamais
assez pour ne pas mourir glorieusement »).
L’homme comme tel est deinon et même deinon au plus haut degré
dans la mesure où il oscille entre le bien et le mal: « Doué dans son industrie
d’une ingéniosité inespérée, il va, tantôt vers le mal, tantôt vers le
bien…… » (v. 365-369), il oscille entre la gloire et l’errance (upsipolis-
apolis), entre l’ingéniosité (pantoporos) et l’enfermement dans le sans issue
(aporos)..
La puissance du destin est terrible (Antigone, v. 951 : « la puissance
du destin est terrible, et ni l’opulence, ni Arès, ni les remparts des cités, ni
les vaisseaux sombres battus des vagues ne peuvent lui échapper »).
Ce qui rend le destin terrible, c’est sans doute qu’il est une puissance
indifférenciée, puissance de vie et puissance de mort, puissance de lumière et
puissance d’aveuglement La tragédie est, à un degré ou à un autre, une théo-
logie de l’aveuglement.
Cette théologie de l’aveuglement est présente dans l’épopée homé-
rique. Alors même que la théologie homérique tend à donner aux dieux une
figure plastique et spirituelle déterminée et précise (un eidos), subsiste un
fond de divinité résistant à la personnalisation et qui est souvent nommé Né-
cessité ou Moire ou Erinyes, un fond de puissance non personnalisée, indif-
férenciée.
Ce fond est repris par la tragédie, qui met en scène une puissance dé-
monique impersonnelle qui aveugle l’homme Ainsi:
- les Perses, v. 94 et sv.: « Au piège qu’a tendu le dessein perfide d’un
dieu, quel mortel pourrait échapper ?…… »
que 1/ l'espace et le temps ont une vérité qui n'est pas dépendante de l'existence des choses,
puisqu'ils désignent un ordre entre les possibles et relèvent à ce titre des idées ou de l'enten-
dement de Dieu (A Clarke, 2 juin 1716: « s'il n'y avait point de créatures, l'espace et le temps
ne seraient que dans les idées de Dieu ») ; 2/ il est cependant nécessaire que le possible soit
pensé sous le jour de l'existence pour que l'espace et le temps y apparaissent comme expri-
mant les relations des choses. espace et temps ne sont pas « produits » par l'existence ; ils sont
un ordre entre les choses en tant qu'elles sont pensées, mais pensées comme existantes.
© Philopsis – Pascal Dupond 107
www.philopsis.fr
- id. v. 353: « Ce qui commença, Maîtresse, toute notre infortune, ce
fut un génie vengeur, un dieu méchant (kakos daimôn) surgi je ne sais
d’où…… »
- id. v. 724: « -Il a été jusque là: fermer le grand Bosphore ! - Un
dieu, sans doute, avait touché ses esprits. -Terrible dieu, pour l’avoir à ce
point aveuglé…… »
- id v. 742: « quand un mortel s’emploie à sa perte, les dieux vien-
nent l’y aider ».
Antigone, v. 581: « Lorsque les dieux ébranlent une maison, le mal-
heur s’acharne sans répit sur la multitude de ses descendant. ……… »
id v. 621: « Le mal paraît un bien à celui dont la divinité mène
l’esprit à sa perte; il n’est alors que pendant peu de temps à l’abri du mal-
heur ».
Le héros tragique est jeté dans l’aveuglement au moment où un démon
mauvais prend possession de sa personnalité raisonnable et l’aliène.
Réponse de la philosophie : Dieu est innocent (theos anantios)
§ 144. Les défenseurs des deux principes sont faibles quand ils sont
confrontés aux raisons a priori (ou prises de la nature de Dieu) de penser
Dieu comme les le font les chrétiens ; mais ils retrouvent leur force dans les
raisons a posteriori prises de l’existence du mal
§ 146. L’homme paraît être la seule partie de l’univers connu qui fasse
exception à l’ordre et la beauté. Leibniz répond : ordre et beauté apparaissent
en tout ce qui a la nature d’un tout, même si ce tout est une partie d’un tout
plus grand ; le désordre ne tient pas à la chose mais à la vue partielle que
nous en avons. Le système solaire, la plante, l’animal, l’homme (considéré
comme individu, non pas seulement dans son organisation animale mais aus-
si dans sa qualité d’être raisonnable) sont des « touts » et par conséquent ont
et font apparaître de la perfection. Mais le genre humain n’est pas un tout, il
n’est qu’une partie de la république des esprits, et tant que nous n’aurons pas
une vue générale sur cette république des esprits, nous serons incapables de
voir comment les désordres du genre humain font partie du plus bel ordre.
« Préjugé » signifie dans le passage autant que « présomption ».
§ 147. « C’est là où le franc arbitre joue son jeu » : le franc arbitre
joue son jeu dans la conduite humaine parce que Dieu donne tout ce qui est
requis pour son exercice (« être, force, vie, raison ») mais « d’une manière
occulte », sans se faire voir et sans se substituer à l’homme dans l’agir. Nous
sommes comme l’enfant qui agit dans son monde en ignorant tout ce qui
conditionne l’exercice de sa liberté, c’est-à-dire l’opération des adultes qui
ouvrent par leurs soins l’espace où l’exercice de cette liberté est possible
« Notre » monde est le monde même mais sous la perspective limitée
selon laquelle il s’ouvre à nous, et cette perspective limitée en fait un idios
kosmos qui souvent se choque avec les autres et c’est par là que le mal ar-
rive le plus souvent.
§ 149. Reprise d’un thème fondamental de la Théodicée :
« l’entendement fournit le principe du mal » ; la limitation des créatures, le
mal métaphysique, moral, physique, fait partie des vérités éternelles que
Dieu ne crée pas.
Puissance, entendement ou sagesse, volonté ou bonté correspondent à
l’être, au vrai et au bien ; la puissance précède l’entendement et la volonté au
sens où les caractères transcendantaux de l’être (unum, verum, bonum) sup-
© Philopsis – Pascal Dupond 108
www.philopsis.fr
posent l’être auquel ils sont attribués ; mais la puissance n’agit que selon le
vrai et le bien.
§ 153. Il n’y a pas de principe du mal, le mal n’est que privation, mais
il n’y en a pas moins du positif dans le mal, à savoir le pouvoir de produire
certains effets.
Pour faire comprendre qu’une privation ait des effets, Leibniz pro-
pose, après l’inertie, une seconde analogie physique : la congélation fait
éclater le canon du mousquet. Leibniz recourt dans le « Dialogue sur la liber-
té » à une analogie mathématique : « …dans l’arithmétique, les zéros joints
aux unités font des nombres différents comme 10, 100, 1000… » (GF 2, 52-
53)
§ 156. « Et quant à la cause du mal, il est vrai que le diable est l’auteur
du péché… » Cette proposition relève t-elle d’une théologie rationnelle ?
Dans la première partie, Leibniz rend compte du mal moral dans une déduc-
tion purement rationnelle, qui est ici brièvement évoquée et présentée
comme seule « fondamentale » (« … l’origine du péché vient de plus
loin… »). S’agit-il d’une simple concession de langage à une « connaissance
du premier genre » de vérités qui sont au fond rationnelles ?
§ 162. Ce paragraphe se réfère à la lettre de Descartes à Elisabeth de
janvier 164651.
51
Deux remarques.
1/ D’abord la comparaison de Dieu et d’un roi modifie très sensiblement les données
du problème. Si les deux gentilshommes dont le roi provoque la rencontre sont pourvus d’un
libre-arbitre rendant leurs actes imputables et punissables, alors leur duel, quelle que soit leur
hostilité initiale, n’est pas nécessaire. Il est contingent, il peut se produire ou non -même s’il
est très probable qu’il ait lieu. Et ce qui le décidera, ce n’est rien d’autre que la libre volonté
des protagonistes. Le roi qui les convoque en un même lieu rend leur rencontre, mais non leur
duel, nécessaire.
Mais supposons, comme Descartes, que le roi sache que les deux gentilshommes sont
tellement hostiles « que rien ne les saurait empêcher de se battre s’ils se rencontrent ». En
rendant leur rencontre nécessaire, ne rend-il pas aussi leur duel nécessaire, sans préjudice de
leur libre-arbitre ? Ici une distinction s’impose. Que sait au juste le roi, quand il sait qu’ils se
battront ? S’il sait que leur tempérament et leurs relations antérieures les prédisposent presque
invinciblement à se battre, il connaît une probabilité, une probabilité équivalant, si on veut, à
une certitude « morale », mais une simple probabilité. Il sait qu’il est très vraisemblable qu’ils
se battront, mais il ne sait pas s’ils se battront vraiment. Et cette différence veut simplement
dire que l’avenir n’est pas entièrement déterminé, justement parce que le libre-arbitre existe.
Et si le roi, seconde hypothèse, sait qu’ils se battront parce qu’il connaît l’avenir ou le déter-
mine par sa volonté, alors il n’y a plus de libre-arbitre. On voit ici que l’argumentation de
Descartes repose sur une équivoque présente dans l’idée : « le roi sait qu’ils se battront ». Ou
le savoir du roi porte en fait sur le passé et il s’y ajoute une conjecture sur l’avenir, mais alors
le futur est contingent et le libre-arbitre garde tous ses droits. Ou bien il porte sur l’avenir, qui
est connu par anticipation parce qu’il est déterminé, mais alors il n’y a plus de libre-arbitre.
2/ Dieu est-il savoir ou vouloir ? Parfois Descartes paraît donner une préséance au sa-
voir : Dieu a su que les inclinations de notre libre-arbitre seraient telles et telles, il a su par an-
ticipation ce que chaque volonté humaine se déterminerait à vouloir et ce qu’il savait qu’elle
voudrait, il l’a aussi voulu. Ici l’initiative revient pour ainsi dire à la volonté humaine, qui est
seulement “devinée” par anticipation et accompagnée par la volonté de Dieu. Mais par ail-
leurs, ce savoir de Dieu est immédiatement un vouloir, Dieu connaît toutes les inclinations de
notre vouloir, parce qu’il les a mises en nous. Dans ces conditions, la volonté humaine perd
son pouvoir d’initiative, et le libre-arbitre disparaît. Selon l’orientation générale de son argu-
mentation, Descartes paraît vouloir montrer que l’omniscience de Dieu ne porte aucun préju-
dice au libre-arbitre humain. Mais, en cours de route, cette omniscience se révèle être aussi la
puissance de déterminer toutes les inclinations du libre-arbitre, de telle sorte que la spontanéi-
té de la volonté humaine devint problématique].
© Philopsis – Pascal Dupond 109
www.philopsis.fr
§ 168. Une cause morale du mal moral, c’est toujours une volonté. Les
« raisons morales » intervenant dans la question reviennent toutes à savoir si
l’homme est innocent ou coupable, si Dieu est innocent ou coupable, bref,
elles reviennent à distribuer d’une façon ou d’une autre la responsabilité du
mal moral entre la volonté humaine et la volonté divine. Leibniz pense avoir
réglé la question en établissant que Dieu a fait le mieux, donc n’est pas res-
ponsable du mal moral, qu’il ne veut pas le mal moral, si ce n’est d’une vo-
lonté permissive et comme condition sine qua non de la plus grande perfec-
tion du tout. Cela implique que la responsabilité du mal moral retombe sur la
volonté humaine.
Mais la solution leibnizienne : c’est l’homme, et non Dieu, qui est res-
ponsable du mal moral a des prémisses métaphysiques : elle suppose que
Dieu ait choisi le meilleur monde, entre une infinité de mondes possibles,
donc que le possible (que pense l’entendement) soit plus vaste que le réel
(que décrète la volonté), et que le réel soit contingent ; elle suppose que si le
réel est pensé comme nécessaire ce soit, non pas au sens de la nécessité ab-
solue (qui exclut la contingence), mais au sens de la nécessité hypothétique
(« Conversation sur la liberté et le destin, GF 3, p. 48)
A ces prémisses métaphysiques, on peut vouloir substituer trois autres
solutions.
1/ Certains soutiennent que le possible et le réel sont exactement coex-
tensifs, donc que tout ce qui est ne pouvait pas ne pas être, est nécessaire ab-
solument, ce qui exclut toute idée d’un choix divin du meilleur. C’est, dit la
« Conversation… », « l’opinion de Hobbes, de Spinoza, de quelques anciens
et peut-être de Monsieur Descartes » (voir GF 3, p. 59, note 2) : tout est né-
cessaire au sens où il est nécessaire que les angles tracés des extrémités du
diamètre vers la circonférence soient des angles droits.
2/ D’autres refusent d’admettre que Dieu ne peut manquer de faire le
mieux ; si on le dit, observent-ils, on prive Dieu de liberté (et les choses de-
viennent nécessaires) ; Dieu n’est libre dans sa création que si cette liberté
est une liberté d’indifférence ; et si la volonté divine est indifférente, il n’y a
pas de raison de penser que notre monde est le meilleur. Réponse de Leib-
niz : ils confondent nécessité absolue et nécessité hypothétique ; mais ce ne
sont pas des adversaires irréductibles : s’ils accordent que Dieu fait le meil-
leur, ce ne sera pas difficile de leur montrer que ce choix du meilleur
n’implique pas une nécessité métaphysique mais seulement une nécessité
morale (ce qui fait disparaître leur motif de soutenir que la volonté de Dieu
est indifférente).
3/ D’autres enfin soutiennent que Dieu aurait pu mieux faire :
quelques scolastiques (thomistes) modernes et Malebranche (voir note 2 de
DM III, Vrin p. 211).
§§ 169-175. Examen de la première position : le nécessitarisme et ses
variations : Diodore, les stoïciens, Pierre Abélard, Hobbes, Spinoza
§ 169. Aristote soutient que les futurs contingents n’ont pas de vérité
déterminée (chapitre 9 de l’Hermeneia). Dans le § 331, Leibniz parle
d’« inadvertance » ! (Aristote « a fort bien reconnu la contingence et la liber-
té, et est même allé trop loin en disant (par inadvertance, comme je crois)
que les propositions sur les futurs contingents n’avaient pas de vérité déter-
minée »)
© Philopsis – Pascal Dupond 110
www.philopsis.fr
Epicure, pour sauver la contingence du futur, nie que toute énoncia-
tion soit vraie ou fausse (Leibniz parle d’une négation du « principe des véri-
tés de raison » ; nier que toute énonciation soit vraie ou fausse, cela atteint
toutes les vérités, vérités de fait et vérités de raison)
Bayle renvoie dos à dos Chrysippe et Epicure en remarquant que
l’affirmation selon laquelle toute énonciation est vraie ou fausse ne prouve
pas l’existence du fatum ; Chrysippe n’a donc pas à s’en prévaloir pour
prouver le fatum, et Epicure n’a pas à la rejeter pour échapper au fatum.
Tirésias dit : tout ce que je dirai arrivera ou non (= toute énonciation
que je ferai est vraie ou fausse) parce que Apollon m’a donné la faculté de
prophétiser ; Bayle commente : c’est une absurdité ; il n’est pas nécessaire
d’avoir le don de prophétiser pour que l’énonciation que l’on fait soit vraie
ou fausse ; supposons qu’il n’y ait point de Dieu qui prédétermine les évé-
nements du monde et en ait la prescience, l’énonciation que fait le plus grand
fou n’en est pas moins vraie ou fausse : vraie si elle est confirmée par
l’événement et fausse dans le cas contraire. Et Bayle conclut : « c’est à quoi
ni Chrysippe ni Epicure ne prenaient garde ».
Nous pourrions poser à Bayle la question suivante : suffit-il, pour
qu’une énonciation soit vraie, qu’il y ait une coïncidence aléatoire entre une
énonciation : « demain il y aura une bataille navale », et l’événement ? Pour
que l’énonciation soit vraie, n’est-il pas nécessaire qu’elle soit une vue ou
une connaissance anticipée de l’événement ? Mutatis mutandis, supposons
qu’un perroquet ait appris à dire que la somme des angles d’un triangle vaut
180°. Cette énonciation est-elle vraie ? Et d’abord sa profération est-elle une
véritable énonciation ? Pour qu’il y ait énonciation et énonciation vraie,
l’être doit devenir manifeste au regard de celui qui énonce, ce qui n’est le cas
ni du perroquet ni du grand fou dont parle Bayle. Et cela Aristote paraît
l’avoir parfaitement compris en Hermeneia 9.
§ 170. Diodore et les stoïciens
Diodore Cronos est l’auteur de l’argument dominateur ; c’est un phi-
losophe de l’école mégarique contemporain d’Aristote. Outre Hermeneia 9,
voir Epictète, Entretiens, II, XIX, Cicéron, De fato.
L’argument met en évidence l’impossibilité de soutenir simultanément
les trois propositions suivantes : « toute proposition vraie concernant le passé
est nécessaire » (= le passé est irrévocable) ; « l’impossible ne suit pas logi-
quement du possible » (= du possible à l’impossible la conséquence n’est pas
bonne) et « Est possible ce qui n’est pas actuellement vrai et ne le sera pas »
(= il y a des possibles qui ne se réaliseront jamais).
Diodore retient les deux premières :
1/ il est impossible que les choses passées ne soient pas, puisqu’elles
ont eu lieu ;
2/ de ce qui est possible je ne peux pas inférer l’impossible ;
et il rejette la 3e ; il affirme donc : « rien n’est possible qui ne soit vrai
actuellement et ne doive pas l’être dans l’avenir » ; donc possible = réel =
nécessaire.
Illustrons par un exemple. A l’ouverture des jeux olympiques, je dis :
il est possible que les athlètes athéniens obtiennent douze médailles (p1) et il
est possible qu’ils ne les obtiennent pas (p2). S’agit-il d’une contingence
subjective ou d’une véritable indétermination dans l’être ? Pour le savoir, re-
portons nous à la fin des jeux, et supposons que p2 soit réalisée ; du même
© Philopsis – Pascal Dupond 111
www.philopsis.fr
coup la possibilité de p1 est supprimée, puisque ce qui est arrivé ne peut être
changé (1e proposition) ; p1 est impossible ; si p1 est impossible (à la ferme-
ture des jeux), alors il n’était pas possible à l’ouverture, car si je l’admettais,
cela voudrait dire que l’impossible peut résulter du possible. Donc le pos-
sible qui ne se réalisera pas est impossible. La contingence que j’exprime en
disant : il est possible que… ou que… a une signification simplement sub-
jective.
On peut donc présenter l’argumentation de Diodore sous la forme sui-
vante :
1/ Si quelque chose était possible qui n’est ni ne sera, un impossible
résulterait d’un possible
2/ Or un impossible ne peut résulter d’un possible
3/ Donc rien n’est possible qui ne soit ou ne doive être (possible = né-
cessaire).
Le sophisme consiste à prendre le mot résulter en deux sens diffé-
rents : dans la première proposition, résulter = succéder au sens temporel :
quelque chose d’impossible (= à l’issue des jeux, il est impossible
qu’Athènes ait 12 médailles, puisqu’elle n’en a gagné par exemple que 8) a
succédé à quelque chose de possible (au début des jeux, il était possible
qu’Athènes gagne 12 médailles. Dans la 2e proposition, résulter = suivre lo-
giquement. Diodore confond la nécessité de fait (quelque chose qui était
possible est devenu impossible) et la nécessité de droit ( = on ne peut pas dé-
duire logiquement l’impossible du possible).
Et c’est bien en ce sens qu’Aristote réplique à Diodore : il faut distin-
guer une nécessité absolue ou aplôs, indépendante de la condition du temps
et une nécessité conditionnelle, soumise à la condition du temps (19 a 23 :
« il est nécessaire que ce qui est soit, tant qu’il est [c’est la condition de
temps] et que ce qui n’est pas ne soit pas tant qu’il n’est pas ») et corrélati-
vement les vérités qui peuvent être « rétrogradées » et « progradées » (si le
théorème de Pythagore est vrai aujourd’hui, il l’était aussi hier et le sera aus-
si demain) et celles qui ne le peuvent pas (que la proposition : il y a une ba-
taille navale soit vraie et nécessaire aujourd’hui (elle a lieu et ne peut pas ne
pas avoir lieu au moment où elle a lieu) n’implique pas qu’elle était vraie et
nécessaire (absolument) hier ; la nécessité conditionnelle étant inséparable
du contexte temporel est énoncée dans une proposition dont la vérité ne peut
pas être rétrogradée.
Cette critique aristotélicienne est sous-tendue par la distinction de
l’être en puissance et de l’être en acte.
Les stoïciens ne font pas la critique de l’argument dominateur : ils ac-
ceptent la contrainte de choisir deux d’entre les trois propositions proposées
mais retiennent la 3e (le possible est ce qui peut ne pas arriver) : « Je crois
que les stoïciens s’engagèrent à donner plus d’étendue aux choses possibles
qu’aux choses futures afin d’atténuer les conséquences odieuses et affreuses
que l’on tirait de leur dogme de la fatalité » (fin de la citation de Bayle).
Cléanthe rejette la première proposition (sur la nécessité des proposi-
tions relatives au passé : « il n’est pas exact de dire que toute proposition
vraie concernant le passé est nécessaire ; c’est là ce que paraît soutenir
l’école de Cléanthe… » : en vertu de l’éternel retour, le passé n’est pas irré-
vocable, il peut revenir) et conserve les deux dernières.
© Philopsis – Pascal Dupond 112
www.philopsis.fr
Chrysippe conserve la première (« Chrysippe reconnut que les choses
passées étaient nécessairement véritables, ce que Cléanthe n’avait point vou-
lu admettre ») et rejette la seconde, admettant ainsi que l’impossible peut
procéder du possible.
Le parti que Chrysippe adopte, commente Leibniz, est difficile : s’il
raisonne avec conséquence, s’il veut être cohérent avec « son dogme de la
destinée », il doit reconnaître que « tout ce qui n’arrive pas est impossible ».
Et selon Plutarque « son opinion de la possibilité est tout à fait opposée à la
doctrine du fatum ».
Et cependant « Chrysippe et son maître Cléanthe étaient là-dessus plus
raisonnables qu’on ne pense ». Pourquoi ? Sans doute parce qu’ils étaient
fondés à refuser le nécessitarisme de Diodore, ce qui est aussi le souci de
Leibniz
Le noyau philosophique des divergences entre Diodore et les stoïciens
et entre stoïciens pourrait se résumer dans la question suivante : le passé est-
il plus nécessaire que le futur ? Leibniz incline vers la négative (« Conversa-
tion avec Sténon », GF 1 p. 127 : « tout futur n’est pas moins certainement et
nécessairement futur que tout passé est nécessairement passé »).
§ 172. Hobbes (voir aussi § 371 : « Hobbes rendait tout matériel et le
soumettait aux seules lois mathématiques » et Réflexions sur l’ouvrage de
M. Hobbes)
§ 173. Spinoza « refus[e] l’entendement et la volonté à l’auteur des
choses » (§ 371 : « Spinoza aussi ôtait à Dieu l’intelligence et le choix, lui
laissant une puissance aveugle de laquelle tout émane nécessairement »).
Leibniz se réfère au scolie de la proposition 17 de la première partie de
l’Ethique, où Spinoza écrit : « Je montrerai plus loin […] que ni
l’entendement ni la volonté n’appartiennent à la nature de Dieu » ; le souci
de Spinoza, comme le montre la suite, est surtout d’établir que 1/ volonté et
entendement ne peuvent se dire de Dieu et de l’homme en un sel et même
sens [« si l’entendement et la volonté appartiennent à l’essence éternelle de
Dieu, il faut entendre par l’un et l’autre attributs autre chose certes que ce
que les hommes ont coutume de faire »], 2/ « l’entendement de Dieu en tant
qu’il est conçu comme constituant l’essence de Dieu, est réellement la cause
des choses », ce qui veut dire que puissance de penser et puissance d’exister
sont en Dieu inséparables et égales ; 3/ ce qu’on appelle volonté de Dieu
n’est rien d’autre que la puissance d’exister inséparable de la puissance de
penser. La conséquence est bien celle qu’en tire Leibniz : « toutes les choses
existent par la nécessité de la nature divine sans que Dieu fasse aucun
choix ».
On peut faire valoir contre les spinozistes deux arguments : 1/ ils sont
dans l’embarras au sujet des fictions romanesques : elles sont possibles, donc
si le possible et le réel sont exactement coextensifs, elles sont aussi réelles ;
or aucun spinoziste ne reconnaîtra que les fictions issues de l’imagination
humaine se rapportent à quelque chose de réel passé, présent ou avenir (sur
les fictions romanesques qui sont intrinsèquement possibles mais non pas
compossibles avec les autres réalités de notre monde, voir lettre à Bourguet,
GF 3, p. 273 ; « De la contingence », GF 1 p. 319 : « Il faut tenir pour certain
que tous les possibles ne parviennent pas à l’existence ; sans quoi on ne
pourrait imaginer aucun être romanesque qui n’ait existé quelque part ou en
quelque temps » ; « De libertate », GF 1 p. 327-328). 2/ La posture spino-
© Philopsis – Pascal Dupond 113
www.philopsis.fr
ziste élimine la distinction universellement reconnue entre ce qui enveloppe
contradiction et est impossible et ce qui n’enveloppe pas contradiction et est
possible. En outre, si tout possible est réel, il n’y a plus aucun sens à parler
de la bonté de Dieu ; voir les textes cités en GF 1 note 3 (p. 334).
§ 175. Examen de la seconde position : l’indifférence divine. Deux ou
trois versions :
1/ « La nature de la justice est arbitraire » (§ 177) - « Dieu a établi le
bien et le mal dans une loi positive » (§ 176) : bien et mal ne se distinguent
que par la loi qui prescrit l’un et interdit l’autre ; si le mal est le mal, c’est
pour la seule raison qu’il est interdit.
2/ Bien et mal se désignent comme tels par leur propre nature (qui est
« fixe ») et ne sont donc pas institués par une loi divine, mais cette diffé-
rence de nature entre le bien et le mal ne détermine pas la volonté divine à
vouloir l’un et à écarter l’autre ; Dieu ne choisit pas le meilleur et « rien ne
l’empêche d’agir injustement et de damner peut-être des innocents ».
3/ Ce que nous appelons juste ou injuste n’a aucun rapport avec ce qui
est juste ou injuste aux yeux de Dieu
Les conséquences sont les mêmes : non seulement on déshonore Dieu
mais on perd toute confiance en Dieu et tout amour de Dieu, on rend impos-
sible toute société des esprits unissant les esprits créés et Dieu.
La religion naturelle exige un Dieu sage et bon : sage parce qu’il
n’agit pas sans connaissance et que sa connaissance est celle des règles éter-
nelles de la bonté et de la justice ; bon parce qu’il veut le bien qu’il connaît.
La question est déjà abordée dans l’Euthyphron de Platon, cité à la fin
du § 182 : le pieux n’est pas le pieux parce qu’il est aimé des dieux, mais il
est aimé des dieux parce qu’il est le pieux.
§§ 178-192
Contre la première des trois positions, Leibniz soutient que les vérités
ainsi que les règles de bonté et de justice sont antérieures aux décrets de
Dieu.
Mais qu’elles soient antérieures aux décrets de Dieu ne veut pas dire
qu’elles soient indépendantes de Dieu. Leibniz n’approuve pas la position de
ceux qui affirment que les vérités éternelles et les règles de bonté et de jus-
tice resteraient ce qu’elles sont même s’il n’y avait aucun Dieu, aucun en-
tendement divin pour les penser, ou que « quand même tout ce qu’il y a
d’intelligence périrait, les propositions véritables demeureraient véritables »
(§ 183).
De Jacques Thomasius, Leibniz reprend l’idée « qu’il n’est pas à pro-
pos d’aller tout à fait au delà de Dieu ». Pour qu’il y ait une vérité éternelle
sur les propriétés du triangle, il est nécessaire qu’il existe un triangle. Or tout
ce qui existe, en quelque modalité que ce soit, n’existe que par l’existence
originaire qui se pose elle-même et pose avec elle tout ce qui est pensable ;
« toute réalité doit être fondée dans quelque chose d’existant » (§ 184) : tout
ce qui est une res, tout ce qui est quelque chose pour la pensée doit participer
de l’être pour être quelque chose, et cette participation de l’être n’est rien
d’autre que la réalité objective du pensable dans l’entendement originaire.
Voir NE livre IV, ch.11, § 13 :
« On demandera [...] où seraient ces idées si aucun esprit n’existait, et
que deviendrait alors le fondement réel de cette certitude des vérités éter-
nelles. Cela nous mène enfin au dernier fondement des vérités, savoir à cet
© Philopsis – Pascal Dupond 114
www.philopsis.fr
esprit suprême et universel qui ne peut manquer d’exister, dont
l’entendement, à dire vrai, est la région des vérités éternelles, comme saint
Augustin l’a reconnu et l’exprime d’une manière assez vive ».
Leibniz se réfère aussi à deux thèmes aristotéliciens.
D’abord celui de la subalternation des sciences ; aucune science ne
peut démontrer ses propres principes, mais les principes d’une sciences peu-
vent être démontrés par une autre, comme ceux de l’optique par la géomé-
trie : le géomètre peut ignorer l’explication physique des phénomènes op-
tiques, et le physicien peut ne pas être capable de démontrer les théorèmes
de géométrie qui sous-tendent ses explications.
Ensuite la définition de la science première comme celle qui prend
pour objet ce que toutes les sciences présupposent, l’être, sans le considérer
en lui-même. C’est là ce qui fait pour Aristote la nécessité d’une science de
l’être en tant qu’être, qu’Aristote finit logiquement par identifier à la science
de l’être premier, soit de l’être qui constitue l’explication ultime de tous les
autres, autrement dit : la théologie.
Au § 186, Leibniz donne sa lecture de la doctrine cartésienne de la
création des vérités éternelles, c’est-à-dire de la doctrine selon laquelle les
vérités éternelles relèvent de la volonté divine. Cette doctrine lui paraît litté-
ralement insoutenable et il faut, par conséquent la lire entre les lignes. Leib-
niz y voit une conséquence de la doctrine cartésienne du jugement, c’est-à-
dire de la doctrine selon laquelle, pour qu’il y ait vérité, sont requis non seu-
lement un acte de l’entendement, mais aussi un acte de la volonté, un ac-
quiescement ; ce qui est conçu par l’entendement ne devient vérité qu’au
moment où la volonté l’affirme. Cette doctrine, appliquée à Dieu, implique
que toutes les vérités, qui passaient jusqu’alors pour relever de
l’entendement de Dieu, soient subordonnées à la volonté et à sa liberté. Or,
objecte Leibniz, si on tient à ce que les vérités nécessaires relèvent de la vo-
lonté de Dieu, cette volonté qui les établit en vérité n’est pas une volonté
libre, tout simplement parce qu’il n’y a pas à choisir (voir aussi « Echantil-
lon de découvertes… », GF 1 p. 291).
Aux § 187-189, Leibniz examine la première raison pour laquelle
Bayle reçoit avec une certaine faveur (bien qu’il reconnaisse ne pas la com-
prendre) la doctrine cartésienne, de la création des vérités éternelles : elle se-
rait un allié dans la lutte contre les stratoniciens c’est-à-dire les nécessita-
ristes ; les stratoniciens excluent toute volonté intelligente de l’origine des
choses ; ils pensent qu’un monde où l’intelligence apparaît peut être l’effet
d’une cause sans intelligence ; ils pensent que la régularité des vérités éter-
nelles suffit à expliquer, sans l’intervention d’aucune volonté, la régularité
du monde ; contre ce danger de spinozisme, la doctrine cartésienne de la
création des vérités éternelles serait l’antidote efficace.
Leibniz objecte : c’est vouloir remédier à un excès par l’excès con-
traire. Entre la doctrine selon laquelle tout dérive de la nécessité et la doc-
trine selon laquelle tout dérive de la volonté, il y a place pour une doctrine
intermédiaire laquelle 1/ constate qu’il y a dans la nature des effets où appa-
raît de l’intelligence, 2/ attribue ces effets intelligents à une causalité non in-
telligente (où intervient la préformation et l’harmonie préétablie) ; c’est le
point d’intersection entre la position de Leibniz et celle des stratoniciens ; 3/
rapporte cette causalité sans intelligence à l’intelligence du créateur (c’est
l’écart avec les stratoniciens).
© Philopsis – Pascal Dupond 115
www.philopsis.fr
Sur les natures plastiques ou principes de vie, voir GF 3, p. 93. La
question des natures plastiques ou formatrices a été débattue entre Bayle (qui
y est opposé au motif qu’elles affaiblissent la doctrine d’une cause intelli-
gente) et Le Clerc (qui les défend). Leibniz les refuse mais en les réinterpré-
tant : il refuse l’idée que des natures incorporelles aient le pouvoir de modi-
fier le mouvement des corps (p. 94) ou de produire leurs corps (100), mais il
soutient l’idée que « les lois du mécanisme toutes seules ne sauraient former
un animal, là où il n’y a rien encore d’organisé » (99) : les lois du méca-
nisme rendent compte du changement d’échelle de l’être organisé (de son
développement ou de son enveloppement) mais non pas de l’organisation ;
ainsi la vérité des natures plastiques est dans l’idée d’une préformation de
l’organisation.
Bayle, selon Leibniz, se fait le raisonnement suivant : si l’on admet
que les vérités éternelles n’ont pas besoin d’un entendement qui les conçoi-
vent pour être régulières (= être les lois nécessaires et invariantes de l’être),
alors on admettra aussi que le monde n’a pas eu besoin d’une cause intelli-
gente pour être régulier (= être un cosmos, un ordre où se réalise une perfec-
tion optimale). Et Leibniz répond (de façon assez elliptique) : si les vérités
éternelles sont régulières en tant que nécessaires et invariantes, leur objet,
qui est la totalité de l’être possible, enveloppe à la fois le régulier et
l’irrégulier, la perfection optimale et les degrés moindres de perfection. Par
conséquent la régularité (nécessité, invariance) des vérités éternelles ne suffit
pas à rendre raison de la régularité du monde (la proportion optimale de dé-
pense et de variété) ; de la régularité des vérités éternelles à la régularité du
monde, la conséquence n’est pas bonne, sauf à faire intervenir un entende-
ment qui discerne, parmi toutes les vérités, celles où se réalise l’optimum et
une volonté qui le fait exister. La médiation de l’entendement et de la volon-
té de Dieu sont nécessaire (§ 350 : « la nature des choses prise sans intelli-
gence et sans choix n’a rien d’assez déterminant »).
L’idée selon laquelle seuls un entendement et une volonté peuvent
rendre raison de la régularité du monde est reprise dans les §§ consacrés aux
axiomes qui fondent l’édifice de la physique. Les lois du mouvement n’ont
pas leur source dans « une nécessité géométrique de causes efficientes »
mais enveloppent « quelque chose qui dépend des causes finales ou de la
convenance » (§ 350).
§ 192. « … toute idée distincte est par là même conforme à son ob-
jet ». Cette formule renvoie au problème général de l’idéalisme : qu'est-ce
qui atteste la conformité d’une idée avec son idéat ? Comme la comparaison
des deux est absurde, le critère doit se trouver dans l’idée elle-même, et c’est
à cette exigence que répond la notion de distinction. Chez Descartes, elle
vient s’ajouter à la clarté, et elle permet d’opposer l’intelligible et le sen-
sible : pour lui, comme pour Leibniz ensuite, la sensation peut être claire,
mais n’est jamais distincte, et, comme telle, elle ne procure pas de représen-
tation adéquate de son objet (PP, I, a.46). Le distinct, c’est ce qu’il est im-
possible de confondre (ibid., a.45). Leibniz reprend et précise l’opposition
du confus et du distinct au § 24 du DM : la connaissance distincte est celle
dont on peut « expliquer les marques », ce qui est le cas quand on définit une
idée ; et si « ce qui entre dans la définition ou connaissance est connu dis-
tinctement, jusqu’aux notions primitives », la connaissance est dite « adé-
quate ».
© Philopsis – Pascal Dupond 116
www.philopsis.fr
N.B. Le problème de la conformité avec l’objet se pose pour nous,
mais pas pour Dieu, puisque la conception distincte des choses précède en
Dieu leur existence : les choses créées sont conformes aux idées de Dieu, et
notre esprit est créé avec des idées innées conformes aux choses, et par là
même conformes aux idées de Dieu.
« …l’entendement divin n’a point besoin de temps pour voir la liaison
des choses… » : la dépendance logique des idées existe en Dieu, mais sans
se déployer dans l’ordre chronologique d’un discours. Leibniz recourt ici à la
notion scolastique d’éminence : ce qui existe dans un effet doit préexister
formellement, c'est-à-dire sous la même forme, dans une cause du même
ordre que son effet, ou éminemment dans une cause d’un ordre supérieur. Par
exemple, la forme spécifique transmise par la génération préexiste formel-
lement dans le géniteur, tandis que la forme de la construction préexiste
éminemment dans la pensée du constructeur.
Ainsi la nature du lien logique de dépendance entre prémisse et con-
séquence permet de penser l’analogie entre l’éternel incréé et le temporel
créé : la discursivité du raisonnement est liée au symbolisme qu’il mobilise,
et au moyen duquel il signifie un rapport intemporel d’implication logique.
La perfection de l’action divine vient de ce que la connaissance di-
vine, à la différence de celle de l’homme, n’est pas tâtonnante : la création
relève d’un choix raisonnable, mais celui-ci, en Dieu, ne requiert pas de syl-
logisme pratique, ni de délibération.
§ 193-fin de la seconde partie. Examen de la seconde position : Dieu
ne choisit pas le meilleur.
§ 193. On voit le bénéfice « théologique » que Leibniz tire des progrès
de l’astronomie : Alphonse de Castille trouve le monde ptoléméen bien im-
parfait et en conclut que Dieu aurait pu améliorer sa création en recevant de
lui quelques bons avis. Mais l’imperfection qu’il trouve dans le monde, nous
le savons aujourd’hui après Copernic et Newton, n’est pas celle du monde
mais celle de sa connaissance du monde : plus la connaissance progresse,
plus la perfection apparaît (lettre à Morell, septembre 1698 : « Nous ne
sommes pas encore dans le vrai point de vue pour juger de la beauté des
choses. C’est à peu près comme dans l’astronomie, où le mouvement des
planètes paraît une pure confusion en le regardant de la terre, mais si nous
étions dans le soleil, nous y trouverions à vue d’œil cette belle disposition du
système que Copernic a découvert à force de raisonner ».
§ 195. Ceux qui soutiennent cette seconde position argumentent ainsi :
si notre monde n’est pas le meilleur, c’est parce qu’il est impossible de pro-
duire une créature parfaite; aucune créature ne pouvant atteindre une absolue
perfection, quelque soit le degré de perfection d’une créature, on peut tou-
jours en concevoir une plus parfaite (Thomas d’Aquin, Somme de théologie,
I a, q 25, a 6.
Réponse de Leibniz : on peut dire d’une chose, d’une substance
simple (qui est limitée par son essence et le degré de perfection correspon-
dant à cette essence) qu’elle occupe un certain rang dans une échelle des de-
grés de perfection ; certaines ont plus de perfection, d’autres en ont moins ;
mais ce qui se dit ainsi des choses ne peut pas se dire de l’univers. Suivent
deux propositions qui semblent donner la raison de cette différence :
1/ l’univers « se devant étendre par toute l’éternité future est un infi-
ni »
© Philopsis – Pascal Dupond 117
www.philopsis.fr
Eternité future : l’infini est plutôt ici a parte post (ou vers l’avenir)
que a parte ante (vers le passé) ; Leibniz paraît donc ici admettre que
l’univers ait eu un commencement, un premier instant
Remarque : ce qui est dit du monde, à savoir qu’il doit s’étendre par
toute l’éternité future et qu’il est infini, peut aussi se dire des substances qui
ont été créées avec le monde, qui dureront autant que le monde et envelop-
pent l’infini. Voir « Système nouveau… » (GF 2, p. 75) : « Tout esprit étant
comme un monde à part […] est aussi durable, aussi subsistant, et aussi ab-
solu que l’univers lui-même des créatures » ; Monadologie (GF 3, p. 265) :
« …chaque substance simple est un miroir du même univers, aussi durable et
aussi ample que lui… » ; « Sur le principe de raison » (RG p. 477) : « …et
puisque, par sa nature elle est un miroir52 de l’univers, elle ne cesse pas da-
vantage que l’univers lui-même ».
On peut donner à la formule « s’étendre par toute l’éternité future un
sens plus précis : aller vers une perfection croissante (en s’inspirant du §
202 : « il se pourrait que l’univers allât toujours de mieux en mieux, si telle
était la nature des choses qu’il ne fût point permis d’atteindre au meilleur
d’un seul coup »53) ; mais à nouveau cela ne distingue pas le monde et les
substances : chez les bienheureux, « le bien peut aller et va à l’infini », il en
va de même pour les autres substances : dans l’opuscule « Sur la doctrine
d’un esprit universel unique », évoquant la « géométrie variable » des orga-
nismes, Leibniz écrit : « l’ordre de la nature demande que tout se redéve-
loppe et retourne un jour à un état remarquable, et qu’il y ait dans ces vicissi-
tudes un certain progrès bien réglé, qui serve à faire mûrir et perfectionner
les choses » ; voir aussi lettre « sur ce qui est indépendant des sens », GF 2,
p. 245 : « …l’avancement ne laisse pas de prévaloir et de gagner ».
52
Voir aussi « Sur la doctrine d’un esprit universel unique », GF 2, p. 229. Leibniz
donne ailleurs une précision intéressante sur la façon dont il faut comprendre le terme miroir :
« Lorsque je dis un miroir, il ne faut pourtant pas penser que je conçois les choses extérieures
comme si elles étaient toujours peintes dans les organes ou dans l’âme même. Il suffit en ef-
fet, pour l’expression d’une chose dans une autre qu’il existe une loi constante des relations
par lesquels les éléments singuliers de la première pourraient être rapportés aux éléments sin-
guliers qui leur correspondent dans la seconde, tout comme un cercle peut être représenté par
une ellipse, c’est-à-dire par une courbe ovale dans une projection en perspective et même par
une hyperbole bien que cette courbe lui soit plus dissemblable et qu’elle ne revienne pas sur
elle-même, car à tout point de l’hyperbole peut être assigné par la même loi constante un
point correspondant du cercle dont elle est le projeté » [NB on obtient une hyperbole en
« tranchant » un cône posé sur sa base par un plan ayant un angle approprié et qui pourra être
par exemple vertical ou perpendiculaire à la base du cône] ; voir aussi RG p. 445-446. Le
concept d’expression est présenté en DM IX : De plus toute substance est comme un monde
entier et un miroir de Dieu ou bien de tout l’univers qu’elle exprime chacune à sa façon, à peu
près comme une même ville est diversement représentée selon les différentes situations de ce-
lui qui la regarde » ; voir aussi l’opuscule « Qu’est-ce que l’idée ? », GF 1, p. 113. Exprimant
l’univers entier selon sa perspective, chaque monade en est comme la concentration ; sur
l’idée de « concentration », voir « Eclaircissement… », GF 2, p. 139 : « … les unités des
substances n’étant autre chose que des différentes concentrations de l’univers, représenté se-
lon les différents points de vue qui les distinguent », et « Réponse aux réflexions de Bayle »,
GF 2, p. 200 : « Les raisons de mécanique qui sont développées dans les corps, sont réunies et
pour ainsi dire concentrées dans les âmes ou Entéléchies et y trouvent même leur source ».
53
Lettre à Morell de mai 1698 : « Je pense au reste que tout est animé, que tous les
esprits, excepté Dieu, sont incorporés, que l’univers va toujours en mieux, ou, s’il recule, c’est
pour mieux sauter ».
© Philopsis – Pascal Dupond 118
www.philopsis.fr
Remarque : même si « devoir s’étendre à toute l’éternité future » est
commun à l’univers et aux substances, cela n’implique pas que l’univers soit
infini dans le même sens que les substances individuelles ; en effet,
2/ l’univers « est l’amas d’un nombre infini de substances » :
a. il n’y a pas en rigueur de termes de nombre infini, puisqu’il appar-
tient à l’essence d’un nombre d’avoir une limite et d’être un tout ; la formule
« nombre infini » signifie donc : il y a dans l’univers plus de substances
qu’on ne le peut exprimer par n’importe quel nombre ; on ne peut pas asso-
cier à l’infinité des substances une quantité déterminée ; ce qui veut dire aus-
si que l’infinité des substances ne se laisse pas totaliser, elle ne se laisse pas
composer en un tout dont les substances seraient les parties.
b. « Il y a une infinité de créatures dans la moindre parcelle de la ma-
tière, à cause de la division actuelle du continuum à l’infini ».
Leibniz distingue la divisibilité à l’infini de l’étendue géométrique et
la division à l’infini de la matière.
Le thème de la divisibilité à l’infini de l’étendue géométrique n’a rien
d’original ; il apparaît chez Aristote, on le retrouve chez Pascal, puis chez
Leibniz54.
Ce qui est proprement leibnizien, c’est le thème de la division à
l’infini de la matière. Voici quelques références :
Lettre à Sophie, 1696 :
« Mes méditations fondamentales roulent sur deux choses : sur l’unité
et sur l’infini. Les âmes sont des unités, les corps sont des multitudes, mais
infinies, tellement que le moindre grain de poussière contient un monde
d’une infinité de créatures ».
Lettre à Foucher, 1696, GF 2, p. 86-87 :
« …je ne comprends pas comment la matière peut être conçue éten-
due, et cependant sans parties actuelles ni mentales [parties mentales = la di-
visibilité de l’étendue géométrique] ; et si cela est ainsi, je ne sais ce que c’est
que d’être étendu. Je crois même que la matière est essentiellement un agré-
gé, et par conséquent qu’il y a toujours des parties actuelles. Ainsi, c’est par
54
De nombreux textes s’y réfèrent : 1/ TH, Discours, § 70, qui traite du labyrinthe de
la composition du continu [NB. dans le raisonnement de « l’habile homme », le membre de
phrase « mais cette dernière moitié est absurde » paraît être une remarque incidente qui inter-
rompt la continuité du raisonnement, qui va de la phrase : « …donc il faut qu’il y ait une der-
nière moitié… » à la phrase : « …donc la division à l’infini ne saurait être admise »]. 2/ lettre
à Des Bosses, 14 février 1706 : « Le continu est divisible à l’infini. Ce qui, dans la ligne
droite, notamment, résulte de ce qu’une partie de la ligne est semblable au tout. C’est pour-
quoi puisque le tout peut être divisé, la partie aussi pourrait l’être, et, semblablement,
n’importe quelle partie de cette partie. Les points ne sont pas des parties du continu mais des
extrémités, et il n’y a pas plus de partie minimum de la ligne que de fraction minimum de
l’unité » ; 3/ la lettre à de Volder du 30 juin 1704 distingue le « corps mathématique » et les
corps qui sont des choses réelles. Le corps mathématique [ = l’étendue géométrique] est une
quantité continue, et il « ne peut être résolu en éléments constitutifs premiers », ce qui montre
qu’ « il n’est en aucune façon réel, mais est un quelque chose de mental qui ne désigne rien
d’autre que la possibilité des parties, et non quelque chose d’actuel. La ligne mathématique se
comporte comme l’unité arithmétique et, de part et d’autre, les parties ne sont que possibles et
par suite indéfinies ; et la ligne n’est pas plus un agrégat des lignes en lesquelles on peut la
couper que l’unité n’est un agrégat des fractions en lesquelles on peut la partager […] »
© Philopsis – Pascal Dupond 119
www.philopsis.fr
la raison et non pas seulement par le sens que nous jugeons qu’elle est divisée
ou plutôt qu’elle n’est autre chose originairement qu’une multitude. Je crois
qu’il est vrai que la matière (et même chaque partie de la matière) est divisée
en un plus grand nombre de parties qu’il n’est possible d’imaginer. C’est ce
qui me fait dire souvent que chaque corps, quelque petit qu’il soit, est un
monde de créatures infinies en nombre. Ainsi je ne crois pas qu’il y ait des
atomes, c’est-à-dire des parties de la matière parfaitement dures ou d’une
fermeté invincible… » ;
Suite de la lettre à de Volder du 30 juin 1704 :
« Mais dans les choses réelles, à savoir les corps, les parties ne sont
pas indéfinies (comme dans l’espace, chose mentale) mais assignées en acte
d’une façon déterminée, dans la mesure où la nature ménage, selon les varié-
tés des mouvements, des divisions et des subdivisions en acte, et bien que ces
divisions procèdent à l’infini, cependant tout ne s’en ramène pas moins à des
éléments constitutifs premiers déterminés ou unités réelles, mais infinis en
nombre. Pour parler précisément, la matière n’est pas composée d’unités
constitutives mais elle en résulte puisque la matière ou masse étendue n’est
qu’un phénomène fondé dans les choses, comme l’arc en ciel ou le parhélie,
et toute réalité n’appartient qu’à des unités. Les phénomènes peuvent donc
toujours être divisés en phénomènes plus petits qui pourraient apparaître à
d’autres animaux plus petits, mais jamais on ne parviendra à des phénomènes
qui seraient les plus petits. En fait les Unités substantielles ne sont pas les
parties mais les fondements des phénomènes ».
Lettre à la princesse de Galles, 12 mai 1716 :
« Le moindre corpuscule est actuellement subdivisé à l’infini, et con-
tient un monde de nouvelles créatures, dont l’Univers manquerait si ce cor-
puscule était un atome, c’est-à-dire un corps tout d’une pièce sans subdivi-
sion ».
« Double infinité chez Pascal et monade » (Grua, p. 553) :
« Que n’aurait-il [Pascal] dit, s’il avait su que toute la matière est or-
ganique et que la moindre portion contient, par l’infinité actuelle de ses par-
ties, d’une infinité de façons, un miroir vivant exprimant tout l’univers infini,
de sorte qu’on y pourrait lire, si l’on avait la vue assez perçante aussi bien
que l’esprit, non seulement le présent étendu à l’infini, mais encore le passé
et tout l’avenir infiniment infini, puisqu’il est infini par chaque moment et
qu’il y a une infinité de moments dans chaque partie du temps, et plus
d’infinité qu’on ne saurait dire dans toute l’éternité future ».
Plusieurs textes montrent qu’il est nécessaire de distinguer la division
de la matière et la divisibilité de l’étendue géométrique et que leur non dis-
tinction conduit à s’enfermer dans le labyrinthe de la composition du conti-
nu. Voir par exemple
Lettre à de Volder du 19 janvier 1706 :
« Dans les choses actuelles, il n’y a qu’une quantité discrète, une mul-
titude de monades ou substances simples plus grande que n’importe quel
nombre […] Mais la quantité continue est quelque chose d’idéal qui appar-
tient aux possibles et aux actuelles prises comme possibles […] Les actuelles
© Philopsis – Pascal Dupond 120
www.philopsis.fr
sont composées comme les nombres qui sont composés d’unités, les idéales
comme les nombres qui sont composés de fractions : les parties sont en acte
dans le tout réel, non dans le tout idéal. En prenant les idéales pour des subs-
tances réelles, quand nous cherchons dans l’ordre des possibles des parties
actuelles et dans les agrégats des actuelles des parties indéterminées, nous
nous enfonçons nous-mêmes dans le labyrinthe du continu et dans des con-
tradictions inextricables ». [L’argumentation de ce texte se fonde sur la dis-
tinction entre quantité continue et quantité discrète : l’étendue géométrique
est divisible en parties mais elle n’est pas constituée de parties, car elle n’a
des parties qu’en puissance, comme la ligne ou l’unité, qui sont des « touts
intellectuels » ; en revanche la matière est divisée en parties et composée de
parties. NB. La lettre à de Volder du 30 juin 1704, citée ci-dessus, exprime
des réserves sur l’idée de composition : la matière n’est pas composée
d’unités constitutives, mais elle en résulte55]
Lettre à Dangicourt (1716):
« C’est comme l’unité dans l’arithmétique, qui est aussi un tout intel-
lectuel ou idéal divisible en parties, comme par exemple en fractions, non pas
actuellement en soi (autrement elle serait réduisible à des parties minimes qui
ne se trouvent point en nombres) mais selon qu’on aura des fractions assi-
gnées. Je dis donc que la matière, qui est quelque chose d’actuel, ne résulte
que des monades, c’est-à-dire de substances simples indivisibles, mais que
l’étendue ou la grandeur géométrique n’est point composée des parties pos-
sibles qu’on y peut seulement assigner, ni résoluble en points, et que les
points aussi ne sont que des extrémités et nullement des parties ou compo-
sants de la ligne ».
Lettre à Rémond de juillet 1714, GF, 3, p. 264 :
« Dans l’idéal ou continu, le tout est antérieur aux parties, comme
l’unité arithmétique est antérieure aux fractions qui la partagent, et qu’on y
peut assigner arbitrairement, les parties ne sont que potentielles ; mais dans le
réel, le simple est antérieur aux assemblages, les parties sont actuelles, sont
avant le tout. Ces considérations lèvent les difficultés sur le continu, qui sup-
posent que le continu est quelque chose de réel, et a des parties avant toute
division, et que la matière est une substance. Il ne faut donc point concevoir
l’étendue comme un espace réel continu, parsemé de points »
Pour résumer : que la matière soit composée d’une infinité d’êtres ré-
els ou qu’elle en résulte, cela n’implique pas que le continuum géométrique
soit composé de points. Le penser, ce serait confondre la matière [ = « les
corps qui sont des choses réelles »], laquelle « n’est qu’un phénomène réglé
et exact et qui ne trompe point » avec « l’étendue continuelle » [= le corps
mathématique], qui « n’est qu’une chose idéale ». Il y a quelque chose de
plus dans la matière que l’étendue continuelle, précisément ce que Leibniz
appelle to dunamikon.
55
Même idée dans le Pacidius Philalethi (1676), Fragments Couturat, 594-627 : « La
division du continu ne doit pas être considérée comme celle du sable en grains, mais comme
celle d’une feuille de papier ou d’une tunique en plis, de telle façon qu’il puisse y avoir une
infinité de plis, les uns plus petits que les autres sans que le corps se dissolve jamais en points
ou minima » ; substituer les plis au grain, c’est une façon de dire que les monades ne sont pas
exactement les composants de la matière.
© Philopsis – Pascal Dupond 121
www.philopsis.fr
La difficulté de ce paragraphe n’est pas résolue : la question est tou-
jours de savoir quel rôle il faut attribuer 1/ au thème de l’extension infinie
vers l’éternité future, 2/ au thème de la division actuelle infinie de la matière
dans l’établissement de la proposition selon laquelle ce qui peut se dire
d’une créature ne peut pas se dire de l’univers (une créature peut toujours
être surpassée par une autre ; mais la perfection des mondes possibles, qui
présente des degrés infiniment variés dans le sens décroissant, va dans
l’autre sens vers un optimum qui est précisément notre monde ; c’est l’image
de la pointe de la pyramide dans le mythe final de la TH). Le nœud de
l’argument est certainement l’idée de totalité : une substance est un tout
(puisque son infinie variété est unie dans son essence ou sa lex seriae),
l’univers n’en est pas un. Reste à savoir pourquoi une substance (en tant
qu’elle est un tout) s’inscrit dans une échelle de perfection indéfiniment
croissante ou décroissante, alors que l’univers (en tant qu’il n’est pas un
tout) s’inscrit dans une échelle indéfiniment décroissante mais qui s’arrête
dans le sens croissant à un optimum. Est-ce le fait que l’univers ne soit pas
un tout qui le fait entrer dans le cas des formes optimales ?
Second point important de ce § 195 : Leibniz refuse que le monde soit
pensé comme un grand animal. Voir aussi lettre à Des Bosses, 11 mars
1706 :
« On ne pourrait, avec quelques anciens, concevoir Dieu comme l’âme
du monde, non seulement parce qu’il est cause du monde, mais aussi parce
que le monde ainsi conçu ne ferait pas un seul corps ni ne pourrait être consi-
déré comme un animal, ni à plus forte raison n’aurait une unité, si ce n’est
verbale. Ce n’est donc qu’une facilité de langage quand nous disons qu’il y a
une unité là où il y a plus que ce qu’on peut embrasser en un tout assignable
et quand nous parlons comme d’une grandeur de ce qui n’en a pas les pro-
priétés »).
Penser le monde comme un grand animal, ce serait, pour Leibniz, 1/
abandonner la science moderne, le rationalisme mécaniste ; 2/ faire de
l’univers un tout, ce qu’il n’est pas ; ce serait aussi 3/ faire de Dieu l’âme de
cet animal, ce que Leibniz refuse : Dieu est cause supramondaine du monde.
« Ceux qui font du monde un dieu ou qui conçoivent Dieu comme l’âme du
monde », ce sont les stoïciens (comme le précise le § 217), mais aussi Spi-
noza et les partisans d’un « Esprit universel » (GF 2, p. 221, note 7 p. 231) ;
la réfutation peut se résumer ainsi : si le monde est fini, alors Dieu qui est in-
fini ne peut pas être l’âme du monde ; si le monde est infini, alors il ne peut
pas être compris comme corps et il n’y a pas alors à lui attribuer une âme.
Difficulté : Leibniz pense le monde comme un amas (le terme se
trouve dans le § 195), un agrégat (à Toland : « c’est un aggregatum, comme
un étang plein de poisson »), et pourtant il accepte l’analogie entre le monde
et le corps vivant : il « en est de l’univers comme de notre corps dont Hippo-
crate dit que tout y conspire » ( ?). Cette analogie souligne que, si l’univers
est un agrégat, il est aussi organisé, et que, comme l’organisme, il peut corri-
ger ses propres désordres (3e écrit contre Clarke). Et comme, dans
l’organisme, une maladie peut être moyen de défense contre un mal plus
grand.
© Philopsis – Pascal Dupond 122
www.philopsis.fr
§ 200. Leibniz explique pourquoi le monde peut être le meilleur pos-
sible sans être un autre Dieu et sans exclure une échelle des degrés de per-
fection.
1/ « Si chaque substance prise à part était parfaite, elles seraient toutes
semblables » : Leibniz applique ici le principe des indiscernables, qui est un
corollaire du principe de raison suffisante56 : s’il y a deux choses, il faut une
raison de cette dualité et cette raison ne peut être qu’une différence de na-
ture ; le principe des indiscernables exige que les choses ne soient jamais dif-
férentes solo numéro]57.
56
Les trois principes (de raison, de continuité, des indiscernables) sont étroitement
liés ; dans la Préface des NE, le principe des indiscernables est dérivé de la loi de continuité :
« j’ai remarqué aussi qu’en vertu des variations insensibles, deux choses individuelles ne sau-
raient être parfaitement semblables » ; dans la correspondance avec Clarke, le principe des in-
discernables est dérivé du principe de raison suffisante : « J’en infère entre autres consé-
quences qu’il n’y a point dans la nature deux êtres réels absolus indiscernables : parce que,
s’il y en avait, Dieu et la Nature agiraient sans raison en traitant l’un autrement que l’autre et
qu’ainsi Dieu ne produit point deux portions de matière parfaitement égales et semblables ».
57
Cette question est discutée dans les NE, II, XXVII. La question initiale est la sui-
vante. Supposons deux feuilles ou deux gouttes d’eau. Qu’est-ce qui nous permet de dire
qu’elles sont « deux » ou que chacune a son identité numérique qui la distingue de l’autre ?
Philalèthe (Locke) répond : notre seule raison d’affirmer que chacune est même que soi et dif-
férente de l’autre, c’est la situation spatio-temporelle ; deux choses ne peuvent pas exister en
même temps dans un même lieu; il suffit que deux choses existent dans des lieux ou des
temps différents pour qu’elles soient (même si nous les supposons parfaitement identiques par
leurs caractères intrinsèques) deux choses différentes.
Théophile (Leibniz) accepte la proposition de Philalèthe au sens où il reconnaît que
c’est bien par la situation temporelle que nous distinguons communément les choses. Mais il
précise aussitôt qu’il existe dans les choses « un principe interne de distinction », qui n’est pas
en lui-même spatio-temporel mais qui, pour notre sensibilité, se manifeste sous la forme
d’une distinction spatio-temporelle. Ce principe est appelé principe des indiscernables ou de
l’identité des indiscernables: deux êtres réels diffèrent toujours par des caractères intrinsèques
ou par leur constitution interne et non pas seulement par leur position dans l’espace et le
temps57.
D’où vient le principe des indiscernables ?
1/ Le principe des indiscernables est dépendant de la conception leibnizienne de la
substance selon laquelle la substance est intelligible et entièrement déterminée jusque dans
son heccéité. Chez Arisyote et dans une part de sa postérité médiévale, la forme est spécifique
(elle représente la nature commune des individus d’une même espèce) et la matière individua-
lisante (elle distingue les individus à l’intérieur d’une même espèce). Cette matière est à la
fois un principe d’individualisation et un principe d’indétermination -au sens ontologique et
au sens gnoséologique: la forme, principe de détermination est aussi principe de connaissance
et ce qui excède la forme, excède la connaissance; donc ce qui constitue proprement
l’individualité d’un être excède la connaissance. Une telle limitation répugne au principe
d’intelligibilité intégrale de l’être, commun à Spinoza et à Leibniz. Il s’agit donc de rendre
l’individualité intelligible, d’étendre l’intelligibilité jusqu’au plus individuel. Tout être réel a
sa propre essence, et cette essence est à la fois individuelle, individualisante, et intelligible.
2/ Les essences individuelles se distribuent dans l’être selon un principe de continuité.
Chez Aristote, les espèces sont foncièrement discontinues. Aucune transition ne conduit de
l’une à l’autre. Or aux yeux de Leibniz, cette discontinuité répugne au principe
d’intelligibilité intégrale (la nature ne fait pas de saut), qui exige que les essences s’inscrivent
dans une série continue. Leibniz présente et justifie cette continuité des essences par une ana-
logie mathématique; cf lettre à Arnauld du 12 avril 1686: « par la notion individuelle d’Adam,
j’entends certes une parfaite représentation d’un tel Adam, qui a telles conditions indivi-
duelles et qui est distingué par là d’une infinité d’autres personnes possibles fort semblables,
mais pourtant différentes de lui (comme toute ellipse diffère du cercle, quelque approchante
qu’elle soit) ». Leibniz pense ici à la question des sections coniques. Soit un cône traversé par
un plan; si ce plan est perpendiculaire à l’axe du cône, la section conique est circulaire, s’il est
incliné par rapport à l’axe, la section conique est une ellipse ; supposons que l’angle
© Philopsis – Pascal Dupond 123
www.philopsis.fr
2/ « Si c’étaient des dieux, il n’aurait pas été possible de les pro-
duire » : un être qui porte le nom de Dieu est un être absolument infini, qui
existe en vertu de son essence ou qui est causa sui. Qu’un tel être soit pro-
duit, c’est-à-dire soit ab altero et non a se, c’est une contradiction dans les
termes.
3/ « … il sera toujours un système de corps […] et d’âmes » : toute
substance de l’univers est « incorporée » : l’assignation à un corps, c’est-à-
dire à un point de vue est ce qui permet à chaque substance d’avoir sa locali-
té spatio-temporelle dans l’univers et d’être liée au tout : sans corps, la subs-
tance serait comme un déserteur de l’ordre universel ; et toute substance est
une âme ou analogue à une âme, en tant qu’elle est perception, appétition,
représentation ou expression du tout.
4/ « … il est aisé de concevoir qu’une structure de l’univers peut être
la meilleure de toutes sans qu’elle devienne un dieu » : on doit distinguer la
perfection de Dieu qui est absolue et la perfection de l’univers qui est opti-
male.
5/ en raison de la division actuelle de la matière à l’infini, il y a néces-
sairement des rapports de subordination ente les créatures.
§ 201. On retrouve ici la distinction entre nécessité métaphysique et
nécessité morale : ce qui existe est nécessaire, non pas métaphysiquement
mais moralement. La nécessité serait métaphysique si le possible et le réel
étaient exactement coextensifs ; elle est morale dès lors que, tous les pos-
sibles n’étant pas compatibles entre eux, Dieu doit choisir et produire, parmi
les ensembles de compossibles, celui où se réalise la plus grande perfection.
Plusieurs textes traitent du thème de la compossibilité.
1/ « Mon principe », RG, p. 29 :
d’inclinaison varie d’une quantité infiniment petite, nous obtenons une série continue
d’ellipses différentes, chacune ayant sa propre essence (sa loi mathématique de construction)
qui la distingue des autres. C’est ainsi qu’il faut concevoir, pour Leibniz la différence entre
les essences ; il existe, dans l’entendement de Dieu une infinité d’Adam possibles tous diffé-
rents, mais d’une différence infiniment petite, et constituant une série continue, exactement
comme les sections coniques forment une série continue par leur différence infiniment petite.
Pour justifier sa position, Théophile fait remarquer deux choses à Philalèthe :
1/ La distinction des temps et des lieux ne suffit jamais à distinguer les choses : consi-
déré en lui-même, un lieu de l’espace est semblable à tout autre, un temps est semblable à tout
autre ; si l’espace et le temps n’ont pas de pouvoir différenciant sur eux-mêmes, il est impos-
sible qu’ils aient un pouvoir différenciant sur les choses (il faut donc finalement, pense Leib-
niz, inverser la position de Locke : ce n’est pas l’espace et le temps qui permet de distinguer
les choses dans l’espace et le temps, ce sont les choses dans l’espace et le temps qui permet-
tent de distinguer les espaces et les temps – ou, pour le dire autrement : l’espace et le temps ne
sont rien en dehors des choses spatio-temporelles; ils expriment les relations entre les choses
[« ce ne sont pas des substances ou des réalités complètes »] ; ils n’ont donc aucun pouvoir
différenciant propre et originaire; les différences qu’ils expriment viennent des choses elles-
mêmes.
2/ « La manière de distinguer que vous semblez proposer ici…… » : pour que la spa-
tialité soit discriminante, il faut supposer que les corps sont impénétrables et que par consé-
quent l’existence d’un corps dans un lieu exclut l’existence de tout autre corps en ce même
lieu. Cette supposition est raisonnable, commente Leibniz, mais l’expérience montre que
l’impénétrabilité n’est pas toujours la condition d’une distinction [« on n’y est point attaché
ici quand il s’agit de distinction »] : nous distinguons deux ombres ou deux rayons lumineux
qui se pénètrent au sens où il y a une portion de l’espace qui leur est commune. L. ne veut pas
dire que le principe d’impénétrabilité est sans valeur, mais simplement qu’il ne s’applique pas
à une certaine catégorie d’être spatiaux, que pourtant nous distinguons facilement et que par
conséquent le vrai principe de distinction des choses n’est pas la situation spatio-temporelle.
© Philopsis – Pascal Dupond 124
www.philopsis.fr
« …mon principe est que toute chose qui peut exister et qui est com-
patible avec les autres existe, parce que la raison pour laquelle existent tous
les possibles ne doit être limitée par aucune raison, si ce n’est qu’ils ne sont
pas tous compatibles. C’est pourquoi il n’y a pas d’autre raison déterminante
que celle selon laquelle existent plutôt les possibles qui enveloppent davan-
tage de réalité » ;
2/ « 24 thèses métaphysiques » (RG p. 467) :
« (6) … on peut dire que tout possible est un existant futur, dans la
mesure naturellement où il est fondé dans l’Etre nécessaire existant en acte,
sans lequel il n’y aurait aucun moyen pour qu’un possible soit actualisé.
« (7) Mais il ne s’ensuit pas que tous les possibles existent ; cela ne
s’ensuivrait que si tous les possibles étaient compossibles.
« (8) Mais parce qu’ils sont incompatibles avec d’autres possibles,
certains possibles ne parviennent pas à l’existence ; et ils ne sont pas incom-
patibles les uns avec les autres seulement dans leur moment commun, mais
aussi de façon universelle, parce que les états futurs sont enveloppés dans les
états présents… ».
3/ Lettre à Bourguet de 1714, GF 3, p. 269 et sv. (et les textes cités
note 3 p. 269).
4/ NE, III, VI, 12 (p. 265) :
« J’ai des raisons pour croire que toutes les espèces possibles ne sont
point compossibles dans l’univers, tout grand qu’il est, et cela non seulement
par rapport aux choses qui sont ensemble en même temps, mais même par
rapport à toute la suite des choses ».
En vertu de leur nature représentative, relationnelle, les choses sont
unies dans un réseau d’entre-expression (qui est le monde) ; et toute chose
qui ne peut pas entrer dans le réseau d’entre-expression qui constitue un
monde est incompossible avec lui.
L’idée selon laquelle l’essence tend d’elle-même à l’existence est pré-
sentée dans De l’origine radicale des choses (Opuscules Schrecker, p. 85).
La raison de cette exigence d’existence est mise en évidence par les thèses
métaphysiques 4, 5 et 6 : l’Etre nécessaire est « existentifiant », il existe
parce qu’il est lui-même une exigence infinie d’existence, et tout ce qui est
compris dans l’orbe de cette exigence infinie d’existence (comme les pos-
sibles que pense son entendement) est comme entraîné (à la mesure de son
degré de perfection) dans cette exigence d’existence58.
§ 202. Réponse à une objection de Diroys : rien ne peut changer que
du moins bien au mieux ou du mieux au moins bien ; si Dieu fait le meilleur,
« ce produit ne peut être changé », c’est donc une substance éternelle, Dieu.
58
Grua 286 : « s’il y avait quelque puissance dans les choses possibles pour se mettre
en existence et pour se faire jour à travers des autres, alors […] dans ce combat, la nécessité
même ferait le meilleur choix possible […] Mais les choses possibles n’ayant point
d’existence n’ont point de puissance pour se faire exister, et par conséquent il faut chercher le
choix et la cause de leur existence dans un être dont l’existence est déjà nécessaire d’elle-
même ».
© Philopsis – Pascal Dupond 125
www.philopsis.fr
La réponse proposée est que le monde peut fort bien changer sans ces-
ser d’être le meilleur : il suffit d’admettre que, « par rapport au bien et au
mal », il ne change pas de « degré », mais seulement « d’espèce ».
Cette distinction est illustrée par deux exemples.
D’une part la diversité des plaisirs : un plaisir auditif peut être du
même degré qu’un plaisir visuel, l’un ne différant de l’autre que par
l’espèce. S’il y a une prime de plaisir accompagnant le passage à quelque
chose de nouveau, elle revient indifféremment à l’auditif et au visuel
Le deuxième exemple est emprunté à la géométrie. En supposant pos-
sible la quadrature du cercle, on peut l’envisager comme changement du
cercle en carré ou du carré en cercle, et il paraît impossible de dire si l’on y
gagne quelque chose, à moins que la chose ne présente une quelconque utili-
té. Cet exemple vise à faire voir un changement dans lequel il n’y a ni amé-
lioration ni péjoration décelable.
Leibniz en tire donc la conclusion qui infirme l’allégation de Diroys :
« le meilleur peut être changé en un autre qui ne lui cède point, et qui ne le
surpasse point ».
Il ajoute toutefois une précision que son propre système impose : « il y
aura toujours entre eux un ordre, et le meilleur ordre qui soit possible ».
L’ordre dont il est question ici doit être envisagé comme la succession tem-
porelle des états du monde, car le monde créé ne saurait être envisagé seu-
lement du point de vue synchronique de « l’ordre des simultanés » −
l’espace −, mais aussi du point de vue diachronique de « l’ordre des succes-
sifs » − le temps − : le monde, c’est toujours le cours du monde. Le cours du
monde, envisagé sous une perspective limitée, peut apparaître comme une
détérioration (par exemple l’écroulement d’une civilisation autrefois bril-
lante), mais, comme ensemble, le cours des choses est le meilleur qui soit
possible.
Cela ne veut pas dire que le monde ne peut aller qu’en s’améliorant :
ce n’est là qu’une interprétation possible, que Leibniz évoque à la fin du pa-
ragraphe, comme une hypothèse difficilement décidable.
Comment envisager l’hypothèse « qu’il ne fût point permis d’atteindre
le meilleur d’un seul coup » ? Il semble qu’il y ait là une nécessité, puisque
l’infinité temporelle − la perpétuité − fait partie de la perfection du meilleur
des mondes. Et d’un autre côté, ce monde doit pouvoir être considéré comme
étant toujours déjà le meilleur. Il est donc le meilleur de telle sorte que, du
point de vue de son existence, il n’en finisse jamais de le devenir.
§ 206. Contre Malebranche, Leibniz n’admet aucune dérogation aux
lois qui ordonnent la création. Il admet seulement que certains événements
exceptionnels relèvent de lois supérieures à celles qui n’ont pas d’autre fin
que d’assurer la conservation de l’univers : Dieu n’a pas de volontés « parti-
culières primitives » (§ 206) ; il n’a que des volontés premières générales,
dans lesquelles s’inscrivent les événements particuliers. C'est pourquoi « les
miracles n’ont rien (...) qui les distingue des autres événements », si ce n’est
« qu’on ne saurait les expliquer par la nature des choses créées » (§ 207).
§ 207. D’où critique de Newton : « … si Dieu faisait une loi générale,
qui portât que les corps s’attirassent les uns les autres, il n’en saurait obtenir
l’exécution que par des miracles perpétuels ». Ce que Leibniz refuse de la loi
de gravitation newtonienne, c’est l’idée d’une action à distance sans contact,
qui transgresse les principes du mécanisme (dont on ne peut pas se passer
© Philopsis – Pascal Dupond 126
www.philopsis.fr
dans la connaissance physique, même s’il n’est pas suffisant), c’est-à-dire le
principe selon lequel tout ce qui a lieu dans les corps a lieu « selon les quali-
té intelligibles des corps que sont les grandeurs, les figures et les mouve-
ments… » (ce qui implique la conséquence suivante : Corpus non moveri ni-
si impulsum a corpore contiguo et moto. Voir aussi « sur le principe de rai-
son » (RG 472) :
« [Le principe de raison] renverse toutes les qualités occultes inexpli-
cables et toutes les imaginations de cet ordre. Car à chaque fois que les au-
teurs introduisent une qualité primitive, ils heurtent ce principe. Si par
exemple quelqu’un affirme qu’il existe dans la matière une force attractive
primitive, de telle sorte que cette force ne puisse être dérivée des notions in-
telligibles des corps (à savoir de la grandeur, de la figure et du mouvement)
et s’il veut, grâce à elle, obtenir que les corps tendent vers un corps sans au-
cune impulsion (comme font ceux qui conçoivent la gravité dans la mesure
où les corps pesants seraient attirés vers le centre de la terre ou tendraient
vers elle en vertu d’une sorte de sympathie) si bien qu’il ne peut pas rendre
raison de l’état ultérieur de la chose à partir de la nature des corps et que le
mode d’attraction reste inexplicable, alors celui-là reconnaît que cette vérité
(que la pierre tend vers la terre) n’est soutenue par aucune raison. Car s’il
juge que la chose n’a pas lieu par une qualité occulte des corps mais par la
volonté de Dieu, c’est-à-dire dans la mesure où elle est soumise à une loi di-
vine, alors il donne du même coup une raison, mais une raison miraculeuse
[…] Il en résulte que tout dans les corps a lieu mécaniquement, c’est-à-dire
selon les qualité intelligibles des corps que sont les grandeurs, les figues et
les mouvements… »
§ 208. « … parmi les règles générales qui ne sont pas absolument né-
cessaires, Dieu choisit celles qui sont les plus naturelles… » : la nature obéit
à la fois à des principes mathématiques qui sont absolument nécessaires (et
relèvent du principe d’identité) et à des principes physiques qui ne sont pas
absolument nécessaires et relèvent du principe de raison suffisante. On ne
peut donc pas connaître les lois de la nature sans faire usage de ce dernier.
Archimède y recourt dans son traité « De l’équilibre » car « il prend pour ac-
cordé que, s’il y a une balance où tout soit de même de part et d’autre, et si
l’on suspend aussi des poids égaux de part et d’autre aux deux extrémités de
cette balance, le tout demeurera en repos. C’est parce qu’il n’y a aucune rai-
son pourquoi un côté descende plutôt que l’autre » ; et le principe
d’économie selon lequel « la nature suit toujours les voies les plus simples »
(non pas les plus courtes mais les plus déterminées, au sens du § 196) en est
une variation ; l’optique en montre la fécondité [réponse à Régis : « … pour-
vu qu’on se figure que la nature a eu pour but de conduire les rayons d’un
point donné à un autre point donné par le chemin le plus facile, on trouve
admirablement bien toutes ces lois, en employant seulement quelques lignes
d’analyse… »]59 ; mais également la dynamique : le principe cartésien de
conservation est en défaut par rapport à l’expérience mais aussi par rapport à
la raison (il manque au principe de l’égalité de la cause pleine et de l’effet
entier).
59
On peut le rapprocher d’un principe d’économie des principes qui a tendu à
s’imposer dans la science moderne sous le nom de rasoir d’Ockham : ne pas multiplier les
êtres sans nécessité, c'est-à-dire les réalités invoquées pour rendre compte des phénomènes
observés.
© Philopsis – Pascal Dupond 127
www.philopsis.fr
Dieu choisit des règles « qui se limitent le moins les unes les autres » ;
il choisit des règles qui sont sans exception : les lois du mécanisme ne sont
jamais violées ; la conservation de la quantité de force et de la direction ne
l’est jamais non plus (Descartes manque à ce principe, puisqu’il admet que
l’âme humaine, à défaut d’être une cause de mouvement, peut du moins
changer la direction du mouvement), les corps organiques ne sont jamais
sans âme comme les âmes ne sont jamais sans corps, etc.) de telle sorte qu’il
y a une uniformité de toute la nature (GF 3, p. 103 : « mon système gardant
une parfaite uniformité dans toute la nature ») et que, comme le dit Arlequin
empereur de la lune, « c’est tout comme ici ».
« On peut même réduire ces deux conditions, la simplicité et la fécon-
dité, à une seule… ». La perfection du monde doit être appréciée non seule-
ment du point de vue de la quantité de bien produit, mais du point de vue de
la qualité de l’agencement des moyens mis en œuvre pour le produire : si
une plus grande complication dans les causes était la rançon d’un surcroît de
bien dans les effets, il y aurait là une imperfection qui diminuerait en fait la
somme totale du bien : « le plus sage fait en sorte, le plus qu’il se peut, que
les moyens soient fins aussi en quelque façon, c'est-à-dire désirables, non
seulement par ce qu’ils font, mais encore par ce qu’ils sont ».
C'est pourquoi le § 209 réédite la thèse générale de la Théodicée, en la
rapprochant du stoïcisme à travers une longue citation de Bayle commentant
Chrysippe : « le bien métaphysique, qui comprend tout, est cause qu’il faut
donner place quelquefois au mal physique et au mal moral ».
§ 211. Le péché est une irrégularité, dans la mesure même où il en-
freint une règle morale, un commandement divin à l’endroit de la volonté
humaine. Mais d’un autre côté, le péché doit être considéré comme régulier
en tant qu’il découle des règles qui président à la création du monde : il fait
partie de l’ordre général de l’univers.
Plus précisément, le péché est dans l’ordre des choses dans la me-
sure où il est lié à ce qui assure la fécondité maximale à l’intérieur de
l’univers (la production de la plus grande richesse d’effets par le minimum
de moyens) : instituer des lois qui empêcheraient le péché donnerait « un
plan plus composé et moins fécond ». Tel ne serait pas le bon moyen de
« prévenir les irrégularités », puisque cette fécondité moindre ne répondrait
pas aux exigences de la sagesse divine.
Leibniz se heurte pourtant à l’objection qu’un univers aussi bien ré-
glé qu’il peut l’être serait par définition totalement régulier, « fort uni », et
ne saurait donc logiquement comporter d’irrégularité.
Il y répond d’une manière qui pourrait paraître sophistique, qui
trouve à se justifier par une métaphore musicale : « ce serait une irrégularité
d’être trop uni », car l’harmonie requiert la diversité des sons, et se contenter
d’un unisson serait à cet égard un manque fautif d’harmonie.
D’où la transposition métaphysique de la métaphore au plan créateur
de Dieu : « je ne crois pas que celui qui est le meilleur et le plus régulier soit
toujours commode en même temps à toutes les créatures ». La commodité se
rapporte sans doute proprement au mal physique, mais c’est du mal en géné-
ral, y compris du péché, qu’il faut dire qu’il s’inscrit dans l’ordre des choses
comme une dissonance dans une harmonie d’ensemble.
§ 212-213. Leibniz explique pourquoi cette compréhension du mal
est en général manquée : « on se trouve porté à croire que ce qui est le meil-
© Philopsis – Pascal Dupond 128
www.philopsis.fr
leur dans le tout est le meilleur aussi qui soit possible dans chaque partie ».
Leibniz voit là une application fautive d’un mode de raisonnement « de
maximis et minimis », qui consiste à déduire que la propriété d’un certain
tout doit appartenir à chacune de ces parties.
Ce mode est valide dans l’ordre quantitatif que les mathématiques
prennent pour objet : le « chemin » d’un point à un autre ne pourra être « le
plus court » − c’est la définition euclidienne de la droite, mais le raisonne-
ment s’appliquerait à n’importe quel parcours d’un point à un autre − que si
chacune de ses parties est elle-même le plus court chemin entre les extrémi-
tés et le point limite considéré.
Leibniz n’a rien à redire à ce raisonnement dans son ordre propre,
mais objecte que « la conséquence de la quantité à la qualité ne va pas tou-
jours bien ». On juge mal de l’univers parce qu’on adopte le point de vue de
la quantité (l’univers est le plus parfait qu’il puisse être, donc chacune de ses
parties doit l’être aussi), au lieu d’adopter le point de vue de la qualité (la
partie du meilleur tout n’est pas nécessairement la meilleure)60.
§ 217. Leibniz prend distance vis-à-vis de la sagesse stoïcienne à pro-
pos d’une pensée de Marc-Aurèle selon laquelle je dois aimer tout ce qui
m’arrive, même le négatif, même la souffrance, dans la pensée que cela con-
tribue à la prospérité, à la perfection, à la permanence de e Dieu. La distance
est double. D’abord Dieu, étant ens supramundanum n’est pas « sustenté »
par les événements du monde. . Ensuite et surtout, Dieu étant un entende-
ment et une volonté, je peux dans une certaine mesure entrer dans
l’intelligence de sa création et reconnaître dans le bien de l’univers mon
propre bien : « Ce qu’il y a de bon dans l’univers est, entre autres, que le
bien général devient effectivement le bien particulier de ceux qui aiment
l’auteur de tout bien ». Le bien particulier est subordonné au bien du tout et
le bien particulier peut paraître lésé par ce qui est dû à la perfection du tout ;
mais l’être raisonnable reconnaît son propre bien dans le bien dans du tout
(voir aussi § 243 : un désordre apparent cesse d’être un désordre pour celui
qui se met dans la voie de l’ordre).
§ 218 et sv. Leibniz en vient à ce qu’il reconnaît être « la principale
objection », laquelle vient d’Arnauld, sans doute son plus grand interlocu-
teur : « Dieu serait nécessité (...) s’il était obligé de créer le meilleur ». Elle a
été reprise par Bayle : « Il n’y a donc aucune liberté en Dieu, il est nécessité
par sa sagesse à créer, et puis à créer précisément un tel ouvrage, et enfin à
créer précisément par telles voies » (§ 227). Leibniz réplique : la nécessité
morale qui oblige Dieu à créer le meilleur des mondes n’entraîne pas la né-
cessité métaphysique de l’acte créateur, car celui-ci et son effet ne sont en
soi que des possibles, dont le contraire n’implique pas contradiction − « mé-
taphysiquement parlant, il pouvait choisir ou faire ce qui ne fût point le meil-
leur ; mais il ne le pouvait point moralement parlant » (§ 234, p.257).
§ 225. Ce § peut être rapproché du § 184.
Le § 184 a montré que l’entendement de Dieu n’est en un sens rien
d’autre que l’infinité des possibles qu’il pense, mais également qu’on ne
60
Dans le Tentamen anagogicum, GF 2 p. 96, Leibniz écrit : « c’est ainsi que les
moindres parties de l’univers sont réglées suivant l’ordre de la plus grande perfection ; autre-
ment le tout ne le serait pas ». Mais ce passage traite du mouvement, dont de quelque chose
qui relève de la quantité et non pas de la qualité
© Philopsis – Pascal Dupond 129
www.philopsis.fr
peut pourtant pas considérer ces possibles intrinsèquement (en faisant abs-
traction de l’entendement qui les pense), puisque seul l’entendement de Dieu
leur confère leur réalité de possible (la réalité objective des possibles sup-
pose la réalité formelle de l’entendement qui les pense). L’entendement de
Dieu est le fondement de leur réalité.
Ici Leibniz montre que, si la sagesse de Dieu et l’infinité des possibles
sont égales extensivement (il n’est aucun possible qui ne soit pensé par
Dieu), la sagesse surpasse les possibles intensivement au sens où elle les
compare, les pèse, les combine, et non pas seulement terme à terme (comme
s’il s’agissait de comparer le carré ou le rectangle ou un César franchissant le
Rubicon et un autre ne le franchissant pas), mais, si on peut dire, monde à
monde ; tous les possibles ne sont pas compossibles ; il ne suffit donc pas
d’évaluer leur perfection intrinsèque, il s’agit d’évaluer la perfection des
mondes dans lesquels ils sont susceptibles d’entrer à titre de compossibles ;
Dieu compare des mondes et non pas seulement des individus, il fait une in-
finité de combinaisons infinies (il y a une infinité d’univers possibles et cha-
cun englobe une infinité d’êtres compossibles).
§ 230. « Il n’est point vrai que Dieu aime sa gloire nécessairement, si
l’on entend par là qu’il est porté nécessairement à se procurer sa gloire par
ses créatures »
Comme le dit le § 233, ce qui est essentiel et nécessaire en Dieu, c’est
l’amour de soi, l’amour de ses propres perfections ainsi que la satisfaction de
les posséder. Mais la manifestation extérieure de sa gloire est contingente et
libre.
Le vice n’est pas moyen mais condition sine qua non ; voir aussi §
336 : « le mal que Dieu a permis n’était pas un objet de sa volonté comme
fin ou comme moyen, mais seulement comme condition ».
© Philopsis – Pascal Dupond 130
www.philopsis.fr
Troisième partie
La troisième partie porte plutôt sur les maux physiques ; mais comme
ceux-ci suivent le mal de coulpe (§ 265 : « nous sommes en droit de nous
borner au mal de coulpe, pour rendre raison du mal de peine »), on revient
vite à la question première du mal moral
§ 241-242. Leibniz soutient qu’il n’y a rien dans l’univers qui ne soit
« dans l’ordre », même ce qui nous paraît faire exception à l’ordre, comme
les souffrances de l’homme juste ou les monstres. Et c’est ce que les mathé-
matiques nous aident à comprendre, en nous montrant qu’il n’y a pas de dif-
férence de nature entre le simple et le complexe. Voir DM VI et « Sur les se-
crets admirables de la nature », GF 1, p. 293. Pour Leibniz, il n’y a pas de
désordre, le désordre est impensable, ce que nous appelons ainsi n’est que
l’absence de l’ordre que nous attendons et en particulier l’absence d’un ordre
simple qui serait à la portée de notre entendement ; ce que nous appelons dé-
sordre n’est en vérité qu’un ordre complexe ; supposons des points répartis
au hasard, sans intention, la ligne qui les relie peut être exprimée par une
fonction algébrique ; il y a donc une différence de degré, non de nature entre
le simple et le complexe.
§ 249. Sur le miracle, voir DM, VII, XVI et XVII. Leibniz distingue
(dans une modalité interrogative : « peut-être ») deux catégories de mi-
racles : les miracles relevant du « premier rang » sont censés excèder les lois
causales dont nous avons la connaissance sans excéder l’ordre de la nature ;
ils ne sont des miracles pour nous qu’à raison des limites de notre connais-
sance. Les miracles du « second rang » excèdent les forces des créatures
parce qu’ils ont lieu à la jointure du créateur et de la créature, comme la
création et l’incarnation (peut-être Leibniz pense t-il aussi à la transsubstan-
tiation). Dans quelle catégorie faut il ranger la transformation de l’eau en vin
à Cana ? On pourrait la ranger dans la première catégorie de miracles en
supposant l’action de certaines substances invisibles naturelles, excédant
notre sensibilité. Mais Leibniz donne à entendre que ce n’est pas possible :
de deux choses l’une : ou bien le miracle, en raison de la connexion des
choses, impacte tout l’univers et modifie le cours du monde (le monde
d’après ne serait donc pas identique au monde d’avant) ou bien Dieu doit
avoir « soustrait » miraculeusement les corps impliqué dans la transforma-
tion de l’eau en vin de la connexion universelle des choses avant de les y ré-
introduire (mais on passe alors dans le miracle du second rang). Le « mi-
racle » est un défi pour la pensée, et on ne peut sans doute pas s’en tenir à
dire qu’il excède les maximes subalternes de la nature. Il est à l’articulation
de l’ordre de la nature et de l’ordre de la grâce
§ 250. Chagrin et douleur, joie et plaisir : plaisir et douleur sont des
affects rapportés au corps, joie et chagrin sont des affects rapportés à
l’existence.
© Philopsis – Pascal Dupond 131
www.philopsis.fr
§ 251. « La raison naturelle nous apprend que nous avons plus de
biens que de maux en cette vie » : correspondance avec Elisabeth, juillet
164661
[…]
§ 275. Le diable se tourne librement au mal : cette proposition
n’implique pas qu’il choisisse le mal pour le mal, au moins originairement ;
le diable agit librement, mais en raison de la « torpeur de la créature » (CD
72), ou « faute d’attention » (GF 2, p. 53), il s’est détourné librement du
souverain bien et a renversé la hiérarchie des biens. Sa méchanceté n’est ja-
mais que la conséquence de sa torpeur.
§ 277. L’homme qui naît en état de péché en tant que descendant
d’Adam et qui pèche à son tour activement n’est pas soustrait par le péché à
la liberté ; le serf arbitre n’est pas une non liberté c’est une liberté qui préfère
le mal au bien, c’est donc une liberté qui conserve intégralement le pouvoir
propre de la volonté, qui est de vouloir ce qui plaît le plus, mais qui, pour
son malheur se plaît le plus au mal, et c’est pourquoi Leibniz peut dire que
« … le franc arbitre et le serf arbitre sont une même chose » : ils ne le sont
pas du point de vue des effets mais du point de vue de la liberté de la volon-
té ; c’est un commentaire de la proposition de St Augustin donnée au § 284 :
« se plaire à pécher est la liberté d’un esclave » ; voir aussi § 289 : « étant
assujettis au péché, nous avons la liberté d’un esclave ».
§ 278. La tentation n’est pas une passivité (« je suis tenté de Dieu » =
Dieu me soumet à la tentation) mais une une auto-affection (celui qui est ten-
té est « attiré et amorcé par sa propre concupiscence »)
§ 288-289. Les trois conditions de la liberté sont l’intelligence, la
spontanéité et la contingence. D’où une difficulté : si la liberté, « telle qu’on
la demande dans les écoles théologiques » exige l’intelligence, au sens d’une
« connaissance distincte de l’objet de la délibération », subsiste t-elle quand
cette connaissance distincte fait défaut, c’est-à-dire quand nos perceptions
sont confuses ? Leibniz répond : oui ; ce que la liberté exige, c’est seulement
61
Descartes répond à une objection d’Elisabeth (16 nov. 1645, et qui se résume ainsi)
: dans une vie humaine le bien-être et le bien agir sont beaucoup moins probables que le mal-
être et le mal agir.
Elisabeth argumente ainsi : si, comme on doit l’admettre, le mal est une privatio boni,
alors la causalité dont le mal résulte - dans un certain ordre de l’être, par exemple le juste et
l’injuste, n’est pas hétérogène à la causalité dont le bien résulte : il n’en est qu’une partie. Et
c’est pourquoi la probabilité de la cause entière - ou du concours de toutes les causes, dont le
juste résulte - est moins grande que celle de la cause partielle, dont résulte l’injuste, ce qui fait
que le mal est plus probable que le bien.
La perspective de Descartes est différente; il envisage le bien et le mal, non distributi-
vement dans les différents plans de la vie, mais globalement et dans la vie humaine intégrale.
Et ainsi le bien et le mal prennent un autre sens. Le bien est tout ce « dont on peut avoir
quelque commodité », le mal tout « ce dont on peut recevoir de l’incommodité ». Cette pers-
pective autorise à mettre en balance les biens et les maux de la vie humaine, ce qui évidem-
ment n’aurait aucun sens, si l’on considérait le bien et le mal dans un même ordre de la vie. Et
quand cette comparaison a lieu, on s’aperçoit que les biens essentiels, ceux dont dépend la
béatitude, relèvent de nous, de notre initiative, tandis que les maux relèvent des choses qui
sont hors de nous. L’emprise de ces maux sur notre propre être dépend donc de l’estime, de la
valeur que nous accordons aux choses extérieures. Si nous reconnaissons que celles-ci ont
moins de valeur que les biens essentiels, alors la balance penchera en faveur du bonheur, nous
comprendrons qu’il y a en cette vie beaucoup plus de biens que de maux, les maux perdront
tout pouvoir de disposer de nous. Celui qui s’est installé dans la jouissance des biens que rien
ne peut lui enlever parvient à considérer les maux qui lui surviennent comme ceux qui sur-
viennent aux personnages imaginaires d’une pièce de théâtre.
© Philopsis – Pascal Dupond 132
www.philopsis.fr
que la volonté tende vers ce que l’entendement se représente comme un bien,
c’est-à-dire agisse comme une cause intentionnelle, quelle que soit la liberté
de son discernement.
On peut se demander si la comparaison entre l’esclavage « juridique »
et l’esclavage « passionnel » ne va pas contre la pensée de Leibniz :
l’esclave (« juridique ») est peut-être responsable du choix qu’il fait entre
deux maux (car son esclavage ne le prive pas de volonté), mais il n’est pas
responsable de la situation qui le contraint à choisir entre deux maux (et
donc de faire un mauvais choix, même s’il n’y a pas d’autre choix qu’un
mauvais choix) ; de même le pécheur est peut-être responsable de son mau-
vais choix, mais est-il responsable de la situation dans laquelle s’exerce sa
volonté, une situation dans laquelle son entendement ne lui présente comme
aimable que des maux ? Il agit avec spontanéité, il agit avec liberté au sens
où il agit en vue d’un bien, mais si son entendement lui représente un mal
comme un bien, où se trouve sa responsabilité ? Faut-il admettre qu’il est
responsable de cet aveuglement ? Mais de proche en proche cet aveuglement
nous conduit jusqu’à l’imperfection métaphysique de la créature et jusqu’à la
forme particulière que prend cette imperfection en Judas ou en Tarquin,
forme particulière qui constitue leur essence. Cette essence est une vérité
éternelle : Dieu n’en est pas responsable. Mais Tarquin, dira t-on, en est en-
core moins responsable. La justice du châtiment est problématique.
Quelque chose cependant doit être gardé en vue : les pensées, les ac-
tions, la conduite qui nous sont assignés par notre essence au fil de son dé-
roulement temporel, nous n’avons aucune autre façon de les découvrir que
de les vivre au présent comme notre nature raisonnable nous dispose à les
vivre, c’est-à-dire en les choisissant (c’est la reprise de la doctrine des confa-
talia et de la critique de l’argos logos) ; et, d’une certaine façon, quand nous
les choisissons, c’est toujours en connaissance de cause dans a mesure où
Dieu nous fait connaître la loi selon laquelle nous devons agir ; et la respon-
sabilité de la volonté consiste à ne pas se laisser détourner d cette loi (§§
310-311)
§ 300. Bayle soutient (§ 299) que ce qui apparaît à la conscience (donc
le plan phénoménal) ne préjuge pas de ce qui a vraiment lieu sur le plan de
l’être : une spontanéité « phénoménale » ne garantit pas une spontanéité
« ontologique ». Leibniz réplique : à partir du moment où nous reconnais-
sons qu’une interaction réelle (ou physique) entre substances est inintelli-
gible et en particulier l’interaction physique entre âme et corps, nous devons
reconnaître que chaque substance est la cause unique de ses actions, ce qui
nous autorise à dire que notre spontanéité phénoménale est aussi ontolo-
gique.
§ 323. Forme/matière. La forme est la source de l’action, alors que la
matière est seulement passive. Voir commentaire du § 22 sur la notion de
force.
La constitution d’un corps relève de deux principes : la matière ou la
force passive et la forme ou la force active
La matière en tant que force passive, c’est ce que Leibniz appelle
« matière première » ; elle est caractérisée par l’étendue, l’antitypie ou résis-
tance à la pénétration et l’inertie ou la résistance au mouvement.
Voir « De la nature du corps… », GF 2, p. 176 : « La force passive
constitue proprement la matière ou masse […] la force passive est cette résis-
© Philopsis – Pascal Dupond 133
www.philopsis.fr
tance par laquelle un corps résiste non seulement à la pénétration, mais aussi
au mouvement, et qui fait qu’un autre corps ne peut venir prendre sa place
sans que lui-même ne lui cède, mais que lui-même ne cède pas sans retarder
en quelque chose le mouvement de celui qui le pousse ; et qu’il s’efforce ain-
si de persévérer dans son état antérieur, en sorte que non seulement il ne le
quitte pas spontanément, mais résiste même à celui qui le change […] Or
cette force passive est partout la même dans le corps et proportionnelle à sa
grandeur ». V
Voir aussi lettre à Rémond de juillet 1714, GF 3 p. 264 : « Les assem-
blages sont ce que nous appelons corps. Dans cette masse on appelle matière
ou bien force passive ou résistance primitive ce qu’on considère dans les
corps comme le passif et comme uniforme partout … ».
Voir aussi la lettre à Des Bosses du 5 février 1712, GF 3, p. 185 : « …
de l’union de la puissance passive des monades naît la matière première,
c’est-à-dire l’exigence d’étendue et d’antitypie, ou de diffusion et de résis-
tance… »
La forme, c’est la force active primitive (Leibniz l’appelle aussi
« forme substantielle » ou « entéléchie première »62) ; elle agit d’abord et par
excellence dans chaque substance simple ou monade, elle est une tendance,
un effort qui produit la variation des perceptions ; elle agit aussi dans les or-
ganismes dont le principe d’unité et d’action est une monade dominante ;
elle agit enfin dans les corps qui sont des agrégats de monades et elle produit
alors le mouvement et la vitesse et, avec le mouvement, la diversité qualita-
tive des corps et leurs altérations ; voir par exemple GF 1 p. 205 : « sans la
force active dans les corps [qui elle-même a sa source dans la force active
des monades], il n’y aurait point de variété dans les phénomènes, ce qui vau-
drait autant que s’il n’y avait rien du tout »63 ; la lettre à Des Bosses men-
tionnée ci-dessus continue ainsi : « …de l’union des entéléchies monadiques
naît la forme substantielle, mais de telle sorte que celle-ci puisse naître et fi-
nir, et qui finira quand cessera cette union, à moins que Dieu ne la conserve
par miracle ».
Ce que nous appelons corps est métaphysiquement parlant un agrégat
de substances. On doit cependant distinguer parmi les corps
1/ Ceux qui ne sont que des agrégats ; voir GF, 3, p. 186, p. 206 :
« …le corps n’a point de véritable unité ; ce n’est qu’un agrégé, que l’Ecole
appelle un par accident, un assemblage comme un troupeau ; son unité vient
de notre perception. C’est un être de raison ou plutôt d’imagination, un phé-
nomène » ; voir aussi p. 264 ). Le corps n’est alors qu’un phénomène bien
fondé.
2/ Et ceux qui sont manifestement plus qu’un agrégat parce que le
multiple y est manifestement organisé, et comme uni par une forme substan-
tielle ; on peut les appeler des « substances corporelles ».
Voir lettre du 29 mai 1716 : « Je restreins la substance corporelle ou
composée aux seuls vivants ou aux seules machines organiques de la nature ;
62
Leibniz parle aussi d’Entéléchies primitives dans sa Réponse aux réflexions de
Bayle, GF 2, p. 195
63
Voir aussi lettre à Jacquelot, 9 février 1704 : « la nature de chaque substance con-
siste dans la force active, c’est-à-dire dans ce qui la fait produire des changements suivant des
lois ».
© Philopsis – Pascal Dupond 134
www.philopsis.fr
le reste n’est pour moi que purs agrégats de substances, que j’appelle subs-
tantiés (substantiata) ; l’agrégat n’est qu’un être par accident ».
Voir aussi lettre à des Bosses, GF 2 p. 187 : « en l’absence de ce lien
substantial des monades, tous les corps, avec toutes leurs qualités, ne seraient
que des phénomènes bien fondés, comme un arc-en-ciel, une image dans un
miroir , en un mot des songes qui se poursuivent de manière parfaitement
congruente à eux-mêmes ; et c’est en cela seulement que consisterait la réali-
té de ces phénomènes »
[Parmi les textes qui distinguent le corps comme agrégat et le corps
comme unité, on peut signaler : 1/ Sur les secrets admirables de la nature »,
GF 1, p. 296 : « Ou il n’y a pas de substances corporelles, et les corps ne
sont que des phénomènes véritables, c’est-à-dire s’accordant entre eux,
comme l’arc-en-ciel ou, mieux, comme un songe parfaitement cohérent, ou il
se trouve, dans les substances corporelles quelque chose d’analogue à l’âme,
que les anciens ont appelé forme ou espèce » ; 2/ NE, GF p. 285 : « Il est bon
cependant de reconnaître la différence entre les substances parfaites et entre
les assemblages de substances (aggregata) qui sont des êtres substan-
tiels » [« substance parfaite » = « substance accomplie » ; « êtres substan-
tiels » = substantiés ?] ; 3/ <Sur le principe de raison> (RG 474) : « De plus
toutes les créatures sont soit substantielles soit accidentelles. Les créatures
substantielles sont les substances ou les substantiés. J’appelle substantiés les
agrégats de substance, comme une armée d’hommes ou un troupeau de bre-
bis ; tous les corps sont de cette nature. La substance est soit simple, comme
l’âme qui n’a pas de parties, soit composée, comme l’animal qui consiste
dans une âme et un corps organique64. Mais comme le corps organique,
comme tous les autres corps, n’est rien d’autre qu’un agrégat d’animaux ou
d’autres êtres vivants, donc un agrégat de corps organiques ou tout au moins
de morceaux (c’est-à-dire de masses) qui sont eux-mêmes résolus finalement
en êtres vivants, on voit que tous les corps sont finalement résolus en êtres
vivants. Et ce qui vient en dernier, dans l’analyse des substances, ce sont les
substances simples, à savoir les âmes, ou si l’on préfère un nom plus général,
les monades, qui n’ont pas de parties ».
§ 324. A rapprocher de la correspondance avec Clarke
§ 336. Trois conditions sont requises pour écarter la nécessité de
l’économie de l’être : la première est que Dieu choisisse librement certains
possibles ; la seconde que « les créatures raisonnables agissent librement
aussi suivant leur nature originelle » ; la troisième est que « le motif du bien
incline la volonté sans la nécessiter ». La 3e condition paraît être une explici-
tation de la 2e : si les créatures raisonnables agissent librement, c’est au sens
où le motif du bien les incline sans nécessiter.
§ 340. Les idées des qualités sensibles n’ont, pour Descartes, aucune
ressemblance avec les mouvements qui se produisent dans les corps (voir
Dioptrique) et ne leur correspondent qu’en vertu d’une institution de la na-
ture. LE refuse cette position
§ 345-346. Les lois du mouvement ne sont pas arbitraires : elles ne
sont pas nécessaires au sens de la nécessité géométrique mais « naissent du
principe de la perfection et de l’ordre » ; elles sont démontrables mais à la
condition de « supposer quelque chose qui n’est pas d’une nécessité absolu-
ment géométrique », comme le principe ou l’axiome selon lequel « l’effet est
égal en force à la cause » ou « l’action est toujours égale à la réaction ». Le
64
Ce texte invite donc à distinguer les substantiés (agrégats de substances) et les subs-
tances composées (substantiés unis par une forme, qui est l’âme).
© Philopsis – Pascal Dupond 135
www.philopsis.fr
second de ces axiomes « suppose dans les choses une répugnance au chan-
gement externe », c’est-à-dire l’inertie, qui ne dérive pas de l’étendue et de
l’antitypie.
§ 348. La loi de continuité s’énonce ainsi dans sa formulation la plus
générale :
« Sans aucun doute quand deux cas supposés ou deux données diffé-
rentes se rapprochent continuellement l’une de l’autre jusqu’à ce qu’enfin
l’un se perde dans l’autre, il est nécessaire aussi que les suites recherchées ou
effets des deux cas se rapprochent continuellement l’un de l’autre et qu’enfin
l’un finisse par devenir l’autre et réciproquement » (« Remarques sur les
principes de Descartes », Sur l’art. 45, LP p. 310).
Avant Leibniz, la loi de continuité trouve ses premières formulations
dans la théorie du mouvement, chez Pascal et chez Galilée.
Pascal, De l’esprit géométrique : « quelque lent que soit un mouve-
ment, on peut le retarder encore davantage et encore ce dernier ; et ainsi à
l’infini sans jamais arriver à un tel degré de lenteur qu’on ne puisse encore en
descendre à une infinité d’autres sans tomber dans le repos ».
Galilée, Discorsi : « Ecoutez-moi bien. Vous ne refuserez pas, je
crois, de m’accorder qu’une pierre tombant de l’état de repos acquiert ses de-
grés successifs de vitesse selon l’ordre dans lequel ces mêmes degrés dimi-
nueraient et se perdraient, si une force motrice la reconduisait à la même hau-
teur ; et le refuseriez-vous que je ne vois pas comment la pierre, dont la vi-
tesse diminue et se consume en totalité au cours de son ascension, pourrait at-
teindre l’état de repos sans être passée par tous les degrés successifs de len-
teur »).
Hobbes définit le mouvement dans le De corpore (2e partie, chapitre
8) de la façon suivante : « le mouvement est l’abandon continu d’un lieu et
l’acquisition d’un autre… ». Cette définition du mouvement lui permet
d’introduire le concept de conatus : « nous définissons l’effort (conatus)
comme le mouvement qui s’effectue en un espace et un temps plus petit que
ce qui est donné, c’est-à-dire déterminé ou assigné par une exposition ou un
nombre, c’est-à-dire un mouvement qui s’effectue en un point » (chapitre 15,
§ 2).
Descartes s’y oppose ; dans la lettre à Mersenne du 11 octobre 1638, il
exprime ses réserves envers les thèses continuistes de Galilée :
« Ce que dit Galilée, que les corps qui descendent passent par tous les
degrés de vitesse, je ne crois point qu’il arrive ainsi ordinairement, mais bien
qu’il n’est pas impossible qu’il arrive quelquefois ».
Et Leibniz critique la 2e et la 3e lois cartésiennes du choc au nom du
principe de continuité : « Il ne se peut pas que la conséquence de l’inégalité
évanouissante ne s’évanouisse pas de façon à rejoindre la conséquence de
l’égalité » (LP p. 311).
Formulations du principe de continuité :
« Rien ne se fait tout d’un coup, et c’est l’une de mes grandes
maximes et des plus vérifiées, que la nature ne fait jamais de sauts » (NE) ;
© Philopsis – Pascal Dupond 136
www.philopsis.fr
« Ma loi de continuité en vertu de laquelle il est permis de considérer
le repos comme un mouvement infiniment petit (c’est-à-dire comme équiva-
lent à une espèce de son contradictoire) et la coïncidence comme une distance
infiniment petite, et l’égalité comme la dernière des inégalités » (lettre à Va-
rignon du 2 février 1702).
La loi de continuité implique une redéfinition de l’égalité :
« Je juge que des termes sont égaux non seulement lorsque leur diffé-
rence est absolument nulle mais aussi lorsqu’elle est incomparablement plus
petite, et bien qu’on ne puisse dire en ce cas que cette différence soit absolu-
ment rien, elle n’est pourtant pas une quantité comparable à celles dont elle
est la différence » (Réponse à M Nieuwentijt au sujet de la méthode différen-
tielle ou infinitésimale).
Enfin on peut le considérer comme une conséquence du principe de
raison suffisante : selon ce dernier, Dieu choisit le meilleur ; or l’être est pré-
férable au néant ; donc il ne peut pas y avoir de vide dans la nature, ce qui
implique le principe de continuité
§ 350. Le principe de convenance est un axiome nécessaire à la dé-
monstration des lois de la nature ; voir Tentamen anagogicum, GF 2, p. 95-
96 :
« Ce véritable milieu qui doit satisfaire les uns et les autres est que
tous les phénomènes naturels se pourraient expliquer mécaniquement, si nous
les entendions assez ; mais que les principes même de la Mécanique ne sau-
raient être expliqués géométriquement, puisqu’ils dépendant des principes
plus sublimes, qui marquent la sagesse de l’auteur dans l’ordre et dans la per-
fection de l’ouvrage ».
§ 355-356-357.
Il y a miracle, pour Leibniz, lorsque se produit dans la nature un effet
qui dépasse les forces de la nature ; et que cet effet soit réitéré, qu’il soit
même constant, cela ne suspend pas son caractère de miracle (voir GF2 p.
256-257, 261). Si Dieu avait voulu que les corps dans l’univers se meuvent
en ligne circulaire, il aurait dû « y mettre la main » ou ordonner à des anges
d’y mettre la main, car cela ne peut pas se produire naturellement, c’est-à-
dire comme un effet de la nature des corps. Si Dieu avait voulu qu’une bles-
sure excite des sentiments agréables, soit il aurait dû donner au corps une
constitution telle que la blessure soit une augmentation de sa perfection, soit,
à nouveau, il aurait dû « y mettre la main ». La nature du corps étant ce que
nous connaissons, la blessure est une diminution de sa perfection, et il serait
contradictoire qu’il y corresponde dans l’âme un sentiment de plaisir, c’est-
à-dire un sentiment accompagnant un accroissement de perfection [« le plai-
sir est une connaissance ou un sentiment de la perfection ou ordre non seu-
lement en nous mais aussi en autrui, car alors on excite encore quelque per-
fection en nous »]
Descartes soutient (Dioptrique, IV, « Des sens en général, AT VI,
112-113), et Bayle est d’accord avec lui sur ce point, qu’il n’y aurait aucune
« convenance » entre les événements du corps et les événements de l’âme et
que cette liaison aurait aussi bien pu être toute différente. Leibniz soutient
qu’il existe un rapport réglé entre les deux séries d’événements.
© Philopsis – Pascal Dupond 137
www.philopsis.fr
Voir « Addition au système nouveau… », GF 2, p. 153 : « … on ne
demeure point d’accord de l’opinion reçue aujourd’hui par plusieurs, et sui-
vie par notre auteur, qu’il n’y a point de ressemblance ou rapport entre nos
sensations et les traces corporelles. Il paraît plutôt que nos sentiments les re-
présentent et les expriment parfaitement […] Ainsi toutes les déclamations et
pointes employées contre l’Ecole et contre la philosophie ordinaire qui en-
seigne la ressemblance de nos sensations avec les traces des objets sont inu-
tiles et ne viennent que des considérations trop superficielles ».
Réponses aux objections du P. Lamy, GF 2, p. 252 : «… la suite des
pensées confuses étant représentative des mouvements du corps dont la mul-
titude et la petitesse ne permet pas qu’on s’en puisse apercevoir distincte-
ment ».
NE, II, VIII, § 6 : « il ne faut point s’imaginer que ces idées de la cou-
leur ou de la douleur soient arbitraires et sans rapport ou connexion naturelle
avec leurs causes… » ; voir aussi id, § 21
Ce qui rend pensable, pour Leibniz, cette convenance, c’est en parti-
culier le fait que la nature du corps ne se réduit pas à l’étendue mais consiste
dans la force : la force dans le corps est analogue à l’appétition dans l’âme.
L’expression est un rapport réglé : « Une chose exprime une autre
(dans mon langage) lorsqu’il y a un rapport constant et réglé entre ce qui se
peut dire de l’une et de l’autre. C’est ainsi qu’une projection de perspective
exprime son géométral » (A Arnauld, 9 octobre 1687)65
Si la rupture de continuité corporelle avait été représentée dans l’âme
par un sentiment agréable, c’est que cette rupture aurait été un passage à une
plus grande perfection (voir la fin du § 342 : si le corps est une prison, la so-
lution de continuité peut annoncer la délivrance).
§ 360. « Il est vrai que Dieu voit tout d’un coup toute la suite de cet
univers lorsqu’il le choisit ». Voir Conversation avec Sténon, GF 1 p. 123 :
« Nous voyons la chose de trois façons, par l’expérience, par le rai-
sonnement et par image spéculaire. Dieu voit de toute éternité que Judas pé-
cherait ; non par l’expérience, puisqu’il n’y a d’expérience que des choses
présentes ; non par le raisonnement, puisque Dieu n’en a pas besoin ; donc
par image spéculaire, c’est-à-dire dans l’idée qui est dans l’entendement di-
vin, et qui inclut la futurition »
§ 38I. La proposition selon laquelle il y a une distinction réelle entre
la substance et l’accident est destinée à fonder l’autonomie de l’action de la
créature. C’est du moins ce qu’on peut conjecturer de la fin du § 381 : Bayle
« va jusqu’à refuser l’action aux créatures ; il ne reconnaît pas même de dis-
tinction réelle entre l’accident et la substance » (la seconde proposition est la
prémisse qui permet d’établir la première). Confirmation dans le § 388.
§ 383. La conservation de la créature est-elle une création continuée ?
Les partisans de la création continuée soutiennent qu’en raison de la discon-
tinuité des moments du temps la créature s’évanouirait à chaque instant si
65
Noter l’incidence du concept d’expression sur la conception leibnizienne de la véri-
té : l’idée vraie n’est pas une intuition immédiate de l’absolu (donc nous n’avons pas les idées
de Dieu), elle n’est pas un dévoilement de la réalité, elle a un rapport constant et réglé avec la
réalité dont elle est l’idée vraie, et ce rapport est garanti par la concordance entre les idées :
« lorsque Dieu nous manifeste une vérité, nous acquérons celle qui est dans son entendement,
car, quoiqu’il y ait une différence infinie entre ses idées et les nôtres quant à la perfection et à
l’étendue, il est toujours vrai qu’on convient dans le même rapport » (NE IV, 5, § 2).
© Philopsis – Pascal Dupond 138
www.philopsis.fr
elle n’était à chaque instant recréée par Dieu. Leibniz objecte : de ce que je
suis, il ne suit pas nécessairement que je serai, mais il en suit naturellement,
si aucune cause ne l’empêche. C’est une application de la loi d’inertie ou de
la loi de causalité : un mouvement se poursuit sans modification si aucune
cause n’arrête le mobile ou ne modifie son mouvement ; la créature continue
d’exister si aucune cause ne s’y oppose.
§ 384. Leibniz conteste la prémisse de la doctrine de la création conti-
nuée, c’est-à-dire la conception cartésienne du temps. Descartes résout le
temps en moments, alors que (en particulier déjà chez Aristote) les instants
ne sont pas des éléments du temps mais des limites.
§ 385. « La créature dépend continuellement de l’opération divine » :
cette dépendance peut être appelée si l’on veut « création continuée », mais
elle n’en est pas une en rigueur de termes : il y a dans la substance une per-
manence, qui est la permanence de sa puissance active primitive, qui produit
les accidents dans leur succession temporelle. Dieu ne recrée pas à chaque
instant sa créature, la création est un acte intemporel qui est coexistant à tous
les moments du devenir des êtres créés, et cet acte intemporel crée une subs-
tance qui est elle-même supra-temporelle. L’existence temporelle ne com-
mence qu’au niveau des accidents. On peut donc parler d’une conservation,
d’une création continuée, mais à la condition de comprendre que cette con-
servation n’est pas inscrite dans le temps comme le sont les modifications
des substances. Voir aussi DM XIV, GF 1 p. 220
§ 388. La doctrine de la création continuée ne fait pas obstacle à
l’action de la créature : le même instant insécable (et dans lequel par consé-
quent aucun ordre chronologique n’est concevable) peut accueillir des réali-
tés entre lesquelles il peut y avoir antériorité et postériorité logique ; ainsi
dans le même instant, il y a l’action par laquelle Dieu produit la créature, et
cette création est antérieure en nature à l’existence créée ; et il y a l’action
par laquelle la créature produit ses affections, production qui est elle-même
antérieure en nature à ce qu’elle produit.
Sur le mythe qui termine la Théodicée.
Selon Spinoza, I, 33, scolie 2 : « Ceux qui soutiennent [que Dieu agit
en vue du bien] semblent poser en dehors de Dieu quelque chose qui ne dé-
pend pas de Dieu et à quoi Dieu a égard comme à un modèle dans ses opéra-
tions […] Cela revient à soumettre Dieu au destin et rien de plus absurde ne
peut être admis au sujet de Dieu, qui nous avons montré qui est la cause
première et l’unique cause libre tant de l’essence de toutes choses que de
leur existence ». En faisant dépendre sa volonté des objets de son entende-
ment, on soumet Dieu au destin.
Leibniz refuse cette lecture : en suivant la raison, Dieu ne fait qu’agir
selon ce qu’il est.
Il y a distinction entre la prévision et la préordination : par sa prévi-
sion, Dieu a la préscience des futurs contingents ; par la préordination, il
« règle et gouverne les choses en détail » (5e écrit à Clarke).
© Philopsis – Pascal Dupond 139
www.philopsis.fr
Annexe 1 : références de quelques concepts leibniziens
Ame
Sur l’indestructibilité de toute âme, voir à Arnauld, 9 octobre 1687 et
Théodicée I, 89
Appétition
« l’action du principe interne qui fait le changement ou le passage
d’une perception à une autre peut être appelée appétition » (PNG)
Atome
La lettre à de Volder du 30 juin 1704 distingue le « corps mathéma-
tique » et les corps qui sont des choses réelles. Le corps mathématique est
une quantité continue ; il « ne peut être résolu en éléments constitutifs pre-
miers », ce qui montre qu’ « il n’est en aucune façon réel, mais est un
quelque chose de mental qui ne désigne rien d’autre que la possibilité des
parties, et non quelque chose d’actuel. La ligne mathématique se comporte
comme l’unité arithmétique et, de part et d’autre, les parties ne sont que pos-
sibles et par suite indéfinies ; et la ligne n’est pas plus un agrégat des lignes
en lesquelles on peut la couper que l’unité n’est un agrégat des fractions en
lesquelles on peut la partager […] Mais dans les choses réelles, à savoir les
corps, les parties ne sont pas indéfinies (comme dans l’espace, chose men-
tale) mais assignées en acte d’une façon déterminée, dans la mesure où la na-
ture ménage selon les variétés des mouvements des divisions et des subdivi-
sions en acte, et bien que ces divisions procèdent à l’infini, cependant tout ne
s’en ramène pas moins à des éléments constitutifs premiers déterminés ou
unités réelles, mais infinis en nombre. Pour parler précisément, la matière
n’est pas composée d’unités constitutives mais elle en résulte puisque la ma-
tière ou masse étendue n’est qu’un phénomène fondé dans les choses,
comme l’arc en ciel ou le parhélie, et toute réalité n’appartient qu’à des uni-
tés. Les phénomènes peuvent donc toujours être divisés en phénomènes plus
petits qui pourraient apparaître à d’autres animaux plus petits, mais jamais
on ne parviendra à des phénomènes qui seraient les plus petits. En fait les
Unités substantielles ne sont pas les parties mais les fondements des phéno-
mènes ».
« Le moindre corpuscule est actuellement subdivisé à l’infini, et con-
tient un monde de nouvelles créatures, dont l’Univers manquerait si ce cor-
puscule était un atome, c’est-à-dire un corps tout d’une pièce sans subdivi-
sion » (à la princesse de Galles, 12 mai 1716).
Connaissance
Leibniz distingue en Dieu la science de simple intelligence qui est la
connaissance des possibles et la science de vision par laquelle Dieu connaît
les existences et les actions de ses créatures.
Certains théologiens, partisans de la liberté d’indifférence, distinguent
en outre ce qu’ils appellent la science moyenne. Par sa science moyenne,
Dieu prévoirait les alternatives devant lesquelles se trouvera placée la volon-
té humaine ainsi que les conséquences résultant du choix qu’elle posera ; il
© Philopsis – Pascal Dupond 140
www.philopsis.fr
pourrait donc faire en sorte que, quelle que soit l’option choisie, elle con-
court à la réalisation du plan providentiel.
Cette science moyenne n’a pas de place dans le système de Leibniz.
Mais Leibniz accepte d’en garder la notion, en divisant alors la science de
simple intelligence en deux parts, l’une concernant les vérités universelles et
nécessaires, l’autre concernant les futurs contingents, ou plus précisément les
vérités possibles contingentes, la science de vision portant alors sur les véri-
tés contingentes actuelles.
Conservation
Ce qui se conserve dans la nature, c’est, non pas la quantité de mou-
vement mais la quantité de force : « il ne faut pas chercher [le fondement des
lois de la nature] dans la conservation de la même quantité de mouvement
[…] mais plutôt dans la nécessité de conserver la même quantité de puis-
sance active, et même (j’ai trouvé à cela de très belles raisons) la même
quantité d’action motrice… » (De ipsa natura). « Il est constant que la
quantité de mouvement est en proportion de la masse et de la vitesse, alors
que la quantité de la puissance, ainsi que nous l’avons montré, est en propor-
tion de la masse et de la hauteur à laquelle un grave peut être élevé par cette
puissance, et que les hauteurs sont comme les carrés des vitesses des corps
qui s’élèvent » (Animadversiones). « La sagesse suprême de Dieu lui a fait
choisir surtout les lois du mouvement les mieux ajustées et les plus conve-
nables aux raisons abstraites ou métaphysiques. Il s’y conserve la même
quantité de la force totale et absolue ou de l’action ; la même quantité de la
force respective ou de la réaction ; la même quantité enfin de la force direc-
tive » (PNG)
Continu
« Le continu est divisible à l’infini. Ce qui, dans la ligne droite, no-
tamment, résulte de ce qu’une partie de la ligne est semblable au tout. C’est
pourquoi puisque le tout peut être divisé, la partie aussi pourrait l’être, et,
semblablement, n’importe quelle partie de cette partie. Les points ne sont pas
des parties du continu mais des extrémités, et il n’y a pas plus de partie mi-
nimum de la ligne que de fraction minimum de l’unité » (à Des Bosses, 14
février 1706).
Différence de statut entre quantité continue et quantité discrète :
« dans les choses actuelles, il n’y a qu’une quantité discrète, une multitude
de monades ou substances simples plus grande que n’importe quel nombre
[…] Mais la quantité continue est quelque chose d’idéal qui appartient aux
possibles et aux actuelles prises comme possibles […] Les actuelles sont
composées comme les nombres qui sont composés d’unités, les idéales
comme les nombres qui sont composés de fractions : les parties sont en acte
dans le tout réel, non dans le tout idéal. En prenant les idéales pour des subs-
tances réelles, quand nous cherchons dans l’ordre des possibles des parties
actuelles et dans les agrégats des actuelles des parties indéterminées, nous
nous enfonçons nous-mêmes dans le labyrinthe du continu et dans des con-
tradictions inextricables » (à de Volder , 19 janvier 1706).
La lettre à Arnauld du 9 octobre 1687 montre qu’il est impossible de
sortir du labyrinthe de la composition du continu dès le moment où l’on fait
de l’étendue l’essence de la matière.
© Philopsis – Pascal Dupond 141
www.philopsis.fr
« La division du continu ne doit pas être considérée comme celle du
sable en grains, mais comme celle d’une feuille de papier ou d’une tunique
en plis, de telle façon qu’il puisse y avoir une infinité de plis, les uns plus pe-
tits que les autres sans que le corps se dissolve jamais en points ou minima »
(Pacidius Philalethi, Fragments Couturat, 594-627).
Continuité (Loi de)
Au moment où Leibniz formule sa loi de continuité, il y a de nom-
breux physiciens « discontinuistes ». Le traitement de l’évolution du mou-
vement selon le principe de continuité résulte donc d’un choix théorique, et
ce choix est celui de la possibilité d’un traitement mathématique des varia-
tions du mouvement.
La loi de continuité du mouvement a été formulée par Galilée et
Hobbes.
Hobbes définit le mouvement dans le De corpore (2e partie, chapitre
8) de la façon suivante : « le mouvement est l’abandon continu d’un lieu et
l’acquisition d’un autre… ». Cette définition du mouvement lui permet
d’introduire le concept de conatus : « nous définissons l’effort (conatus)
comme le mouvement qui s’effectue en un espace et un temps plus petit que
ce qui est donné, c’est-à-dire déterminé ou assigné par une exposition ou un
nombre, c’est-à-dire un mouvement qui s’effectue en un point » (chapitre 15,
§ 2).
Animadversiones [Remarques sur la partie générale des Principes de
Descartes], G IV, 373 : Leibniz critique la 2e et la 3e lois cartésiennes du
choc au nom du principe de continuité : « il ne se peut pas que la consé-
quence de l’inégalité évanouissante ne s’évanouisse pas de façon à rejoindre
la conséquence de l’égalité » (G IV 378)
Lettre à Arnauld de 1687, dans laquelle Leibniz reproche à Descartes
« de n’avoir pas considéré que tout ce qu’on dit du mouvement, de
l’inégalité et du ressort se doit vérifier aussi quand on suppose ces choses in-
finiment petites ou infinies… ». Descartes se met en contradiction avec les
exigences de la continuité dans ses lois du choc, et dans la lettre à Mersenne
du 11 octobre 1638, il exprime ses réserves envers les thèses continuistes de
Galilée : « Ce que dit Galilée, que les corps qui descendent passent par tous
les degrés de vitesse, je ne crois point qu’il arrive ainsi ordinairement, mais
bien qu’il n’est pas impossible qu’il arrive quelquefois ».
Nouveaux Essais : « Rien ne se fait tout d’un coup, et c’est l’une de
mes grandes maximes et des plus vérifiées, que la nature ne fait jamais de
sauts »
Lettre à Varignon du 2 février 1702 : « ma loi de continuité en vertu
de laquelle il est permis de considérer le repos comme un mouvement infi-
niment petit (c’est-à-dire comme équivalent à une espèce de son contradic-
toire) et la coïncidence comme une distance infiniment petite, et l’égalité
comme la dernière des inégalités ».
Le thème selon lequel il y a une continuité dans la croissance ou la dé-
croissance de la vitesse dans un mouvement uniformément accéléré vient de
Pascal (De l’esprit géométrique : « quelque lent que soit un mouvement, on
peut le retarder encore davantage et encore ce dernier ; et ainsi à l’infini sans
jamais arriver à un tel degré de lenteur qu’on ne puisse encore en descendre
à une infinité d’autres sans tomber dans le repos ») et de Galilée (Discorsi :
© Philopsis – Pascal Dupond 142
www.philopsis.fr
« Ecoutez-moi bien. Vous ne refuserez pas, je crois, de m’accorder qu’une
pierre tombant de l’état de repos acquiert ses degrés successifs de vitesse se-
lon l’ordre dans lequel ces mêmes degrés diminueraient et se perdraient, si
une force motrice la reconduisait à la même hauteur ; et le refuseriez-vous
que je ne vois pas comment la pierre, dont la vitesse diminue et se consume
en totalité au cours de son ascension, pourrait atteindre l’état de repos sans
être passée par tous les degrés successifs de lenteur ».
Corps (substance corporelle)
Le lettre à J. Thomasius de 1669 définit le corps par l’étendue (qui est
donnée à la perception visuelle) et l’antitypie (qui est donnée à la perception
tactile). Dans des textes ultérieurs, Leibniz montre que la nature du corps ne
consiste pas, contrairement à ce que pensait Descartes, dans l’étendue. Voir
1/ De Primae philosophiae emendatione (dans ce texte, Leibniz parle de la
force d’agir qui est propre à chaque substance, qui ne cesse jamais d’agir, et
qui appartient à la substance corporelle comme à la substance spirituelle) ; 2/
à Arnauld : « nous remarquons dans la matière une qualité que quelques uns
ont appelée l’inertie naturelle par laquelle le corps résiste en quelque façon
au mouvement… […] s’il n’y avait dans les corps que l’étendue ou la situa-
tion, c’est-à-dire ce que les géomètres y connaissent, joints à la seule notion
du changement, cette étendue serait entièrement indifférente à l’égard de ce
changement, et les résultats du concours s’expliqueraient par la seule com-
position géométriques des mouvements » ; 3/ NE, III, VI, § 19 ; 4/ lettre du
18 juin 1691 [G IV, 487] ; 5/ à de Volder, 24 mars – 3 avril 1699 ; 6/ De ipsa
natura
Définition
Sur les différents types de définitions, voir DM XXIV
Degrés de connaissance
DM, § XXIV distingue les connaissances confuses, distinctes, adé-
quates, intuitives
Dieu trinitaire
Chez Luther, les trois personnes divines correspondent à la création, la
rédemption et la sanctification.
Parfois la Trinité est comprise selon le paradigme sujet/objet/acte.
Leibniz écrit ainsi : On ne trouve pas dans la nature « une substance absolue
qui en contienne plusieurs respectives. Cependant, pour rendre ces notions
plus aisées par quelque chose d’approchant, je ne trouve rien dans les créa-
tures de plus propre à illustrer ce sujet que la réflexion des esprits quand un
même esprit est son propre objet immédiat, et agit sur soi-même en pensant à
soi-même et à ce qu’il fait, car le redoublement donne une image ou ombre
de deux substances respectives dans une même substance absolue […] Je
n’ose pourtant porter la comparaison assez loin et je n’entreprends point
d’avancer que la différence qui est entre les trois personnes divines n’est
plus grande que celle qui est entre ce qui entend et ce qui est entendu, lors-
qu’un esprit fini pense à soi, d’autant que ce qui est modal, accidentel, im-
parfait et mutable en nous, est réel, essentiel, achevé et immuable en Dieu »
© Philopsis – Pascal Dupond 143
www.philopsis.fr
Parfois la Trinité est comprise comme correspondant aux trois pôles
de l’action divine au dehors : « comme tous les esprits sont des unités, on
peut dire que Dieu est l’unité primitive, exprimée par toutes les autres selon
leur portée. Sa bonté l’a mu à agir, et il y a en lui trois primautés, pouvoir,
savoir et vouloir, c’est de quoi résulte l’opération ou la créature ». L’ordre
n’est nullement indifférent : « La volonté n’est point la première source,
c’est tout le contraire, elle suit naturellement la connaissance du bien. Je se-
rais plutôt pour ceux qui reconnaissant en Dieu trois formalités : force, con-
naissance et volonté. Car toute action d’un esprit demande posse, scire,
velle ». L’essence primitive de toute substance consiste dans la force. Ainsi
la puissance active ou tendance s’appelle force (NE, II, 21, 1) ; c’est cette
force en Dieu qui fait que Dieu est nécessairement et que tout ce qui est doit
en émaner. Ensuite vient la lumière ou sagesse, qui comprend toutes les
idées possibles et toutes les vérités éternelles. Le dernier complément est
l’amour ou la volonté, qui choisit parmi les possibles ce qui est le meilleur,
et c’est là l’origine des vérités contingentes ou du monde actuel. Ainsi « la
volonté naît lorsque la force est déterminée par la lumière » (A Morell, sep-
tembre 1698)
Direction
« … la même direction ou détermination subsiste toujours en somme
dans la nature » (à Arnauld, 30 avril 1687)
Egalité
Redéfinition de l’égalité : « je juge que des termes sont égaux non
seulement lorsque leur différence est absolument nulle mais aussi lorsqu’elle
est incomparablement plus petite, et bien qu’on ne puisse dire en ce cas que
cette différence soit absolument rien, elle n’est pourtant pas une quantité
comparable à celles dont elle est la différence » (Réponse à M Nieuwentijt
au sujet de la méthode différentielle ou infinitésimale)
Esprit
Voir lettre à Jean-Frédéric de 1671, § 11, Œuvres publiées par Lucy
Prenant, p. 99.
Voir aussi lettre à Morell, mai 1698 : « comme tous les esprits sont
des unités, on peut dire que Dieu est l’unité primitive, exprimée par tous les
autres esprits suivant leur portée ».
Esprit incréé et esprit créé : les substances portent le caractère de
l’infinité divine par la complexité infinie de l’univers qu’elles expriment, de
sorte que leur perception ne diffère pas de celle de Dieu en étendue mais
seulement en distinction
Expression
« Une chose exprime une autre (dans mon langage) lorsqu’il y a un
rapport constant et réglé entre ce qui se peut dire de l’une et de l’autre. C’est
ainsi qu’une projection de perspective exprime son géométral » (A Arnauld,
9 octobre 1687, LP p. 261)
Perception et expression sont employés comme deux termes substi-
tuables dans lettre à Arnauld du 9 octobre 1687 : « … à qui j’attribue une
expression ou perception inférieure à la pensée ».
© Philopsis – Pascal Dupond 144
www.philopsis.fr
Finalité
« …la finalité sert dans la physique même à découvrir les vérités ca-
chées » (De ipsa natura) ; elle sert aussi à rendre raison des lois du mouve-
ment qui ne peuvent pas être découvertes « par la seule considération des
causes efficientes ou de la matière » : « ces lois ne dépendant point du prin-
cipe de la nécessité comme les vérités logiques, arithmétiques et géomé-
triques ; mais du principe de convenance, c’est-à-dire du choix de la sa-
gesse » (PNG) ; voir aussi DM XIX, XXI, XXII ; voir aussi Animadver-
siones et Grua, II, 486)
Foi
« Les récompenses et châtiments sont encore invisibles au dehors et
ne paraissent qu’aux yeux de notre raison ou foi, ce que je prends ici pour
une même chose, car la vraie foi est fondée en raison. Et puisque les mer-
veilles de la nature nous font trouver les opérations de Dieu admirablement
belles toutes les fois que nous pouvons envisager un tout dans son naturel,
quoi que cette beauté ne paraisse pas en regardant les choses détachées ou
arrachées de leur tout, nous pouvons juger par cela même que tout ce que
nous ne pouvons pas encore débrouiller ni envisager tout entier avec toutes
ses parties, ne doit pas moins avoir de la justesse et de la beauté. Et bien
connaître ce grand point, c’est avoir le fondement naturel de la foi, de
l’espérance et de l’amour de Dieu, puisque ces vertus sont fondées sur la
connaissance des perfections divines » (1703)
Voir aussi TH, Discours, § 44 : croire = « ce qu’on ne juge que par les
effets »
Force
Force primitive et force dérivative : Théodicée, première partie, § 87 ;
à de Volder, 21 janvier 1704 [« la force dérivative, c’est l’état présent en tant
qu’il tend au suivant ou enveloppe d’avance le suivant, en tant que tout ce
qui est présent est gros du futur. Mais la chose permanente elle-même, en
tant qu’elle enveloppe tous les cas, a une force primitive, de telle sorte que la
force primitive est comme la loi de la série et la force dérivative comme la
détermination qui assigne un terme quelconque dans la série »] ; à de Volder
30 juin 1704.
Il existe deux sortes d’action : « ou bien il s’agit du conflit de deux
corps, comme dans l’équilibre de la balance, ou bien il s’agit de la produc-
tion d’un certain effet, tel que élever un grave à une hauteur donnée, tendre
un élastique à tel degré de tension ». Et il existe deux sortes de forces : « et
pour les forces, celles-ci sont ou bien mortes, telles celles qu’a le premier
conatus d’un grave qui tombe ou celui qui est acquis à n’importe quel mo-
ment ; ou bien ce sont des forces vives, telles celles qui sont dans l’impetus
que le grave reçoit en tombant pendant une certaine durée. Et l’impetus de la
force vive est à l’égard de la sollicitation nue de la force morte comme
l’infini au fini, c’est-à-dire comme dans nos différentielles la ligne à ses
éléments. Car l’impetus est formé de l’accroissement continu des sollicita-
tions » (à de Volder, G II, 154) – «… à savoir que la vitesse croît uniformé-
ment selon le temps, mais que la force absolue elle-même croît selon
l’espace ou le carré des temps, c’est-à-dire selon l’effet. De telle sorte que,
© Philopsis – Pascal Dupond 145
www.philopsis.fr
selon une analogie de la géométrie ou de notre Analyse, les sollicitations
sont comme dx, les vitesses comme x, les forces comme xx, c’est-à-dire
comme l’intégrale xdx1 » [commentaire : dans un mouvement uniformément
accéléré, une quantité élémentaire de vitesse s’additionne d’instant en ins-
tant. Le conatus (ou « différence des vitesses ») représente la quantité dont
varie dans l’instant la vitesse acquise. C’est l’accélération élémentaire,
l’accroissement de la vitesse du mobile dans un élément infinitésimal du
temps. L’impetus, c’est la vitesse du mobile à un instant déterminé, acquise
au bout d’un temps déterminé. Il représente la sommation des conatus (cad
l’intégrale sur un intervalle de temps des conatus). Si nous notons gdt le co-
natus, l’impetus sera noté [intégrale sur l’intervalle t t0] gdt = gt = v+c. Enfin
l’espace parcouru durant un intervalle de temps donné sera l’intégrale des
impetus, soit e = [intégrale sur l’intervalle t t0] gtdt = ½ gt2 + C1t + C2, et
c’est précisément l’espace parcouru, carré des temps, qui donne une bonne
‘estimation’ de la force ‘absolue’.
Infini
Quelques jalons historiques (Leibniz : « Histoire et origine du calcul
infinitésimal »)
Leibniz étudie l’analyse cartésienne à partir de 1673
Sur l’infini qui est un infini d’infini, voir Grua, II, 553-555
Voir aussi NE, II, XVII
Cinq figures de l’infini
1/ L’infinité de Dieu, qui est l’infinité vraie, l’absolu (NE p. 133, fin),
l’absolument simple, mais qui se laisse pluraliser en absolus qui sont ses at-
tributs ; « puissance active ayant des quasi-parties, éminemment, mais ni
formellement ni en acte. Cet infini est Dieu lui-même » (à Des Bosses, 1e
septembre 1706).
2/ L’infinité des mondes possibles (Monadologie § 53 ; Théodicée §
225 [Leibniz distingue une modalité extensive et une modalité intensive de
l’infini, une infinité de premier degré et une infinité réfléchie par
l’intermédiaire d’un système combinatoire ; la formule ‘infiniment infini’
marque le moment où le jeu combinatoire transforme l’infini en objet de
connaissance
3/ L’infinité de la substance : être, c’est percevoir et exprimer l’infini,
sous un certain point de vue
4/ L’infinité de l’univers66. La multiplicité des substances est telle
qu’on ne peut lui assigner de limite : « A proprement parler, il est vrai qu’il y
a une infinité de choses, c’est-à-dire qu’il y en a toujours plus qu’on en
puisse assigner » (NE 132) ( = la multitude des choses de l’univers n’est pas
nombrable ; on ne peut pas associer à l’infinité des substances une quantité
66
« je tiens que le nombre des âmes , ou au moins des formes, est infini, et que, la ma-
tière étant divisible sans fin, on n’y peut assigner aucune partie si petite où il n’y ait dedans
des corps animés, ou au moins doués d’une entéléchie primitive ou (si vous permettez qu’on
se serve si généralement du nom de vie) d’un principe vital, cad des substances corporelles
dont on pourra dire en général de toutes qu’elles sont vivantes […] aussi les philosophes ont
reconnu que c’est la forme qui donne l’être déterminé à la matière, et ceux qui ne prennent
pas garde à cela ne sortiront jamais du labyrinthe de compositione continui, s’ils y entrent une
fois » (A Arnauld, 9 octobre 1687)
© Philopsis – Pascal Dupond 146
www.philopsis.fr
déterminée, car il n’y a pas de nombre infini)67 ; « l’univers […] se devant
étendre par toute l’éternité future est un infini. De plus, il y a une infinité de
créatures dans la moindre parcelle de matière, à cause de la division actuelle
du continuum à l’infini. Et l’infini, c’est-à-dire l’amas d’un nombre infini de
substances, à proprement parler n’est pas un tout ; non plus que le nombre
infini lui-même, duquel on ne saurait dire s’il est pair ou impair. C’est cela
même qui sert à réfuter ceux qui font du monde un Dieu ou qui conçoivent
Dieu comme l’âme du monde ; le monde ou l’univers ne pouvant être consi-
déré comme un animal ou comme une substance » (cité dans Leibniz et
l’infini, p. 29-30). L’infinité des substances ne se laisse pas totaliser, elle ne
se laisse pas composer en un tout dont les substances seraient les parties
[« les unités substantielles ne sont pas les parties mais les fondements des
phénomènes » (à Volder, 30 juin1704). La question est de savoir comment
le monde peut être un tout (comme le dit par exemple Théodicée, première
partie, § 8), si l’infini des substances qui le composent ne se laisse pas totali-
ser.
5/ La divisibilité de la matière : « Mes méditations fondamentales
roulent sur deux choses : sur l’unité et sur l’infini. Les âmes sont des unités,
les corps sont des multitudes, mais infinies, tellement que le moindre grain
de poussière contient un monde d’une infinité de créatures » [Lettre à So-
phie, 1696] – « Ainsi je crois qu’il n’y a aucune partie de la matière qui ne
soit, je ne dis pas divisible, mais actuellement divisée, et que par conséquent
la moindre parcelle doit être considérée comme un monde plein d’une infini-
té de créatures différentes » [Lettre à Foucher].
On ne doit pas confondre la divisibilité de la matière et la divisibilité
de l’étendue géométrique. C’est en ce sens qu’on peut lire un passage de la
lettre à Dangicourt du 11 septembre 1716 : « …cependant je ne dis point que
le continuum soit composé de points géométriques car la matière n’est point
le continuum et l’étendue continuelle n’est qu’une chose idéale consistant en
possibilité, qui n’a point en elle de parties actuelles ». Que la matière soit
composée d’une infinité d’êtres réels n’implique pas que le continuum géo-
métrique soit composé de points. Le penser, ce serait confondre la matière et
l’étendue continuelle, la matière, qui « n’est qu’un phénomène réglé et exact
et qui ne trompe point » et l’étendue continuelle, qui « n’est qu’une chose
idéale ». L’étendue idéale est divisible en parties mais elle n’est pas consti-
tuée de parties ; elle fait partie des « touts intellectuels » qui n’ont des parties
qu’en puissance, comme la ligne ou l’unité : « C’est comme l’unité dans
l’arithmétique, qui est aussi un tout intellectuel ou idéal divisible en parties,
comme par exemple en fractions, non pas actuellement en soi (autrement elle
serait réduisible à des parties minimes qui ne se trouvent point en nombres)
mais selon qu’on aura des fractions assignées. Je dis donc que la matière, qui
est quelque chose d’actuel, ne résulte que des monades, c’est-à-dire de subs-
tances simples indivisibles, mais que l’étendue ou la grandeur géométrique
n’est point composée des parties possibles qu’on y peut seulement assigner,
67
Leibniz distingue l’infini catégorématique et l’infini syncatégorématique. Le pre-
mier désigne une multitude composée d’une infinité nombrable de parties ; le second une
multitude infinie qui n’est pas dénombrable. Le premier n’existe pas, pour Leibniz, car son
idée enveloppe contradiction : « Il n’est pas donné d’infini catégorématique, c’est-à-dire ayant
en acte des parties infinies formellement » (à Des Bosses, 1e septembre 1706)
© Philopsis – Pascal Dupond 147
www.philopsis.fr
ni résoluble en points, et que les points aussi ne sont que des extrémités et
nullment des parties ou composants de la ligne » (à Dangicourt)
La conception leibnizienne de l’infini se rassemble autour des posi-
tions suivantes :
A/ L’esprit humain a une idée innée de l’infini : « l’idée de l’absolu
[qui est le véritable infini] est en nous intérieurement comme celle de l’être »
(NE, II, XVII, p. 133). Il ne peut donc être question de chercher, comme le
voudrait Locke, une genèse de l’idée d’infini : ni l’induction, ni l’expérience
interne ne sont en mesure de nous donner cette idée.
Contre Locke, on doit dire également que si l’augmentation à l’infini
des quantités nous donne l’idée de l’infini, ce n’est pas seulement au sens où
rien n’arrêterait notre esprit dans sa progression (cela signifierait infini = in-
défini), c’est au sens où il y a une raison de la progression interminable [« la
même raison subsiste toujours […] et la considération de l’infini vient de
celle de la similitude ou de la même raison » (idem)
B/ L’infini existe en acte et non pas seulement en puissance (lettre à
Foucher : « Je suis tellement pour l’infini actuel qu’au lieu d’admettre que la
nature l’abhorre comme on le dit vulgairement, je tiens qu’elle l’affiche par-
tout pour mieux marquer la perfection de son auteur ».
La question de savoir si l’infini est « en acte » ou seulement « en puis-
sance » remonte à Aristote. Voir Physique, III, 206a [« L’infini n’est donc
pas à considérer comme quelque chose de spécial et de précis, un homme,
par exemple, une maison ; mais il faut comprendre l’existence de l’infini
comme on dit que sont le jour ou l’Olympiade, auxquels l’être n’appartient
pas comme étant telle substance, mais qui sont toujours à devenir et à périr,
limité et fini, sans doute, mais étant toujours autre et toujours autre »]. Aris-
tote fait de l’infini quelque chose qui ne peut être qu’en puissance. Pour
Leibniz, il y a un infini en puissance (la matière est divisible à l’infini) mais
aussi un infini en acte. Innovation de grande importance : l’absence de li-
mites ne correspond pas à l’indéterminé mais au contraire au maximum de
détermination
Descartes refuse la possibilité d’une connaissance de l’infini : « la na-
ture de l’infini est telle que des pensées finies ne le sauraient comprendre »
(Principes, Première partie, § 19). Leibniz reprend la distinction cartésienne
entre connaître et comprendre mais écarte la restriction cartésienne : « Bien
que nous soyons des êtres finis, nous pouvons concevoir bien des choses
concernant l’infini… » (Réflexions sur la partie générale des Principes de
Descartes), par exemple sur les asymptotes, ligne infinie et dont nous con-
naissons la raison pourquoi elle est infinie.
C/ L’esprit humain est capable de calcul sur l’infini, calcul qui sera
appelé « calcul différentiel et intégral ». Descartes pensait que « trouver la
proportion entre les lignes droites et les lignes courbes [était] impossible
pour les hommes », et cela parce que l’algèbre cartésienne ne connaît que
des équations ayant un degré déterminé [une équation de degré n possède n
racines et peut se ramener à un produit de n facteurs de premier degré (x –
a). Leibniz fait sauter le verrou cartésien et propose une solution pour la
quadrature du cercle (= trouver un nombre exprimant le rapport du cercle au
carré circonscrit) ; si la surface du carré est égale à 1, celle du cercle est
égale à 1 – 1/3 /+ 1/5 – 1/7 + 1/9…… L’aire du cercle qui est finie est donc
égale à une série infinie de termes, une série qui n’échappe pas à la raison,
© Philopsis – Pascal Dupond 148
www.philopsis.fr
puisque la série « n’est constituée que par une loi de progression unique » et
que « l’esprit peut la concevoir convenablement tout entière ».
Leibniz est l’inventeur du calcul différentiel, qui porte sur les diffé-
rences infiniment petites entre deux valeurs d’une variable. Ces différences
sont à la fois l’objet et l’instrument d’un calcul dont Leibniz détermine les
règles et dont il met en évidence la portée générale [Marquis de l’Hospital :
« dans tout cela, il n’y a encore que la première partie du calcul de M. Leib-
niz, laquelle consiste à descendre des grandeurs entières à leurs différences
infiniment petites, et à comparer entre eux ces infiniment petits, de quelque
genre qu’ils soient ; c’est ce qu’on appelle calcul différentiel. Pour l’autre
partie, qu’on appelle calcul intégral, et qui consiste à remonter de ces infini-
ment petits aux grandeurs ou aux touts dont ils sont les différences, c’est-à-
dire à en trouver les sommes, j’avais aussi dessein de la donner…… »].
Origines du calcul différentiel
La première se trouve dans les calculs sur les suites de nombres. Par
exemple : « la somme des différences entre termes consécutifs (quel qu’en
soit le nombre) est égal à la différence entre les deux termes extrêmes »..
La deuxième source du calcul différentiel est géométrique et vient des
problèmes de quadrature.
Le concept central est celui de différence (dX) : concept général qui
n’est pas défini comme un concept représentant une grandeur de nature dé-
terminée mais une différence quelconque (entre deux valeurs d’une va-
riable), différence seulement déterminée dans son rapport avec une grandeur
arbitrairement choisie.
X et dX sont homogènes : la variable et sa différence sont de même
espèce, de même genre ou nature. Ce qui justifie qu’on leur applique les
mêmes opérations
X et dX sont incomparables [reprenant Euclide, Leibniz précise que
« seules sont comparables des grandeurs homogènes dont le produit de l’une
par un nombre fini peut surpasser l’autre], au sens où ils ne sont pas du
même ordre de grandeur. Ce qui fait que X + dX est la même chose que X
[« on demande qu’on puisse prendre indifféremment l’une pour l’autre deux
quantités qui ne diffèrent entre elles que d’une quantité infiniment petite ou
(ce qui est la même chose) qu’une quantité qui n’est augmentée ou diminuée
que d’une autre infiniment moindre qu’elle puisse être considérée comme
demeurant la même »].
Le calcul différentiel devient calcul infinitésimal (un calcul des infi-
niment petits) quand il est appliqué aux courbes : « on demande qu’une ligne
courbe puisse être considérée comme l’assemblage d’une infinité de lignes
droites, chacune infiniment petite ou, ce qui est la même chose, comme un
polygone à un nombre infini de côtés, chacun infiniment petit, lesquels dé-
terminent par les angles qu’ils font entre eux la courbure de la ligne ».
Même considération en ce qui concerne la tangente : « …dans son
principe, trouver la tangente consiste à tracer une droite figurant deux points
infiniment proches de la courbe, cad à tracer le côté d’un polygone infinitan-
gulaire qui, à mes yeux, équivaut à la courbe » [cette équivalence mathéma-
tique entre le polygone infinitangulaire et la courbe a une racine ontolo-
gique : la figure « n’est jamais exacte et déterminée à la rigueur dans la na-
ture à cause de la division actuelle à l’infini des parties de la matière (lettre
à Arnauld du 9 octobre 1687).
© Philopsis – Pascal Dupond 149
www.philopsis.fr
D/ La « référence » du calcul différentiel est problématique : les diffé-
rentielles sont-elles des réalités qui existeraient dans la nature ou sont-elles
des fictions utiles ? Leibniz refuse de réaliser les infinitésimaux, à les définir
comme des « infiniment petits » qui auraient le statut de ‘choses’ ; les diffé-
rentielles sont des affections de grandeurs qui reçoivent leur détermination
des opérations dans lesquelles elles sont engagées. Les différentielles ne sont
pas infiniment petites, elles sont infiniment plus petites que les grandeurs
qu’on différencie. Leibniz écrit à Varignon (20 juin 1702 : « Pour dire le
vrai, je ne suis pas trop persuadé moi-même qu’il faut considérer nos infinis
et infiniment petits autrement que comme des choses idéales ou des fictions
bien fondées. Je crois qu’il n’y a point de créature au dessous de laquelle il
n’y ait une infinité de créatures, cependant je ne crois point qu’il y en ait, ni
même qu’il puisse y en avoir d’infiniment petites, et c’est ce que je crois
pouvoir démontrer. Il est que les substances simples (c’est-à-dire qui ne sont
pas des êtres par agrégation) sont véritablement indivisibles, mais elles sont
immatérielles et ne sont que principe d’action ». Voir aussi la lettre à Des
Bosses du 11 mars 1706 : « En parlant philosophiquement, je n’admets pas
plus les grandeurs infiniment petites que les grandeurs infiniment grandes,
c’est-à-dire pas plus les infinitésimaux que les infinituples. Je les considère
en effet toutes les deux comme des façons commodes de parler, des fictions
de l’esprit, bonnes pour le calcul, qui sont de même nature que les racines
imaginaires en algèbre. Cependant j’ai démontré que ces expressions sont
d’un grand usage pour faciliter la réflexion et même l’invention, et qu’elles
ne peuvent nous faire tomber dans l’erreur, puisqu’il suffit de prendre pour
infiniment petite une grandeur aussi petite que l’on veut, de telle sorte que
l’erreur est moindre qu’une erreur donnée, d’où il suit qu’une erreur n’est
pas assignable »
On peut admettre que la conception leibnizienne de l’expression rend
superflue la recherche d’un fondement et d’une garantie ontologiques de la
quantité différentielle. Jacqueline Guichard écrit : « l’ordre mathématique et
ses concepts, en tant que système de symboles bien faits, c’est-à-dire expres-
sifs de rapports n’a pas besoin d’un fondement extérieur, dans la correspon-
dance avec des éléments réellement infinitésimaux ; son opérationnalité est
indépendante de l’ordre métaphysique, dans lequel la question de l’existence
d’infiniment petits a toute sa pertinence
Mécanisme
« Il faut toujours expliquer la nature mathématiquement ou mécani-
quement, pourvu qu’on sache que les principes mêmes ou les lois de la mé-
canique ou de la force ne dépendent pas de la seule étendue mathématique
mais de quelques raisons métaphysiques » (à Arnauld, 4-14 juillet 1686)
« On peut expliquer machinalement, je l’avoue, les particularités de la
nature, mais c’est après avoir reconnu ou supposé les principes de la méca-
nique même, qu’on ne saurait établir a priori que par des raisonnements de
métaphysique » (à Arnauld, 30 avril 1687). Les principes de la mécanique
sont métaphysiques en ce qu’ils ne sont pas réductibles à la géométrie et re-
posent sur la notion de force ou puissance d’agir. Voir aussi DM XVIII
Mouvement
© Philopsis – Pascal Dupond 150
www.philopsis.fr
« Le mouvement, en tant qu’il n’est qu’une modification de l’étendue
[…] enveloppe quelque chose d’imaginaire » (à Arnauld, 30 avril 1687, voir
aussi 4-14 juillet 1686)
« Pour pouvoir dire qu’un corps est en mouvement, nous ne demande-
rons pas seulement qu’il change de position par rapport aux autres, mais en-
core qu’il y ait en ce corps même une cause du changement, une force, une
action » (Animaversiones). Voir aussi DM, XVIII
« … le mouvement est indépendant de l’observation, mais il n’est
point indépendant de l’observabilité. Il n’y a point de mouvement quand il
n’y a point de changement observable » (à Clarke, 4e réponse)
Perfection
« la perfection n’étant autre chose que la grandeur de la réalité posi-
tive prise précisément, en mettant à part les limites ou bornes dans les
choses qui en ont » (Monadologie, § 41)
Prédestination
Leibniz a tôt pensé que les controverses naissent de malentendus
Il existe plusieurs grandes orientations dans la question de la prédesti-
nation.
L’une d’entre elles, adoptée par Luther, Calvin, Bèze admet un décret
primitif d’élection ou de réprobation, parce qu’il a plu à Dieu de montrer
ainsi sa gloire. D’où le décret de rendre l’homme condamnable par sa chute
(thèse supralapsaire).
Leibniz leur accorde que Dieu agit pour manifester sa gloire, mais
précise que cette gloire consiste à agir par des raisons prévalentes ou aussi
sagement que possible.
Leibniz exclut la création pour le péché ou pour la gloire de punir
comme le pensaient certains supralapsaires, tout en reconnaissant qu’il faut,
avec Luther, avoir confiance dans le Dieu caché.
Selon l’opinion moyenne, reprise par les calvinistes Sohn et Zanchi et
le jésuite Bellarmin, Dieu choisit les élus dans la masse réprouvée en consé-
quence du péché originel et les dirige à la vie éternelle par des moyens in-
faillibles (thèse infralapsaire absolue).
Demeure inexpliquée, selon Leibniz, l’origine du péché d’Adam
comme de l’impénitence des damnés. Ce qui est en tout cas, exclu, dans
l’esprit de Leibniz, c’est que Dieu n’ait pas pu ou voulu leur donner des
forces pour ne pas pécher. La solution se trouve dans le choix divin de de la
meilleure des séries infinies. Le salut de tous ne fait pas partie de la série la
plus parfaite
Pour le jeune Augustin, suivi par Melanchton et d’autres, Dieu prédes-
tine ceux qu’il prévoit croire au Christ et réprouver les réfractaires (thèse in-
fralapsaire conditionnelle).
Leibniz répond : Foi, charité ou bonnes œuvres (qui sont indisso-
ciables : si la foi est pratique, on ne peut pas vraiment dissocier la foi et les
bonnes œuvres) sont prévues chez les élus mais comme dons de Dieu ; ces
dons de Dieu ne sont pas arbitraires : « il ne faut pas s’imaginer des décrets
absolus qui n’aient aucun motif raisonnable » (DM 31) – « J’ai trouvé avec
St Augustin, Thomas d’Aquin et Luther que Dieu est la dernière raison des
choses et que ceux qui parlent des bonnes qualités prévues, soit foi soit
© Philopsis – Pascal Dupond 151
www.philopsis.fr
œuvres de la charité, comme cause des décrets favorables de Dieu disent la
vérité mais qu’ils ne disent pas assez parce que ces mêmes bonnes qualités
étant encore des dons de Dieu, dépendent d’autres décrets dont le dernier
motif ne peut être enfin que le bon plaisir de Dieu, lequel n’est pas tyran-
nique ni sans raison mais qui a pour objet cet abîme et cette profondeur de
richesses dont parle St Paul, c’est-à-dire l’harmonie et la perfection de
l’univers » (1695). Dieu n’est pas déterminé au décret de damnation éter-
nelle par sa nature absolue mais par l’homme – possible – rejetant la grâce,
étant admis que cet homme possible rejetant la grâce fait partie du meilleur
des mondes possibles.
Leibniz reprend certains concepts théologiques : nécessité absolu et
hypothétique, nécessité morale, volonté antécédente et conséquente.
Chez les scolastiques, la volonté antécédente est la volonté du salut
universel selon Paul (I Tim. 2, 4 : « J’exhorte donc avant toutes choses à
faire des prières… cela est bon et agréable devant Dieu notre sauveur, qui
veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de
la vérité »), tandis que la volonté conséquente est réduite au salut de
quelques uns parce que la justice demande le châtiment des pécheurs.
Cette distinction a parfois été comprise comme antithèse du signe et
du bon plaisir (Dieu déclare qu’il veut sauver tous les hommes mais a la vo-
lonté cachée de n’en sauver que quelques uns). Cette lecture se trouve chez
Luther, pour autant qu’il distingue le Dieu révélé qui veut le salut de tous et
le Dieu caché qui veut la mort du pécheur. Cette lecture est pour Leibniz ab-
solument impossible. Leibniz réinterprète la distinction en lui donnant le
schème physique de la composition des forces.
Raison
« Et quoique la raison divine surpasse infiniment la nôtre, on peut dire
sans impiété que nous avons la raison commune avec Dieu, et qu’elle fait
non seulement les liens de toute la société et amitié des hommes, mais en-
core de Dieu et de l’homme » (après 1704)
Réflexion
« Les bêtes, autant qu’on en peut juger, manquent de cette réflexion
qui nous fait penser à nous-mêmes » (Considérations sur les principes de
vie, 97)
Substance
La proposition énonçant la convertibilité de l’un et de l’être se trouve
dans la lettre à Arnauld du 30 avril 1687 : « …que ce qui n’est pas vérita-
blement un être n’est pas non plus véritablement un être ».
Vérité
Les Animadversiones distinguent les vérités de fait et les vérités de
raison. La première des vérités de raison est le principe de contradiction, qui
revient au même que le principe d’identité. Quant aux vérités de fait, Leibniz
précise : « il y a autant de vérités de fait premières qu’il y a de perceptions
immédiates ou, si l’on peut dire, de consciences. Car je n’ai pas seulement
conscience de mon moi pensant, mais aussi de mes pensées, et il n’est pas
plus vrai ni plus certain que je pense qu’il n’est vrai et certain que je pense
© Philopsis – Pascal Dupond 152
www.philopsis.fr
telle ou telle chose.. Aussi est-on en droit de rapporter toutes les vérités de
fait premières à ces deux-ci : je pense et des choses diverses sont pensées
par moi. D’où il suit non pas seulement que je suis, mais encore que je suis
affecté de diverses manières ».
De nombreux textes distinguent les vérités nécessaires et les vérités
contingentes. Un texte, donné par Grua, I, 303 les distingue ainsi : « En fait
dans les propositions nécessaires on parvient par une analyse continuée
jusqu’au bout à une équation identique ; et c’est cela même démontrer une
vérité dans la rigueur géométrique ; dans les contingentes, les analyses pro-
gressent à l’infini par des raisons de raisons, de telle sorte qu’on n’a jamais
une démonstration complète, que cependant la raison de la vérité s’y trouve
toujours, et que Dieu seul la comprend parfaitement, lui qui seul pénètre la
série infinie d’un seul trait de son esprit ».
Une autre présentation de cette distinction énonce : « Il y a deux pro-
positions premières : la première est le principe des nécessaires, selon lequel
ce qui implique contradiction est faux ; la seconde le principe des contin-
gentes selon lequel ce qui est plus parfait ou a une plus grande raison est
vrai. Sur le premier s’appuient toutes les vérités métaphysiques, cad absolu-
ment nécessaires, telles que les vérités logiques, arithmétiques, géométriques
et autres semblables [à rapprocher de TH, DCFR, § 2]. En effet à celui qui
les nie on peut toujours montrer que le contraire implique contradiction. Sur
le second s’appuient toutes les vérités contingentes par leur nature, néces-
saires seulement à partir de l’hypothèse de la volonté de la divinité ou de la
volonté d’un autre » (Grua, I, 303).
Le principe des contingentes peut aussi être formulé ainsi : « Dieu
veut choisir le plus parfait » (Grua, I, 301-302). Ce principe est indémon-
trable : « c’est absolument la même chose de dire que Dieu est libre, et de
dire que cette proposition est un principe indémontrable. Car si on pouvait
rendre raison de ce premier décret divin, par cela même Dieu ne l’aurait pas
librement décrété ». Le principe des contingentes est aussi indémontrable
que le principe d’identité, principe des nécessaires.
Le partage entre vérités nécessaires et vérités contingentes correspond
aussi au partage entre l’ordre des essences et l’ordre des existences.
© Philopsis – Pascal Dupond 153
www.philopsis.fr
Annexe II. Thomas d'Aquin − Somme de Théologie.
Première partie.
Question 22.
Article 2 : Toutes choses sont-elles soumises à la providence divine ?
Il semble que non.
1. Rien de ce qui est prévu n’est fortuit. Si donc tout est prévu par
Dieu, il n’y aura rien de fortuit, ce qui fait disparaître le hasard et la chance,
contrairement à l’opinion commune.
2. Tout pourvoyeur sage exclut autant qu’il le peut tout défaut et tout
mal des choses dont il prend soin. Or nous voyons que les choses comportent
de nombreux maux. Ou bien par conséquent Dieu ne peut les empêcher, et il
n’est donc pas tout-puissant ; ou bien il n’a pas soin de toutes choses.
3.Les choses qui se produisent par nécessité ne requièrent ni provi-
dence ni prudence : aussi Aristote dit-il, au 6ème livre de l’Éthique à Nico-
maque, que la prudence est la droite règle des choses contingentes, les-
quelles relèvent du conseil et du choix. Puis donc que beaucoup de choses se
produisent par nécessité, toutes ne sont pas soumises à providence.
4. Ce qui est laissé à soi-même n’est pas soumis à la providence d’un
être qui le gouverne. Mais les hommes sont laissés par Dieu à eux-mêmes,
selon l’Ecclésiastique (15, 14) : au commencement Dieu a fait l’homme et
l’a laissé aux mains de son propre conseil ; et spécialement les méchants, se-
lon le Psaume 80 (13) : il les a abandonnés aux désirs de leur cœur. Tout
n’est donc pas soumis à la providence divine.
5. L’Apôtre Paul (Première épître aux Corinthiens, 9, 9) dit que Dieu
n’a pas souci des bœufs, ni pour autant des autres créatures dépourvues de
raison. Tout n’est donc pas soumis à la providence divine.
En sens contraire, le Livre de la Sagesse (8, 1) dit au sujet de la sa-
gesse divine qu’elle s’étend avec force d’une extrémité à l’autre et dispose
tout avec douceur.
Je réponds : certains ont totalement nié la providence, tels Démocrite
et Épicure, qui affirmaient que le monde s’était fait par hasard. D’autres ont
affirmé que seuls les incorruptibles sont soumis à la providence, tandis que
les corruptibles ne le sont pas individuellement, mais spécifiquement, car
c’est de ce dernier point de vue qu’ils sont incorruptibles. C’est en leur nom
que Job s’exprime en disant (22, 14) : les nuées lui font écran, et il se pro-
mène aux limites du ciel sans prêter attention aux choses de chez nous. Rab-
bi Moïse a pourtant excepté les hommes du cas général des corruptibles, à
cause de la splendeur de l’intelligence, à laquelle ils ont part ; mais pour les
autres individus corruptibles, il a suivi l’opinion susdite.
Il faut cependant dire que toutes choses sont soumises à la provi-
dence divine, non seulement en général, mais aussi singulièrement. (...)
Puisqu’en effet tout agent agit en fonction d’une fin, l’ordination de ses ef-
© Philopsis – Pascal Dupond 154
www.philopsis.fr
fets à la fin va aussi loin que la causalité de l’agent premier. Aussi arrive-t-il
que dans les œuvres d’un certain agent il advienne quelque chose qui n’est
pas ordonné à la fin, parce que cet effet s’ensuit de quelque autre cause,
étrangère à l’intention de l’agent. Or la causalité de Dieu, qui est l’agent
premier, s’étend à tous les êtres, corruptibles comme incorruptibles, non seu-
lement quant à leurs principes spécifiques, mais encore quant aux principes
individuels. Aussi faut-il que tout ce qui a l’être d’une quelconque manière
soit ordonné par Dieu à sa fin, conformément à ce mot de l’Apôtre Paul
(Romains, 13, 1) : ce que Dieu fait être, il l’ordonne. Puis donc que la pro-
vidence de Dieu n’est rien d’autre que la conception de l’ordination des
choses à leur fin (...), ils faut que toutes choses, pour autant qu’elles ont part
à l’être, soient soumises à la providence divine.
Pareillement (...), Dieu connaît tout, les particuliers autant que les
universels. Et comme sa connaissance a le même rapport aux choses que la
connaissance de l’art à ses produits (...), il faut que toutes choses soient sou-
mises à son ordination, de même que tous les produits le sont à celle de l’art.
1. Il en va autrement de la cause universelle et de la cause particulière.
Car quelque chose peut échapper à l’ordre de la cause particulière, mais pas
à l’ordre de la cause universelle. Rien, en effet, n’est soustrait à l’ordre d’une
cause particulière, si ce n’est pas une autre cause particulière qui y fait obs-
tacle : par exemple le bois est empêché de brûler par l’action de l’eau. C'est
pourquoi, comme toutes les causes particulières sont incluses dans la cause
universelle, il est impossible qu’un effet échappe à l’ordre de la cause uni-
verselle. Par suite, dans la mesure où un effet échappe à l’ordre d’une
cause particulière, on dit qu’il relève du hasard ou de la chance, au re-
gard de cette cause ; mais au regard de la cause universelle, à l’ordre de
laquelle il ne peut se soustraire, on dit qu’il est prévu. C’est ainsi que la
rencontre de deux serviteurs, tout en étant fortuite pour eux, est pourtant
prévue par leur maître, qui les envoie sciemment au même endroit, sans que
chacun sache ce qui concerne l’autre.
2. Il en va autrement de quiconque prend soin d’une chose particu-
lière, et d’un pourvoyeur universel. Car un pourvoyeur particulier exclut tout
défaut de ce dont il a la charge autant qu’il le peut, tandis qu’un pourvoyeur
universel permet qu’un défaut se produise dans une partie afin que le bien du
tout ne soit pas empêché. Aussi dit-on que les corruptions et les défauts dans
les choses naturelles contrarient leur nature particulière, et sont pourtant dans
l’intention de la nature universelle, en ce que le défaut de l’un contribue au
bien de l’autre, voire de tout l’univers ; car la corruption de l’un est la géné-
ration d’un autre, par laquelle l’espèce se conserve. Puis donc que Dieu est
le pourvoyeur universel de tout l’être, il appartient à sa providence de
permettre certains défauts dans des choses particulières, pour que ne
soit pas empêché le bien total de l’univers. Si en effet tous les maux
étaient empêchés, beaucoup de biens manqueraient à l’univers : le lion ne
pourrait vivre sans tuer des bêtes ; et la patience des martyrs n’aurait pas lieu
sans la persécution des tyrans. C'est pourquoi Augustin dit dans
l’Enchiridion (11) : le Dieu tout-puissant ne permettrait aucunement qu’il y
ait un quelconque mal dans ses œuvres, s’il n’était tout-puissant et bon au
point de pouvoir tirer un bien même du mal. − C’est par ces deux raisons,
maintenant réfutées, que semblent avoir été motivés ceux qui ont soustrait
© Philopsis – Pascal Dupond 155
www.philopsis.fr
les êtres corruptibles à la divine providence, parce qu’ils y trouvaient des ha-
sards et des maux.
3. L’homme n’est pas l’instituteur de la nature, mais il se sert des
choses naturelles, pour son propre usage, dans les œuvres de l’art et de la
vertu. C'est pourquoi la providence humaine ne s’étend pas aux choses né-
cessaires, qui se produisent par nature. Mais la providence de Dieu s’y étend,
parce qu'il est l’auteur de la nature. − C’est cette raison qui semble avoir mo-
tivé deux qui ont soustrait le cours des choses naturelles à la divine provi-
dence, le mettant au compte de la nécessité matérielle, tels Démocrite et les
anciens Naturalistes.
4. Que Dieu ait laissé l’homme à lui-même n’exclut pas celui-ci de la
providence divine, mais cela montre qu’il n’a pas été programmé avec une
puissance active déterminée à un seul effet, comme les choses naturelles :
celles-ci sont seulement agies, en ce sens qu’elles sont dirigées vers leur fin
par un autre, mais n’agissent pas elles-mêmes, au sens où elles se dirige-
raient elles-mêmes vers leur fin, comme les créatures rationnelles au moyen
du libre arbitre, par lequel elles délibèrent et choisissent. D’où l’expression :
aux mains de son propre conseil. Or comme même l’acte du libre arbitre
renvoie à Dieu comme à sa cause, ce qui provient du libre arbitre est néces-
sairement soumis à la providence divine : car la providence humaine est
contenue dans la providence divine, comme la cause particulière dans la
cause universelle. − Dieu cependant exerce sa providence sur les hommes
justes d’une manière plus excellente que sur les impies, en ce qu’il ne permet
pas qu’il se produise à leur encontre quoi que ce soit qui au bout du compte
empêcherait leur salut : car tout concourt au bien de ceux qui aiment Dieu
(Romains, 8, 28). Mais du fait qu’il n’exempte pas les impies du mal de
faute, on dit qu’il les abandonne. Non pas cependant au point de les exclure
totalement de sa providence : autrement, ils seraient anéantis, à moins que sa
providence ne les en préserve. − C’est cette raison qui semble avoir motivé
Cicéron, qui soustrait les affaires humaines à la divine providence, parce que
nous en délibérons.
5. Du fait que la créature rationnelle a par le libre arbitre la maîtrise de
son acte (...), c’est d’une manière spéciale qu’elle est soumise à la provi-
dence divine, à savoir en ce que quelque chose est imputé à sa faute ou à son
mérite, et qu’elle en retire une peine ou une récompense. Et c’est en ce sens
que l’Apôtre exclut les bœufs du soin de Dieu, ce qui ne veut pas dire que les
individus de l’ordre des créatures dépourvues de raison ne relèvent pas de la
providence divine, comme Rabbi Moïse l’a pensé.
Article 4 : La providence impose-t-elle une nécessité aux choses aux-
quelles elle pourvoit ?
(...) La providence divine impose une nécessité à certaines choses,
mais non pas à toutes, comme certains l’ont cru. Car il appartient à la provi-
dence d’ordonner les choses à leur fin. Or, après la bonté divine, qui est une
fin séparée des choses, le principal bien inhérent aux choses elles-mêmes est
la perfection de l’univers, laquelle ne serait pas si on ne trouvait dans les
choses tous les degrés d’être. C'est pourquoi il appartient à la providence
divine de produire tous les degrés d’étants. Et c’est ainsi qu’elle a apprêté
© Philopsis – Pascal Dupond 156
www.philopsis.fr
pour certains effets des causes nécessaires, afin qu’ils adviennent nécessai-
rement ; mais pour certains des causes contingentes, pour qu’ils adviennent
en étant contingents, d’après la condition de leurs causes prochaines. (...)
Question 23.
Article 1 : Les hommes sont-ils prédestinés par Dieu ?
(...) Il y a une convenance à ce que Dieu prédestine les hommes. Car
toutes choses sont soumises à la providence divine (...). Or il appartient à la
providence d’ordonner les choses à leur fin (...). Mais la fin à laquelle les
choses créées sont ordonnées par Dieu est double. Il y a une fin qui dépasse
ce à quoi le pouvoir de la nature créée est proportionné : cette fin est la vie
éternelle, qui consiste dans la vision de Dieu, laquelle est au-dessus de la na-
ture de toute créature (...). Mais il y a une autre fin qui est proportionnée à la
nature créée, et que pour autant la créature peut atteindre selon la puissance
de sa nature. Or ce à quoi une chose ne peut pas parvenir par la puissance de
sa nature, il faut qu’elle y soit conduite par un autre : c’est ainsi que la flèche
est envoyée vers sa cible par l’archer. C'est pourquoi, à proprement parler, la
créature rationnelle, qui est apte à recevoir la vie éternelle (capax vitae ae-
ternae), y est amenée pour autant qu’elle est conduite par Dieu. Et la concep-
tion (ratio) de cette conduite préexiste assurément en Dieu, pour autant qu’il
y a en lui cette conception de l’ordination de toute chose à sa fin que nous
avons appelée (...) sa providence. Or la conception d’une chose à faire qui
existe dans l’esprit d’un auteur (actoris) est une sorte de préexistence de la
chose à faire en lui. C'est pourquoi la conception de ladite conduite de la
créature rationnelle à cette fin qu’est la vie éternelle est dénommée prédesti-
nation : car destiner, c’est envoyer. Et il apparaît ainsi que la prédestination
est, quant à ses objets, une partie de la providence. (...)
Article 3 : Dieu réprouve-t-il certains hommes ?
Il semble que non.
1. Dieu aime tout homme, selon Sagesse, 11, 25 : Tu aimes tous les
êtres, et tu ne hais rien de ce que tu as fait. Dieu ne réprouve donc aucun
homme.
2. Si Dieu réprouve un homme, il faut que la réprobation ait le même
rapport aux réprouvés que la prédestination aux prédestinés. Or la prédesti-
nation est la cause du salut des prédestinés. La réprobation sera donc la
cause de la perdition des réprouvés. Mais cela est faux, car Osée dit (13, 9) :
Ta perdition, Israël, vient de toi ; de moi vient seulement ton secours. Dieu
ne réprouve donc personne.
3. On ne doit imputer à personne ce qu’il ne peut éviter. Mais si Dieu
réprouve quelqu'un, ce dernier ne peut éviter d’être perdu. L’Ecclésiaste (7,
13) dit en effet : Considère les œuvres de Dieu ; personne ne peut redresser
ce qu’il a dédaigné. Il ne faudrait donc pas imputer aux hommes leur perte.
Mais cela est faux. Dieu ne réprouve donc personne.
© Philopsis – Pascal Dupond 157
www.philopsis.fr
En sens contraire, Malachie dit (1, 2-3) : J’ai aimé Jacob, mais j’ai
pris Esaü en haine.
Je réponds que Dieu réprouve certains. On a dit en effet (a.1) que la
prédestination est une partie de la providence. Or il appartient à la provi-
dence de permettre un défaut dans les choses qui lui sont soumises (...). Puis
donc que les hommes sont ordonnés à la vie éternelle par la divine provi-
dence, il appartient aussi à celle-ci de permettre que certains manquent cette
fin. Et c’est ce qu’on appelle réprouver.
Ainsi donc, de même que la prédestination est une partie de la pro-
vidence à l’égard de ceux qui sont divinement ordonnés au salut éternel, de
même la réprobation est une partie de la providence à l’égard de ceux qui
déchoient de cette fin. C'est pourquoi la réprobation ne signifie pas seule-
ment une prescience : elle y ajoute une autre idée (ratio), tout comme la pro-
vidence (...). De même en effet que la prédestination inclut la volonté
d’accorder la grâce et la gloire, de même la réprobation inclut la volonté de
permettre que quelqu'un tombe en faute, et d’infliger pour cela la peine de
damnation.
1. Dieu aime tous les hommes, et même toutes les créatures en ce qu’à
tous il veut du bien ; mais pour autant il ne veut pas tout bien à tous. Dans la
mesure donc où il ne veut pas pour certains ce bien qu’est la vie éternelle, il
est dit les avoir en haine, ou les réprouver.
2. Du point de vue causal, il en va autrement de la réprobation et de la
prédestination. Car la prédestination est cause à la fois de ce qui est attendu
dans la vie future, à savoir la gloire, et de ce qui est reçu dans la vie présente,
à savoir la grâce. La réprobation au contraire n’est pas cause de ce qui est
présentement, à savoir la faute, mais elle est la cause de l’abandon par
Dieu. Elle est cependant cause de ce qui est conféré dans la vie future, à sa-
voir la peine éternelle. Or la faute provient du libre arbitre de celui qui
est réprouvé et déserté par la grâce. C’est ce qui vérifie la parole du pro-
phète : Ta perdition, Israël, vient de toi.
3. La réprobation divine ne retire rien de la puissance du réprouvé.
C'est pourquoi, lorsque l’on dit que le réprouvé ne peut obtenir la grâce, il ne
faut pas l’entendre au sens d’une impossibilité absolue, mais au sens d’une
impossibilité conditionnelle, au même sens (...) où le prédestiné est néces-
sairement sauvé, d’une nécessité conditionnelle, qui ne supprime pas le
libre arbitre. C'est pourquoi, bien que personne ne puisse obtenir la grâce
s’il est réprouvé par Dieu, il dépend pourtant de son libre arbitre de tomber
dans tel ou tel péché. C’est donc aussi à juste titre (merito) qu’on le lui im-
pute comme une faute.
Article 4 : Les prédestinés sont-ils choisis par Dieu ? (...)
[Réponses aux objections]
1. Si l’on considère en général la communication de la bonté divine,
elle se fait sans choix, puisque rien n’existe qui ne participe en quelque
© Philopsis – Pascal Dupond 158
www.philopsis.fr
chose de sa bonté (...). Mais si l’on considère la communication de tel ou tel
bien, elle ne va pas sans choix : car il donne à certains tels biens qu’il ne
donne pas à d’autres. Et c’est en ce sens qu’on parle de choix dans
l’attribution de la grâce et de la gloire.
2. (...)
3. Dieu veut que tous les hommes soient sauvés d’une volonté an-
técédente, ce qui n’est pas vouloir absolu- ment parlant (simpliciter), mais
relativement (secundum quid). Mais il ne le veut pas d’une volonté consé-
quente, ce qui est vouloir absolument parlant.
Article 5 : La prescience des mérites est-elle la cause de la prédestina-
tion ?
Il semble que oui.
1. Selon l’Apôtre Paul (Romains, 8, 29), ceux qu’il a connus
d’avance, il les a prédestinés. Et au sujet de Romains, 9, 15 − J’aurai pitié de
qui j’aurai pitié, etc. −, la Glose ambrosienne dit : Je ferai miséricorde à celui
dont je sais d’avance qu’il reviendra à moi de tout son cœur.
2. La prédestination divine inclut la volonté divine, qui ne peut pas
être dépourvue de raison, puisque, comme dit Augustin, la prédestination
est le dessein de faire miséricorde. Mais il ne peut y avoir à la prédestination
aucune autre raison que la prescience des mérites. Celle-ci est donc la cause
ou la raison de la prédestination.
3. Selon Romains, 9, 14, il n’y a pas d’iniquité en Dieu. Or il paraît
inique de donner inégalement aux égaux. Mais tous les hommes sont égaux
eu égard à la fois à leur nature et au péché originel : il n’apparaît d’inégalité
entre eux que dans le caractère méritant ou déméritant de leurs actes propres.
C’est donc seulement à cause de la prescience des différences de mérite que
Dieu prépare des sorts inégaux pour les hommes, en les prédestinant ou en
les réprouvant.
En sens contraire, l’Apôtre dit à Tite (3, 5) : ce n’est pas pour les
œuvres de justice que nous avons faites, mais d’après sa miséricorde, qu’il
nous a sauvés. Or c’est de la même façon qu’il nous a sauvés qu’il nous a
prédestinés à être sauvés. Ce n’est donc pas la prescience des mérites qui est
la cause ou la raison de la prédestination.
Je réponds : puisque la prédestination inclut la volonté (...), il faut
chercher la raison de la prédestination de la même façon qu’on cherche la
raison de la volonté divine. Or (...) il n’est pas possible d’assigner une cause
à la volonté divine quant à l’acte de vouloir, mais on le peut quant à ce qui
est voulu, au sens où Dieu veut quelque chose à cause d’autre chose. C'est
pourquoi personne n’a été assez insensé pour dire que les mérites sont causes
de la prédestination quant à l’acte de celui qui prédestine. Mais cela entraîne
la question de savoir si la prédestination a une cause du côté de ses effets. Et
cela revient à demander si c’est à cause de quelque mérite que Dieu a préor-
donné qu’il accorderait à quelqu'un l’effet de la prédestination.
© Philopsis – Pascal Dupond 159
www.philopsis.fr
Il y en a qui ont dit que l’effet de la prédestination est préordonné en
fonction de mérites préexistant dans une autre vie. Ce fut la position
d’Origène, qui affirma que les âmes humaines furent d’abord créées, et
qu’en fonction de la diversité de leurs œuvres, divers états leur échurent
lorsqu'elles furent unies dans ce monde à des corps. − L’Apôtre toutefois ex-
clut cette opinion en disant (Romains, 9, 11-13) : Avant même qu’il fussent
nés, et n’aient rien fait de bien ni de mal, ce n’est pas d’après leurs œuvres,
mais de par celui qui appelle, qu’il a été dit que l’aîné serait assujetti au
plus jeune.
Il y en a d’autres qui ont dit que les mérites préexistant en cette vie
sont la raison et la cause de l’effet de la prédestination. Les Pélagiens ont en
effet affirmé que le commencement des bonnes actions vient de nous, mais
leur achèvement de Dieu. Et ainsi, le fait que l’effet de la prédestination soit
accordé à l’un mais pas à l’autre vient de ce que le premier a fourni le com-
mencement en se préparant, mais pas l’autre. − Mais l’Apôtre dit au con-
traire, en II Corinthiens, 3, 5, que nous ne sommes pas capables de penser
quelque chose par nous-mêmes comme si cela venait de nous. Or on ne peut
trouver aucun principe antérieur à la pensée. C'est pourquoi on ne peut pas
dire qu’il y ait en nous un commencement qui serait la raison de l’effet de la
prédestination.
C'est pourquoi il y en a eu d’autres qui ont dit que les mérites
s’ensuivant de cet effet sont la raison de la prédestination, en ce sens que
Dieu donne à quelqu'un la grâce, et sait d’avance qu’il la lui donnera, parce
qu'il sait d’avance qu’il en usera bien, tout comme un roi donne un cheval à
un soldat dont il sait qu’il en fera bon usage. − Ceux-là toutefois paraissent
avoir fait une distinction entre ce qui vient de la grâce et ce qui vient du libre
arbitre, comme si la même chose ne pouvait venir des deux. Or il est mani-
feste que ce qui relève de la grâce est l’effet de la prédestination ; et cela,
étant compris dans la prédestination, ne peut être posé comme sa raison. Si
donc quelque chose d’autre de notre part est la raison de la prédestination,
cela sera en dehors de l’effet de la prédestination. Mais il n’y a pas à distin-
guer ce qui vient du libre arbitre et ce qui vient de la prédestination, de
même que ce qui vient de la cause seconde n’est pas distinct de ce qui
vient de la cause première : car la providence divine produit ses effets par
les opérations des causes secondes (...). C'est pourquoi même ce qui vient du
libre arbitre vient de la prédestination.
Il faut donc dire que nous pouvons considérer de deux manières l’effet
de la prédestination. D’une part, en particulier. Rien alors n’empêche qu’un
effet de la prédestination soit cause et raison d’un autre : l’ultérieur de
l’antérieur selon l’ordre de la cause finale, l’antérieur de l’ultérieur selon
l’ordre de la cause méritoire, qui se ramène à une disposition de la matière.
Ainsi disons-nous que Dieu a préordonné qu’il donnerait à quelqu'un la
gloire d’après ses mérites, et qu’il a préordonné de donner à quelqu'un la
grâce afin qu’il mérite la gloire. − On peut d’autre part considérer l’effet de
la prédestination en général. Il est alors impossible que l’effet total de la pré-
destination en général ait une cause en nous. Car tout ce qui en l’homme
l’ordonne au salut est tout entier compris dans l’effet de la prédestina-
tion, même la préparation à la grâce : c’est que cela ne peut se faire sans
le secours divin, comme le dit la dernière des Lamentations (v.21) : Fais-
nous revenir à toi, Seigneur, et nous reviendrons. La prédestination a pour-
© Philopsis – Pascal Dupond 160
www.philopsis.fr
tant de ce point de vue, quant à son effet, une raison qui est la bonté divine, à
laquelle tout l’effet de la prédestination est ordonné comme à sa fin, et d’où
il procède comme de son premier principe moteur.
1. L’usage de la grâce, connu d’avance, n’est pas la raison du don de
la grâce, sinon du point de vue de la cause finale (...).
2. Quant à son effet, la prédestination a pour raison, en général, la
bonté divine elle-même. Mais en particulier, tel effet est la raison de tel autre
(...).
3. On peut trouver dans la bonté divine elle-même une raison de la
prédestination des uns et de la réprobation des autres. Dieu est dit en effet
avoir tout fait à cause de sa bonté, de telle sorte que sa bonté soit manifestée
dans les choses. Or il est nécessaire que la bonté divine, qui est en elle-même
une et simple, soit manifestée dans les choses de multiples manières, ce pour
quoi les choses créées ne peuvent atteindre la simplicité divine. Et de là vient
que sont requises pour l’achèvement de l’univers des choses de divers de-
grés, dont les unes ont dans l’univers un rang élevé, et les autres un rang in-
fime. Et pour sauvegarder la diversité des degrés de réalité, Dieu permet
qu’il arrive certains maux, afin que beaucoup de biens ne soient pas empê-
chés (...).
Considérons donc l’ensemble du genre humain comme l’univers en-
tier. Dieu a voulu, en ce qui concerne les hommes, que chez certains, qu’il
prédestine, sa bonté soit manifestée par manière de miséricorde, en les épar-
gnant ; et chez d’autres, qu’il réprouve, par manière de justice, en les punis-
sant. Et telle est la raison pour laquelle Dieu en élit certains, et en réprouve
d’autres. C’est cette cause que mentionne l’Apôtre (Romains, 9, 22-23) :
voulant manifester sa colère (c'est-à-dire sa juste vindicte) et rendre évidente
sa puissance, Dieu a supporté (c'est-à-dire permis) avec beaucoup de pa-
tience des vases de colère faits pour la destruction, afin de manifester les ri-
chesses de sa gloire dans des vases de miséricorde, qu’il a préparés pour la
gloire. Et en dans la deuxième épître à Timothée (2, 20), il dit : dans une
grande maison, il n’y a pas seulement des vases d’or et d’argent, mais aussi
des vases de bois et de terre, les uns pour un usage noble, les autres pour un
usage vil.
Mais le fait qu’il ait élu les uns pour la gloire et réprouvé les
autres n’a pas d’autre raison que la divine volonté. C'est pourquoi Augus-
tin dit, dans son commentaire de Jean : qu’il tire celui-ci et ne tire pas celui-
là, garde-toi d’en juger, si tu ne veux errer. Ainsi, dans les choses naturelles,
on peut assigner une raison pour laquelle, alors que toute la matière première
est en soi uniforme, une partie en existe sous la forme du feu, une autre sous
celle de la terre, fondée par Dieu au commencement : c’est pour qu’il y ait
une diversité d’espèces naturelles. Mais que telle partie de la matière soit
sous telle forme, telle autre sous une autre, dépend de la seule volonté di-
vine. De même, c’est de la seule volonté de l’artisan que dépend le fait que
telle pierre soit dans telle partie du mur, et telle autre dans une autre, bien
qu’il y ait pour l’art une raison à ce que certaines soit ici et d’autres là.
Et il n’y a pour autant aucune injustice en Dieu, s’il dispose inégale-
ment d’êtres qui ne sont pas inégaux. Cela irait contre la notion de justice si
l’effet de la prédestination répondait à un dû, et n’était pas accordé par grâce.
Car dans les choses qui sont accordées par grâce, on peut donner à son gré à
© Philopsis – Pascal Dupond 161
www.philopsis.fr
qui l’on veut, plus ou moins, pourvu que personne ne se voie retirer son dû,
sans préjudice de la justice. Et c’est ce que dit le chef de famille, en Mat-
thieu, 20, 14-15 : Prends ce qui est à toi, et va. N’ai-je pas le droit de faire
ce que je veux ?
© Philopsis – Pascal Dupond 162
www.philopsis.fr
Annexe 3 : Luther
Commentaire de l’Épître aux Romains (1515-1516).
« (...) Qu’est-ce donc en somme que le péché originel ? En premier
lieu, selon les subtilités des théologiens scolastiques, c’est la privation ou
l’absence de la justice originelle. La justice, en effet, selon eux, ne se trouve
que dans la volonté, comme en son sujet. Donc également la privation de la
justice qui est son contraire. (...) En second lieu, selon l’apôtre [Paul] et la
simplicité du sens dans le Christ Jésus, ce n’est pas seulement la privation
d’une qualité dans la volonté, pas même seulement la privation de lumière
dans l’intelligence, de force dans la mémoire, mais en définitive la privation
de toute sorte de rectitude et puissance de toutes nos forces tant du corps que
de l’âme et de tout l’homme intérieur et extérieur. En outre, c’est le penchant
même au mal, le dégoût du bien, l’ennui de la lumière, la fuite et
l’abomination des bonnes œuvres, la course vers le mal. (...) »
Articles de Smalkade (1537-1538).
« (...) Ce péché originel est une corruption si pernicieuse et si pro-
fonde de la nature humaine, qu’aucune raison ne peut le comprendre ; mais il
faut le croire, en se fondant sur la révélation de l'Écriture, Psaume 51, Ro-
mains 5, Exode 33, Genèse 3.
C'est pourquoi ce que les théologiens de l’École ont enseigné contrai-
rement à cet article n’est qu’erreur et aveuglement :
À savoir, qu’après la chute d’Adam les forces naturelles de l’homme
sont restées entières et intactes et que l’homme a, par nature, une raison
droite et une volonté bonne, comme l’enseignent les philosophes.
De même : que l’homme possède un libre arbitre pour faire le bien et
s’abstenir du mal et, inversement, pour s’abstenir du bien et faire le mal.
(...) »
Du serf arbitre (1525).
« (...) La volonté humaine, placée entre Dieu et Satan, est semblable à
une bête de somme. Quand c’est Dieu qui la monte, elle va où Dieu veut
qu’elle aille. (...) Lorsque Satan la monte, elle va où Satan veut qu’elle aille.
Et elle n’est pas libre de choisir l’un ou l’autre de ces deux cavaliers. Mais
ceux-ci se combattent pour s’emparer d’elle et la posséder. (...)
Il est avant tout nécessaire et salutaire pour le chrétien de savoir que la
prescience de Dieu n’est pas contingente, mais qu’il prévoit, décide et fait
tout en vertu de sa volonté immuable, éternelle et infaillible. Ce coup de
foudre abat et réduit en poudre le libre arbitre ; c'est pourquoi ceux qui af-
firment le libre arbitre doivent nier ce coup de foudre, ou le dissimuler, ou
l’écarter d’une manière quelconque. Il suit de là irréfutablement que tout ce
que nous faisons, que tout ce qui arrive, alors même que cela nous paraît
muable et fortuit, en réalité arrive nécessairement et immuablement, quand
on fixe son regard sur la volonté de Dieu. (...)
Dieu cache sa bonté et sa miséricorde sous sa colère éternelle, sa jus-
tice, sous l’iniquité. C’est ici le plus haut degré de la foi, de croire qu’il est
clément, celui qui sauve si peu d’hommes et en damne un si grand nombre ;
de croire qu’il est juste, celui dont la volonté nous rend nécessairement dam-
© Philopsis – Pascal Dupond 163
www.philopsis.fr
nables, en sorte que, selon les propres paroles d’Érasme, il semblerait pren-
dre plaisir aux tourments des malheureux et serait plus digne de haine que
d’amour. Si je pouvais comprendre par la raison comment un Dieu qui mani-
feste tant de colère et d’injustice peut être juste et bon, qu’aurais-je besoin de
la foi ? Mais comme ceci ne peut être compris, c’est ici que ma foi a
l’occasion de s’exercer lorsque ces choses sont prêchées. (...) »
Prédications et enseignements divers.
« La raison est contraire à la foi. C’est uniquement à Dieu qu’il appar-
tient de nous donner la foi contre la nature et contre la raison ».
« La vérité varie selon les sciences. En théologie, c’est une vérité que
le verbe s’est fait chair ; en philosophie, c’est une proposition simplement
impossible et absurde. La Sorbonne, la mère des erreurs, a lamentablement
défini qu’une vérité est vérité à la fois pour la philosophie et pour la théolo-
gie ».
« La raison est la plus grande des prostituées du diable. Par sa nature
et ses procédés, elle est une prostituée nuisible, une prostituée mangée par la
gale et la lèpre. (...) Il faut lui jeter de l’ordure à la face afin de la rendre plus
laide encore ».
© Philopsis – Pascal Dupond 164
www.philopsis.fr
Annexe 4 : Calvin, L’Institution chrétienne (1559).
Livre I : Dieu en titre et qualité de Créateur et souverain gouverneur
du monde.
Chapitre VII. − Sur quoi se fonde l’autorité de l'Écriture.
(...) Quand à ce que ces canailles [= les catholiques et les libertins]
demandent d’où et comment nous serons persuadés que l'Écriture est procé-
dée de Dieu, si nous n’avons refuge au décret de l'Église : c’est autant
comme si aucun s’enquérait d’où nous apprendrons à discerner la clarté des
ténèbres, le blanc du noir, le doux de l’amer. (...)
L'Écriture a de quoi se faire connaître, voire d’un sentiment aussi no-
toire et infaillible comme ont les choses blanches et noires de montrer leur
couleur, et les choses douces et amères, leur saveur. (...)
Le témoignage du Saint-Esprit est plus excellent que toute raison.
Que ce point soit résolu, qu’il n’y a que celui que le Saint-Esprit aura
enseigné, qui se repose en l'Écriture en droite fermeté. (...) C’est une telle
persuasion, laquelle ne requiert point de raisons, toutefois une telle connais-
sance, laquelle est appuyée sur une très bonne raison, c’est à savoir, d’autant
que notre esprit y a plus certain et assuré repos qu’en aucunes raisons. Fina-
lement, c’est un tel sentiment qu’il ne se peut engendrer que de révélation
céleste. (...)
Chapitre VIII. − Preuves qui rendent l'Écriture indubitable.
(...) Ceux qui veulent prouver par arguments aux incrédules que l'Écri-
ture est de Dieu, sont inconsidérés. (...) [Cela] ne se connaît que par foi. (...)
Chapitre XVI. − Dieu gouverneur du monde.
(...) Les événements quels qu’ils soient sont gouvernés par le Conseil
secret de Dieu. (...)
Quand on parle de la Providence de Dieu, ce mot ne signifie pas
qu’étant oisif au ciel, il spécule ce qui se fait en terre, mais plutôt qu’il est
comme un patron de navire qui tient le gouvernail, pour adresser tous évé-
nements. (...) Rien du tout ne se fait sans Dieu et sa prédestination. (...) Ceux
qui veulent rendre cette doctrine odieuse calomnient que c’est la fantaisie
des Stoïques que toute choses adviennent par nécessité. (...) Mais nous cons-
tituons Dieu maître et modérateur de toutes choses, lequel nous disons, dès
le commencement, avoir selon sa sagesse, déterminé ce qu’il devait faire et
maintenant exécute par sa puissance tout ce qu’il a délibéré. D’où nous con-
cluons que non seulement le ciel et la terre et toutes les créatures insensibles
sont gouvernées par sa Providence, mais aussi les conseils et les vouloirs de
hommes, tellement qu’il les adresse au but qu’il a proposé. (...)
Chapitre XVIII. − Suite du même sujet.
© Philopsis – Pascal Dupond 165
www.philopsis.fr
(...) Si à cause de la tardiveté de notre sens, la sagesse de Dieu nous
apparaît variable et de plusieurs figures, faut-il pourtant qu’il y ait de la va-
riété en Dieu ? (...) Mais plutôt quand nous ne comprenons point comment
Dieu veut que ce qu’il défend de faire se fasse, que notre débilité et petitesse
nous vienne en mémoire, et aussi que la clarté en laquelle il habite n’est pas
en vain nommée inaccessible, pour ce qu’elle est enveloppée d’obscurité.
Ces gaudisseurs qui jargonnent contre Dieu allèguent que si Dieu met
non seulement les méchants en besogne pour s’en servir, mais qu’il gou-
verne leurs conseils et affections, il est acteur de tous maléfices et par consé-
quent que les hommes sont injustement damnés (...) puisqu'ils complaisent
en son vouloir. (...)
Ils mettent perversement le commandement de Dieu avec son vouloir
secret. (...) Ce point nous doit être liquide : quand Dieu accomplit par les
méchants ce qu’il a décrété en son conseil secret, il ne sont pas pourtant ex-
cusables, comme s’il avaient obéi à son commandement, lequel ils violent et
renversent tant qu’en eux est, et par leur méchante cupidité. (...)
Livre II : De la connaissance de Dieu en tant qu’il s’est montré Ré-
dempteur en Jésus-Christ.
Chapitre I. − Comment par la chute et révolte d’Adam, tout le genre
humain a été asservi à malédiction et est déchu de son origine.
(...) L’infidélité a été la racine de la révolte. De là est procédée
l’ambition et l’orgueil, auxquels deux vices l’ingratitude a été conjointe.
Or, comme la vie spirituelle d’Adam était d’être et demeurer conjoint
avec son Créateur, aussi la mort de son âme a été d’en être séparé. Et ne se
faut pas ébahir s’il a ruiné tout son lignage, par sa révolte, ayant perverti tout
ordre de nature au ciel et en la terre.
Adam donc s’est tellement corrompu et infecté que la contagion est
descendue de lui sur tout son lignage.
Le Seigneur avait mis en Adam les grâces et dons qu’il voulait confé-
rer à la nature humaine, pourtant qu’icelui, quand il les a perdus, ne les a
point perdus seulement pour soi, mais pour nous tous. (...) La souillure n’a
point eu cause et fondement en la substance de la chair ou de l’âme, mais en
ce que Dieu avait ordonné que les dons qu’il avait commis en dépôt au pre-
mier homme fussent communs et à lui et aux siens, pour les garder ou pour
les perdre. (...)
Le péché originel est une corruption et perversité héréditaire de notre
nature, laquelle épandue sur toutes les parties de l'âme nous fait coupables
premièrement de l’ire de Dieu, puis après produit en nous les œuvres que
l'Écriture appelle œuvres de la chair. (...)
L’homme n’est autre chose de soi-même que concupiscence. (...)
Chapitre II. − Que l’homme est maintenant dépouillé de franc-arbitre
et misérablement asservi à tout mal.
© Philopsis – Pascal Dupond 166
www.philopsis.fr
(...) La sentence des philosophes, c’est que la raison, qui en
l’entendement humain, suffit à nous bien conduire, et montrer ce qui est bon
de faire ; que la volonté étant sous icelle, est tentée et sollicitée par le sens à
mal faire, néanmoins, en tant qu’elle a libre élection, qu’elle ne peut être
empêchée de suivre la raison entièrement.
La plupart des Pères a plus suivi la philosophie qu’il n’était métier.
(...) Ils craignaient, s’ils ôtaient à l’homme toute liberté de bien faire, que les
philosophes se moquassent de leur doctrine ; que la chair, laquelle est assez
prompte à nonchalance, ne prît occasion de paresse n’appliquer son étude à
bien. (...) [S. Augustin seul a dit] que les dons naturels ont été corrompus en
l’homme, et les surnaturels lui ont été du tout ôtés. (...) Quant à moi, (...) si je
voulais clairement enseigner quelle est la corruption de la nature, je me con-
tenterais de ces mots. (...)
C’est une chose résolue que l’homme n’a point libéral arbitre à bien
faire, sinon qu’il soit aidé de la grâce de Dieu et de grâce spéciale qui est
donnée aux élus seulement, par régénération, car je laisse là ces frénétiques
qui babillent qu’elle est indifféremment exposée à tous. (...)
Celui a très bien profité en la connaissance de soi-même, lequel par
l’intelligence de sa calamité, pauvreté, nudité et ignominie, est abattu et
étonné. Car il n’y a nul danger que l’homme s’abaisse trop fort, moyennant
qu’il entende qu’il lui faut recouvrer en Dieu ce qui lui défaut en soi-même.
Au contraire, il ne se peut attribuer un seul grain de bien outre mesure, qu’il
ne se ruine de vaine confiance, qu’il ne soit coupable de sacrilège, en ce
qu’il usurpe la gloire de Dieu. (...) L’homme quittant le royaume des cieux et
Dieu a été privé des dons spirituels dont il était garni et remparé pour son sa-
lut. De là il s’ensuit qu’il est tellement banni du royaume de Dieu que toutes
choses concernant la vie bienheureuse de l’âme sont aussi éteintes en lui (...)
à savoir, la foi, l’amour de Dieu, charité envers le prochain, affection de
vivre saintement et justement. (...) Pareillement aussi l’intégrité de
l’entendement et la droiture du cœur nous ont été ôtées, voilà quelle est la
corruption de dons naturels. (...)
Ces petites gouttes de vérité que nous voyons éparses aux livres des
philosophes, par combien de mensonges sont-elles obscurcies ! (...) Mais
leur ignorance est qu’ils n’ont jamais le moins du monde goûté aucune certi-
tude de la bonne volonté de Dieu, sans laquelle l’entendement humain est
rempli de merveilleuse confusion. (...)
Chapitre III. − Que la nature de l’homme corrompu ne produit rien qui
ne mérite condamnation.
(...) La volonté (...), selon qu’elle est liée et tenue captive en servitude
de péché, ne se peut aucunement remuer à Dieu, tant s’en faut qu’elle s’y
applique. (...) L’homme, après avoir été corrompu par sa chute, pèche volon-
tairement et non pas malgré son cœur, ni par contrainte ; il pèche, dis-je, par
une affection très entière et non pas étant contraint de violence (...) et néan-
moins sa nature est si perverse qu’il ne peut être ému, poussé ou mené sinon
au mal. Si cela est vrai, il est notoire qu’il est sujet à nécessité de pécher. (...)
[Dieu] émeut notre volonté, non pas comme on a longtemps imaginé
et enseigné, tellement qu’il soit, après, en notre élection d’obtempérer à son
© Philopsis – Pascal Dupond 167
www.philopsis.fr
mouvement ou résister ; mais il la meut avec telle efficace qu’il faut qu’elle
suive. (...)
Chapitre V. − Réfutation des objections en faveur du franc-arbitre.
(...) L’entendement de l’homme est tellement du tout aliéné de la jus-
tice de Dieu, qu’il ne peut rien imaginer, concevoir ni comprendre, sinon
toute méchanceté, iniquité et corruption. Semblablement que son cœur est
tellement envenimé de péché qu’il ne peut produire que toute perversité. Et
s’il advient qu’il en sorte quelque chose qui ait apparence de bien, néan-
moins que l’entendement demeure toujours enveloppé en hypocrisie et vani-
té et le cœur adonné à toute malice. (...)
Livre III : De la manière de participer à la grâce de Jésus-Christ, des
fruits qui nous en reviennent et des effets qui s’ensuivent.
Chapitre II. − De la foi.
(...) Il n’y a que les élus auxquels ils fasse ce bien d’enraciner la foi
vive en leur cœur, pour les y faire persévérer jusques à la fin. (...) Les ré-
prouvés ne parviennent jamais jusques à cette révélation secrète de leur sa-
lut, laquelle l'Écriture n’attribue sinon aux fidèles. (...) Nous avons une en-
tière définition de la foi si nous déterminons qu’elle est une ferme et certaine
connaissance de la bonne volonté de Dieu envers nous, laquelle étant fondée
sur la Promesse gratuite donnée en Jésus-christ, est révélée à notre entende-
ment et scellée en notre cœur par le Saint-Esprit. (...)
Chapitre III. − [Régénération par la foi].
(...) Cela s’accorde bien que nous ne soyons pas sans bonnes œuvres
et que nous soyons réputés justes, sans bonnes œuvres. (...)
Chapitre XI. − De la justification par la foi.
(...) C’est le principal article de la religion chrétienne. (...) Celui est dit
être justifié devant Dieu qui est réputé juste devant le jugement de Dieu et
est agréable pour sa justice. (...) Celui sera dit justifié par foi, lequel étant
exclu de la justice des œuvres, appréhende par foi la justice de Jésus-Christ,
de laquelle étant vêtu, il apparaît devant la justice de Dieu, non pas comme
pécheur, mais comme juste. (...) Ainsi nous disons en somme que notre jus-
tice devant Dieu est une acceptation, par laquelle nous recevant en sa grâce,
il nous tient pour justes. Et disons qu’icelle consiste en la rémission des pé-
chés et en ce que la justice de Jésus-Christ nous est imputée. (...)
Chapitre XXI. − De l’Élection éternelle, par laquelle Dieu en a prédes-
tiné les uns à salut, les autres à condamnation.
© Philopsis – Pascal Dupond 168
www.philopsis.fr
(...) Nous appelons Prédestination : le conseil éternel de Dieu par le-
quel il a déterminé ce qu’il voulait faire d’un chacun homme. Car il ne les
crée pas tous en pareille condition, mais ordonne les uns à la vie éternelle,
les autres à éternelle damnation.
Nous disons donc, comme l'Écriture le montre évidemment, que Dieu
a une fois décrété, par son conseil éternel et immuable, lesquels il voulait
prendre à salut, et lesquels il voulait dévouer à perdition. Nous disons que ce
conseil, quant aux élus, est fondé en sa miséricorde, sans aucun regard de di-
gnité humaine. Au contraire que l’entrée de vie est forclose à tous ceux qu’il
veut livrer à damnation, et que cela se fait par son jugement occulte et in-
compréhensible, combien qu’il soit juste et équitable. Davantage, nous en-
seignons que la vocation des élus est comme une montre et témoignage de
leur élection. Pareillement, que leur justification en est une autre marque et
enseigne, jusques à ce qu’ils viennent en la gloire, en laquelle gît
l’accomplissement d’icelle. or, comme le Seigneur marque ceux qu’il a élus,
en les appelant et justifiant, ainsi au contraire, en privant les réprouvés de la
connaissance de sa Parole, ou de la sanctification de son Esprit, il démontre
par tel signe quelle sera leur fin et que jugement leur est préparé. (...)
Chapitre XXIII. − [Réfutation des calomnies contre sa doctrine].
(...) Dieu n’est point comptable envers nous, pour rendre raison de ce
qu’il fait. (...)
On ne peut nier que Dieu n’ait prévu devant que créer l’homme, à
quelle fin il devait venir, et ne l’ait pas prévu, pour ce qu’il l’avait ainsi or-
donné en son conseil. (...) Dieu non seulement a prévu la chute du premier
homme et en icelle la ruine de toute sa postérité, mais il l’a ainsi voulu. (...)
© Philopsis – Pascal Dupond 169
www.philopsis.fr
Annexe 5 : Confession d’Augsbourg
PREMIÈRE PARTIE
ARTICLES FONDAMENTAUX DE LA FOI ET DE LA DOC-
TRINE
Article 1. - DE DIEU
Nos églises enseignent en parfaite unanimité la doctrine proclamée par
le Concile de Nicée : à savoir qu'il y a un seul Être divin, qui est appelé et
qui est réellement Dieu. Pourtant, il y a en lui trois Personnes, également
puissantes et éternelles : Dieu le Père, Dieu le Fils, Dieu le Saint-Esprit ;
tous les trois un seul Être divin, éternel, indivisible, infini, tout-puissant, in-
finiment sage et bon, créateur et conservateur de toutes choses visibles et in-
visibles. Par le terme de Personne, nous ne désignons pas une partie ni une
qualité inhérente à un être, mais ce qui subsiste par lui-même. C'est ainsi que
les Pères de l'Eglise ont entendu ce terme.
Nous rejetons donc toutes les hérésies contraires à cet article : nous
condamnons les Manichéens qui ont statué deux dieux, un bon et un mau-
vais, les Valentiniens, les Ariens, les Eunomiens, les Mahométans et autres.
Nous condamnons aussi les Samosaténiens, anciens et modernes, qui n'ad-
mettent qu'une seule Personne, et qui, en usant de sophismes impies et sub-
tils, prétendent que le Verbe et le Saint-Esprit ne sont pas des personnes dis-
tinctes, mais que le « Verbe » signifie une parole ou une voix, et que le «
Saint-Esprit » ne serait autre chose qu'un mouvement produit dans les créa-
tures.
Article 2. - DU PÉCHÉ ORIGINEL
Nous enseignons que par suite de la chute d'Adam, tous les hommes
nés de manière naturelle sont conçus et nés dans le péché ; ce qui veut dire
que, dès le sein de leur mère, ils sont pleins de convoitises mauvaises et de
penchants pervers. Il ne peut y avoir en eux, par nature, ni crainte de Dieu ni
confiance en lui. Ce péché héréditaire et cette corruption innée et conta-
gieuse est un péché réel, qui assujettit à la damnation et à la colère éternelle
de Dieu tous ceux qui ne sont pas régénérés par le Baptême et par le Saint-
Esprit.
Par conséquent, nous rejetons les Pélagiens et autres qui, au mépris de
la passion et du mérite de Christ, rendent bonne la nature humaine par ses
forces naturelles, en soutenant que le péché originel n'est pas un péché.
Article 3. - DU FILS DE DIEU
Nous enseignons aussi que Dieu le Fils est devenu homme, né de la
pure Vierge Marie, et que les deux natures, la divine et l'humaine, unies in-
séparablement dans une personne unique, constituent un seul Christ, qui est
vrai Dieu et vrai homme. Il est véritablement né, il a réellement souffert, il a
été crucifié, il est mort, il a été enseveli, afin qu'il s'offrît en sacrifice, non
seulement pour le péché originel, mais aussi pour tous les autres péchés, afin
d'apaiser la juste colère de Dieu.
Le même Christ est descendu aux enfers ; il est réellement ressuscité
© Philopsis – Pascal Dupond 170
www.philopsis.fr
le troisième jour, monté au ciel, assis à la droite de Dieu, afin qu'il étende
son règne et sa domination éternels sur toutes les créatures, qu'il sanctifie,
purifie, affermisse et console par le Saint-Esprit tous ceux qui croient en lui,
et afin qu'il leur donne en partage la vie et toutes sortes de dons, et qu'il les
protège contre le diable et le péché.
Ce même Seigneur Jésus-Christ reviendra enfin visiblement, pour ju-
ger les vivants et les morts, etc., - selon le Symbole des Apôtres.
Article 4 - DE LA JUSTIFICATION
Nous enseignons aussi que nous ne pouvons pas obtenir la rémission
des péchés et la Justice devant Dieu par notre propre mérite, par nos œuvres
ou par nos satisfactions, mais que nous obtenons la rémission des péchés et
que nous sommes justifiés devant Dieu par pure grâce, à cause de Jésus-
Christ et par la foi, - lorsque nous croyons que Christ a souffert pour nous, et
que, grâce à lui, le pardon des péchés, la Justice et la vie éternelle nous sont
accordés. Car Dieu veut que cette foi nous tienne lieu de justice devant lui, il
veut nous l'imputer à justice, comme l'explique saint Paul aux chapitres 3 et
4 de l'Epître aux Romains.
Article 5. - DU MINISTÈRE DE LA PAROLE
Pour qu'on obtienne cette foi, Dieu a institué le Ministère de la Parole
et nous a donné l'Evangile et les Sacrements. Par ces moyens il nous donne
le Saint-Esprit, qui produit la foi, où et quand il le veut, dans ceux qui enten-
dent l'Evangile. Cet Evangile enseigne que nous avons, par la foi, un Dieu
plein de grâce, et cela non point à cause de nos mérites, mais pour le mérite
de Christ.
Nous condamnons donc les Anabaptistes et autres sectes semblables,
qui enseignent que nous pouvons obtenir le Saint-Esprit sans l'instrumentali-
té de la Parole extérieure de l'Evangile, mais par nos propres efforts, par nos
méditations et par nos œuvres.
Article 6. - DE LA NOUVELLE OBÉISSANCE
Nous enseignons aussi que cette foi doit produire des fruits et des
bonnes œuvres, et qu'il faut que l'on fasse, pour l'amour de Dieu, toutes
sortes de bonnes œuvres que Dieu lui-même a commandées. Mais il faut se
garder de mettre sa confiance dans ces œuvres et de vouloir mériter par elles
la grâce de Dieu. Car c'est par la foi en Christ que nous obtenons la rémis-
sion des péchés et la justice, comme le dit Jésus-Christ lui-même, Luc 17, 10
: « Quand vous aurez fait toutes les choses qui vous sont commandées, dites
: nous sommes des serviteurs inutiles ». Voilà ce qu'enseignent aussi les
Pères. Saint Ambroise déclare : « II est ordonné de Dieu que celui qui croit
en Christ sera sauvé, non point par les œuvres, mais par la foi seule, recevant
ainsi la rémission des péchés gratuitement et sans mérite ».
Article 7. - DE L'ÉGLISE
Nous enseignons aussi qu'il n'y a qu'une Sainte Eglise chrétienne et
qu'elle subsistera éternellement. Elle est l'Assemblée de tous les croyants
parmi lesquels l'Evangile est enseigné en pureté et où les Saints Sacrements
sont administrés conformément à l'Evangile.
Car pour qu'il y ait unité véritable de l'Eglise chrétienne, il suffit que
© Philopsis – Pascal Dupond 171
www.philopsis.fr
tous soient d'accord dans l'enseignement de la doctrine correcte de l'Evangile
et dans l'administration des sacrements en conformité avec la Parole divine.
Mais pour l'unité véritable de l'Eglise chrétienne il n'est pas indispensable
qu'on observe partout les mêmes rites et cérémonies qui sont d'institution
humaine. C'est ce que déclare saint Paul, Eph. 4, 5-6 : « Un seul corps et un
seul esprit, comme aussi vous aves été appelés à une seule espérance par
votre vocation ; un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême ».
Article 8. - CE QU'EST L'ÉGLISE DANS LE MONDE
L'Eglise chrétienne, à proprement parler, n'est pas autre chose que
l'Assemblée de tous les saints et croyants. Cependant, dans ce monde, beau-
coup de faux chrétiens et d'hypocrites, et même des pécheurs manifestes sont
mêlés aux fidèles ; néanmoins les sacrements sont efficaces, même s'ils sont
administrés par des prêtres impies, - comme Christ lui-même a dit, Matth.
23, 2 : « Les Scribes et les Pharisiens sont assis dans la chaire de Moïse,
etc... ».
Nous condamnons donc les Donatistes, et tous ceux qui enseignent
autrement.
Article 9. - DU BAPTÊME
Nous enseignons que le baptême est nécessaire au salut, et que par le
Baptême la grâce divine nous est offerte. Nous enseignons aussi qu'on doit
baptiser les enfants, et que, par ce Baptême, ils sont offerts à Dieu et lui de-
viennent agréables.
C'est pourquoi nous condamnons les Anabaptistes, qui rejettent le
Baptême des enfants.
Article 10. - DE LA SAINTE CÈNE
Quant à la Sainte Cène du Seigneur, nous enseignons que le vrai
corps et le vrai sang de Christ sont réellement présents, distribués et reçus
dans la Cène, sous les espèces du pain et du vin. Nous rejetons donc la doc-
trine contraire.
Article 11. - DE LA CONFESSION
Au sujet de la Confession, nous enseignons qu'on doit maintenir l'Ab-
solution privée dans l'Eglise et ne pas la et les autres lois en vigueur, punir
les maiiancuis laisser tomber en désuétude. Toutefois, dans la Confession,
l'énumération de tous les délits n'est pas nécessaire, puisque, en réalité, elle
est impossible, comme le déclare le Psaume 19, 13 : « Qui connaît ses éga-
rements ? ».
Article 12. - DE LA REPENTANCE
En ce qui concerne la Repentance, nous enseignons que ceux qui ont
péché après le Baptême peuvent obtenir la rémission des péchés toutes les
fois qu'ils s'en repentent, et que l'Eglise ne doit pas leur refuser l'Absolution.
La vraie repentance comprend, en premier lieu, la contrition, c'est-à-dire la
douleur et la terreur qu'on ressent à cause du péché ; en second lieu, la foi en
l'Evangile et en l'Absolution, c'est-à-dire la certitude que les péchés nous
sont remis et que la grâce nous est méritée par Jésus-Christ. C'est cette foi
qui console les cœurs et qui rend la paix aux consciences. Après cela, on doit
© Philopsis – Pascal Dupond 172
www.philopsis.fr
amender sa vie et renoncer au péché. Car tels doivent être les fruits de la Re-
pentance, comme le dit Jean-Baptiste, Matth. 3, 8 : « Faites les fruits dignes
de la 'repentance ».
Nous rejetons donc ceux qui enseignent qu'une fois converti, on ne
peut plus retomber dans le péché. D'autre part, nous condamnons aussi les
Novatiens, qui refusaient l'absolution à ceux qui avaient péché après le Bap-
tême.
Enfin, nous rejetons ceux qui enseignent qu'on obtient la rémission
des péchés, non par la foi, mais par nos satisfactions.
Article 13. - DE L'EMPLOI DES SACREMENTS
En ce qui concerne l'emploi des Sacrements, nous enseignons que les
Sacrements n'ont pas été institués seulement pour être des signes visibles
auxquels on reconnaît les chrétiens, mais aussi des signes et des témoignages
de la bonne volonté d.e Dieu envers nous, institués pour réveiller et affermir
notre foi. C'est pourquoi ils exigent la foi, et ne sont employés correctement
que si on les reçoit avec foi et si on s'en sert pour consolider la foi.
Article 14. - DU GOUVERNEMENT DE L'ÉGLISE
Quant au gouvernement de l'Eglise, nous enseignons que nul ne doit
enseigner ou prêcher publiquement dans l'Eglise, ni administrer les Sacre-
ments, à moins qu'il n'ait reçu une vocation régulière.
Article 15. - DES RITES ECCLÉSIASTIQUES
Quant aux rites ecclésiastiques établis par des hommes, nous ensei-
gnons qu'on doit observer ceux qu'on peut observer sans péché et qui contri-
buent à la paix et au bon ordre dans l'Eglise, comme par exemple certaines
fêtes et autres solennités. Cependant nous précisons toujours qu'on ne doit
pas en charger les consciences, comme si ces sortes de cultes étaient néces-
saires au salut. Bien plus, nous enseignons que toutes les ordonnances et
toutes les traditions instituées par les hommes pour réconcilier Dieu et méri-
ter sa grâce, sont contraires à l'Evangile et à la doctrine du salut par la foi en
Christ. Voilà pourquoi nous tenons pour inutiles et contraires à l'Evangile les
vœux monastiques et autres traditions qui établissent des différences entre
les aliments les jours, etc., par lesquelles on croit mériter la grâce et offrir sa-
tisfaction pour les péchés.
Article 16. - DU GOUVERNEMENT CIVIL
En ce qui concerne l'Etat et le gouvernement temporel, nous ensei-
gnons que toutes les autorités dans le monde, les gouvernements et les lois
civiles qui maintiennent l'ordre public, sont des institutions excellentes
créées et établies par Dieu. Un chrétien est libre d'exercer les fonctions de
magistrat, de souverain, de juge. Il peut sans prononcer des jugements selon
les lois impériales et les autres lois en vigueur, punir les malfaiteurs au
moyen de l'épée, entreprendre une guerre juste, être soldat, acheter et vendre,
prêter serment sur injonction, posséder des biens, contracter mariage, etc.
Nous condamnons les Anabaptistes, qui prétendent que toutes ces choses
sont contraires à la profession chrétienne. Nous condamnons aussi ceux qui
enseignent que « perfection chrétienne » consiste à quitter sa maison femme
et enfants, et à renoncer à toutes les choses mentionnées ci-dessus. Alors que
© Philopsis – Pascal Dupond 173
www.philopsis.fr
la véritable perfection consiste à craindre Dieu et à se confier entièrement en
lui. Car l'Evangile n'enseigne pas une conduite ou une justice temporelle et
extérieure, mais il insiste sur la vie intérieure, sur la justice du cœur qui est
éternelle. Il ne renverse pas le gouvernement civil, ni l'Etat, ni le mariage,
mais il veut qu'on observe toutes ces choses, comme de véritables institu-
tions divines ; et il prescrit que l'on mette en pratique la charité chrétienne
dans ces états, et que chacun fasse des bonnes œuvres selon sa vocation. Il
est donc évident que les chrétiens sont redevables d'obéir aux autorités et aux
lois, sauf dans le cas où ils ne peuvent s'y conformer sans pécher. Dans ce
cas on doit obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes, Actes 5, 29
Article 17. - DU RETOUR DU CHRIST POUR LE JUGEMENT
Nous enseignons que notre Seigneur Jésus-Christ apparaîtra au der-
nier jour pour le jugement. Il ressuscitera tous les morts. Aux justes et aux
élus il donnera la vie éternelle et la félicité. Quant aux impies et aux démons,
il les condamnera à l'Enfer et aux tourments éternels. Nous condamnons
donc les Anabaptistes, qui enseignent que pour les damnés et pour les dé-
mons les peines et les tourments auront une fin. Nous rejetons aussi certaines
doctrines juives, que l'on rencontre aussi actuellement, d'après lesquelles,
avant la résurrection des morts, les justes et les pieux détruiront les impies et
régneront seuls sur la terre.
Article 18. - DU LIBRE ARBITRE
En ce qui concerne le Libre Arbitre, nous enseignons ne l'homme
possède une certaine liberté de volonté pour mener une vie extérieurement
honorable et pour choisir entre les choses accessibles à la raison. Mais sans
la grâce, l'assistance et l'opération du Saint-Esprit, il n'est pas possible à
l'homme de plaire à Dieu, de le craindre sincèrement et de mettre sa con-
fiance en lui, et d'extirper de son cœur la mauvaise convoitise innée. Ceci
n'est possible. que par le Saint-Esprit, qui nous est donné par la Parole. Car
saint Paul déclare, 1 Cor. 2, 14 : « L'homme naturel n'accueille point les
choses qui sont de l'Esprit de Dieu ».
Et pour qu'on sache bien que nous n'innovons en rien, voici des pa-
roles bien claires prononcées par saint Augustin au sujet du Libre Arbitre
(Hypognosticon, Livre 3) : « Nous confessons qu'il y a chez tous les hommes
un libre arbitre. Car ils possèdent tous, par nature, la raison et l'intelligence
innées. Non pas qu'ils soient capables d'entrer en relation avec Dieu, comme
par exemple de l'aimer et de le craindre de tout leur cœur ; mais ce n'est que
dans les œuvres extérieures de cette vie qu'ils sont libres de choisir le bien ou
le mal. Par le bien, je comprends ce que la nature humaine est capable d'ac-
complir : par exemple, labourer un champ ou le laisser en friche ; manger,
boire, voir un ami, ou ne pas le faire ; se vêtir ou se dévêtir, bâtir, prendre
femme, exercer un métier, et faire d'autres choses semblables qui sont
bonnes et utiles. Et encore, tout cela ne se fait pas sans Dieu et ne subsiste
pas sans lui, puisque c'est de lui et par lui que sont toutes choses. D'autre
part, l'homme peut aussi par son propre choix se déterminer pour le mal,
comme par exemple se prosterner devant une idole, commettre un meurtre,
etc. ».
Article 19. - DE L'ORIGINE DU PÉCHÉ
© Philopsis – Pascal Dupond 174
www.philopsis.fr
En ce qui concerne l'origine du péché, voici ce que nous enseignons :
Quoique Dieu le Tout-Puissant ait créé et conserve la nature toute entière,
c'est cependant la volonté pervertie qui produit le péché dans tous les mé-
chants et les impies. Car telle est la volonté du diable et de tous les impies,
qui s'est détournée de Dieu et s'est portée vers le mal du moment que Dieu
avait retiré sa main ; c'est ce que dit Jésus-Christ, Jean 8, 44 : « Quand le
diable profère le mensonge, il parle de son propre fonds ».
Article 20. - DE LA FOI ET DES BONNES ŒUVRES
C'est à tort qu'on nous accuse de prohiber les bonnes œuvres. Car les
écrits des nôtres sur les Dix Commandements et sur d'autres sujets analogues
prouvent qu'ils ont donné des instructions et des exhortations utiles et solides
au sujet des divers états chrétiens et de leurs œuvres. Autrefois, les prédica-
teurs parlaient peu de ces choses ; par contre ils prônaient régulièrement,
dans leurs sermons, des niaiseries, des pratiques puériles et vaines, telles que
rosaires, cultes des saints, moinerie, pèlerinages, neuvaines, jours fériés, con-
fréries, etc. Aussi nos adversaires ne font-ils plus tant de cas de toutes ces
observances inutiles, comme ils le faisaient autrefois; ils ont même appris à
parler de la foi, dont autrefois ils ne faisaient jamais mention. Ils vont jusqu'à
enseigner maintenant que nous ne sommes pas justifiés devant Dieu uni-
quement par les œuvres. Ils y joignent la foi en Christ, et disent : La foi et les
œuvres nous justifient devant Dieu ; et sans doute, cette doctrine peut offrir
déjà plus de consolation que celle qui veut que l'on mette sa confiance uni-
quement dans les œuvres.
Or, puisque la doctrine de la Foi - la plus importante du Christianisme
- a été si longtemps négligée, comme on est obligé d'en convenir, et que
leurs prédicateurs, partout, n'ont guère prêché que le salut par les œuvres :
les nôtres ont instruit les fidèles de la façon suivante : Premièrement, nous
déclarons que nos œuvres n'ont pas le pouvoir de nous réconcilier avec Dieu
ni d'acquérir sa grâce, mais que cela se fait uniquement par la foi : lorsque
nous croyons que nos péchés sont pardonnes à cause de Christ qui seul est le
Médiateur pour réconcilier le Père avec nous (1 Tim. 2, 5). Celui donc qui
s'imagine qu'il peut accomplir cela par ses œuvres, et mériter la grâce, celui-
là méprise Christ ; il cherche un chemin à lui pour aller vers Dieu, - chose
contraire à l'Evangile. Cette doctrine de la foi est traitée ouvertement et clai-
rement par saint Paul en de nombreux endroits de ses écrits, particulièrement
dans l'Epître aux Ephésiens, où il dit (ch. 2, 8) : « Vous êtes sauvés par
grâce, par la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu ; non par
les œuvres, afin que personne ne se glorifie, etc. ». Et pour prouver que nous
ne donnons pas ici une nouvelle interprétation de Paul, nous mentionnons le
témoignage de saint Augustin, qui expose souvent ces choses, et qui en-
seigne aussi que c'est par la foi en Christ, et non par les œuvres, que nous ob-
tenons la grâce et que nous devenons justes devant Dieu, ce que démontre
son livre De Spiritu et Litera tout entier.
Bien que cette doctrine soit méprisée de ceux qui ignorent les tenta-
tions, il est cependant certain qu'elle est éminemment consolante et salutaire
pour les consciences inquiètes et terrifiées. Car la conscience ne pourra ja-
mais trouver le repos et la paix par les œuvres, mais uniquement par la foi,
dès qu'elle s'assure que nous sommes réconciliés avec Dieu par Christ,
comme le dit saint Paul, Rom. 5, 1 : « Etant donc justifiés par la foi, nous
© Philopsis – Pascal Dupond 175
www.philopsis.fr
avons le repos et la paix avec Dieu ».
Autrefois, cette consolation n'était pas offerte dans les sermons, mais
on renvoyait à leurs propres œuvres les pauvres consciences qui, dès lors, se
sont lancées dans toutes sortes de pratiques. Il y eut des hommes que leur
conscience poussait à se réfugier dans les cloîtres, dans l'espoir d'y acquérir
la grâce par la pratique de la vie monastique. On inventa aussi des œuvres
inédites pour acquérir la grâce et faire satisfaction pour les péchés. Mais
beaucoup d'entre eux ont prouvé que l'on n'obtient pas la paix du cœur par
ces moyens. Il était donc urgent de prêcher cette doctrine de la foi en Christ
et de l'inculquer avec insistance, pour qu'on sache qu'on ne saisit la grâce di-
vine que par la foi, et sans aucun mérite.
Nous instruisons aussi tout le monde, qu'ici nous ne parlons pas de
cette sorte de croyance qu'ont aussi les démons et les impies.. Ceux-ci aussi
croient aux faits historiques; ils croient que Christ a souffert et qu'il est res-
suscité des morts. Mais nous parlons de la véritable foi, de celle par laquelle
nous croyons que par Christ nous recevons la grâce et la rémission des pé-
chés. Quiconque possède cette foi, sait que par Christ il a un Dieu propice, il
connaît donc Dieu, il l'invoque, et il n'est pas sans Dieu comme les païens.
Car le diable et les incrédules ne croient pas cet article, la rémission des pé-
chés. C'est pourquoi ils sont des ennemis de Dieu incapables de l'invoquer et
de s'attendre à quelque chose de bon de sa part. C'est dans ce sens que l'Ecri-
ture parle de la foi. Elle n'appelle pas foi la science que possèdent les dé-
mons et les impies. L'Epître aux Hébreux (ch. 11) nous enseigne que la foi
n'est pas la simple connaissance des faits historiques, mais la confiance que
Dieu nous donne ce qu'il a promis. Saint Augustin nous rappelle que le terme
de « Foi » dans les Ecritures signifie la confiance en Dieu, - que Dieu nous
est propice, - et qu'il ne désigne pas seulement une connaissance d'ordre his-
torique, que les démons, eux aussi, possèdent.
En second lieu, nous enseignons qu'il est absolument nécessaire que
l'on fasse de bonnes œuvres, non pas dans l'intention de s'y fier et de mériter
la grâce, mais par amour pour Dieu, et pour sa louange. C'est toujours la foi
seule qui saisit la grâce et la rémission des péchés.
Or, puisque par la foi le Saint-Esprit nous est donné, le cœur devient
aussi disposé aux bonnes œuvres, et capable de les accomplir. Car aupara-
vant, puisqu'il est sans le Saint-Esprit, le cœur est trop faible : de plus, il est
sous le pouvoir du diable, qui pousse 1a misérable nature humaine à des pé-
chés innombrables, comme nous pouvons le constater chez les philosophes,
qui se sont fait forts de mener une vie honorable et irréprochable, mais qui
n'ont point réussi, puisqu'il est notoire qu'ils sont tombés dans de gros vices.
C'est ce qui arrive chez l'homme lorsque, en dehors de la vraie foi, et sans le
Saint-Esprit, il se gouverne seul par ses propres forces humaines. Il n'y a
donc pas lieu de reprocher à la doctrine de la Foi de défendre les bonnes
œuvres. Au contraire, elle est à louer de ce qu'elle apprend à faire de bonnes
œuvres, et de ce qu'elle offre précisément le secours nécessaire pour les ac-
complir. Car en dehors de la foi, et en dehors de Christ, la nature humaine
avec son pouvoir, est de beaucoup trop faible pour faire de bonnes œuvres,
pour invoquer Dieu, pour avoir patience dans les afflictions, pour aimer son
prochain, s'acquitter avec zèle des devoirs de sa vocation, être obéissant, et
réprimer les mauvaises convoitises. Ces grandes et véritables bonnes œuvres,
© Philopsis – Pascal Dupond 176
www.philopsis.fr
on ne saurait les faire sans l'aide de Christ, comme il le dit lui-même, Jean
15, 5 : « Sans moi, vous ne pouvez rien faire ».
© Philopsis – Pascal Dupond 177
www.philopsis.fr
Annexe 6 : Identité personnelle et responsabilité morale. Le
dialogue de Philalèthe et de Théophile dans les Nouveaux Essais
Nouveaux Essais sur l’entendement humain, Livre deuxième, « Ce
que c’est qu’identité et diversité »
§ 1 Dans ce chapitre, sont examinées les idées d’identité et de diversi-
té, qui sont dites des idées relatives en ce qu’elles relèvent de la catégorie de
la relation: affirmer que deux êtres sont identiques ou divers, c’est considérer
chacun relativement à l’autre; il s’agit bien de l’être pros ti.
La question initiale est la suivante. Supposons deux choses de la
même espèce, deux choses ayant une identité spécifique. Qu’est-ce qui nous
permet de dire qu’elles sont « deux » ou que chacune a son identité numé-
rique qui la distingue de l’autre ? Philalèthe (Locke) répond : notre seule rai-
son d’affirmer que chacune est même que soi et différente de l’autre, c’est la
situation spatio-temporelle : deux choses de la même espèce ne peuvent pas
exister en même temps dans un même lieu; il suffit que deux choses existent
dans des lieux ou des temps différents pour qu’elles soient (même si nous les
supposons parfaitement identiques par leurs caractères intrinsèques) deux
choses différentes.
Théophile (Leibniz) accepte la proposition de Philalèthe au sens où il
reconnaît que c’est bien par la situation temporelle que nous distinguons
communément les choses. Mais il précise aussitôt qu’il existe dans les
choses « un principe interne de distinction », qui n’est pas en lui-même spa-
tio-temporel mais qui, pour notre sensibilité, se manifeste sous la forme
d’une distinction spatio-temporelle. Ce principe est appelé principe des in-
discernables ou de l’identité des indiscernables: deux êtres réels diffèrent
toujours par des caractères intrinsèques ou par leur constitution interne et
non pas seulement par leur position dans l’espace et le temps68.
D’où vient le principe des indiscernables ?
1/ Le principe des indiscernables est très étroitement dépendant de la
conception leibn. de la substance selon laquelle la substance est intelligible
et entièrement déterminée jusque dans son heccéité. Chez Aristote et dans sa
postérité médiévale, la forme est spécifique (elle représente la nature com-
mune des individus d’une même espèce) et la matière individualisante (elle
distingue les individus à l’intérieur d’une même espèce). Cette matière est à
la fois un principe d’individualisation et un principe d’indétermination -au
sens ontologique et au sens gnoséologique: la forme, principe de détermina-
tion est aussi principe de connaissance et ce qui excède la forme, excède la
connaissance; donc ce qui constitue proprement l’individualité d’un être ex-
cède la connaissance. Une telle limitation répugne au principe
d’intelligibilité intégrale de l’être, commun à Spinoza et à Leibniz. Il s’agit
donc de rendre l’individualité intelligible, d’étendre l’intelligibilité jusqu’au
plus individuel. Tout être réel a sa propre essence, et cette essence est à la
fois individuelle, individualisante, et intelligible.
2/ Les essences individuelles se distribuent dans l’être selon un prin-
cipe de continuité. Chez Aristote, les espèces sont foncièrement disconti-
nues. Aucune transition ne conduit de l’une à l’autre. Or aux yeux de Leib-
68
Cf De la nature en elle-même, § 13 (Prenant, p. 350: « nulle part ne se trouve une
similitude parfaite »), Correspondance avec Clarke, Prenant p. 434-435, D.M., § 9.
© Philopsis – Pascal Dupond 178
www.philopsis.fr
niz, cette discontinuité répugne au principe d’intelligibilité intégrale (la na-
ture ne fait pas de saut), qui exige que les essences s’inscrivent dans une sé-
rie continue. L présente et justifie cette continuité des essences par une ana-
logie mathématique; cf lettre à Arnauld du 12 avril 1686: “par la notion indi-
viduelle d’Adam, j’entends certes une parfaite représentation d’un tel Adam,
qui a telles conditions individuelles et qui est distingué par là d’une infinité
d’autres personnes possibles fort semblables, mais pourtant différentes de lui
(comme toute ellipse diffère du cercle, quelque approchante qu’elle soit)”.
Leibniz pense ici à la question des sections coniques. Soit un cône traversé
par un plan; si ce plan est perpendiculaire à l’axe du cône, la section conique
est circulaire, s’il est incliné par rapport à l’axe, la section conique est une
ellipse; supposons que l’angle d’inclinaison varie d’une quantité infiniment
petite, nous obtenons une série continue d’ellipses différentes, chacune diffé-
rant de la précédente et de la suivante d’une quantité infiniment petite, cha-
cune ayant sa propre essence (sa loi mathématique de construction) qui la
distingue des autres. C’est ainsi qu’il faut concevoir, pour Leibniz la diffé-
rence entre les essences; il existe, dans l’entendement de Dieu une infinité
d’Adam possibles tous différents, mais d’une différence infiniment petite, et
constituant une série continue, exactement comme les sections coniques
forment une série continue par leur différence infiniment petite.
Comment Théophile justifie-t-il la correction apportée à la proposition
de Philalèthe ? Il fait remarquer deux choses :
1/ la distinction des temps et des lieux ne suffit jamais à distinguer les
choses : considéré en lui-même, un lieu de l’espace est semblable à tout
autre, un temps est semblable à tout autre ; si l’espace et le temps n’ont pas
de pouvoir différentiant sur eux-mêmes, il est impossible qu’ils aient un
pouvoir différenciant sur les choses (il faut donc finalement, pense L, inver-
ser la position de Locke : ce n’est pas l’espace et le temps qui permet de dis-
tinguer les choses dans l’espace et le temps, ce sont les choses dans l’espace
et le temps qui permettent de distinguer les espaces et les temps – ou, pour le
dire autrement : l’espace et le temps ne sont rien en dehors des choses spa-
tio-temporelles; ils expriment les relations entre les choses [« ce ne sont pas
des substances ou des réalités complètes »] ; ils n’ont donc aucun pouvoir
différenciant propre et originaire; les différences qu’ils expriment viennent
des choses elles-mêmes.
2/ “La manière de distinguer que vous semblez proposer ici……”:
pour que la spatialité soit discriminante, il faut supposer que les corps sont
impénétrables et que par conséquent l’existence d’un corps dans un lieu ex-
clut l’existence de tout autre corps en ce même lieu. Cette supposition est
raisonnable, commente Leibniz, mais l’expérience montre que
l’impénétrabilité n’est pas toujours la condition d’une distinction [« on n’y
est point attaché ici quand il s’agit de distinction »] : nous distinguons deux
ombres ou deux rayons lumineux qui se pénètrent au sens où il y a une por-
tion de l’espace qui leur est commune. Leibniz ne veut pas dire que le prin-
cipe d’impénétrabilité est sans valeur, mais simplement qu’il ne s’applique
pas à une certaine catégorie d’être spatiaux, que pourtant nous distinguons
facilement et que par conséquent le vrai principe de distinction des choses
n’est pas la situation spatio-temporelle.
Pour conclure ce point : Kant va restituer à l’espace la valeur discri-
minante que Leibniz lui avait refusé. Kant argumente ainsi : si Leibniz sou-
© Philopsis – Pascal Dupond 179
www.philopsis.fr
tient que les êtres réels diffèrent toujours par leur essence, plutôt par leur si-
tuation spatio-temporelle (ou s’il pense que la différence spatio-temporelle
est le phénomène d’une différence de nature ou d’essence), c’est parce qu’il
ne reconnaît pas la véritable nature de l’espace et du temps, c’est parce qu’il
réduit l’espace et le temps à des relations entre les choses et à des relations
« intelligibles », exprimables conceptuellement ; pour Leibniz, il n’y a pas
d’espace absolu ; la spatialité d’une chose, ce n’est donc pas son emplace-
ment dans l’espace absolu, mais l’ensemble de ses relations aux chose co-
existantes, lesquelles résultent de leur essence. Tous les caractères spatiaux
d’une chose étendue résultent de son concept ou de son essence.
Kant (inspiré d’ailleurs de Newton) refuse ce point de vue Dans Le
premier fondement de la différence des régions dans l’espace, Kant réfléchit
sur le paradoxe des objets symétriques: deux corps peuvent être tout à fait
égaux et semblables “sans toutefois pouvoir être enfermés dans les mêmes
limites”; il n’ont aucune différence conceptuellement exprimable et pourtant
aucun artifice ne permet de les faire coïncider. L’espace est donc intrinsè-
quement différentiant : il est impossible de soutenir que la différence spatiale
serait une représentation confuse d’une différence de nature conceptuelle.
§ 2. Distinguant trois sortes de substance, Locke se demande quelles
sont pour chacune, les conditions de son identité numérique (celle qui nous
fait dire : c’est bien le même être, le même individu, ce n’est pas un autre)
Dieu est nécessairement identique puisqu’il est par nature sans altéri-
té : il n’y a pas pour Dieu d’altérité temporelle (un temps d’avant ou d’après
son existence), ni d’altérité interne (il n’y a pas d’événement qui ferait cé-
sure dans la continuité divine et déterminerait un avant et un après) ni
d’altérité spatiale (Dieu est présent partout).
Pour les esprits, l’identité numérique paraît avoir une double condi-
tion : une date et un lieu de naissance, l’assignation à un temps et à un lieu
du commencement de l’existence et la relation subsistante à ce temps et à ce
lieu.
Pour les corps, à nouveau une double condition (dont l’articulation est
problématique) : l’invariance et l’occupation sans partage de son propre lieu.
Cette seconde condition vaut d’ailleurs pour les esprits : si les esprits,
comme les corps n’étaient pas impénétrables, les idées d’identité et de diver-
sité seraient entièrement sans objet.
§ 3: « ce qu’on nomme principe d’individuation… ». Dans la philoso-
phie scolastique, l’individuation désigne la réalisation de l’universel dans un
individu. Le principe d’individuation est ce qui fait qu’un être appartenant à
un type spécifique (à l’espèce ’canard’) est lui-même et se distingue de tout
autre (Donald n’est pas Picsou). On parle aussi dans le même sens d’eccéité
ou de differentia individuans. La question de l’individuation a été amplement
discutée dans la philosophie médiévale, sous deux angles : qu’est-ce qui in-
dividualise les membres d’une même espèce ? et : y a-t-il une connaissance
de ce qui individualise les membres d’une même espèce ? Dans la tradition
aristotélicienne, l’individuation vient de la matière et se dérobe à la connais-
sance ou à l’intelligence (elle se dérobe à l’intelligence parce qu’elle se pré-
sente comme une rhapsodie de propriétés multiples que l’intelligence ne peut
pas rassembler dans une forme unifiante). Duns Scot (1265-1308) refuse
cette position. Il veut donner à l’individu une intelligibilité analogue à celle
qu’Aristote donne à l’espèce : l’individualité d’un être (ce qui le distingue de
© Philopsis – Pascal Dupond 180
www.philopsis.fr
tout autre de la même espèce) doit pouvoir se désigner en termes d’unité
sensée (par des caractères qui se rassemblent dans l’unité d’un sens ou d’un
style, au sens où on reconnaît quelqu’un par le style de sa démarche ou par le
style de sa vie) et non seulement en termes de multiplicité rhapsodique. Et
c’est ainsi qu’il affirme la présence en tout être réel d’une forme individuali-
sante, qui ne se confond ni avec la forme spécifique, ni avec la matière, et
qu’il appelle ecceité. Ainsi la socratité est une forme individualisante par
laquelle Socrate est différent de tout autre individu et reste ce seul et même
Socrate tout au long de sa carrière, quels que puissent être les accidents qui
lui surviennent.
Locke paraît ne pas vouloir entrer dans ces subtilités. Il présente
comme évidente l’idée qu’il n’y a d’individuation que par l’existence, pour
autant que l’existence fixe chaque être à un temps déterminé et à un
lieu « incommunicable » à deux êtres de la même espèce. Lieu incommuni-
cable – je comprends ainsi : un être peut se déplacer dans l’espace, mais,
quand il se déplace, il emporte avec lui « son » lieu, que nul autre être ne
peut partager. C’est une variation du principe d’impénétrabilité.
Locke présente sa lecture de l’individuation comme une vérité évi-
dente pour les substances ou les modes les plus simples, mais aisément trans-
férables aux substances et modes les plus complexes.
Pour illustrer cette lecture, Locke prend l’exemple de la plus simple
substance matérielle : l’atome. Il suppose « un atome, cad un corps continu
sous une surface immuable, qui existe dans un temps et un lieu déterminés ».
Cette supposition, on le voit comporte deux parties : on suppose un être
ayant telle essence et on le suppose existant.
Essence : « un corps continu sous une surface immuable ». Reprise
des thèmes fondamentaux de l’atomisme antique.
L’atomisme est une lecture rationnelle du réel au sens où il répond à
ce que nous nous représentons comme les conditions fondamentales de
l’intelligibilité des choses. Il y répond dans un style qui est, pour reprendre la
formule hégélienne, la logique de l’entendement. Le rationnel de l’atomisme
est une expression du principe d’identité. On peut l’établir en réfléchissant
sur la procédure d’établissement de la réalité de l’atome, puis sur son indes-
tructibilité et son impénétrabilité.
Dans l’atomisme ancien, le concept d’atome est obtenu par un proces-
sus d’abstraction consistant à éliminer des corps que nous percevons tout ce
qui n’est pas corps : les états passagers de la matière, dus à la composition, et
le vide. L’atome est un corps pur, un corps, si l’on ose dire, intégralement
corporel, un grain d’être. Il y a dans la nature des atomes et du vide, mais
atome et vide existent chacun par soi et pur de tout mélange . Le vide ne doit
rien à l’atome, l’atome ne doit rien au vide, si ce n’est la possibilité de son
mouvement.
Le grain d’être est indestructible69 et impénétrable70.
L’atome est indestructible en vertu de « la logique et la nature même
des choses ». Son indestructibilité est une propriété « physique », mais plus
fondamentalement « logique ». De deux choses l’une : ou bien la destruction
se fait par annihilation ou elle se fait par division. Elle ne peut se faire par
69
« Aucune force n’est capable de les détruire, car leur solidité triomphe finalement
de toute atteinte ».
70
« La qualité propre de la matière est de faire obstacle et d’offrir de la résistance ».
© Philopsis – Pascal Dupond 181
www.philopsis.fr
annihilation, car cela contredirait la règle fondamentale de la physique : rien
ne naît de rien, rien de retourne au néant. Elle ne peut donc se faire que par
division. Si la division allait à l’infini, réduisant la matière à des parties de
plus en plus petites, la nature ne pourrait pas, avec des quasi-néants, former
les êtres composés dont nous constatons l’existence, elle ne saurait en un
temps fini quelconque remonter le handicap d’une destruction se poursuivant
depuis un temps infini. La supposition d’une divisibilité se poursuivant à
l’infini est incompatible avec ce que l’expérience nous présente. Et comme
(d’après le premier argument), aucune autre destructibilité que la divisibilité
ne peur être admise, on conclut qu’il existe des parties indestructibles et
éternelles.
L’« identité » de l’atome à lui-même, le caractère infranchissable de
la frontière entre l’être et le néant ont le rang de conditions de possibilité de
notre expérience de la nature.
L’impénétrabilité se prête à la même analyse. Elle n’est pas une pro-
priété empirique (l’expérience ne nous présente aucun corps qui soit abso-
lument résistant, non seulement parce que nous voyons, rappelle Lucrèce, la
foudre traverser les murs les plus compacts, mais aussi et surtout parce que
l’expérience est incapable de révéler une propriété négative), c’est une pro-
priété logique. Comme Bergson le remarque (Essai sur les données immé-
diates de la conscience, p. 66-67), quand nous disons que la matière est im-
pénétrable, nous nous représentons toujours deux (ou plusieurs) corps, ayant
chacun leur identité, ce qui suppose l’idée de nombre et l’espace partes extra
partes accompagnant l’idée de nombre (« l’idée d’un nombre quelconque
renferme celle d’une juxtaposition dans l’espace »). Dire que deux corps
sont impénétrables et dire qu’ils sont deux serait donc une seule et même
chose. L’idée d’impénétrabilité nous paraît ajouter quelque chose à l’idée de
nombre pour autant que nous considérions l’idée de nombre sans l’espace.
Mais si nous comprenons que l’idée de nombre est impensable sans réfé-
rence à l’espace, nous verrons que l’impénétrabilité n’est rien d’autre que la
dualité spatiale.
Pour résumer : la rationalité de l’atomisme est une rationalité de
l’identité de l’être ou de l’exclusion réciproque de l’être et du néant : l’être et
le néant ne se mélangent pas.
Locke est, dans définition de l’atome, fidèle à la tradition : l’atome est
un corps continu (= un grain d’être parfaitement homogène, pur, qui est ce
qu’il est) avec une surface immuable (= que rien ne peut rompre, percer :
c’est l’impénétrabilité)
Puis on le considère existant, dans un instant puis dans la succession
des instants.
Dans un instant, quelconque, il est un seul et même être, il est un indi-
vidu pour autant qu’il est « le même avec lui-même » ou pour autant qu’il est
« ce qu’il est effectivement et rien d’autre ». A quoi l’atome doit-il son indi-
vidualité instantanée ? La doit-il à son être (ou à son existence) ou la doit-il à
sa façon d’être ? D’après le raisonnement de Locke, il la doit à sa façon
d’être : à son pouvoir d’être sans mélange, purement soi, à sa pureté ontolo-
gique : il est individué pour autant qu’il est un grain d’être pur et rien
d’autre.
© Philopsis – Pascal Dupond 182
www.philopsis.fr
Etant individué dans l’instant, il l’est aussi dans la succession des ins-
tants pour autant qu’il continue d’exister, cad transfère d’un instant à l’autre
du temps sa constitution de pur grain d’être.
Ce qui est acquis pour les corps simples est transféré aux corps com-
posés : une même masse est celle qui est composée des mêmes atomes. Ré-
serve faite pour les êtres vivants.
Pour résumer : un être ne peut avoir une individualité que s’il est ca-
pable d’être même que soi, d’abord dans l’instant puis dans la succession des
instants. Or cette identité, un être paraît bien la devoir à sa constitution plu-
tôt qu’à son existence.
Leibniz critique la construction de Locke. Il critique à la fois (implici-
tement) l’individuation par l’existence et (explicitement) l’individuation par
l’identité à soi. L’opposition à Locke se présente sur ce second point comme
une véritable inversion. Locke cherche la condition de l’individuation dans
l’identité ; Leibniz la cherche dans la non identité
Précisons le sens de cette inversion.
Premier point : Leibniz a adhéré aux thèses atomistes quand il était,
dit-il, « petit garçon ». Puis il l’a abandonné pour des raisons qui tiennent en
particulier à son dynamisme. Mais quelque chose en subsiste : L. a toujours
le souci de remonter aux éléments des choses, cad au simple, qui est la raison
du composé. Ce souci n’est pas platonicien ou arist., mais bien conforme à
l’inspiration de l’atomisme antique. Et dans un opuscule tardif tel que la
Monadologie, le concept d’atome est explicitement mentionné (§ 3: “et ces
monades sont les véritables atomes de la nature et en un mot les éléments
des choses”). Ce qui veut dire que, si les premiers atomistes se sont trompés,
ce n’est pas en ce qu’ils ont compris la recherche des causes et des principes
premiers comme une recherche des éléments simples des choses, c’est en ce
qu’ils ont mal compris la nature de ces éléments simples. Pour les atomistes,
les éléments des choses sont des corps.
Second point : L’atomisme est, pour Leibniz, incapable de rendre
compte de l’individuation. 1/ L’atome étant un grain d’être pur et inaltérable,
les atomes ne peuvent différer entre eux que par le volume ou la figure. 2/
Rien n’interdit de concevoir des atomes qui auraient même figure et même
volume. 3/ Des atomes de même volume et de même forme ne peuvent diffé-
rer entre eux (et être individués) que par leur localisation spatio-temporelle
[« des dénominations extérieures sans fondement interne »]. 4/ La localisa-
tion spatio-temporelle est incapable de distinguer les êtres, c’est au contraire
la différence des êtres qui distingue les lieux de l’espace que ces êtres occu-
pent.
Troisième point. Locke dit : un être ne peut être individué (en diffé-
rant de tout autre être) que s’il est d’abord « même que soi ». Leibniz dit in-
versement : un être ne peut être individué en différant de tout autre qu’ s’il
diffère de soi. Reprenons l’argumentation de Leibniz
1/ « la vérité est que tout corps est altérable… ».
Dans l’atomisme traditionnel, cette proposition signifie : tout corps
composé (composé d’atomes et de vide) peut se décomposer. Cette possibili-
té est fondée dans la nature même du composé. Le simple est inaltérable
parce qu’il est même que soi. Le composé est altérable parce qu’il est un mé-
lange, parce qu’il n’est pas même que soi ou parce qu’il est à lui-même
© Philopsis – Pascal Dupond 183
www.philopsis.fr
autre : parce qu’il est autre que soi, il est exposé à l’altérité 71. Et la réalisa-
tion de cette possibilité relève de la contingence : quand la décomposition se
produira-t-elle ? ce sont les chocs innombrables des atomes dans l’univers
qui en décideront.
La proposition que nous examinons peut recevoir un sens comparable,
et tout à fait banal en physique aristotélicienne : tout être réel est un composé
de matière et de forme et la matière représente dans le composé, la possibili-
té permanente de l’altération et de la destruction. Et cette altération est le re-
tour de l’unité à la diversité
Ce n’est pas en ce sens que Leibniz entend la proposition, comme le
montre la précision qui suit : « et même altéré toujours actuellement… ». Al-
téré actuellement signifie : l’altération est en acte et non en puissance ; elle
relève de l’essence de l’être et non pas des accidents de l’ordre des ren-
contres. Leibniz présente ici une idée paradoxale. D’où vient l’altération ?
comme nous l’avons vu, elle vient de l’autre : un être s’altère pour autant
qu’il pâtit d’un autre être. Habituellement on distingue ce qu’un être est par
soi et ce qu’il est par un autre. Dans ce cas, ce qu’il est par soi est essentiel et
nécessaire et ce qu’il est par un autre est accidentel et contingent. Or avec
Leibniz, ce partage devient impossible : si les êtres sont non pas altérables
mais « altérés toujours actuellement », l’altération qui est la leur en vertu de
l’autre fait partie de leur essence. L’altération est donc indivisiblement « ex-
terne » (un être varie parce que les autres agissent sur lui) et interne (cette
variation constitue son essence). Il est devenu impossible de distinguer le
« par soi » et le « par un autre » : l’hétéro-altération (l’altération qu’un être
« subit » en raison de ce qui est autre que lui) est une auto-altération (une al-
tération qu’un être « agit » en vertu du dynamisme de son essence).
Comment des corps peuvent-ils différer les uns des autres, de telle
sorte que chacun soit « lui-même », ait son individualité numérique ?
L’atomisme répond : ils ne peuvent différer les uns des autres qu’à la condi-
tion que chacun soit même que soi (soit pure identité sans altérité) et trans-
fère cette identité à travers l’espace et le temps. Leibniz donne une réponse
inverse : ils ne peuvent différer les uns des autres qu’à la condition de diffé-
rer de soi. En effet : 1/ il ne peuvent différer les uns des autres qu’en se réfé-
rant les uns aux autres ; 2/ ils ne peuvent se référer les uns aux autres et dif-
férer les uns des autres qu’en agissant les uns sur les autres, en pâtissant les
uns des autres ; 3/ cet agir et ce pâtir relève de l’essence et non pas de
l’accident (s’il relevait de l’accident, on devrait à nouveau distinguer une in-
variance essentielle et une variation accidentelle, on reviendrait à
l’atomisme). Un corps diffère constamment de soi parce que la loi de son es-
sence, qui est une loi (invariante) de variation, n’est rien d’autre que la loi de
ses rapports avec les autres corps dans l’action et la passion. Les corps ont
une constitution différentielle comme les éléments d’une langue : chacun est
établi dans son identité non par fermeture mais par ouverture aux autres.
71
Pour le dire autrement : l’atome est inaltérable parce qu’il n’est en rapport avec rien
(il est, pour reprendre la formule de Leibniz, sans porte ni fenêtre). Le composé est altérable
parce qu’il est un nœud de rapports (il a des portes et des fenêtres).
L’atomisme tente donc de distinguer rigoureusement ce qui par constitution est
« même que soi » et « autre que soi » [la distinction n’est peut-être pas possible : comment ce
qui est autre soi pourrait-il avoir son fondement dans ce qui est même que soi ? La solution
consiste à donner aux atomes ou à certains atomes une forme qui leur permet de s’accrocher ;
le crochet, c’est la relation à l’autre qui s’annonce dans la relation à soi.
© Philopsis – Pascal Dupond 184
www.philopsis.fr
§ 4. Dans le § 3, Locke a expliqué que l’identité d’une masse de ma-
tière inanimée est fondée sur l’identité de ses parties composantes (qui elle-
même sont identiques par inaltérabilité). L’identité d’un être animé est d’une
autre nature : l’identité n’est plus dans l’élément mais dans l’ensemble ; ce
qui veut dire qu’une plante ne reste identique à elle-même, qu’elle n’est une
seule et même plante qu’aussi longtemps qu’elle conserve son unité. L’unité
de la plante consiste dans une certaine disposition de ses parties qui permet
les fonctions vitales. Mais cette « disposition » des parties, suffit-elle à
rendre raison de l’identité numérique de la plante ? On peut discerner une
certaine hésitation de Locke : une même disposition des parties, une même
structure peut être commune à deux plantes différentes : dans ce cas il est
clair que cette commune disposition fonde une identité de ressemblance ou
une identité spécifique mais non pas une identité numérique. L’identité nu-
mérique suppose quelque chose de plus. Pour le comprendre, appelons D1 la
disposition des parties de la plante P1 et D2 la disposition des parties de la
plante P2, et supposons que ces deux plantes sont de la même espèce et que
la disposition des parties y est donc spécifiquement identique. La condition
pour que D1 confère à P1 une identité numérique et non pas seulement une
identité spécifique est D1 se distingue de D2. Or nous avons supposé que les
deux plantes sont de la même espèce. Donc si D1 se distingue de D2, ce
n’est pas en tant que disposition forme ou structure mais en tant que struc-
ture immanente à une matière qu’elle organise successivement.
L’organisation continue de la plante ne fonde son identité numérique que si
elle est considérée dans sa présence à un certain amas de matière. Mais alors
d’où vient l’identité numérique ? En langage aristotélicien, on poserait la
question : est-ce la forme, est-ce la matière, qui fait de la plante un individu ?
Locke ne peut choisir, car 1/ une plante ne peut pas rester la même tout au
long de sa carrière si elle ne conserve pas son unité son organisation, sa vie,
à travers le renouvellement des parties composantes ; 2/ comme les parties
composantes se renouvellent sans cesse, il paraît nécessaire de faire passer
l’identité numérique du côté de la disposition, de l’organisation, de la
forme ; 3/ en même temps, on voit bien que la forme ne suffit pas : elle n’est
individualisante que si elle se distingue de toute autre par son inhérence à un
composé particulier.
Le propos de Philalèthe ne retient qu’une partie de l’argumentation de
Locke. Mais la réponse de Théophile montre que l’embarras de Locke n’a
pas échappé à Leibniz. Pourquoi Locke ne peut-il pas fonder l’identité nu-
mérique de la plante sur la seule permanence de sa structure, pourquoi la
distinction des plantes se fait-elle aussi par la matière que cette structure in-
forme (alors même que cette matière se renouvelle constamment) ? C’est,
répond Leibniz, parce que la structure, telle qu’il la pense n’est pas assez in-
dividualisante : elle distingue un hêtre d’un chêne, mais elle ne distingue pas
un chêne d’un autre chêne, elle est « spécifiante » mais non pas « individua-
lisante ». Et reprenant la critique qu’Aristote, déjà adressait aux mécanistes,
Leibniz précise : Locke a réduit la forme à la configuration ; et à partir de là,
comprenant que la configuration ne peut pas assurer l’identité numérique, il
est contraint de chercher l’identité numérique du côté de la matière et de sa
localisation spatio-temporelle. D’où une sorte d’indécision : quand on
cherche l’identité numérique du côté de la matière, comme la matière se re-
nouvelle sans cesse, on est renvoyé à la forme ; et quand on la cherche du
© Philopsis – Pascal Dupond 185
www.philopsis.fr
côté de la forme, comme la forme, réduite à la configuration est spécifiante
mais non individualisante, on est renvoyé à la matière.
Pour comprendre cette situation, posons la question suivante : existe-t-
il une différence entre la persistance de l’identité formelle d’une plante et la
persistance de l’identité formelle d’un fer à cheval plongé dans l’eau de
Hongrie. Pour Leibniz, assurément. Pour Locke aussi d’ailleurs. Mais Leib-
niz est convaincu que si l’on adopte les prémisses « atomistes » de Locke, on
devient incapable de penser cette différence : selon les prémisses de Locke,
nous avons dans les deux cas un renouvellement de la matière et une forme
identique géométriquement ou spécifiquement, et cette forme n’est pas par
elle-même individuelle et individualisante ; elle ne s’individualise que par la
localisation spatio-temporelle des atomes qu’elle configure.
Où est la différence entre l’identité formelle du vivant et l’identité
formelle du fer à cheval ? dans le second cas, « la figure est un accident qui
ne passe pas d’un sujet à l’autre ». Entendons : le véritable sujet, c’est la ma-
tière, et la forme n’est qu’un accident ; quand on compare l’objet en fer
« avant » et l’objet en cuivre « après », on dit : c’est « la même forme » ;
mais la formule « la même » ne signifie ici rien d’autre que l’identité géomé-
trique (spécifique) de deux configurations successives; elle ne désigne pas
une identité numérique ; du point de vue de l’identité numérique, il y a au-
tant de différence entre la forme de l’objet en fer et la forme de l’objet en
cuivre qu’entre les particules de fer et les particules de cuivre. En revanche,
dans le premier cas, celui de la plante, la forme possède une véritable identi-
té numérique, car elle se continue elle-même, elle réalise sa continuité
comme sa propre opération, à travers le changement de la matière. Elle se
forme et informe la matière, elle n’est pas formée par la matière [voir aussi
sur cette question Hans Jonas, Le phénomène de la vie, p. 86-89).
On voit clairement l’enjeu du débat : il concerne le statut de la forme.
Du point de vue de Leibniz, quand on part de prémisses atomistes, la forme
ne peut être que le résultat des processus qui ont lieu dans la matière, elle est
effet et non cause, elle est prédicat et non sujet. Sous des prémisses ato-
mistes, on ne peut pas penser une forme qui aurait une puissance opérante et
qui, à ce titre, aurait à travers le temps une véritable identité numérique.
Locke dit il est vrai, que l’identité numérique de la plante est celle de sa
forme ; mais tout en le disant, il ne peut pas le penser : il fait de la forme une
configuration, extérieure à la matière qu’elle informe (ou même produite par
elle), il ne peut donc pas distinguer la forme « opérante » et « individuali-
sante » de la plante et la forme géométrique, spécifique, inactive d’une ma-
tière/fer qui est devenu une matière/cuivre. La forme ou la structure (telle
que Locke la comprend) rend compte de l’unité de la plante mais non pas de
son individualité numérique ; pour passer de l’unité à l’individualité numé-
rique, il faut considérer la forme dans son immanence à la matière ; c’est
donc la matière et la localisation spatio-temporelle de ses parties qui est le
socle de l’identité numérique.
Quant à Leibniz, sa façon de comprendre l’identité numérique de
l’organisme se résume en deux propositions. 1/ La forme ou la structure des
organismes est unifiante et individualisante ; 2/ la forme organique est uni-
fiante et individualisante parce qu’elle est jointe à un « principe de vie sub-
sistant », c’est-à-dire un principe actif, causal, opérant, interne à la matière
qu’elle informe. Il y a donc deux types de composés : ceux dont la forme est
© Philopsis – Pascal Dupond 186
www.philopsis.fr
une configuration et qui sont une pure multiplicité, comme un tas de pierre,
et ceux dont la multiplicité est véritablement composée et organisée par une
« forme substantielle », le principe de vie dans la plante, l’âme dans l’animal
ou l’esprit dans l’être raisonnable (« être le même », cela n’a donc pas le
même sens pour ces deux types de composé : pour le tas de sable, cela signi-
fie l’invariance, pour l’organisme, cela signifie la permanence de la forme à
travers le renouvellement des parties composantes72. 3/ Malgré leur « prin-
cipe de vie », les êtres organisés (comme la plante) n’ont pas une véritable
identité numérique. « Aussi bien que d’autres » [= les corps inanimés] ils
n’ont finalement qu’une identité numérique apparente ; leur identité numé-
rique n’est pas différente de celle d’un fleuve ou de celle du navire de Thé-
sée ; le renouvellement constant de la matière exclut qu’il y ait en eux une
véritable identité numérique (si ce n’est dans notre façon de parler et pour les
commodités de la pratique). L’identité numérique ne peut appartenir qu’aux
« substances qui ont en elle une véritable et réelle unité substantielle » cad
au « principe de vie subsistant » : non pas à l’organisé mais à l’organisant.
Ces véritables substances sont les monades, au nombre desquelles il y a les
esprits qui disent « moi ».
On peut donc conclure que Locke et Leibniz ont en commun de cher-
cher l’identité numérique véritable dans l’élément. Mais ce n’est pas le
même : pour l’un, ce sont les atomes ; pour l’autre, ce sont les monades,
« l’organisant », le principe de l’organisation, substance absolument simple.
§§ 5 et 6. Ayant montré comment une plante peut être la même à tra-
vers la durée, Locke étend le résultat à la Brute, cad à l’animal, puis à
l’homme.
L’identité de la brute consiste dans la permanence d’une forme. Elle
est donc, précise Locke, tout à fait comparable à l’identité de la montre qui
consiste aussi dans la permanence d’une certaine « organisation ou construc-
tion ». Locke est tout à fait conscient de la distance qui sépare les effets de
l’organisation dans un organisme et les effets de l’organisation dans une ma-
chine : dans une machine, l’organisation n’a pas d’autre effet que la trans-
mission mécanique d’un mouvement reçu de l’extérieur ; dans un organisme,
le mouvement vient du dedans et produit des échanges métaboliques. Mais
cette différence n’est pas essentielle, du moins du point de vue de la question
présente. Quelle que soit la plus ou moins grande complexité des opérations,
un être organisé est le même à travers le temps par la permanence de sa
forme.
72
.A Arnauld, p. 225; Mon. , § 70; Principes de la nature et de la grâce, § 3, p. 390).
Un être vivant est une substance composée d’une multiplicité infinie de substances simples,
dont l’une (l’âme) est le centre et le principe de son unité. Comment faut-il se représenter le
pouvoir unifiant qui appartient à la monade centrale ou dominante ? Le concept d’expression
est ici fondamental. La monade se définit par une action interne, qui est la perception.; cette
perception est une représentation de la multiplicité dans l’unité (Mon., § 14: “l’état passager
qui enveloppe et représente une multitude dans l’unité ou dans la substance simple n’est autre
chose que ce qu’on appelle perception…”); cette représentation est plus ou moins distincte.
Dans un composé de substances simples, l’âme est celle de ces substances simples dans la-
quelle la représentation de la multiplicité (et de l’unité de la multiplicité) de l’être composé
est la plus claire et la plus distincte; du moment que les monades n’ont aucune influence réelle
les unes sur les autres, le pouvoir synthétique de l’âme sur le corps doit être compris comme
relevant de l’expression.
© Philopsis – Pascal Dupond 187
www.philopsis.fr
« Quiconque attachera l’identité de l’homme à quelque autre chose
qu’à un corps bien organisé… » L’idée de Locke est la suivante: supposons
que l’identité d’un homme (celle qui nous fait dire : c’est la même homme
de sa naissance à sa mort) soit d’une autre nature que l’identité d’un animal,
donc soit autre chose que la permanence de l’organisation vitale de la nais-
sance à la mort ; supposons que l’identité d’un homme (car il n’y a pas
d’autre solution) relève d’un principe immatériel, il faut en tirer toutes les
conséquences et admettre que, si il est possible à un homme de rester le
même homme en passant de l’état d’embryon à l’état de vieillard, ou de la fo-
lie à la sagesse, alors il lui est possible aussi de rester le même homme en
étant successivement Seth, Ismaël, Socrate. Or une telle conséquence est
inamissible : notre idée de l’homme, ce n’est sans doute pas seulement, mais
c’est nécessairement aussi l’idée d’un corps et d’une forme extérieure. Le
corps change, de la naissance à la mort, mais il change continûment car il
n’y a pas de rupture dans la carrière qui conduit de la naissance à la mort. En
revanche, aucune continuité perceptible ne relie les corps de Seth, Ismaël et
Socrate, et nous ne pouvons donc pas les considérer comme le même
homme. Et même celui qui croit à la transmigration des âmes ne dira jamais
qu’Héliogabale et le pourceau dans lequel il s’est réincarné soient le même
homme
L’identité de l’homme ne peut aller au-delà de l’existence d’un orga-
nisme qui est conçu, croît puis meurt; elle est adhérente à la vie de cet orga-
nisme et ne peut en excéder les limites.
Que répond Théophile ?
A la première partie, il répond : « cela se peut entendre dans mon
sens… ». L’identité d’un homme consiste bien, en un sens, dans la continua-
tion de la même organisation et de la même vie ; mais, ajoute Locke, cette
organisation (qui se perpétue comme la forme du navire de Thésée) ne suffi-
rait pas à rendre raison de l’identité d’un homme, s’il n’y avait pas un prin-
cipe de vie subsistant.
A la seconde partie, il répond en distinguant la question du nom et la
question de la chose.
1/ Question de chose. Quand nous disons que Socrate est le même
homme tout au long se sa carrière, nous voulons dire, si du moins nous pen-
sons avec rigueur ce terme « le même », qu’il est une seule et même « subs-
tance individuelle », « maintenue » comme une même substance par « la
même âme ». Pour que Socrate soit une même « substance individuelle », il
faut, Leibniz l’accorde à Locke, qu’il ait le même corps (au moins dans une
certaine mesure), mais s’il a le même corps, c’est parce qu’il y a même âme.
Si Socrate n’a pas d’âme (au sens d’une cause à la fois simple et unifiante de
toute la vie du corps), il n’est plus que son corps, et ce corps étant dans un
flux continuel (même si la configuration demeure), il devient impossible de
dire à la rigueur que c’est le même corps et que Socrate est le même homme
tout au long se sa carrière.
2/ S’il n’y a pas de corps humain sans âme humaine, l’expression
« corps humain » est équivoque et peut s’entendre en deux sens. Le corps de
Socrate, c’est d’abord le corps « grossier », celui que ses contemporains ont
perçu, dans la continuité de sa vie, de la naissance à la mort. C’est aussi et
d’abord le corps « subtil » qui accompagnait l’âme de Socrate, avant sa nais-
sance et l’accompagne après sa mort, un corps subtil qui est dans une trans-
© Philopsis – Pascal Dupond 188
www.philopsis.fr
formation ou une fluxion constante, dans l’enveloppement ou dans le déve-
loppement, (Mon. 72 et 73) et qui souffre en certain temps un grand chan-
gement : à la naissance et à la mort.
3/ La transmigration des âme est possible, en ce sens qu’elle ne com-
porte rien de contradictoire : les âmes pourraient, tout en conservant leur
même corps subtil passer de corps grossiers en corps grossiers, à l’intérieur
d’une même espèce ou même d’espèce à espèce. Mais que ce soit possible
n’implique pas que ce soit réel. Leibniz n’admet pas la transmigration des
âmes.
4/ Question de nom. Supposons que Caïn, Cham et Ismaël soient la
même âme réincarnée en différents corps « grossiers ». Dirons-nous qu’il
s’agit du même homme ? Cette fois, répond Leibniz, c’est une question de
nom. Quand nous pensons « le même homme », nous pensons habituelle-
ment « le même corps », mais aussi et surtout « la même personne » (une
identité morale au sens de la reconnaissance de soi comme le même dans la
continuité d’une seule histoire). Supposons qu’entre les trois personnages
bibliques il y ait continuité de substance (âme et corps subtil), mais disconti-
nuité « physique » (du point de vue du corps grossier, celui qui naît et meurt)
et discontinuité « morale » : nous nous refuserons à dire qu’il s’agit du
même homme.
Leibniz ajoute (contre Locke) : ce qui fait l’homme et le même
homme, c’est d’abord l’identité morale et la personne. L’âme d’Héliogabale
se réincarne dans un pourceau, en perdant la mémoire de sa vie antérieure et
l’exercice de la raison : il y a continuité de substance mais il ne s’agit ni du
même homme ni même d’un homme. Lucius, transformé en âne, conserve
les pensées d’un homme et du même homme qu’avant la transformation, on
accordera peut-être que c’est le même homme.
Cette question n’est qu’un jeu : dans la dimension de la fiction, cha-
cun départagera comme il veut ce qui est encore humain et ce qui ne l’est
plus. Mais ce qui est plus important, c’est de comprendre que, contrairement
à ce que pense Locke, quand nous pensons « le même homme », nous pen-
sons d’abord : « la même personne ».
§ 7. Locke conclut de ses analyses précédentes : « ce n’est donc pas
l’unité de substance qui comprend toute sorte d’identité ». Comprenons : il
n’est pas nécessaire qu’il y ait unité de substance pour qu’il y ait identité ;
une homme est identique à lui-même tout au long se da carrière sans unité de
substance. Il est donc nécessaire de distinguer différentes figures de
l’identité. Substance, homme, personne correspondent à trois formes diffé-
rentes d’identité.
§ 8. L’idée de l’homme est l’idée d’un animal d’une certaine forme.
La forme de l’homme sans l’exercice de la raison est un homme. La forme
du perroquet avec l’exercice de la raison est un perroquet.
Sur le premier point, Leibniz exprime une réserve : la seule « figure
humaine » « sans apparence de raison » ne suffit pas à établir qu’il s’agit
d’un homme. Et s’il est établi (par la filiation) que cette figure humaine, sans
apparence de raison, est bien celle d’un homme, alors il faut supposer (pour
ne pas contredire l’essence de l’homme qui est « une et la même en un cha-
cun ») que la raison est en cet homme enveloppée et pour ainsi dire en puis-
sance [« l’intérieur de l’âme raisonnable y demeurerait, malgré la suspension
de l’exercice de la raison »].
© Philopsis – Pascal Dupond 189
www.philopsis.fr
Sur le second point, Leibniz exprime un accord partiel : les catégories
d’homme et d’être raisonnable ne sont pas nécessairement coextensives, et
la raison peut appartenir à d’autres animaux que l’homme. Donc un perro-
quet raisonnable reste un perroquet. Néanmoins, ajoute Leibniz, l’identité
morale ou personnelle contribue davantage que l’identité physique à nous
faire juger qu’un certain être est un homme et éventuellement le même
homme que nous avons connu autrefois sous une toute autre figure : si une
fille de roi est métamorphosée en perroquet, mais en un perroquet ayant
l’identité morale de la personne d’avant la métamorphose, ses parents recon-
naîtront et chériront ce perroquet comme leur fille.
§9. Locke a laissé entendre un peu avant que nous ne donnons pas
exactement le même sens à la notion d’identité quand nous pensons l’identité
d’une substance et l’identité d’une personne. Locke a montré qu’un homme
est le même homme pour autant qu’il y ait permanence d’une configuration.
Que signifie, pour une personne, être « la même personne » ?
Ce que signifie « être la même personne » se déduit de l’idée de
personne. Une personne est un « être » - concept aussi indéterminé que
possible, désignant le sujet d’un attribut ou d’une propriété. Les attributs qui
font d’un être une personne sont les suivants : la pensée, l’intelligence, la
raison, la réflexion, le sentiment de ses propres actions [ce qui veut dire : une
personne est un être qui ne peut agir, quelle que soit l’opération (voir,
entendre, flairer, goûter, sentir, méditer, vouloir) sans avoir la conscience de
cette action, qui ne peut agir sans apercevoir qu’elle agit et par suite sans
apercevoir qu’elle l’aperçoit. Locke reprend ici Principes, 9 : « par le mot de
penser, j’entends tout ce qui se fait en nous de telle sorte que nous
l’apercevons immédiatement par nous-mêmes… »], et par suite le sentiment
d’être le même Soi en différents temps et en différents lieux. L’identité
personnelle est la conscience d’être une seule et même conscience à travers
la diversité des représentations, la certitude immédiate que c’est un même
soi conscient de soi qui accompagne la diversité de nos actes et peut se les
remémorer après-coup.
Et Locke précise immédiatement que ce sentiment de l’identité de soi-
même doit être considéré (décrit, analysé) tel qu’il se donne à la conscience
sans qu’on ait à chercher si le Soi « est continué dans la même substance »
sans qu’on ait à chercher un soutien ontologique de l’identité personnelle ;
l’identité du soi est considérée dans sa dimension phénoménologique et non
dans sa dimension ontologique; ou plus exactement la première a priorité sur
la seconde: nous avons la certitude que le même soi demeure et qu’il existe
une identité personnelle avant de savoir « si le même soi est continué dans la
même substance ou dans diverses substances ».
Kant a lu Locke et c’est pourquoi on peut illustrer ce que Locke dit ici
par une note des paralogismes (p. 294-295). Kant montre que l’on peut par-
faitement penser la continuité d’une histoire humaine sans faire intervenir le
concept de substance. Il l’explique par une analogie « physique ». De même
que des boules élastiques peuvent se transmettre l’une à l’autre l’intégralité
de leur état de mouvement, on peut supposer, par analogie, des substances
psychiques qui se transmettraient l’une à l’autre leurs états, ainsi que la
conscience qui y est jointe; la dernière d’entre elles rassemblerait en elle
l’histoire intégrale de toutes les autres ainsi que la sienne propre; il y aurait
la continuité d’une seule et même histoire sans identité de substance. Y au-
© Philopsis – Pascal Dupond 190
www.philopsis.fr
rait-il identité personnelle ? Kant répond non : « et pourtant elle n’aurait pas
été la même personne dans tous ces états ». Mais si Kant parle ainsi, c’est
peut-être parce que lui-même ne parvient pas à ébranler entièrement le privi-
lège du concept de substance; il ne peut pas concevoir une identité de la per-
sonne qui ne serait pas en même temps une identité de substance (l’âme); et
c’est pourquoi, proposant la fiction de la continuité d’une histoire person-
nelle sans identité de substance, il conclut que ce ne serait pas la même per-
sonne. Locke est sur ce point plus audacieux : il cherche à penser une identi-
té du moi, une identité de la personne qui serait indifférente à la question de
l’être, une identité qui se constituerait au niveau de l’attribut et non pas au
niveau de l’être qui est le sujet logique de cet attribut.
Le § 10 nous donne une raison de penser l’identité personnelle sans
recourir à l’idée de substance. Et cette raison, c’est qu’on ne peut pas con-
clure de l’identité personnelle à l’identité substantielle. Si on se souvenait de
tout son passé, s’il y avait une continuité de l’identité personnelle, cette iden-
tité personnelle continue serait un argument en faveur de l’identité de la
substance. Mais en fait, les souvenirs que nous gardons de notre vie sont dis-
continus et brouillés (et d’autant plus brouillés que nous nous enfonçons
dans notre passé) (p. 265: “Mais ce qui semble faire de la peine dans ce
point…”); donc la question de savoir si l’identité personnelle est aussi une
identité substantielle doit demeurer douteuse; on peut très bien penser
l’identité personnelle sans identité substantielle: de même que l’organisation
vitale demeure à travers le constant renouvellement des parties, on peut rai-
sonnablement supposer aussi que l’identité personnelle se continue « dans
différentes substances qui se succèdent l’une à l’autre ». Mais cette incerti-
tude n’a pas d’importance. Le problème de l’identité personnelle peut de-
meurer purement phénoménologique (il concerne ce que Leibniz appelle
dans sa réponse à Locke, l’identité apparente à nous-mêmes) et on n’a pas à
s’encombrer de décisions ontologiques.
La réponse de Théophile montre que Leibniz est en accord et en
désaccord avec Locke.
En accord : la conscienciosité, le sentiment du moi, prouve une
identité morale ou personnelle. En désaccord sur deux points fondamentaux :
A) L’identité de la personne n’est pas seulement une identité
apparente (l’identité dans l’apparaître), c’est aussi aussi une identité réelle
(l’identité d’un être ou d’une substance). L’identité personnelle est fondée
sur une identité substantielle (on distinguera ainsi l’incessabilité de l’âme
d’une bête (qui relève de l’identité réelle) et l’immortalité de l’âme humaine
(qui est une identité réelle jointe à une identité personnelle).
Leibniz invoque l’ « ordre des choses » : « une perception intime et
immédiate ne peut pas tromper naturellement », donc ce qui apparaît à une
telle perception intime et immédiate peut être considéré comme réel. « A
chaque passage prochain accompagné de conscience ou de sentiment du
moi » [à chaque passage d’un état de conscience à celui qui lui succède im-
médiatement - Leibniz parle ici des passages qui se font de proche en
proche, avec conscience de la continuité, par contraste avec ceux où une cé-
sure se produit, comme dans un évanouissement ou bien comme dans le pas-
sage d’un âge de la vie à un autre, sans véritable continuité du soi phénomé-
nal] nous avons la perception intime et immédiate d’une identité du soi appa-
rent ou phénoménal ; cette perception ne pouvant tromper, elle indique une
© Philopsis – Pascal Dupond 191
www.philopsis.fr
identité. L’apparaître n’a pas d’autonomie, il témoigne d’une façon ou d’une
autre d’un être sous-jacent ; la question est donc seulement de savoir à
quelles conditions le passage de l’apparaître à l’être est légitime, à quelles
conditions nous sommes fondés à dire que nous sommes (uns et identiques à
nous-mêmes) tels que nous nous apparaissons..
« Si l’homme pouvait n’être que machine et avoir avec cela de la
conscienciosité…… ». Supposons que l’organisme vivant soit une machine.
Une machine a une forme, une structure, mais cette forme n’a pas de pouvoir
causal : elle est le résultat mécanique, comme la vague, de l’interaction de
ses parties ; une machine est une unité apparente et une multiplicité réelle
(elle est ens per agregatum) ; et en tant que multiplicité, elle ne peut pas pro-
duire quelque chose qui aurait, comme le soi phénoménal, une véritable uni-
té. Supposons donc que l’organisme vivant soit une machine. Comme on ne
peut pas comprendre comment cette machine pourrait produire l’identité ap-
parente du soi, on ne peut pas fonder l’identité apparente sur une identité ré-
elle et on renonce alors à l’identité réelle. Locke n’y renonce pas parce que
ce serait quelque chose d’inutile, Locke y renonce parce que son concept de
l’être lui rend impossible qu’il y ait un fondement réel de l’identité person-
nelle.
Le sous-entendu de Leibniz est le suivant : Locke, comme Descartes, réduit
le vivant à une machine. Comme il est impossible de comprendre comment une telle
machine pourrait produire l’identité d’un soi, de deux choses l’une : ou bien, comme
Descartes, on ajoute à la machine du corps humain une seconde substance pour ser-
vir de substrat réel à la continuité phénoménale du soi ; ou bien, comme Locke, on
se contente de la machine du corps humain, mais comme celle-ci ne peut pas pro-
duire l’unité du soi, le soi (phénoménal) est comme suspendu dans le vide.
Dès le moment où on renonce au concept mécaniste de la vie, il n’y a
plus de difficulté à fonder l’identité du soi phénoménal sur quelque chose de
réel, cad sur une substance réellement identique à elle-même.
B) « Je ne voudrais point dire non plus que l’identité personnelle et
même le soi……». Ici commence le second argument contre Locke. Locke
identifie l’identité personnelle à la conscience de soi (§ 10, p. 266: « car
c’est par la conscience qu’il a en lui-même de ses pensées et de ses actions
présentes qu’il est dans ce moment le même à lui-même; et par la même rai-
son il sera le même soi aussi longtemps que cette conscience peut s’étendre
aux actions passées ou à venir… »). Leibniz a d’abord contesté que l’identité
personnelle soit purement phénoménale et non substantielle; à présent il va
contester que l’identité personnelle soit réductible à ce qui de la personne est
accessible à sa propre conscience ou à sa propre mémoire mémoire.
Leibniz pointe ici une difficulté qui a été exprimée par un autre auteur
(Thomas Reid, 1785) comme une contradiction logique que met en évidence
la fiction suivante :
« Supposez un brave officier qui, étant enfant, a été fouetté à l’école
pour avoir dérobé des fruits dans un verger, qui, au cours de sa première
campagne a réussi à prendre un étendard à l’ennemi, et qui a été fait général à
un âge avancé. Supposez également, ce qui est de l’ordre du possible, que,
lorsqu’il prit l’étendard, il était conscient d’avoir été fouetté à l’école et que,
lorsqu’il fut nommé général, il était conscient d’avoir pris l’étendard mais
n’avait absolument plus conscience d’avoir été fouetté.
« Cela étant posé, il s’ensuit, d’après le doctrine de M. Locke, que ce-
lui qui a été fouetté à l’école est la même personne que celui qui a pris
© Philopsis – Pascal Dupond 192
www.philopsis.fr
l’étendard et que celui qui a pris l’étendard est la même personne que celui
qui a été fait général. D’où il s’ensuit, s’il existe une vérié en logique, que le
général est la même personne que celui qui a été fouetté à l’école. Mas le gé-
néral n’a plus conscience d’avoir été fouetté ; par conséquent d’après la doc-
trine de M. Locke, il n’est pas la personne qui a été fouettée. D’où il s’ensuit
que le général est, et en même temps, n’est pas, la même personne que celui
qui a été fouetté à l’école ».
L’identité est une relation transitive : si a est b et si b est c, alors a est
c ; d’après la règle de l’identité, si l’enfant est le brave officier et si le brave
officier est le général, alors l’enfant est le général. Or selon la thèse de
Locke, l’enfant n’est pas la même personne que le général, puisque le géné-
ral ne se souvient pas de l’enfant. Comment le général peut-il à la fois être et
ne pas être la même personne que l’enfant ?
Certains auteurs anglo-saxons proposent la solution suivante : plu-
sieurs occurrences de personne (a, b, c, d, ) appartiennent à la carrière d’une
même personne X si ces occurrences soient reliées entre elles deux à deux :
si a est relié à b, si b est relié à c, si c est relié à d, X est une même personne
sans qu’il soit nécessaire que a soit relié à c ou b à d.
La position de Leibniz est différente. La solution que nous venons de
mentionner accepte l’essentiel de la thèse de Locke [l’identité personne n’est
rien d’autre que la mémoire de soi]. Leibniz l’infléchit profondément.
Il reconnaît que la mémoire joue son rôle dans la constitution de
l’identité personnelle mais quelle mémoire ?
1/ C’est d’abord une mémoire personnelle immédiate tissant le flux
continu de notre présent [cad ce que Leibniz appelle : « chaque passage pro-
chain accompagné de réflexion et de sentiment de soi »]
2/ C’est aussi une mémoire personnelle plus ample, plus lâche, parse-
mée de lacunes, d’accrocs, mais capable cependant d’assurer une cohésion,
une continuité de notre soi ; cette mémoire plus lâche, Leibniz l’appelle une
« moyenne liaison de conscienciosité ». C’est cette mémoire que Locke a
pris en compte
2/ C’est enfin une mémoire interpersonnelle.
Supposons une maladie de la mémoire qui priverait quelqu’un du sou-
venir des événements récents (il ne saurait pas comment il est entré dans
l’état présent), mais sans altération de souvenirs plus éloignés Dans ce cas,
dit Leibniz, l’identité personnelle persiste, cet homme peut légitimement se
considérer comme le même de son enfance à l’époque présente, en raison
d’une « moyenne liaison de conscienciosité » . Il le peut (et même le doit)
d’autant plus qu’il peut substituer au souvenir personnel altéré le témoignage
des autres et reconstruire ainsi la continuité de son histoire, même si cette
histoire n’est pas partout équivalemment personnelle.
Et cette identité personnelle médiate, médiatisée par le témoignage des
autres autorise, précise Leibniz, le châtiment. J’ai commis une faute de pro-
pos délibéré, dont je ne me souviens plus en raison d’une maladie de la mé-
moire, mais dont les autres se souviennent. La punition de cette faute de-
meure, selon Leibniz, tout à fait légitime. Ce point est évidemment problé-
matique : la punition est juste si celui qui subit la faute peut réactualiser par
le souvenir l’intention coupable de celui qui a commis la faute ; s’il ne le
peut pas, il demeure civilement responsable de l’injustice dont il est objecti-
vement la cause (comme nous sommes civilement responsables des injus-
© Philopsis – Pascal Dupond 193
www.philopsis.fr
tices que nous avons commises involontairement), mais on peut douter qu’il
soit pénalement responsable (Locke exclut explicitement la responsabilité
pénale au § 19). Qu’est-ce qui perme à Leibniz de dire que le souvenir des
autres est un substitut valable de la mémoire personnelle ? C’est certaine-
ment la conviction que le souvenir de l’intention mauvaise est, chez celui qui
a perdu la mémoire, endormi plutôt qu’anéanti. Un peu avant, Leibniz avait
dit : quand un homme est aussi stupide qu’un orang-outang, il n’est pas dé-
pourvu de raison, mais la raison est en lui inactive [« l’intérieur de l’âme rai-
sonnable y demeurerait malgré la suspension de l’exercice de la raison »]. La
même idée se retrouve ici : si un homme perd la mémoire de ses fautes (au
point que l’intention de l’infracteur lui soit totalement étrangère), sa mé-
moire est inopérante mais non pas effacée : elle redeviendra active le jour du
jugement, et comme elle est toujours là, subsistante, inconsciente, cela ne
fait pas une grande différence, du point de vue du châtiment, que le souvenir
de l’intention coupable vienne des autres plutôt que de ma mémoire person-
nelle. Toute cette argumentation suppose que l’identité personnelle se dé-
termine sur un plan plus profond que celui de l’identité conscientielle.
Leibniz s’adresse à lui-même une objection : n’est-il pas dangereux de
s’identifier à une personne dont je ne me souviens pas mais que les autres
me disent que j’ai été ? Les autres ne peuvent-ils pas me tromper (on pensera
à la dimension « politique » que prend cette question, pour nous au-
jourd’hui : on pensera aux procès staliniens) ? A l’objection, Leibniz donne
une quadruple réponse.
1/ Les autres peuvent en certains cas me tromper, mais je peux me
tromper moi-même et croire que certains événements me sont arrivés, alors
que je les ai rêvés ou imaginés. Donc notre mémoire personnelle n’est pas
meilleure garantie de notre identité que la mémoire interpersonnelle
La remarque de Leibniz lève la question suivante : dans le tissu de
notre identité personnelle, qu’est-ce qui relève de ce que nous appelons « ré-
el », qu’est-ce qui relève de l’imaginaire ? Dans la mémoire des individus ou
des peuples, le réel et l’imaginaire se mêlent inextricablement dans le tissu
du passé. Et il peut arriver que l’imaginaire compte plus que tout événement
réel dans la constitution de l’identité personnelle. Dans Traum und Existenz,
Binswanger rapporte le rêve suivant :
« Je me trouvais dans un autre monde merveilleux, dans un océan où,
dépourvu de forme, je me laissais flotter. Je voyais de très loin la terre et tous
les autres et je me sentais extraordinairement léger et débordant d’un senti-
ment de puissance ». Et B commente : « Le malade décrit ce rêve comme un
rêve de mort. Ce flottement sans aucune forme, cette totale disparition de la
forme corporelle propre n’est pas favorable du point de vue diagnostique. De
même l’opposition entre le monstrueux sentiment de puissance et l’absence
de forme de la personne indique un trouble momentané plus profond dans la
structure de son esprit ; mais cela n’appartient plus au rêve mais à la psy-
chose en tant que telle lorsque le malade définit de rêve comme un point cru-
cial de sa vie et qu’il subit une telle fascination par son contenu thymique
qu’il le revit sans trêve dans ses rêveries et qu’il préfère ce sentiment à tout
autre contenu vital et s’efforce à plusieurs reprises de s’évader de la vie ».
2/ Il y a des cas où le rapport d’autrui est une preuve de vérité.
Leibniz pense sans doute à quelque chose comme le recoupement des
témoignages, selon la pratique des historiens. Mais son propos a un socle
© Philopsis – Pascal Dupond 194
www.philopsis.fr
métaphysique. L’expérience de chaque homme est une facette de
l’expérience intégrale de l’humanité, cohérente et coordonnée avec toutes les
autres facettes ; l’expérience individuelle est une perspective singulière limi-
tée sur le monde, l’expérience de l’humanité est l’intégration de toutes ces
perspectives singulières limitées; ce que l’un perçoit obscurément et confu-
sément, un autre le perçoit plus clairement et plus distinctement en raison de
sa situation ; et la société humaine est un seul et unique champ d’expérience
où la connaissance de l’un est en correspondance réglée avec celle de
l’autre ; chaque subjectivité est insérée dans un tissu d’intersubjectivité.
Et c’est en ce sens que l’identité personnelle peut aller jusqu’à faire
l’économie du souvenir personnel; la soustraction, par maladie de la mé-
moire, d’une partie de notre histoire, ce n’est finalement qu’un cas particu-
lier du perspectivisme et de la finitude de toute monade. L’expérience de
l’humanité étend nos connaissances au-delà de notre perspective limitée, et
elle peut par conséquent aussi suppléer le souvenir personnel dans le cas par-
ticulier d’une maladie de la mémoire. L’identité personnelle ne se réduit pas
pour Leibniz à son noyau conscientiel : elle s’ouvre vers l’inconscient et vers
le rapport inter-personnel de chaque homme à tous les autres et de chaque
homme à Dieu
3/ Si la qualification morale des actions suppose un lien de société, ce
lien est d’abord avec Dieu qui ne peut tromper (socle théologique de
l’identité personnelle)
4/ Le soi qui s’apparaît identique à soi dans l’identité personnelle est
aussi un soi réel.
A nouveau s’accuse la distance entre Locke et Leibniz. Pour Locke, la
notion de soi désigne une identité conscientielle : l’identité de la conscience
dans la diversité temporelle de ses représentations et de ses actions (p. 266:
« tant qu’un être intelligent peut répéter en soi-même l’idée d’une action
passée avec la même conscience qu’il en avait eue premièrement, et avec la
même qu’il a d’une action présente, jusque là, il est le même soi… ») ;
l’identité personnelle n’a pas de fondement substantiel et se confond avec la
conscienciosité. Pour Leibniz, 1/ le soi est la personne considérée en son
identité réelle, physique, substantielle 2/ l’identité personnelle n’est pas le
soi mais l’apparence du soi, le soi dans son apparaître à la personne ou aux
autres personnes ; c) l’apparence du soi ne se confond pas avec la conscien-
ciosité (l’identité en première personne de la conscience dans la diversité de
ses actes) : elle intègre le témoignage de l’autre et le champ de
l’intersubjectivité.
Locke et Leibniz s’accordent à reconnaître que, si nous avons, par la
mémoire, une certaine identité personnelle, cette identité personnelle de
mémoire est trop lacunaire pour qu’on en conclue à une identité réelle. Mais
à partir de là, il se séparent : Locke soutient qu’il faut s’en tenir à ce que
nous connaissons par cette mémoire lacunaire de notre identité personnelle
et s’abstenir de toute thèse sur l’identité réelle ; pour Leibniz, Locke a oublié
deux choses : 1/ « la réflexion présente et immédiate prouve « l’identité
réelle et personnelle » ; 2/ au delà de la réflexion présente et immédiate, là
où notre continuité consciente commence à se trouer et à se brouiller, le
témoignage des autres nous aide à rétablir notre identité en rapprochant ainsi
autant que possible le « soi » et l’ « apparence du soi ». Pour contrer Locke,
Leibniz recourt donc à une double procédure : 1/ il considère l’identité
© Philopsis – Pascal Dupond 195
www.philopsis.fr
personnelle à une très petite échelle, à une échelle où elle en peut pas être
trompeuse (celle de la réflexion présente et immédiate) et il observe qu’à
cette échelle elle prouve notre identité réelle : l’identité dans l’apparence du
soi prouve l’identité du soi ; 2/ puis il élargit le champ et considère l’identité
personnelle à une grande échelle ; à cette échelle, le tissu de l’identité
personnelle se déchire, se troue, au sens où notre mémoire personnelle ne
suffit plus à en assurer la continuité ; mais notre identité réelle et personnelle
n’est pas pour autant perdue, : notre « souvenir d’intervalle » (le souvenir
d’une continuité brouillée) et le « témoignage conspirant des autres » nous
en donne une preuve raisonnable.
En conclusion de cette analyse, Leibniz fait deux remarques.
1/ On peut contester l’identité réelle du soi (car une preuve de fait
n’est pas une démonstration), mais même si on la conteste, on n’est pas pour
autant contraint d’identifier identité personnelle et identité conscientielle :
notre identité personnelle (ou l’identité dans l’apparence du soi) est un tissu
où se mêlent les apparences internes (ce que nous nous souvenons avoir été
et avoir fait) et les apparences externes (ce que nous avons été ou ce que
nous avons fait au témoignage des autres) ou même « d’autres marques »
(nous sommes nos souvenirs conscients mais aussi nos souvenirs incons-
cients, souvenirs d’apprentissages devenus des habitudes, souvenirs brouillés
par leur éloignement mais qui contribuent à donner à notre vie son style per-
sonnel.
2/ S’il y avait contradiction entre les diverses apparences, si le témoi-
gnage des autres venait contredire ce que la conscience dit « clairement » on
serait dans la difficulté, l’identité personnelle deviendrait problématique.
Pour LE, cette contradiction est une fiction : l’identité réelle et la connais-
sance divine donnent la garantie que la contradiction est apparente, qu’elle
vient de la confusion de notre connaissance et non de la chose même. Mais si
nous supprimons les instruments métaphysique de cette garantie, s’il n’y a
plus de point de vue du Sirius où se résolvent les contradictions, l’identité
personnelle devient problématique.
§ 11 Locke donne ici une nouvelle raison d’affranchir l’identité de la
personne et l’identité de l’homme (ou d’affranchir l’identité personnelle de
tout ancrage ontologique). Toutes les particules de notre corps, dit Locke,
font partie de ce que nous appelons « nous-mêmes » (ce soi conscient qui se
reconnaît intérieurement le même), tant qu’elle sont vitalement unies à lui, et
tout ce qui leur arrive est sensible au « soi ». Quand une partie du corps n’est
plus intégrée à cette union vital, quand la main est coupée, elle cesse d’être
« nous-même », elle nous devient aussi étrangère que le corps le plus
éloigné. Locke en conclut que l’identité personnelle est bien indépendante de
l’identité réelle : quand la main est retranchée, ce n’est plus, « la substance
en laquelle consistait le Soi personnel en un temps » n’est plus la même,
mais la personne est la même (« car on ne doute point de la continuation de
la même personne »).
Le résumé de Leibniz est très libre; car Locke ne dit pas que « le corps
étant dans un flux perpétuel, l’homme ne saurait demeurer le même », il dit
seulement que la variation de l’identité réelle n’entraîne pas une variation de
l’identité personnelle.
Leibniz répond : « j’aimerais mieux dire que le moi et le lui sont sans
parties ». Il critique la prémisse de Locke selon laquelle la diversité
© Philopsis – Pascal Dupond 196
www.philopsis.fr
corporelle fait partie de nous-mêmes). LE soutient que 1/ le même moi
physique (= le même homme) se conserve d’un bout à l’autre de la vie ; 2/ le
corps renouvelle constamment ses parties; il « ne peut point manquer d’en
perdre à tout moment » ; donc il n’a pas d’identité. Si on réunit ces deux
propositions, il en résulte que la diversité corporelle ne fait pas partie de
nous-mêmes; la diversité corporelle est étrangère à ce que nous appelons
“nous-mêmes”. L’identité du moi est d’un autre ordre que la diversité des
parties du corps physique ; ce qui a lieu dans le corps physique ne peut rien
nous apprendre sur la nature de l’identité du moi ; donc que le corps
physique s’altère sans altération de l’identité du moi, cela ne prouve pas que
l’identité du moi serait sans support réel, cela prouve simplement que ce
support réel ne peut pas être le corps physique. D’où la distance entre Locke
et Leibniz : Locke admet la possibilité que le socle réel de l’identité
personnelle soit le corps humain, au sens d’une multiplicité de particules
unies au même soi, et cela le conduit à souligner l’indépendance de l’identité
personnelle et de l’identité réelle : il se pourrait que le substrat réel de
l’identité personnelle change sans que change l’identité personnelle. LE
soutient que le socle réel de l’identité personnelle est un principe de vie
subsistant, une âme, absolument simple « informant » la diversité des
particules du corps humain. Que la suppression d’une partie du corps
n’entraîne aucune variation de la personne, cela nous apprend que le substrat
réel de l’identité personnelle est une âme et non un corps.
§ 12. Locke demande « si la même substance qui pense étant changée,
la personne peut être la même, ou si cette substance demeurant la même, il
peut y avoir différentes personnes ». Peut-il y avoir identité personnelle sans
identité réelle (une seule et même personne produite par plusieurs substances
ou traversant plusieurs substances) ou identité réelle sans identité person-
nelle (une substance identique recevant successivement différentes personna-
lités) ?
Pour répondre à la question, Locke distingue deux cas de figure qui
font alternative : ou bien on « fait consister la pensée dans une constitution
animale », ou bien on l’attribue à une substance immatérielle
a/ L’identité de l’animal n’est pas substantielle, puisqu’elle n’est rien
d’autre qu’une identité de « constitution » ou de vie ; conséquence : si
l’identité (personnelle) du soi est déposée dans l’identité de la constitution
animale, il est clair qu’elle n’est pas déposée dans une substance identique.
b) Supposons que la pensée et par conséquent aussi l’identité person-
nelle ne soient pas réductibles à la constitution animale. Supposons que la
pensée ait une cause immatérielle ; Locke remarque : il n’en résulte pas né-
cessairement que l’identité personnelle se conserve dans une substance iden-
tique. On ne pourrait en effet conclure de l’identité de la personne à
l’identité de la substance que si l’identité de la personne était impossible
sans identité de substance. Or rien ne permet de le soutenir. Le raisonnement
est le suivant : nous avons admis tout à l’heure que « l’identité animale se
conserve dans un changement de substances matérielles » ; on peut mainte-
nant supposer analogiquement que l’identité personnelle se conserve à tra-
vers une diversité de substances immatérielles ou qu’elle est produite à tra-
vers une multiplicité de substances immatérielle produisant la pensée. Nous
refusons d’attribuer la pensée à l’action de substances matérielles ? Nous
pensons que la pensée ne peut venir que d’une substance immatérielle ? Soit.
© Philopsis – Pascal Dupond 197
www.philopsis.fr
Mais nous ne pouvons en conclure que l’identité personnelle est l’identité
d’une seule et même substance. Si l’identité vitale de l’animal se con-
serve non pas dans une seule et même substance mais dans une structure,
l’identité à soi de la personne n’a pas davantage besoin pour se conserver
d’une substance identique.
Pour échapper à cette conséquence, il reste une issue et une seule :
montrer que l’identité vitale n’est pas, ne peut pas être une identité de struc-
ture, que la vie est l’effet d’un seul esprit immatériel ; mais alors il faut re-
connaître que rien d’essentiel ne distingue la brute et l’homme.
Locke nous met devant une alternative, dont le nœud est le concept de
vie.
Ou bien nous concevons l’identité vitale comme la permanence (non
substantielle) d’une structure matérielle; rien n’empêche alors de concevoir
la personne, sur ce modèle, comme la permanence non substantielle d’une
structure ; cette structure est-elle un agencement de parties matérielles ou un
agencement de parties immatérielles ? nous n’en savons rien ; et cela n’a pas
d’importance, car la conséquence est la même : L’identité de la personne
n’est pas l’identité d’une seule et même substance.
Ou bien la vie animale est quelque chose de plus que la permanence
non substantielle d’une structure matérielle ; mais alors elle ne peut être
qu’un principe immatériel plus ou moins analogue à ce qui est appelé par les
cartésiens « âme » ou « esprit » ; les animaux, comme les hommes pensent et
ont une âme immortelle.
§ 13. Ce nouveau moment me paraît établir ceci : même si on choisit
le second terme de l’alternative, même si on soutient que la vie vient d’un
principe immatériel, on ne peut pas pour autant en conclure que l’identité
personnelle est l’identité d’un seul et même esprit. Que l’identité d’une
personne soit l’identité d’un esprit, cela ne peut être qu’un acte de foi.
Locke argumente ainsi : il faut distinguer l’action présente et le
souvenir d’une action passée.
Quand j’agis, quand je suis dans le présent de mon action, cette action
est une avec elle-même et l’identité de l’agent que je suis est évidente ; je ne
peux pas douter d’être un seul et même agent.
Quand je me souviens d’une action passée et quand je me l’attribue,
j’identifie l’agent qui a produit autrefois une certaine pensée ou une certaine
conduite et l’agent qui s’en souvient aujourd’hui, et je dis : c’est la même
personne, c’est moi. Mais, remarque Locke, que j’identifie dans la personne
identique que j’appelle « moi » l’agent d’hier et l’agent d’aujourd’hui ne
veut pas dire qu’ils soient réellement le même, que l’agent d’hier soit
réellement le même que l’agent d’aujourd’hui. Ce qui autorise le doute sur
ce point, c’est la possibilité de l’illusion : « il est possible que ce qui n’a
jamais été puisse être représenté à l’esprit comme ayant été véritablement. Il
suffit pour s’en convaincre de penser au rêve. Je rêve que je suis assis devant
le feu, je pense être celui qui est assis devant le feu, je m’attribue l’action
d’être devant le feu. Au réveil je m’aperçois que je n’étais pas (réellement)
ce que je pensais être, que je n’étais pas réellement l’auteur de l’action que je
m’attribuais, que mon imputation était fausse. Or il y a une certaine analogie
entre le rêve et le souvenir. Dans le rêve, je m’attribue illusoirement les
qualités ou les actions, les mérites ou les démérites d’un autre (ou de moi-
même en tant qu’autre : la personne rêvée) ; pourquoi, dans le souvenir ne
© Philopsis – Pascal Dupond 198
www.philopsis.fr
m’imputerais-je pas de façon identique, identiquement illusoire, les actions
d’un autre ? Je rêve, et je suis persuadé d’avoir affaire à un seul et même
moi, alors qu’il y a une dualité : le sujet rêvant et le sujet rêvé. Je me
remémore mon passé et je dis : l’agent qui a fait cette action est le même que
celui qui s’en souvient. Mais, observe Locke, il y a là deux actions (l’action
passée et la représentation de l’action passée) et leur recouvrement dans
l’identité de cette personne que j’appelle moi ne prouve pas que l’agent soit
le même.
Dans l’effectuation présente de l’action, l’identité réelle de l’agent est
évidente ; dans le souvenir de l’action passée, l’identité réelle de l’agent est
douteuse.
Comment, dans ces conditions, s’assurer que les actions passées dont
nous souvenons, que nous imputons à notre personne, que nous intégrons à
notre identité personnelle, sont bien les nôtres, celle d’un seul et même
agent et non pas celle d’agents multiples qui se fondraient dans ce que nous
pensons être l’unité de notre personne ? Locke répond : il n’y a pas d’autre
recours (du moins « jusques à ce que nous connaissions plus clairement la
nature des substances pensantes ») que la bonté de Dieu. L’argument est très
frappant : si l’identité de la personne ne prouve pas l’identité de l’agent, si
un homme peut imputer à sa personne des actions que l’agent qu’il est n’a
pas commises, rien n’exclut qu’un homme porte comme un trait de son
identité personnelle la culpabilité d’une faute qu’un autre homme a
commise, ou qu’un homme soit, en son identité personnelle, glorieux d’une
belle action qu’il n’a pas accomplie. Locke envisage une sorte de
déconnection de l’identité personnelle et de l’identité de l’agent ou de
l’homme qui ferait que la conscience de soi éthique serait distribuée entre
les personnes sans corrélation avec les actions effectivement accomplies.
Abîme de cette analyse : le transitivisme, le transfert trans-
générationnel.
La réponse de Leibniz revient à refermer l’abîme : 1/ la pensée ne
serait pas possible (elle ne saurait pas ce qu’elle pense, donc elle serait
privée de vérité) si elle n’enveloppait pas en elle « un souvenir présent ou
immédiat », qui n’est pas l’action interne, la pensée dans le présent ou
l’instant de son effectuation mais « la conscience ou la réflexion qui
accompagne l’action interne », mais le souvenir immédiat de la pensée faute
duquel la pensée ne serait plus la pensée. Locke distinguait l’action dans son
effectuation (qui donne la certitude de l’identité de l’agent) et le souvenir
présent de l’action passée (qui ne nous permet pas de savoir si l’agent est le
même ou non). Leibniz lui répond : cette distinction est en partie factice. Il
n’y a pas d’un côté l’action (avec l’évidence de l’identité de l’agent) et de
l’autre le souvenir de l’action (et le doute sur l’identité de l’agent) ; il n’y a
pas d’action qui ne soit aussi souvenir d’elle-même, pour être l’action
qu’elle est. Et cette connexion essentielle de l’action et du souvenir de
l’action prouve que l’agent est le même. La situation est différente dans le
cas du souvenir du passé : « un souvenir de quelque intervalle peut
tromper » ; je peux m’attribuer des mérites ou des démérites qui ne sont pas
réellement les miens ; mais, précise Leibniz, on peut expliquer ce genre
d’illusion, et il n’y a donc rien en elle qui doive inquiéter : l’explication
pourra toujours départager en droit ce qui, dans ce que j’attribue à ma
personne, relève de l’agent que je suis et ce qui relève des autres.
© Philopsis – Pascal Dupond 199
www.philopsis.fr
§ 14. Au début du § 12, deux questions ont été posées :
1/ Peut-il y avoir identité personnelle sans identité réelle ? Locke
suspend son jugement. Tout son effort est de montrer que la conscience
d’être une seule et même personne ne prouve pas que nous soyons un seul et
même être. En reprenant les termes de Leibniz (qui est, sur ce point en
désaccord avec Locke), l’identité du soi apparent ne nous apprend rien sur
son socle ontologique et ne prouve pas l’identité d’un esprit.
2/ Peut-il y avoir une identité réelle sans identité personnelle ? Deux
ou plusieurs personnalités différentes peuvent-elles se succéder en une seule
et même substance immatérielle ? Locke va donner une réponse affirmative,
selon l’orientation qu’il suit depuis le début de ce chapitre et qui consiste à
désolidariser identité personnelle et identité réelle.
1/ « l’identité personnelle ne s’étend pas plus loin que le sentiment in-
térieur qu’on a de sa propre existence » (§ 14, p. 268) : l’identité personnelle
n’est rien d’autre que l’ensemble des propriétés que nous nous attribuons et
qui constituent notre identité consciente (au double sens de ce que nous pen-
sons être, et être en tant qu’un et le même). Tout ce qui appartient à ce que
nous sommes sans faire partie de la conscience de ce que nous sommes est
étranger à notre personne. Nous sommes pythagoriciens, nous sommes con-
vaincus que les âmes existent avant et après leur incarnation, qu’une même
âme traverse de multiples incarnations successives. Ce qu’elle a vécu dans
ses vies antérieures fait-il partie de sa personne présente ? Si nous supposons
qu’elle a oublié tout ce qui lui est arrivé dans ses vies antérieures, la réponse
est négative : tout ce qu’elle a vécu avant n’est rien pour elle. Un homme af-
firme être la réincarnation de Socrate ; est-il la même personne que Socrate ?
S’il n’a aucun souvenir des pensées et des actes de Socrate, il n’est pas la
même personne que Socrate, il n’y a entre Socrate et lui aucune identité per-
sonnelle. Celui qui aurait en son corps quelques particules du corps de So-
crate ne pourrait pas se dire identique personnellement à Socrate, car il man-
querait la condition de l’identité personnelle, qui est la conscience commune;
si on suppose maintenant, non plus des parties corporelles communes, mais
l’identité réelle d’une substance immatérielle qui se réincarne en plusieurs
corps successifs, rien ne change: sans conscience commune, il n’y a pas
d’identité personnelle.
On perçoit cependant chez Locke l’ombre d’une incertitude : il dit
avoir connu quelqu’un qui disait être la réincarnation de Socrate et dont les
actes n’étaient pas indignes de ceux de Socrate. Son âme était-elle celle de
Socrate ? Locke écarte la question. La seule chose qui l’intéresse, c’est de
souligner que s’il n’y a pas de continuité de souvenir, même si c’est la même
âme, ce n’est pas la même personne. Mais un certain embarras demeure : cet
homme qui disait être la réincarnation de Socrate, que pensait-il au juste en
le disant ? Exprimait-il de façon imagée son admiration pour Socrate et son
désir de ressembler à un tel modèle ? Rien ne le laisse supposer. Voulait-il
dire que sa mémoire consciente était en continuité avec celle de Socrate,
qu’il avait conscience d’être la même personne que Socrate ? Rien ne permet
non plus de le dire. Supposons que cet homme ne soit pas fou, une seule voie
demeure : l’identité réelle des différentes personnes successives peut
s’annoncer, s’exprimer, se faire reconnaître autrement que par une identité
personnelle. Entre l’identité réelle de l’être en soi (dont le paradigme est
l’atome) et l’identité personnelle de l’être pour soi (le souvenir de soi), il y
© Philopsis – Pascal Dupond 200
www.philopsis.fr
aurait une 3e voie, une façon d’être en continuité consciente avec soi-même
sans rétroréférence, sans représentation de soi dans le passé, une certaine fa-
çon d’être fidèle à soi qui ne serait ni l’aveugle persistance dans l’identité ni
le souvenir de soi. Mais Locke peut-il penser cette 3e voie ? Il est, semble-t-il
trop cartésien pour le pouvoir. Il ne reconnaît rien d’intermédiaire entre le
type d’identité qui est celui de la matière et le type d’identité qui est celui de
la pensée.
Locke ne croit pas impossible une transmigration des âmes : les âmes
sont « indifférentes à l’égard de quelque portion de matière que ce soit »
(souvenir du dualisme cartésien: l’étendue n’a aucune commensurabilité
avec les actes intellectuels), donc le passage d’une même âme en différents
corps ne renferme aucune absurdité. Mais la question n’a aucune impor-
tance : il n’y a pas d’autre mémoire que la mémoire consciente et celui qui
renaît sans mémoire consciente de son passé vient au monde pour la pre-
mière fois. La conviction de la transmigration des âmes ne présente aucune
incidence pratique
La réponse de Théophile met bien en évidence, à nouveau, ce que
Leibniz refuse dans la position de Locke : la séparation entre identité
personnelle et identité réelle. Locke pense qu’un esprit peut être dépouillé de
tout son passé, de tout sentiment de son existence passée (dans le cas d’une
amnésie accidentelle dans cette vie, mais aussi dans la supposition d’une
réincarnation « amnésique » ; si un esprit est ainsi dépouillé de son passé,
l’être demeure et la personne se brise : continuité de la substance,
discontinuité de la personne. Leibniz répond: tout dépend de ce qu’on entend
par sentiment :
1/ Si on entend par sentiment du passé le souvenir distinct, explicite,
personnel du passé, l’aperception du passé, alors la proposition est vraie; un
homme peut perdre le souvenir personnel d’une partie de son histoire, et
c’est ce que la clinique appelle l’amnésie et même nous perdons tous à un
degré ou à un autre le souvenir personnel de la plus grande partie de notre
passé, mais cela ne nous empêche pas d’être bien assuré de notre identité
personnelle.
2/ Si on entend par sentiment du passé toutes les petites perceptions
indistinctes qui entrent dans ce que nous sentons comme un poids de passé
derrière nous, alors la proposition est fausse : un être immatériel ne peut pas
être dépouillé de toute perception de son existence passée ; toute substance
rassemble et exprime dans sa perception présente la totalité de son passé et
même de son avenir, mais cette perception est confuse et comme
impersonnelle. Leibniz dit : « un être immatériel ne peut être dépouillé… ».
La proposition n’exprime pas un constat empirique (nous sentons en arrière
de nous un poids de passé ; les personnes en narco-analyse retrouvent le
souvenir d’événements qui paraissaient avoir entièrement disparus ; les
personnes qui sont plongées brutalement dans un grand danger voient parfois
défiler devant elles, comme un film en accéléré tous les événements de leur
vie) ; elle se présente comme une proposition métaphysique pouvant
recevoir une preuve rationnelle. Mais cela n’exclut naturellement pas qu’elle
puisse recevoir une confirmation de certains faits empiriques.
En distinguant la perception « sourde » du passé et la perception
distincte ou aperception, Leibniz justifie la distinction entre identité réelle et
identité personnelle : l’identité réelle consiste dans « la continuation et
© Philopsis – Pascal Dupond 201
www.philopsis.fr
liaison des perceptions », l’identité personnelle consiste dans ce qui apparaît
à la conscience de ce tissu de perception ; entre perception et aperception, il
y a bien une dénivellation mais non pas une fracture, la perception et
l’aperception, l’identité réelle et l’identité personnelle relèvent du même
ordre d’être, leur différence est de degré, non de nature: l’identité réelle est
le tissu continu de notre vie psychique confuse, et l’identité personnelle est
la part de ce tissu continu qui s’explicite en se polarisant autour du moi ; et
ainsi l’identité réelle et l’identité personnelle peuvent, au moins en droit, se
rejoindre et devenir exactement coextensives.
Revenons à la question de Locke : plusieurs personnes peuvent-elles
se succéder en une seule et même substance ? Locke dit oui, Leibniz a une
position nuancée : on peut, penserait-il sans doute, voir les choses sous un
angle qui invite à répondre oui, mais c’est malgré tout plutôt non qu’il faut
répondre… Supposons la transmigration des âme au sens où une âme,
toujours jointe au même corps subtil s’incarne successivement dans plusieurs
corps grossiers : celui de Nestor, puis celui de Socrate puis celui de quelque
moderne, disons Locke lui-même. Nestor, Socrate et Locke sont identiques
réellement; il s’agit du même être, du même tissu continu de perceptions.
L’expérience montre que Socrate ne se souvient pas de Nestor et Locke ne se
souvient pas de Socrate. Donc il ne s’agit pas de la même personne. S’agit-il
de personnes différentes ? C’est tout aussi difficile à admettre : les petites
perceptions qui font le tissu de cette âme pourraient se développer,
s’expliciter de telle sorte que Socrate se reconnaisse en Nestor comme il se
reconnaît en sa propre enfance et Locke en Socrate. Il n’y a ni la même
personne ni des personnes différentes. Cette situation de double exclusion
n’est pas très satisfaisante pour l’esprit ; ce qu’elle révèle, en fait c’est le
défaut de l’hypothèse initiale, celle de la transmigration. La pensée de
Leibniz est qu’à chaque esprit correspond une personne et qu’à chaque
personne correspond un esprit ; les termes « personne » et esprit » ont le
même référent, mais le signifient de deux façons différentes : le terme esprit
le désigne dans sa continuité réelle, le terme personne dans ce qui, de cette
continuité réelle, est distinctement identique. Et si « rien ne se néglige dans
le monde, par rapport même à la morale… », alors on peut supposer qu’un
jour le confus deviendra distinct et que l’identité personnelle sera
coextensive à l’identité réelle.
Leibniz cherche à penser, contre Locke, une continuité entre identité
réelle et identité personnelle. D’où aussi leur différence sur la question du
rapport entre âme et corps. Locke écrit au § 14 : « … les Ames étant
indifférentes à l’égard de quelque portion de matière que ce soit, autant que
nous le pouvons connaître par leur nature… ». Et Leibniz le conteste en
écrivant : « les âmes, selon mes hypothèses, ne sont point indifférentes à
quelque portion de matière que ce soit… ». Pourquoi cette différence ?
Locke ne croit pas impossible que l’identité personnelle ait pour
substrat réel une constitution animale purement matérielle. De ce point de
vue il n’est pas du tout cartésien. Mais il garde de Descartes un certain
dualisme, c’est-à-dire la conviction qu’il y a une disproportion, une
incommensurabilité entre la matière et la pensée. Il se peut que la matière ait
reçu de Dieu le pouvoir de produire la pensée ; mais si c’est le cas, ce
pouvoir est pour nous incompréhensible. Ce qui l’intéresse dans l’hypothèse
que la pensée soit produite par la constitution animale, ce n’est pas ce qu’un
© Philopsis – Pascal Dupond 202
www.philopsis.fr
« matérialiste » pourrait y voir, c’est-à-dire l’abandon de l’âme ou de
l’esprit, avec toutes connotations religieuses qui accompagnent ces concepts,
c’est plutôt la conclusion que l’identité personnelle peut être pensée par elle-
même, sans prise de position préalable sur la nature de son substrat réel, que
le concept de personne n’a pas besoin du soutien ontologique de l’âme ou de
l’esprit.
Leibniz, lui, renoue plutôt avec l’orientation aristotélicienne (qu’il
transforme aussi profondément) : il pense qu’il n’y a pas d’âme sans corps et
que l’âme et le corps sont en un sens « la même chose » en deux manières
d’être différentes : l’âme désigne comme unité et comme lumière ce que le
corps désigne comme diversité et comme opacité ; l’âme est l’expression
dans l’unité de la diversité corporelle qui lui est liée. Loin d’être incommen-
surables, âme et corps sont « le même ».
Que résulte-t-il de cette différence ?
Pour Locke, il y a alternative: où Socrate est conscient d’être Nestor et
Socrate et Nestor sont une seule et même personne ; ou Socrate n’est pas
conscient d’être Nestor, ce sont deux personnes différentes, Socrate n’est pas
Nestor. Il est vrai que nous pouvons supposer une identité réelle sans
souvenir, c’est)à-dire sans identité personnelle; mais l’identité réelle n’est
pas celle qui nous importe quand nous posons la question : Socrate et Nestor
sont-ils « le même » ou ne sont-ils pas « le même » : même si l’âme de
Nestor est passée en Socrate, si Socrate n’est pas conscient d’être Nestor,
tout se passe comme si l’âme de Nestor était morte avec Nestor, et l’âme de
Socrate née avec Socrate ; si Socrate n’a pas le souvenir de Nestor, cela n’a
aucune importance pour la vie de Socrate qu’il ait été Nestor. Locke
distingue deux types d’identité : l’identité en première personne (ou
personnelle ou « pour soi ») et l’identité en troisième personne (ou réelle ou
« en soi »). Et ces deux types d’identité sont trop hétérogènes pour
communiquer, et c’est pourquoi 1/ nous pouvons concevoir une identité
personnelle sans identité réelle et une identité réelle sans identité
personnelle ; 2/ l’identité réelle, étant séparée de l’identité personnelle, ne
joue rigoureusement aucun rôle dans la constitution ce qu’on appelle soi : si
l’âme de Nestor est celle de Socrate, mais si Socrate ne se souvient pas de
Nestor, le soi de Socrate est tout à fait étranger à Nestor. Nous sommes donc
dans le tout ou rien : il n’y a pas de médiation possible entre la proposition :
Socrate est entièrement Nestor (= la même personne que Nestor (il se
souvient de N comme de son passé) et Socrate n’est rien de Nestor.
Leibniz pense contre Locke que les âmes ne sont pas indifférentes à la
portion de matière à laquelle elles sont unies : les âmes expriment le corps
auquel elles sont jointes, elles « sont » dans l’unité et dans la lumière (la
transparence) ce que leur corps est dans la multiplicité et dans l’opacité et
parce qu’elles l’expriment, elles sont affectées par le corps. [Nous sommes
ici dans la même situation que dans la sphère du langage, d’où vient le
concept d’expression : j’exprime une idée à l’aide d’un certain matériel
linguistique : celui-ci est comme le corps de l’idée, le corps dont l’âme est
l’idée ; l’idée rassemble dans une unité simple la multiplicité du matériel
linguistique et en fait pour ainsi dire disparaître la multiplicité devant
l’attention de celui qui comprend l’idée ; mais l’idée ne transcende pas le
matériel linguistique qui en est le vecteur, elle ne peut pas se détacher de son
vecteur charnel qui en est l’incarnation et peut-être aussi la limitation]. Donc
© Philopsis – Pascal Dupond 203
www.philopsis.fr
si l’âme exprime son corps, ce corps est comme la masse inertielle de l’âme,
sa pesanteur, sa localité, sa finitude. On peut dire aussi : le corps est l’opacité
de l’âme, l’âme est la transparence du corps, ou encore : l’âme est la vie
éveillée et le corps est la vie dormante ; l’éveil et le sommeil ne sont pas ici
deux moments successifs, mais plutôt deux moments synchrones,
dialectiquement liés, d’une même vie : le corps vivant est le sommeil, l’âme
la vigilance de notre histoire ; et cette vigilance serait impossible sans le
sommeil qui en est le fond. Conséquence : tout ce qui survient à l’âme
survient au corps, tout ce qui survient au corps survient à l’âme : c’est une
seule et même série d’événements en deux langues différentes : la langue
d’une histoire personnelle (en éveil) et la langue d’une histoire
impersonnelle (l’articulation de ces deux langues est l’enjeu de la médecine
dite psychosomatique). Tout ce qu’une âme a vécu dans un certain corps
grossier lui appartient comme sa propre histoire ; et si elle revient dans un
nouveau corps grossier, comme ce corps grossier est dans une
correspondance réglée avec elle, il faudra qu’il se ressente de ce que l’âme a
vécu dans ses précédents corps grossiers et en témoigne comme le corps
grossier peut en témoigner, c’est-à-dire par des « marques réelles ». En un
sens, l’âme comme son corps grossier « sont » toute leur histoire passée
comme ils sont toute leur histoire à venir. Mais si l’âme est la part lucide,
vigilante de la vie, si l’âme est la vie se rassemblant à la pointe de la
conscience et de l’agir, alors que le corps est cette même vie mais comme en
sommeil, alors il se pourrait que notre histoire passée soit plus présente, plus
visible, plus manifeste dans la vie dormante du corps (ou dans la vie
dormante du corps du langage, dans ce qui, du corps du langage, échappe à
l’intention de dire ou à l’idée) que dans la vie vigile de l’âme : l’âme ne peut
éclairer le réel qu’en limitant son champ de conscience ; elle doit refouler
tout ce qui n’est pas nécessaire à la pertinence de son agir ; le corps lui peut
s’abandonner à l’inconscient, et comme il s’y abandonne, il peut en
témoigner, pour nous-mêmes et surtout pour les autres. Le corps est la trame
inconsciente de cette histoire que l’âme vit en première personne
Conséquence : s’il y a deux scènes pour une seule et même histoire,
alors il n’y a plus d’alternative; Socrate peut ne pas être conscient d’avoir été
Nestor, et pourtant l’avoir été, c’est-à-dire l’être au sens où cet « avoir été »
agit en son existence présente.
Leibniz conclut ainsi: « on voit par là comment les actions d’un
ancien… ». Importance du verbe appartenir. Ici encore, il s’agit d’échapper à
une alternative qui se formulerait ainsi: ou bien mes actions antérieures
m’appartiennent personnellement parce que j’en suis conscient comme des
miennes; ou bien elles m’appartiennent seulement réellement (c’est-à-dire
sans que j’en sois conscient) et alors elles sont comme si elles ne
m’appartenaient pas. Contre cette alternative, Leibniz montre que le réel et le
personnel ne sont finalement que des degrés unis par une transition
insensible, et il n’y a donc pas lieu de les opposer; on peut légitimement dire
que les actions d’un ancien m’appartiennent, si elles existent en moi en telle
façon qu’elles peuvent par développement devenir conscientes.
On voit donc bien où se situe la différence entre Locke et Leibniz. Le
souci de Locke est de dégager l’identité personnelle de toute interrogation
métaphysique sur la nature de son substrat réel, de penser la personne en
faisant abstraction de toute considération sur l’âme ou sur l’esprit qui serait
© Philopsis – Pascal Dupond 204
www.philopsis.fr
le substrat réel de la personne. Leibniz réinscrit l’identité personnelle dans
une identité réelle.
Le § 15, que Leibniz ne cite pas, a l’intérêt de bien mettre en évidence
une conséquence paradoxale résultant de la volonté d’émanciper l’identité
personnelle de toute question sur son substrat réel : la séparation entre
l’identité de l’homme et l’identité de la personne. Locke suppose qu’un
savetier meurt, que son âme quitte son corps et que l’âme d’un Prince,
« accompagnée d’un sentiment intérieur de la vie de Prince », passe tout
aussitôt dans le corps du savetier que son âme vient d’abandonner. Le Prince
d’avant le transfert et le savetier d’après le transfert sont, dit Locke, la même
personne, puisque par hypothèse, le soi conscient du Prince est passé dans le
savetier (et cette personne est responsable des actions du Prince mais non
pas de celles du savetier) ; mais comme « au jugement de tout le monde »,
c’est au corps qu’on reconnaît le même homme, le Prince d’avant et le
savetier d’après ne sont pas le même homme. En bref, après le transfert, la
personne et l’homme sont dissociés : la personne qui demeure, c’est le
Prince, l’homme qui demeure, c’est le savetier.
Locke donne un autre exemple au § 19 : si le roi du Mogol est
conscient d’avoir été Socrate dans une autre vie, ils sont la même personne
mais non le même homme. Et si Socrate dormant n’est pas conscient d’être
le même Soi que Socrate veillant, ils ont beau être le même homme, ils ne
sont pas la même personne. Effet de paradoxe : là où il y a manifestement le
même homme, l’identité personnelle peut être tout à fait absente ; et là où il
n’y a manifestement pas le même homme, l’identité personnelle peut être
tout à fait présente : dans la fiction que propose Locke, Socrate veillant a
plus d’identité personnelle avec le roi du Mogol qu’avec Socrate dormant.
Leibniz pourrait répondre (comme il le fait quand il examine un peu
plus loin une autre fiction proposée par Locke) que « la nature n’admet point
ces fictions ». A vrai dire, ce que la nature refuse, ce n’est pas la fiction
comme telle, le « fictionnel », c’est cette fiction d’un soi (de roi) qui
demeure identique en passant dans un corps (de savetier), qui demeure lui
aussi identique. Si l’âme et le corps sont inséparables, il est inévitable que le
soi du prince soit affecté d’humilité par le corps du savetier ou, à l’inverse,
le corps du savetier affecté de fierté par le soi du Prince ; le Prince ne peut
pas conserver son soi de Prince en passant dans le corps du savetier, comme
le savetier ne peut pas conserver son corps de savetier en accueillant le soi
du Prince. La fiction que refuse la nature consiste à désolidariser
complètement l’identité du corps et l’identité du soi, opération qui elle-
même résulte du parti-pris de séparer identité personnelle et identité réelle.
Le § 16 de l’Essai souligne à nouveau la différence entre identité du
soi et identité de l’homme. Je pense au déluge et à l’arche de Noé et je dis
« j’y étais » ou bien « j’ai vécu ces événements » parce que je m’en souviens
comme je me souviens de l’inondation de la Tamise de l’hiver précédent,
comme je me souviens de ce que j’ai fait l’heure d’avant, la minute d’avant,
la seconde d’avant : tous ces événements relèvent, pour Locke,
équivalemment de mon identité personnelle ; certes les premiers,
contrairement aux autres, ne relèvent pas de mon identité humaine actuelle;
les premiers ne sont pas survenus, comme les seconds, à l’homme que je
suis ; mais cela ne compte en rien pour leur appartenance à l’identité
personnelle. D’où la conclusion : si j’ai conscience d’être l’auteur d’un acte,
© Philopsis – Pascal Dupond 205
www.philopsis.fr
si ma conscience me l’adjuge comme mien, j’en suis entièrement
responsable ; cette responsabilité n’a donc pas de degré : l’acte peut avoir été
accompli il y a mille ans ou hier, la responsabilité n’en est pas modifiée [on
pourrait opposer à Locke que, dans la plupart des cas, nous n’éprouvons pas
le même degré de responsabilité vis-à-vis des fautes anciennes que vis-à-vis
des fautes récentes, parce que nous ne pouvons pas nous reconnaître dans
l’auteur de nos fautes anciennes comme nous nous reconnaissons dans
l’auteur de nos fautes récentes. La remarque de Locke est donc contre-
intuitive. Mais elle est la conséquence nécessaire du principe du « tout ou
rien » qui caractérise sa conception de l’identité personnelle.
Leibniz répond, dans le droit fil des analyses antérieures, que l’identité
personnelle n’est pas réductible à la conscienciosité et qu’elle fait intervenir
le témoignage des autres ; je ne suis pas punissable d’une mauvaise action
que je serais persuadé d’avoir commise, « si d’autres n’en conviennent
point ». Leibniz veut-il dire que je suis par principe absous des mauvaises
actions qui n’ont pas eu de témoin ? Certainement pas; il veut dire plutôt,
comme nous l’avons déjà vu, que la subjectivité n’est pas séparable de
l’intersubjectivité : chaque monade exprime le même monde que les autres,
sous une perspective singulière; donc il appartient à l’essence d’un
événement survenant à une monade d’être exprimé, d’une façon ou d’une
autre, par toutes les autres. Si j’ose dire: il n’y a pas d’événement me
survenant qui ne soit « public », qui ne relève du koinos cosmos ; donc une
action que j’ai réellement accomplie a, par nécessité d’essence, des témoins
ou plutôt des « échos » dans l’existence des autres ; et si elle n’a pas de
témoin ou d’écho perceptible par les autres, si elle relève de l’idios kosmos,
c’est que je l’ai rêvée et non effectivement accomplie. Donc une action que
je suis persuadé d’avoir accomplie ne m’est pas imputable si elle n’a pas de
témoin; et une action que je ne me souviens pas d’avoir accomplie m’est
imputable, si elle a des témoins. Le lieu du vrai n’est pas la subjectivité mais
l’intersubjectivité.
Le § 17 reprend l’idée selon laquelle les âmes sont « indifférentes à
l’égard de quelque portion de matière que ce soit ». Ici on dirait plutôt
(comme la fiction de substitution l’a montré) : la personne est indifférente à
l’égard de quelque portion de matière que ce soit. Le petit doigt fait partie de
la conscience que nous avons de nous-même. En principe, quand le petit
doigt est séparé du reste du corps, la conscience abandonne le petit doigt et
demeure dans le reste du corps ; mais il n’est donc pas absurde de supposer
que l’inverse se produise, c’est-à-dire que la conscience abandonne le reste
du corps et demeure dans le petit doigt…. Dans ce cas, dit Locke, « le petit
doigt serait la personne, la même personne ». Locke parle de façon abrégée,
il faudrait dire plutôt : il y aurait la même personne, mais le corps auquel
cette personne est liée serait cette fois le petit doigt. Le paradoxe se durcit : il
y a difficulté à imaginer que le même soi ou la même personne demeure en
passant du corps altier du roi au corps voûté du savetier ; et il y a une
difficulté encore plus grand à imaginer que la même personne demeure dans
un corps qui, cette fois, n’a plus rien d’humain. Et c’est cette difficulté que
pointe Leibniz en se référant à « la parfaite correspondance de l’âme et du
corps » ; retour à l’inspiration d’Aristote : que nous disions que l’homme est
le plus intelligent des animaux parce qu’il se tient droit et qu’il a des mains
ou qu’il se tient droit et qu’il a des mains parce qu’il est le plus intelligent
© Philopsis – Pascal Dupond 206
www.philopsis.fr
des animaux, âme et corps sont le même (en deux manières d’être
différentes).
§ 18. La réflexion de Locke s’oriente ici vers des questions d’ordre
juridique et moral. Si le soi abandonne le reste du corps et rejoint le petit
doigt, il reste responsable, après la séparation, de toutes les actions qu’il a
accomplies avec le corps entier. Supposons que ce corps, que le soi a
abandonné pour rejoindre le petit doigt, reçoive une âme ou une personnalité
nouvelles : toutes les actions accomplies par cette personne sont
indifférentes au soi qui est passé dans le petit doigt.
A travers ces fictions qui sont passablement arbitraires, Locke veut
établir que le droit et la morale ne s’embarrassent pas de questions
métaphysiques portant sur l’être sous-jacent à la personne : cet être peut être
matériel ou spirituel, un ou multiple ; du moment qu’il produit l’identité d’un
soi ou d’une personne, les conditions de l’imputation et de la responsabilité
sont pleinement réunies.
Leibniz ratifie en un sens la position de Locke : la condition de
l’imputation et de la responsabilité, c’est bien l’existence d’un soi conscient,
capable de s’attribuer à lui-même des actions. Si nous supposons que Dieu
transfère le soi conscient d’un âme à une autre, ces deux âmes doivent être
considérées du point de vue des notions morales comme la même : la
responsabilité suit la personne et est indifférente à l’être qui en est le
substrat. Mais à nouveau, il s’agit pour Leibniz d’une fiction arbitraire : si
cette supposition se réalisait, il y aurait divorce entre l’aperceptible (deux
êtres réels différents) et la vérité (une seule et même personne).
Le § 20 de l’Essai propose un nouvel argument pour établir la
différence entre l’identité de la personne et l’identité de l’homme, argument
emprunté lui aussi à une sorte de consensus sur ce qui est de droit.
Supposons qu’un homme ayant sa raison devienne fou ou qu’un homme fou
retrouve sa raison; selon le sentiment du genre humain, il ne faut pas punir
l’homme devenu fou pour les fautes commises par l’homme ayant sa raison
ni punir l’homme qui a retrouvé sa raison pour les fautes commises par
l’homme fou. Pourtant personne ne doute qu’il ne s’agisse du même homme;
il y a donc bien consensus pour dissocier l’identité de la personne et
l’identité de l’homme et pour diriger l’imputation vers la personne et non
vers l’homme.
Leibniz reconnaît la justesse de l’observation mais en donne une tout
autre analyse. Il commence par donner de la peine une lecture utilitariste ;
puis il montre que si l’homme devenu fou n’est pas puni pour les actions
accomplies quand il avait sa raison, ce n’est pas parce que l’homme fou et
l’homme ayant sa raison feraient deux personnes, c’est tout simplement
parce que le châtiment ne présente pas, pour le fou, la signification
rétributive qui le justifie; si un homme ayant sa raison commet des fautes
avant de devenir fou, la justice attendra un éventuel retour de sa raison pour
lui faire subir le châtiment. Et cela montre, contre Locke, qu’il y a consensus
pour admettre qu’un homme est une seule et même personne (et une
personne punissable), même s’il perd la mémoire de ses actions passées,
même s’il perd la raison (évidemment cela suppose que l’identité de la
personne ne se réduise pas à la conscienciosité et qu’il y ait une continuité
entre identité personnelle et identité réelle.
Le § 21 montre à nouveau que l’identité d’une personne est l’identité
© Philopsis – Pascal Dupond 207
www.philopsis.fr
d’une conscience et non pas l’identité d’un homme, et cela quelle que soit la
conception que l’on ait de ce qui fait l’identité d’un homme.
§ 22. Locke se fait à lui-même une objection. Un homme en état
d’ivresse, un somnambule (ou, comme dit Leibniz, un « noctambule ») font
un acte répréhensible dont ils disent ne plus se souvenir, l’un quand il est
dégrisé, l’autre quand il se réveille. Selon la théorie de Locke ils devraient
être absous par le défaut de conscience ou de souvenir. Or on admet
communément que les fautes commises dans ces circonstances sont
punissables. Faut-il en conclure que la punition frappe l’homme et non la
personne ? Non, répond Locke. C’est bien la personne qui est punie. On
présume simplement, par défaut de preuve du contraire, qu’elle était
consciente au moment de l’acte et que sa dénégation est de mauvaise foi. La
justice humaine ne peut pas sonder les reins et les cœurs, et elle n’en doit pas
moins séparer le coupable et le non coupable, les cas où l’altération de la
conscience est censée avoir brisé la continuité de la personne et les cas où
elle est censée l’avoir préservée ; la seule solution est de prendre en compte
non pas le facteur subjectif (ce que l’auteur de l’acte dit de son acte) mais les
facteurs objectifs (l’altération de la personnalité est manifestement plus
profonde dans la psychose que dans l’ivresse ou dans le somnambulisme).
Faillibilité de la justice humaine. Appel à la justice divine qui est seule juste.
On notera enfin que la proposition : « …étant accusé ou excusé par sa
propre conscience » se prête à deux lectures (conscience = souvenir et
conscience = conscience morale, aptitude à discriminer le bien et le mal) et
conduit à une difficulté : selon la pensée de Locke, l’innocent est excusé par
sa conscience comme le coupable est accusé par la sienne; mais on pourrait
objecter à Locke que l’innocent (qui développe une conscience scrupuleuse)
est toujours disposé à s’accuser tandis que le coupable (qui perd la
conscience de ses fautes par la répétition) est toujours porté à s’excuser ; et
si la conscience inverse ainsi la réalité, c’est toute la justification de la peine
par la conscience qui devient défaillante.
Leibniz déplace la question du plan juridique au plan pragmatique : le
but de la punition est d’empêcher la récidive. L’ivresse est punissable parce
que, même si elle brise la continuité de la personne, la volonté y intervient
assez pour que la punition ait un effet dissuasif et prévienne la récidive ; le
somnambulisme relève plutôt de la maladie, et cela le soustrait à la punition,
sauf s’il s’avérait que la punition est dans ce cas aussi dissuasive.
Leibniz évoque aussi la difficulté qui vient d’être mentionnée : celui
qui est innocent aux yeux de Dieu peut se considérer lui-même et être
considéré par les autres comme un coupable (et à l’inverse, celui qui est
coupable aux yeux de Dieu peut se considérer lui-même et être considéré par
les autres comme un homme de bien) ; si l’on suit le raisonnement de Locke,
l’innocent sera puni et le coupable sera récompensé. Les dispositions de la
conscience humaine ne peuvent donc pas être le critère ultime du jugement
(d’autant que les dispositions de la conscience peuvent être modifiées par le
jugement : la conscience de la faute peut non pas précéder mais suivre le
châtiment)
Le § 23 propose une fiction pour faire comprendre que l’identité
personnelle est l’identité d’une conscience et non pas l’identité d’un être.
Locke suppose qu’un même individu est visité successivement par deux
personnalités différentes, une pendant le jour, l’autre pendant la nuit, et
© Philopsis – Pascal Dupond 208
www.philopsis.fr
qu’inversement une seule et même personnalité visite successivement deux
individus différents. Dans le premier cas, nous avons deux personnes dans le
même être, dans le second cas, la même personne en deux êtres différents
(comme un homme est le même en deux habits différents).
La réponse de Leibniz consiste évidemment à refonder dans l’être
l’identité personnelle. En premier lieu, il reprend la fiction de Locke, mais en
soulignant qu’elle doit être modifiée (car en elle-même elle est abstraite et
contradictoire : une fiction peut s’affranchir du réel mais non pas du
possible). Supposons le transfert dont il a été question un peu plus haut :
l’esprit du prince passe dans le corps du savetier. Qu’est-ce qui est au juste
transféré ? Locke dit : c’est la personnalité ou la conscience. Leibniz
répond : pour que l’échange se fasse sans contradiction, ce n’est pas la seule
personnalité qui doit passer du Prince au savetier mais, avec elle, « toutes les
apparences » : apparence à soi et apparence aux autres, dont le corps visible
fait évidemment partie ; si le transfert ne concerne pas toutes les apparences,
il y aura « contradiction entre les consciences des uns et le témoignage des
autres » (si la personne du prince entre dans le corps du savetier, elle dit par
la bouche du savetier : je suis le prince, mais les autres pensent : le savetier
est devenu fou, voilà qu’il se prend pour le Prince, bref la discordance est
inévitable). Nous devons au moins supposer, pour que la fiction ne soit pas
absurde, un transfert qui concerne toutes les apparences, ce qui veut dire que
quand il « passe » dans le savetier, le prince conserve son corps de prince.
Que peut-on conclure de la fiction ainsi modifiée ?
1/ Il faut concéder à Locke qu’en ce cas, « l’identité personnelle
suivrait les apparences constantes que la morale humaine doit avoir en vue »,
il y aurait donc bien, en un sens, séparation, désolidarisation entre l’être et
l’apparence ;
2/ même ainsi rectifiée (pour ne pas être contradictoire), la fiction
proposée n’est possible que sous la supposition d’un miracle, le miracle d’un
« divorce entre monde insensible et sensible ». L’idée de Leibniz est qu’il est
impossible de séparer une substance de son acte ou de son opération, car cet
acte ou cette opération sont la substance elle-même [sur ce thème, voir
Descartes, Principes, I, 63] ; il est impossible de la séparer des petites
perceptions qui en sont, si l’on peut dire, l’acte minimal et qui sont elles-
mêmes inséparables des perceptions conscientes. La fiction selon laquelle les
apparences passeraient d’une substance à une autre est donc contradictoire
puisqu’elle implique que l’on sépare ce qui est en vérité inséparable, c’est-à-
dire la substance et son acte (et dans l’acte même, qui est à la fois effort et
représentation, le sensible et l’insensible). Donc la fiction proposée par
Locke n’est pensable que si l’on se donne le droit de déchirer contre l’ordre
des choses (donc par miracle) le tissu continu qui unit dans la vie de l’esprit
l’insensible et le sensible, en conservant à la substance les petites
perceptions qui en sont l’acte minimal et en transférant à une autre substance
toutes les apparences. Pour résumer : même rectifiée, le fiction de Locke est
en contradiction avec l’ordre des choses, et cela rend sa valeur heuristique
problématique (d’où la question générale : de quoi une fiction peut-elle
s’affranchir, de quoi ne peut-elle pas s’affranchir ?)
Leibniz va donc proposer une autre fiction qui, elle, sera conforme à
l’ordre des choses (au sens où il n’est plus question de transférer les seules
apparences sensibles d’une substance à une autre. Soient deux terres T et
© Philopsis – Pascal Dupond 209
www.philopsis.fr
T’sensiblement semblables (en deux lieux ou deux temps différents de
l’univers) et deux populations sensiblement jumelles A et A’, B et B’
(sensiblement jumelles = jumelles selon les apparences intérieures et
extérieures). On suppose que Dieu substitue, d’une terre à l’autre, non plus
seulement les apparences internes et externes des individus, mais les
individus eux-mêmes (c’est-à-dire, dit Leibniz, les esprits seuls ou bien les
esprits joints aux corps (cela ne fait pas de différence puisque le corps est
une façon d’apparaître de l’être réel). Donc A’ qui était en T’ passe en T
dans le moment où A qui était en T passe en T’. Personne ne pourrait, il faut
l’accorder à Locke, s’apercevoir de la substitution (du point de vue de l’être,
il y aurait eu substitution mais du point de vue des apparences, rien n’aurait
changé). Mais qu’est-ce qu’on gagne avec la fiction ainsi rectifiée ? Pas
grand chose : l’important est ailleurs. Leibniz montre que la fiction qu’il
propose et que Locke ne peut pas récuser (puisqu’elle n’est rien d’autre que
la fiction de Locke affranchie de contradiction) rend manifeste l’absurdité de
la réduction de la personne à la conscienciosité. On laisse tomber la question
du transfert et on se demande simplement, en considérant chaque couple de
jumeaux (A et A’, B et B’, etc) , si ce sont deux personnes ou la même, deux
soi ou le même soi. D’un côté, on est obligé de dire : il y a deux personnes
puisque les deux champs de conscience ont une localité différente, l’un est
situé sur une terre, l’autre sur l’autre terre ; mais en même temps, si on réduit
la personne à la conscienciosité, on est obligé de dire : il n’y a là qu’une
seule (puisque nous les supposons indiscernables). Donc on est conduit à
une contradiction. Il est vrai que la contradiction disparaît dès le moment où
nous supposons un esprit, divin ou autre, « capable d’envisager les
intervalles et rapports externes des temps et lieux » (ce serait la solution de
Locke), elle se résout aussi si l’on considère les constitutions internes
insensibles des hommes habitant les deux terres (ce serait la solution de
Leibniz). Mais ces deux solutions font intervenir un facteur étranger au
noyau de la théorie lockienne : si on s’en tient à ce noyau, si on réduit la
personne à la conscienciosité, « sans se mettre en peine de l’identité ou
diversité réelle des substances », la contradiction est insurmontable.
Pour résumer : Leibniz paraît reprocher à Locke une subtile
incohérence : il soutient que l’identité personnelle peut être pensée sans
référence à quelque chose qui serait de l’ordre de l’identité réelle, il construit
des fictions illustrant que l’identité d’une personne est indépendante de toute
identité humaine (la personne du Prince passe dans l’homme savetier), il
réduit la personne à la conscienciosité, mais tout cela ne marche pas : à un
moment la pensée de Locke est rattrapée par le réel, il lui faut reconnaître
que l’identité personnelle est ancrée dans une identité réelle, c’est-à-dire
l’identité d’un homme. Sans cet ancrage, nous tombons dans la
contradiction.
Que pourrait répondre Locke ? Il pourrait répondre d’abord qu’il n’a
jamais douté de l’ancrage réel de l’identité personnelle ; il a seulement douté
que nous puissions en déterminer la nature et savoir si le substrat de
l’identité personnelle est matériel ou spirituel ; il a aussi douté qu’il y ait un
lien infrangible entre l’identité de la personne et son substrat réel ; il a
imaginé le transfert d’une personne d’un substrat à un autre, ce qui
évidemment ne suppose pas qu’une personne puisse être indépendante de
tout substrat. Et Locke ajouterait : il n’y a aucune contradiction à imaginer
© Philopsis – Pascal Dupond 210
www.philopsis.fr
non pas deux personnes qui seraient une seule personne (car si on s’exprime
ainsi, la contradiction est inévitable), mais deux hommes (différents par le
lieu ou le temps) qui seraient une seule personne ; si nous supposons deux
mondes semblables, pourquoi une même personnalité ne serait-elle pas
partagée par plusieurs êtres réels ? Cela fait disparaître la contradiction.
Cette réponse est-elle suffisante ? Probablement non. Mais pour en
évaluer les limites, il serait nécessaire d’abord mieux distinguer, avec
Ricœur, l’identité au sens de l’idem et l’identité au sens de l’ipse.
§ 24. Locke établit à nouveau que le soi n’est rien d’autre que
conscience et qu’il n’y a pas d’autre façon d’être un seul et même soi qu’en
étant une seule et même conscience. Que nous donnions au soi un substrat
matériel ou immatériel ne change rien : le soi est le même par l’identité de la
conscience.
Je suis un soi qui se sent dans la substance dont il est présentement
composé (dans la totalité de son corps sensible). Je peux reporter au passé ce
lien entre le soi et la substance (matérielle) dans laquelle il se sent et prendre
ainsi conscience d’une certaine permanence de ce soi incarné. L’identité de
la personne que je suis n’est pas l’identité, le souvenir de soi d’une personne
désincarnée, c’est l’identité, le souvenir de soi d’une personne qui se sent
dans tout son corps ; mais que le soi soit incarné, que l’identité du soi soit
l’identité d’un soi incarné ne veut pas dire que l’identité de ce soi incarné lui
viendrait de l’incarnation, du corps et non de la conscience ; supposons que
nous privions de conscience soit une partie soit le tout du corps, ils ne font
plus partie du soi. Donc ils ne faisaient partie du soi que par la conscience ;
c’est donc la conscience qui fait l’identité du soi incarné.
De même si je suppose que je suis une substance spirituelle ayant
accompli des actes dont je ne me souviens plus, ces actes me sont aussi
étrangers que s’ils avaient été accomplis par une tout autre substance.
Ce qui confirme que la personne n’est rien d’autre que conscience.
§ 26. La notion de personne a, à l’origine, dans le droit romain, une
signification juridique; et cette signification est constamment présente dans
les réflexions de Locke et de Leibniz Si « le mot de personne est un terme de
Barreau qui approprie des actions et le mérite ou le démérite de ces
actions… », la question de la personne, c’est d’abord celle du rapport entre
l’agent et son action, la question des modalités de l’attribution d’une action à
un agent. A la question : qu’est-ce qu’on veut dire quand on dit que
quelqu’un est l’auteur d’une action ? Locke répond : ce n’est rien d’autre que
la reconnaissance par la conscience de l’agent de cette action comme sienne.
Conséquence pénale: pour qu’il y ait châtiment, il est nécessaire que le
coupable se souvienne de l’action qui est punie et la reconnaisse entièrement
comme sienne.
La réponse de Leibniz est dans le droit fil de ce qui précède. Leibniz
cherche constamment à limiter l’importance de la conscience de soi dans la
définition de la personne et des actions qui lui sont imputables ; il va donc ici
préciser que la reconnaissance ou l’aveu par une conscience de certaines
actions comme siennes ne doit pas être considéré comme le fondement de
l’imputation ; le témoignage d’autrui suffit, ou, en dernier ressort, la
connaissance qui sonde les reins et les cœurs et qui sait ce qui appartient à
l’un et ce qui appartient à l’autre. Locke suspend l’attribution, l’imputation à
la conscience de l’agent (ce qui m’appartient, c’est ce que je reconnais
© Philopsis – Pascal Dupond 211
www.philopsis.fr
comme mien. Leibniz fait revenir l’attribution dans la constitution de la
réalité : ce qui m’appartient, ce qui appartient à un être, c’est ce qui est
inscrit dans son essence ; pour nous, qui ne contemplons pas l’essence des
êtres, il peut y avoir du doute sur ce qui appartient à l’un ou à l’autre (et on
pensera à la difficulté, dans une instruction pénale à savoir précisément ce
qu’a fait l’un et ce qu’a fait l’autre) ; mais devant Dieu, qui lit les essences,
l’imputation retrouve sa transparence (et Leibniz ajoute : pour que le
châtiment soit juste, il n’est pas nécessaire que le coupable en connaisse la
raison; il suffit que « d’autres esprits mieux informés » y trouvent matière à
glorifier la justice divine).
§ 27. Locke rappelle que l’hypothèse qui a été formulée dans ce
chapitre (l’autonomie de l’identité personnelle) est autorisée par l’ignorance
concernant la nature de la chose pensante et son rapport au corps. Il est
possible que la chose pensante ne puisse penser et se souvenir hors d’un
corps organisé, il est possible que ses facultés soient dépendantes non
seulement de son union à un corps mais de son union à tel corps et de
l’intégrité des organes de ce corps. Si tel était le cas, il n’y aurait plus
d’autonomie de l’identité personnelle. En l’absence de toute connaissance
certaine sur ce sujet, on admet habituellement que l’esprit humain est une
substance immatérielle ; et s’il est une substance immatérielle il n’y a aucune
contradiction à supposer qu’il soit uni successivement à différents corps
(Locke paraît être ici en deçà de ce que sa pensée a de plus interrogatif).
§ 28. Il y a plusieurs catégories d’être : les substances, les modes, les
composés de substance, enfin les composés de modes. Dans tous ces cas de
figure l’identité est attachée à la continuité d’existence. Concernant l’identité
personnelle, la difficulté est de savoir de quelle catégorie d’être elle relève
mais non pas de savoir ce qu’elle signifie en tant que telle (car elle signifie
toujours une continuation dans le temps d’une identité instantanée à soi).
§ 29. Que voulons-nous dire quand nous disons « c’est le même
homme » ? Locke répond : cela dépend de notre idée de l’homme. Trois cas
de figure sont possibles :
Si l’homme consiste et consiste seulement en un esprit raisonnable
(qui est aussi, comme tel, un soi conscient de soi), alors, tant que cet esprit
demeure (tant que la personnalité consciente d’elle-même demeure), joint ou
non à un corps, le même homme demeure (l’homme a la même identité que
son esprit raisonnable).
Si l’homme consiste dans l’union d’un esprit raisonnable à une
certaine configuration de parties, le même homme demeure tant que cette
union persiste, alors même que les parties matérielles associées dans cette
configuration se renouvellent constamment.
Si enfin, elle consiste dans une certaine configuration ou forme de
parties matérielles unies vitalement dans un composé dont la forme demeure,
le même homme demeure tant que cette configuration subsiste.
Théophile répond à son interlocuteur que la distinction des significa-
tions a certes son importance, mais n’épuise pas le fond de la question de
l’identité. « Je vous ai montré la source de la vraie identité physique » : iden-
tité physique = identité réelle ; un homme a une identité réelle de sa nais-
sance à sa mort ; et cette identité réelle s’étend même bien au delà de sa
naissance et au delà de sa mort ; la source de cette identité réelle est un
« principe de vie subsistant » ; « la morale [= l’identité personnelle, qui est
© Philopsis – Pascal Dupond 212
www.philopsis.fr
aussi l’identité morale au sens où elle est le principe de le responsabilité] n’y
contredit pas, non plus que le souvenir » : cette identité réelle est en partie
aussi une identité apparente au sens d’une identité consciente ou person-
nelle et cette identité personnelle ne saurait contredire l’identité physique,
puisqu’elle n’en est que la frange lumineuse ; cette identité morale et le sou-
venir « ne sauraient toujours marquer l’identité physique à la personne
même… » : l’identité apparente (c’est-à-dire la part de l’identité réelle qui
entre dans l’apparaître ou dans la conscience – de soi ou des autres) et
l’identité réelle ne seront jamais pour nous coextensives, mais l’une ne sau-
rait contredire l’autre : il y a toujours un tiers (et en dernier ressort : Dieu)
pour rétablir l cohérence, l’unité de l’apparent et du réel.
Pour conclure. Locke n’est pas opposé à la réunion de l’identité per-
sonnelle et de l’identité réelle (début du § 25) et il rejoint de ce point de vue
Leibniz ; il dit seulement : on ne gagne rien, pour penser ce qu’est une per-
sonne à fonder l’identité de la personne sur l’identité d’une substance. Le
concept de substance ne nous aide en rien à comprendre ce qu’est une per-
sonne. Quant à Leibniz, s’il défend la fondation de l’identité personnelle sur
une identité réelle, c’est certainement pour des raisons éthico-juridiques;
mais c’est aussi pour montrer que le soi plonge dans l’inconscient et qu’il
faut dépasser l’opposition cartésienne de la 1e personne et de la 3e personne.
© Philopsis – Pascal Dupond 213
You might also like
- Fragments de DemocriteDocument9 pagesFragments de DemocritecedrelleNo ratings yet
- Le Tournant LinguistiqueDocument7 pagesLe Tournant LinguistiqueFatoumata FofanaNo ratings yet
- Spleen Et Idéal - Charles Baudelaire Et Victor HugoDocument5 pagesSpleen Et Idéal - Charles Baudelaire Et Victor Hugobeebac2009No ratings yet
- RAPIN René - Histoire Du JansénismeDocument531 pagesRAPIN René - Histoire Du Jansénismejanuspoquelin37No ratings yet
- Pensées de Blaise Pascal - Fragments 425 et 430 : le divertissement: Commentaire de texteFrom EverandPensées de Blaise Pascal - Fragments 425 et 430 : le divertissement: Commentaire de texteNo ratings yet
- L'ecole LyonnaiseDocument2 pagesL'ecole LyonnaiseRay Hanna100% (1)
- Notes Sur L'écologie D'aldo Leopold ("Almanach D'un Comté Des Sables")Document1 pageNotes Sur L'écologie D'aldo Leopold ("Almanach D'un Comté Des Sables")the_existentialistNo ratings yet
- L'Enfer de Dante Alighieri (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreFrom EverandL'Enfer de Dante Alighieri (Fiche de lecture): Analyse complète et résumé détaillé de l'oeuvreNo ratings yet
- Augustin D'hipponeDocument22 pagesAugustin D'hipponeAlfredo Matos100% (1)
- Ruyer Raymond Ruyer Par Lui MemeDocument13 pagesRuyer Raymond Ruyer Par Lui Memenadhamz100% (1)
- Penser Le Mal À L'âge Classique - Leibniz, Spinoza, MalebrancheDocument45 pagesPenser Le Mal À L'âge Classique - Leibniz, Spinoza, MalebrancheMondetNo ratings yet
- Candide ou l'Optimisme de Voltaire (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)From EverandCandide ou l'Optimisme de Voltaire (Analyse approfondie): Approfondissez votre lecture de cette œuvre avec notre profil littéraire (résumé, fiche de lecture et axes de lecture)No ratings yet
- Bernanos - Un Itinéraire Spirituel 2Document20 pagesBernanos - Un Itinéraire Spirituel 2duckbannyNo ratings yet
- Mémoires (Saint-Simon) Tome 2Document619 pagesMémoires (Saint-Simon) Tome 2BileonetNo ratings yet
- Lethique Du Pardon Chez Paul RicoeurDocument12 pagesLethique Du Pardon Chez Paul RicoeurRosa AminaNo ratings yet
- Fin de partie - Le comique de la pièce : sélection d'extraits - Samuel Beckett (Commentaire de texte): Document rédigé par Natacha CerfFrom EverandFin de partie - Le comique de la pièce : sélection d'extraits - Samuel Beckett (Commentaire de texte): Document rédigé par Natacha CerfNo ratings yet
- AcynismeDocument18 pagesAcynismeJohann Sebastian MastropianoNo ratings yet
- Essence et absolu, vaches sacrées de la philosophieFrom EverandEssence et absolu, vaches sacrées de la philosophieRating: 4 out of 5 stars4/5 (1)
- Hegel Et La ThéologieDocument29 pagesHegel Et La ThéologiefelipeassmarNo ratings yet
- Vers Le Dieu 1 Le Soufisme Dibn ArabDocument18 pagesVers Le Dieu 1 Le Soufisme Dibn ArabDaboNo ratings yet
- Berdiaev - L Esprit Religieux de La Philosophie Russe PDFDocument17 pagesBerdiaev - L Esprit Religieux de La Philosophie Russe PDFbergzauberNo ratings yet
- Essais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsFrom EverandEssais d'un dictionnaire universel: Contenant généralement tous les mots François tant vieux que modernes, & les termes de toutes les Sciences & des ArtsNo ratings yet
- Valeur Morale Joie SpinozaDocument7 pagesValeur Morale Joie SpinozasantseteshNo ratings yet
- Nicolas de Condorcet: La défense de la Révolution et de la république des LumièresFrom EverandNicolas de Condorcet: La défense de la Révolution et de la république des LumièresNo ratings yet
- Paul Allard Les Origines Du Servage en FranceDocument334 pagesPaul Allard Les Origines Du Servage en FranceneirotsihNo ratings yet
- Edgard Poe et ses oeuvres: Une biographie méconnue de Verne consacrée au maître du suspenseFrom EverandEdgard Poe et ses oeuvres: Une biographie méconnue de Verne consacrée au maître du suspenseNo ratings yet
- Montaigne Sur Les BoiteuxDocument15 pagesMontaigne Sur Les BoiteuxGaltier Julien100% (1)
- Cours Familier de Littérature (Volume 4) Un Entretien par MoisFrom EverandCours Familier de Littérature (Volume 4) Un Entretien par MoisNo ratings yet
- L3 - La Technique - Corpus PDFDocument24 pagesL3 - La Technique - Corpus PDFmabox965100% (1)
- La philosophie mystique en France à la fin du XVIIIe siècle: Saint-Martin et son maître Martinez PasqualisFrom EverandLa philosophie mystique en France à la fin du XVIIIe siècle: Saint-Martin et son maître Martinez PasqualisNo ratings yet
- Libre ArbitreDocument14 pagesLibre ArbitreAnge Aristide DjedjeNo ratings yet
- Pedro Álvares Cabral, sur les pas de Vasco de Gama: Le Brésil au hasard des alizésFrom EverandPedro Álvares Cabral, sur les pas de Vasco de Gama: Le Brésil au hasard des alizésNo ratings yet
- L'histoire en Transe. Le Temps Et L'histoire Dans L'œuvre de Glaubert Rocha (These de Cristiane Nova)Document398 pagesL'histoire en Transe. Le Temps Et L'histoire Dans L'œuvre de Glaubert Rocha (These de Cristiane Nova)Cristiane NovaNo ratings yet
- La Perfectibilité Chez CondorcetDocument9 pagesLa Perfectibilité Chez CondorcetHammadi AbidNo ratings yet
- Les opinions et les croyances : Genèse, Évolution: édition intégrale annotéeFrom EverandLes opinions et les croyances : Genèse, Évolution: édition intégrale annotéeNo ratings yet
- Jacques D'Hondt - La Critique Hégélienne de La MétaphysiqueDocument19 pagesJacques D'Hondt - La Critique Hégélienne de La MétaphysiqueannipNo ratings yet
- La philosophie dans le boudoir: Analyse complète de l'oeuvreFrom EverandLa philosophie dans le boudoir: Analyse complète de l'oeuvreNo ratings yet
- La Condition Des Femmes Au XVIIe SiècleDocument9 pagesLa Condition Des Femmes Au XVIIe SiècleBiró-Merczel AnnaNo ratings yet
- Le Prince de Machiavel (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreFrom EverandLe Prince de Machiavel (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreNo ratings yet
- L'éducation de GargantuaDocument4 pagesL'éducation de GargantuaJustine PALUSNo ratings yet
- Troncy, Il Faut Reconstruire L'haciendaDocument4 pagesTroncy, Il Faut Reconstruire L'haciendatchoukpNo ratings yet
- KleinDocument44 pagesKleinJulio Premat100% (1)
- Sonnet Pour HélèneDocument6 pagesSonnet Pour HélèneSHARK VAVA100% (1)
- Thème 2 Invitation Au VoyageDocument4 pagesThème 2 Invitation Au VoyageFlorian EnteNo ratings yet
- Lettre À MénécéeDocument3 pagesLettre À Ménécéee.toile100% (2)
- ROPER. L'amour - Le Mot Grec Pour Le DireDocument7 pagesROPER. L'amour - Le Mot Grec Pour Le DireB_The_ResourcererNo ratings yet
- Tariq Ramadan - Le Coran Et Le CoeurDocument5 pagesTariq Ramadan - Le Coran Et Le CoeurMlleOKNo ratings yet
- Labyrinthe 294 4 Maupassant Et La Vision FantastiqueDocument9 pagesLabyrinthe 294 4 Maupassant Et La Vision FantastiqueGhilès H-gNo ratings yet
- Vinculum SubstantialeDocument151 pagesVinculum SubstantialeAndré BernardesNo ratings yet
- Taine Origine t4 Gouv RevDocument670 pagesTaine Origine t4 Gouv RevAndré BernardesNo ratings yet
- Taine Origine t5 ModerneDocument784 pagesTaine Origine t5 ModerneAndré BernardesNo ratings yet
- Taine Origine t2 AnarchieDocument493 pagesTaine Origine t2 AnarchieAndré BernardesNo ratings yet
- DecouverteDocument240 pagesDecouverteAndré BernardesNo ratings yet
- Dictionnaire de Théologie Catolique, Vol. 15, Parte IDocument784 pagesDictionnaire de Théologie Catolique, Vol. 15, Parte IFrancesco Patruno100% (1)
- Compilation de Textes Sur Les Merites de La Science Et Le Mal de Lignorance 1Document34 pagesCompilation de Textes Sur Les Merites de La Science Et Le Mal de Lignorance 1im ONo ratings yet
- La Salafiyyah Est L'islam Authentique: Une Voie Unique Et Non MultipleDocument21 pagesLa Salafiyyah Est L'islam Authentique: Une Voie Unique Et Non MultiplefadNo ratings yet
- AkalaDocument88 pagesAkalaⵎⴰⵙⵙ ⵏⵏⵙⵏNo ratings yet
- Comment Enseigner L Histoire Au Cycle 3Document7 pagesComment Enseigner L Histoire Au Cycle 3Tatiana BourgatteNo ratings yet
- Dimo GarciaDocument70 pagesDimo GarciadiminchiNo ratings yet
- La Lutte ContreDocument506 pagesLa Lutte ContreCfca AntisemitismNo ratings yet
- 2 Nature Et CultureDocument2 pages2 Nature Et CultureMame Ali Amadou DIEYENo ratings yet
- Respect Du DépôtsDocument7 pagesRespect Du DépôtsNIARENo ratings yet
- 12 Copie PDFDocument7 pages12 Copie PDFJean-Paul Yves Le GoffNo ratings yet
- Colloque LausanneDocument18 pagesColloque LausanneBAKARY SYLLANo ratings yet
- Sainte Marguerite Marie ChantsDocument13 pagesSainte Marguerite Marie ChantsJordi PifarréNo ratings yet
- Dieu N'est Pas Grand - Comment La Religion Empoisonne Tout (PDFDrive)Document265 pagesDieu N'est Pas Grand - Comment La Religion Empoisonne Tout (PDFDrive)Seydina Ousmane DraméNo ratings yet
- (Tome 1) "De Moïse À Mohammed, L'islam Entreprise Juive" Par Le Père Gabriel Théry (Hanna Zakarias)Document351 pages(Tome 1) "De Moïse À Mohammed, L'islam Entreprise Juive" Par Le Père Gabriel Théry (Hanna Zakarias)vbeziau100% (6)
- Le Predicateur Et Son Message - Alfred GibbsDocument471 pagesLe Predicateur Et Son Message - Alfred Gibbsrenel cheryNo ratings yet
- Combattre Lesprit de SorcellerieDocument7 pagesCombattre Lesprit de SorcellerieAHUI EPOUAN AGENORNo ratings yet
- Ceillier, Bauzon. Histoire Générale Des Auteurs Sacrés Et Ecclésiastiques (Nouvelle Édition) - 1858. Volume 5.Document688 pagesCeillier, Bauzon. Histoire Générale Des Auteurs Sacrés Et Ecclésiastiques (Nouvelle Édition) - 1858. Volume 5.Patrologia Latina, Graeca et OrientalisNo ratings yet
- Amorth Gabriele - Exorcisme Et PsychiatrieDocument246 pagesAmorth Gabriele - Exorcisme Et PsychiatrieMichel BeelNo ratings yet
- 1 Dons Spirituels, Charisme Et SpiritualitéDocument1 page1 Dons Spirituels, Charisme Et SpiritualitéJoel AbisseyNo ratings yet
- Hermeneutique - L'interprétation de La Bible - Jean Sebastien MorinDocument42 pagesHermeneutique - L'interprétation de La Bible - Jean Sebastien MorinHaguin Harry Mbuya100% (1)
- 172 Jours Pour Heriter Du Royaume Des Cieux PDFDocument374 pages172 Jours Pour Heriter Du Royaume Des Cieux PDFLoveline BihinaNo ratings yet
- Concert Marie Reine - RevueDocument2 pagesConcert Marie Reine - RevueGwladys BettoNo ratings yet
- BillyGraham-Wikipédia 1710682457341Document23 pagesBillyGraham-Wikipédia 1710682457341Kouamé Innocent N'guessanNo ratings yet
- Beuttler AppelDocument31 pagesBeuttler AppelDésire AttéménéNo ratings yet
- Des Arguments Sur La PolygamieDocument4 pagesDes Arguments Sur La Polygamiemarwachamlal70No ratings yet
- Mathlaboul FawzayniDocument3 pagesMathlaboul Fawzaynijacques kodjoNo ratings yet
- Le Texte Du - Chemin de Croix - PDFDocument6 pagesLe Texte Du - Chemin de Croix - PDFPaulNo ratings yet
- French 11Document33 pagesFrench 11nuckcheddyNo ratings yet
- Un Faux Enlevement A Venir Part1 PDFDocument42 pagesUn Faux Enlevement A Venir Part1 PDFYaqoubTouréNo ratings yet
- Politique Et ReligionDocument13 pagesPolitique Et ReligionScrib_InisiNo ratings yet
- Éveil du troisième oeil: développez le pouvoir de l'esprit, améliorez l'intuition, les capacités psychiques, l'empathie, en utilisant la méditation des chakras et l'auto-guérisonFrom EverandÉveil du troisième oeil: développez le pouvoir de l'esprit, améliorez l'intuition, les capacités psychiques, l'empathie, en utilisant la méditation des chakras et l'auto-guérisonRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (8)
- Des Prières Pour Combattre Les Esprits Marins: Des Prières Et Des Déclarations Puissantes Pour Détruire Les Activités Des Esprits MarinsFrom EverandDes Prières Pour Combattre Les Esprits Marins: Des Prières Et Des Déclarations Puissantes Pour Détruire Les Activités Des Esprits MarinsRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (4)
- Appelez à l'Existence: Prières et Déclarations Prophétiques pour transformer votre vieFrom EverandAppelez à l'Existence: Prières et Déclarations Prophétiques pour transformer votre vieRating: 3 out of 5 stars3/5 (2)
- Livre de Magie Vaudou de Louisiane : 10 Rituels Magiques des BayousFrom EverandLivre de Magie Vaudou de Louisiane : 10 Rituels Magiques des BayousRating: 3.5 out of 5 stars3.5/5 (4)
- Meditation Sur L’Univers, L’Homme Et Le CoranFrom EverandMeditation Sur L’Univers, L’Homme Et Le CoranRating: 4 out of 5 stars4/5 (5)
- Un Coeur de Missionnaire et Une Vie de MissionnaireFrom EverandUn Coeur de Missionnaire et Une Vie de MissionnaireRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Revue des incompris revue d'histoire des oubliettes: Le Réveil de l'Horloge de Célestin Louis Maxime Dubuisson aliéniste et poèteFrom EverandRevue des incompris revue d'histoire des oubliettes: Le Réveil de l'Horloge de Célestin Louis Maxime Dubuisson aliéniste et poèteRating: 3 out of 5 stars3/5 (3)
- Miracles et signes divins dans le CoranFrom EverandMiracles et signes divins dans le CoranRating: 4.5 out of 5 stars4.5/5 (7)
- Prières Puissantes Contre Les Activités De Satan: Prières De Minuit Pour Vaincre Totalement Les Attaques SataniquesFrom EverandPrières Puissantes Contre Les Activités De Satan: Prières De Minuit Pour Vaincre Totalement Les Attaques SataniquesRating: 5 out of 5 stars5/5 (1)
- Recueil de Prieres Spirites: Fondamentaux du spiritisme à l'usage des médiumsFrom EverandRecueil de Prieres Spirites: Fondamentaux du spiritisme à l'usage des médiumsRating: 3 out of 5 stars3/5 (1)
- Mari de nuit femme de nuit: Un phenomene spirituel, aux consequences effectivesFrom EverandMari de nuit femme de nuit: Un phenomene spirituel, aux consequences effectivesRating: 4 out of 5 stars4/5 (24)
- Comment vous pouvez avoir un temps de recueillement efficace avec Dieu tous les joursFrom EverandComment vous pouvez avoir un temps de recueillement efficace avec Dieu tous les joursRating: 5 out of 5 stars5/5 (5)