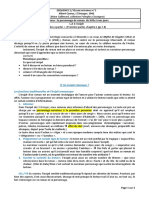Professional Documents
Culture Documents
LA CHAMBRE, Nouvelle Littéraire de Fiction Pure, Par Olivier Mathieu Dit Robert Pioche
Uploaded by
oliviero440 ratings0% found this document useful (0 votes)
2K views21 pagesOlivier Mathieu, dit Robert Pioche, écrivain né à Paris le 14 octobre 1960, publie ici, sur Scribd, une nouvelle littéraire de pure FICTION, intitulée: "La chambre". Les personnages sont tous imaginaires, par exemple "Xavier de Parouart". Cette nouvelle littéraire se trouve par ailleurs, à cette date (2010), depuis de nombreuses années, sur le site littéraire suisse de Monsieur Daniel Fattore. Rappelons ici qu'Olivier Mathieu, dit Robert Pioche, a obtenu une voix à l'Académie française, en décembre 2003, lors de l'élection qui vit la victoire de..... Monsieur Giscard.
Original Title
LA CHAMBRE, nouvelle littéraire de fiction pure, par Olivier Mathieu dit Robert Pioche
Copyright
© Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentOlivier Mathieu, dit Robert Pioche, écrivain né à Paris le 14 octobre 1960, publie ici, sur Scribd, une nouvelle littéraire de pure FICTION, intitulée: "La chambre". Les personnages sont tous imaginaires, par exemple "Xavier de Parouart". Cette nouvelle littéraire se trouve par ailleurs, à cette date (2010), depuis de nombreuses années, sur le site littéraire suisse de Monsieur Daniel Fattore. Rappelons ici qu'Olivier Mathieu, dit Robert Pioche, a obtenu une voix à l'Académie française, en décembre 2003, lors de l'élection qui vit la victoire de..... Monsieur Giscard.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
0 ratings0% found this document useful (0 votes)
2K views21 pagesLA CHAMBRE, Nouvelle Littéraire de Fiction Pure, Par Olivier Mathieu Dit Robert Pioche
Uploaded by
oliviero44Olivier Mathieu, dit Robert Pioche, écrivain né à Paris le 14 octobre 1960, publie ici, sur Scribd, une nouvelle littéraire de pure FICTION, intitulée: "La chambre". Les personnages sont tous imaginaires, par exemple "Xavier de Parouart". Cette nouvelle littéraire se trouve par ailleurs, à cette date (2010), depuis de nombreuses années, sur le site littéraire suisse de Monsieur Daniel Fattore. Rappelons ici qu'Olivier Mathieu, dit Robert Pioche, a obtenu une voix à l'Académie française, en décembre 2003, lors de l'élection qui vit la victoire de..... Monsieur Giscard.
Copyright:
Attribution Non-Commercial (BY-NC)
Available Formats
Download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
You are on page 1of 21
Présentation de la nouvelle littéraire
« La chambre »,
diffusée par ailleurs depuis de nombreuses années
sur le site littéraire suisse de Monsieur Daniel Fattore.
Olivier Mathieu, un « Immortel » raté.
La nouvelle que voici met en scène un personnage (appelé
ici Robert Pioche) qui, à l’heure de mourir, un matin, dans une
chambre d’hôpital à Paris, réunit autour de lui ses meilleurs
amis (Frédéric Virais, cinéaste ; un vieux noble, nommé Pierre
de La Taupe ; et, enfin, Xavier de Parouart) pour un adieu
ultime et déchirant.
Quand il ne reste qu’un quart d’heure de vie à cet homme,
celui-ci prononce, à l’intention de tous ceux qui furent les
compagnons de son existence, quelques mots, selon un plan
rédigé d’avance. Peu à peu, la chambre se vide. A la fin, une
fois qu’il a salué tout un chacun, Robert Pioche exprime le désir
de demeurer rigoureusement seul, dans le silence absolu qui
convient à une si douloureuse circonstance.
A la surprise générale, cependant, Xavier de Parouart se
met à hurler. Car au même moment, dans l’instant précis où
l’ordre a été donné que la porte de la chambre où va mourir
Robert Pioche ne soit plus jamais ouverte, voilà que des
nouvelles effarantes et apocalyptiques, sont soudain diffusées
par la télévision, la radio, Internet et les éditions spéciales de
tous les journaux. Est-ce la fin du monde ? Robert Pioche va-t-il
donc mourir sans avoir appris la nouvelle ? On entre, ici, dans la
fiction complète.
Ce texte original et inédit, « La chambre » (« La chambre
d’hôpital », le premier titre envisagé, voire celui auquel l’auteur
retournera lors d’une édition définitive de cette nouvelle, aurait
sans doute trop rappelé « La chambre d’hôtel » d’Edith Piaf), a
été écrit par Olivier Mathieu à l’automne de 2007.
Le lecteur admirera, sûrement, les changements de
registres, dans l’écriture, d’un « chapitre » à un autre de cette
histoire - notamment dans le fort beau dialogue poétique
(imaginaire, comme le reste) entre Robert Pioche et son chien,
au « chapitre » IV, avant le coup de théâtre final. Même si, à la
fin, ce même lecteur demeure dans le doute le plus complet
quant à la nature desdites informations apocalyptiques.
Inutile de préciser, enfin, que cette nouvelle ne peut que
confirmer ce que tous les gens sérieux et bien informés savent :
à savoir qu’Olivier Mathieu n’est nullement mort, en octobre
2006, comme il a été annoncé à tort.
La nouvelle de cette « mort » a été démentie, dès
décembre 2006, par Olivier Mathieu, dans son livre Un peu
d’encre, de larmes, de poudre et puis de sang. En outre,
comment Olivier Mathieu pourrait-il être « mort en octobre
2006 » s’il a été candidat à l’Académie française le 8 mars
2007, comme on peut le voir sur le site officiel de l’Académie,
avant de présenter de nouveau sa candidature le 31 mai 2007 ?
Or, Olivier Mathieu est d’autant moins devenu « Immortel » que
cette candidature du 31 mai 2007 a été refusée par l’Académie
française.
Il est donc d’autant plus étrange et curieux, voire cocasse,
de voir que différents individus, de soi-disant éditeurs, de
supposés journalistes, ou divers auteurs d’oeuvrettes
continuent, jusqu’à cette fin d’année 2007, à colporter la
rumeur de sa mort.
.
LA CHAMBRE,
nouvelle littéraire,
par Olivier Mathieu.
Personnages principaux :
Xavier de Parouart, jeune noble parisien ;
Pierre de La Taupe, vieux noble parisien ;
Frédéric Virais, cinéaste ;
Robert Pioche, mourant.
Personnages secondaires et inexistants
(toute ressemblance avec des noms de personnes ayant
vraiment existé serait purement et totalement fortuite)
Monsieur Blanchemorue.
Monsieur Régis Blancheforge.
M. Jean Legrossier.
M. Marcel de Lôdelouphoque.
M. Paul Hideux-Gueux.
I
La mort annoncée de Robert Pioche
C’était un matin de printemps, à Paris.
Xavier de Parouart se dirigeait d’un pas allègre vers
l’hôpital du quartier de Montparnasse où son vieil ami Robert
Pioche l’attendait, pour la toute dernière fois, dans une
chambre de malade.
Xavier de Parouart, en une si macabre circonstance, ne
prêta guère d’attention aux publicités qui, un peu partout,
annonçaient la sortie imminente, dans les salles, du nouveau
film de Frédéric Virais, le cinéaste à la mode de ces années-là.
On disait de Frédéric Virais qu’il avait réinventé le néo-réalisme.
Il était dix heures du matin. Xavier ramassa, sur la
banquette du métro, le journal L’Objectif de la veille,
abandonné par un voyageur, et il y jeta un coup d’œil.
« Merveille ! » s’exclama-t-il. Le supplément littéraire de
L’Objectif, sous la plume du fameux critique Bernard de la
Pêche, consacrait un dossier spécial à un grand écrivain
injustement oublié, Goering, le précurseur du néo-réalisme, l’un
de ces artistes sans lesquels le Vingtième Siècle n’aurait point
été ce qu’il avait été.
Xavier de Parouart avait consacré sa thèse de doctorat,
jadis, aux suicidés magnifiques de la littérature. Et il ne se
plongea donc qu’avec plus d’intérêt dans cette lecture, jusqu’à
sa station de destination. Il avait toujours aimé, jusqu’à la folie
même, les drames sans pathos de Goering, cet inoubliable
artiste, ce typique représentant de l’expressionnisme qui avait
cruellement mis fin à ses jours, privant l’humanité de son
talent, de sa bonté, de son style hors pair.
Ce ne fut qu’en arrivant à l’hôpital que Xavier de Parouart
replia le journal. Goering s’était suicidé mais aujourd’hui Robert
Pioche, quant à lui, allait mourir. Non point par suicide, comme
il l’avait annoncé, mais presque banalement : dans un lit
d’hôpital.
Xavier, dans l’ascenseur, rencontra Frédéric Virais, l’autre
grand ami de Robert Pioche. Ils se saluèrent.
- C’est quoi, ce journal ? demanda Frédéric. Tu lis
L’Objectif, maintenant ?
- Un dossier littéraire passionnant. Sur Goering. Tu sais,
l’auteur de la Bataille navale et de l’Expédition au Pôle Sud du
Capitaine Scott.
- Ah oui, Reinhardt Goering. Bien sûr. Celui qui s’est
suicidé en 1936. Je m’en inspire, moi aussi.
- Et ton prochain film ?
- Il doit sortir le mois prochain. Tu as vu les pubs, sur les
murs du métro ?
- Oui.
Ils changèrent de conversation.
- Au fait, dans quelle chambre meurt, aujourd’hui, notre
ami ?
- Dans la zone des malades terminaux. Le pauvre !
s’exclama Frédéric.
- Bof ! Ce n’est qu’un mauvais moment à passer… Robert
Pioche a passé sa vie à nous dire qu’il se flinguerait, ou qu’il
sortirait de scène d’une façon originale. Vraiment, le voir mourir
dans un lit d’hôpital, je trouve ça nul.
- Nous en avons déjà parlé, dit Frédéric. Ne revenons pas
là-dessus, je t’en prie. Ce n’est pas le moment propice !
- J’espère qu’à midi, en tout cas, ce sera terminé. J’ai un
rendez-vous !
- Tu ne devrais pas dire ça. Pas aujourd’hui… Aujourd’hui,
un homme meurt !
Ils entrèrent dans la chambre numéro 7, où Robert Pioche
gisait sur le lit, entouré par une multitude d’appareils. Des
femmes lui épongeaient le front.
Xavier ne changerait jamais. Il ne put s’empêcher de
persifler :
- Il a demandé à être maquillé, pour ne pas nous infliger un
spectacle trop atroce ?
Xavier avait sans doute choisi de prendre les choses à la
légère. Ce devait être sa façon, à lui, de lutter contre l’émotion.
Frédéric Virais se montra nettement plus prévenant à l’égard du
malade :
- Il y a trop de lumière, dans cette chambre, s’inquiéta
Frédéric. Cette lumière ne te dérange pas trop, Robert ?
On entendit, pour la première fois, la voix altérée mais
sublime de Robert Pioche :
- Je veux mourir dans la lumière.
Pierre de la Taupe nota :
- Et dire que Robert Pioche va mourir comme Goethe.
Mehr Licht ! « Davantage de lumière ! »
II
L’adieu à Frédéric Virais
Quelques instants plus tard, le médecin s’approcha de
Xavier de Parouart et prononça la phrase tant redoutée:
- La fin est venue…
Robert Pioche eut un sourire déchirant. Car il avait
entendu, naturellement.
- Oui, il reste un quart d’heure, bégaya le médecin, gêné.
Alors Robert Pioche, d’un doigt tremblant mais fier,
adressa un signe aux quelques personnes qui entouraient son
lit : à ceux qui devaient sortir, aux rares qui pouvaient rester. Le
médecin s’esquiva, tête basse. La science n’avait rien pu faire,
elle avouait son impuissance. Un curé se mit à tourbillonner
autour du lit, comme un vautour autour d’un macchabée.
- L’extrême onction ?
- Dehors ! lui enjoignit Robert Pioche.
Il n’y eut bientôt plus, au chevet de Robert Pioche, que
Xavier de Parouart, Frédéric Virais et Pierre de La Taupe.
A Frédéric, Robert Pioche dit :
- Il advient au jeu des échecs que le Roi demeure seul,
face à toutes les pièces de l’adversaire. Mes ennemis, ou ceux
qui se voulurent tels, vont se réjouir. Je vais achever d’être
vaincu. Ils auront gagné. A mille contre un, à la fin, ils
auront triomphé d’un homme seul et désarmé. Je ne crois pas
que ce soit un très glorieux triomphe que le leur.
Frédéric pleurait à chaudes larmes. Frédéric et Robert
Pioche, il y avait vingt ans qu’ils se connaissaient. Frédéric
n’était pas un mauvais garçon. Au fond, il aurait un peu voulu
être Robert Pioche, mais il n’en avait jamais eu le courage – ou
peut-être, plus simplement, le talent. Il était devenu cinéaste,
peut-être, parce qu’il n’avait jamais su être complètement
l’acteur de sa propre existence. Frédéric avait croisé Robert
Pioche quand ce dernier était au faîte de sa célébrité : c’est-à-
dire, au fond, quand il avait été le moins lui-même. Et peut-être
Frédéric, au moins au début, parce qu’il n’était pas dénué d’une
sorte de superficialité de cette espèce, avait-il seulement voulu
connaître ce Robert Pioche dont tout le monde parlait. Ensuite,
ils étaient devenus amis – ou ils auraient pu l’être, davantage
en vérité que ce qu’ils n’avaient été.
Grâce à Robert Pioche, et encore aujourd’hui, Frédéric
Virais n’aurait pas été seulement cinéaste : il aurait été, pour
une fois, acteur. Il bafouilla :
- Et dire que, pendant toutes ces dernières dix années, je
ne t’ai apporté aucune aide…
Robert Pioche eut un geste miséricordieux de résignation.
- Oh ! Tu n’as pas été le seul… Tu avais tes problèmes, toi
aussi !
- Tu étais souvent un emmerdeur, dit Frédéric. Tu étais
fatigant.
- Oui, convint Robert Pioche.
- Mais voilà, le moment est venu que je te le dise… Je n’ai
jamais vu au monde quelqu’un qui t’ait ressemblé. Robert, je
voudrais que tu ne… que tu ne…
Frédéric Virais fut incapable d’achever sa phrase : « que tu
ne meures pas ».
Robert Pioche dit :
- Allons, Frédéric… Veille sur mes livres, puisque tu les as
collectionnés.
III
L’adieu à Xavier de Parouart
Soudain, même Xavier de Parouart sembla ému.
Xavier de Parouart, l’une des rares personnes auxquelles
Robert Pioche n’avait jamais eu besoin d’expliquer les choses.
Ils se regardèrent. Les vrais amis, comme les amants, n’ont pas
besoin de beaucoup de mots.
Robert Pioche ne répéta donc pas, à Xavier, qu’à l’issue de
vingt années d’exil, d’injustice et de misère, vingt années sans
domicile, sans travail, sans argent, sans sécurité sociale, vingt
années pendant lesquelles il avait été privé des droits les plus
élémentaires, diffamé, caricaturé, persécuté, vingt longues
années vécues en paria et en miséreux, vingt années pendant
lesquelles il avait subi la loi du silence, il allait capituler – et
cela, sans que personne sans doute ne lui rende honneur. A
quoi bon dire cela, et, surtout, à quoi bon le dire à Xavier ?
Personne, sinon Robert Pioche, dans la situation où il s’était
trouvé, n’aurait résisté aussi longtemps. Vingt ans. Vingt
années pendant lesquelles il n’avait pu compter sur aucune
solidarité humaine, amicale ou politique que ce soit. Robert
Pioche n’avait pas eu droit à un sou, pour manger. Il avait
encore eu moins le droit, de la plupart, à une émotion. Le
monde moderne tout entier était malade dans ses cerveaux et
dans ses cœurs, voilà ce qu’il avait appris. Ceux qui avaient cru
« penser comme » lui (il n’avait jamais pensé, lui, comme
personne : et surtout pas comme eux) étaient perdus, ils ne
devaient pas s’en prendre à qui les avait défaits et supplantés.
Ils avaient perdu, parce qu’ils avaient depuis longtemps
abandonné le champ de bataille. Ils avaient perdu, parce qu’ils
avaient accepté de se vider de la sève originelle.
Rarissimes et presque inexistants, ceux qui ne l’avaient
pas trahi, Robert Pioche, qui ne l’avaient pas abandonné,
oublié, frappé d’un coup de couteau dans le dos. Parmi les amis
de longue date, il y avait eu Frédéric, et Pierre de La Taupe, et
Xavier de Parouart, mais la liste s’arrêtait là.
Le plus atroce était peut-être que le mourant, dans son lit,
ne pouvait imaginer les propos de Xavier de Parouart, quelques
instants plus tôt, avait tenus à Frédéric Virais, dans l’ascenseur,
quand il avait demandé avec désinvolture :
- Dans quelle chambre meurt notre ami ? J’espère que ce
sera vite fini. Parce que, à midi, j’ai un rendez-vous.
Et dire que lui, Robert Pioche, il voyait danser déjà, devant
ses yeux, des ombres maléfiques. Il soupira, avec une infinie
noblesse:
- En capitulant, je vais consentir aux uns et aux autres, qui
m’ont pareillement haï, de se réjouir. Leur infinie bêtise, à tous,
m’a consterné.
Xavier de Parouart hocha la tête, en signe d’assentiment. Il
savait, ou il aurait dû savoir quelle était la fierté de Robert
Pioche. Celle d’avoir obéi à l’amour de la vérité, à sa liberté, au
refus de tout embrigadement, au rejet du travail. Celle d’avoir
obéi aux idéaux de son enfance, à l’éducation qu’il avait reçue,
et à son destin.
Robert Pioche allait entrer en agonie, d’un instant à un
autre. Mais il sourit à Xavier de Parouart, car il avait confiance
dans l’amitié sincère de celui-ci :
- J’ai fait mon possible. De nos jours, dans cette Europe où
nous sommes nés, il n’y avait peut-être plus rien à faire. Je ne
lègue rien à personne, surtout pas aux épiciers de l’idéalisme et
aux anticonformistes autoproclamés. Je ne crois pas en quelque
postérité que ce soit, et je ne serai pas responsable de la
mienne. Je récuse les menteurs de profession, les mauvais
maîtres d’un monde sans beauté ni génie. Comme je récuse les
lamentables andouilles auxquels des ignorants ont eu intérêt à
m’assimiler. L’Histoire, certes, ne suivra plus son cours, qu’elle
a interrompu depuis longtemps. Pourtant, la réalité reprendra la
dessus. La réalité, et la Nature, auront le dernier mot. Que l’on
me distingue des bêleurs de la mystification, mais aussi des
sectaires, des frustrés, des convaincus d’avance.
Sans doute Robert Pioche enviait-il secrètement Xavier
qui, un instant plus tard, sentirait sur sa peau la chaleur du
soleil, et la caresse du vent.
Le temps manquait. Tout avait été dit, au moins fallait-il
l’espérer.
- Tu vois, je capitule, dit Robert Pioche, comme s’il s’était
excusé.
- La plupart des hommes ont capitulé bien avant toi,
déclama Xavier de Parouart en feignant d’essuyer, sur son
visage, une larme.
Les yeux bleus de Robert Pioche restèrent secs, presque
froids. C’était les yeux d’un homme qui voulait entrer, debout,
dans la mort. Xavier de Parouart et Robert Pioche, ils avaient
été – et tout le monde ne peut en dire autant. Robert Pioche,
qui, d’un instant à l’autre, serait un ancien vivant ; et Xavier de
Parouart qui, lui aussi, savait être un futur mort.
Un gros plan sur le visage de Robert Pioche aurait offert un
spectacle pathétique. Les rictus de douleur se multipliaient, la
fièvre gagnait du terrain. Ses paroles devenaient
incompréhensibles, incohérentes, dénuées de toute
signification.
Pierre de La Taupe s’écria :
- Notre malheureux ami Robert Pioche délire. Il faut lui
donner l’absolution finale !
C’était les divagations, bien excusables certes, de la mort
qui s’approchait.
Pierre de La Taupe rappela :
- Notre amitié est née, jadis, dans une cellule.
- Oui, répondit Robert Pioche. Et je vais être le premier à
m’évader de cette prison qu’est la vie.
Des curieux étaient venus présenter leurs condoléances.
Ainsi, on entendait Jean Legrossier, un habitant du seizième
arrondissement de Paris :
- Seigneur Jésus ! Je connaissais Robert Pioche. J’ai appris
sa mort. S’il y a moyen d’en savoir plus sur sa fin de vie et les
circonstances de sa mort, je vous serais reconnaissant de me le
faire savoir.
Les plumitifs d’une malencontreuse feuille de chou
réactionnaire de province, Rognures des Gaulois, débordaient
de chagrin:
- Pourriez-vous nous fournir la documentation dont vous
disposez sur Robert Pioche ?
Marcel de Lalôdelouphoque, le bien connu directeur du
Bulletin rétinien, gazette paroissiale dont la lecture était
réservée aux borgnes de son village, fredonnait ses laudes
plates et burlesques :
- C’est avec tristesse, une fois, que nous avons appris le
décès imminent de Robert Pioche. Un abonné me demande,
une fois, comment se procurer son livre La Racontaine. Que
puis-je lui répondre, une fois ?
Un certain Paul Hideux-Gueux demandait, avec une
sensibilité exquise :
- Merci de m’indiquer la cause du décès de Robert Pioche !
Fernand Gotrille gémissait :
- J’ai toujours apprécié Robert Pioche. Je vous prie de
m’informer sur toutes les initiatives futures sur lui.
Diable ! Comment faisait-il pour « apprécier » Robert
Pioche ? Fernand ne s’était plus manifesté, par bonheur, depuis
plus de dix ans. Il y a dix ans, Robert Pioche lui avait proposé de
lui vendre un livre. Fernand Gotrille avait répondu, dans un
accès de colère :
- C’est moi qui décide quand je dois acheter un livre .
- Diantre, s’était émerveillé Robert Pioche, quel homme de
caractère !…
Depuis dix ans, cet improbable événement ne s’était pas
produit. Fernand n’avait pas « décidé » d’acheter un seul livre.
Il jugeait probablement cette lecture inutile afin de pouvoir
« apprécier » encore davantage Robert Pioche.
Un autre anonyme verseur de larmes de crocodile adjurait
le Ciel :
- Que l’âme de Robert Pioche désormais à l’abri de la
malédiction du Diable repose en paix dans le Royaume de Dieu
Vérité !
Robert Pioche s'alarma :
- Faudrait pas, en plus, que mon âme soit vouée aux
gémonies ? Ou aux flammes de la géhenne éternelle ? Mais est-
il vraiment nécessaire de me retrouver après ma mort, dans le
« Royaume de Dieu Vérité » ?
Quand Frédéric Virais, Xavier de Parouart et Pierre de La
Taupe eurent l’un après l’autre disparu de son champ visuel,
Robert Pioche sentit ses forces l’abandonner :
- Je désire rester seul avec Però… annonça-t-il.
La porte se ferma lentement. Et, cette fois, la chambre fut
strictement vide.
Ordre avait été donné que plus personne n’entre, sous
quelque prétexte que ce soit. Voilà. Nul ne pénétrerait plus
dans la chambre, sinon la Mort elle-même.
Requiem pour Robert Pioche.
Après les humaines condoléances, la humble consolation
d’un chien.
IV
L’adieu au chien Però.
Ainsi Robert Pioche demeura-t-il seul, avec le chien Però.
- Qu’as-tu cherché, Robert Pioche ? Un homme ? demanda Però.
- Cela risquerait, de nos jours, d’être mal compris.
- Cherchas-tu une femme ?
- Le monde moderne a abîmé les trop humains.
- Le monde moderne ne te plaisait pas ?
- « Tout ce qui est moderne me dégoûte » (Robert Pioche,
1965). Cependant, mieux vaut être sucé par une femme
qu’enculé par mon époque.
- Tu eus la possibilité de choisir d’autres voies.
- Il n’y avait pas d’autre chemin, pour moi. Tels furent mon
amour du drame, ma passion de l’échec, mon idée de la
beauté. J’ai pleuré d’amour pour les Astres du Désastre.
Aristocrate du cœur et de l’esprit, je suis le dernier des
sensibles.
- Un jour fut, où tu n’étais pas seul.
- Au-delà de l’instant, la connaissance détruit.
- Si chercher, c’est mentir : pourquoi chercher ?
- Pour ma solitude d’après que la foudre a tonné.
- Tu ne regrettes rien ?
- Je suis né en 1960 : après la mort de la dernière promesse de
beauté. Mes mains de mort regretteront le Soleil.
- A quoi bon avoir agité une lanterne dans la nuit ?
- Pour le bel gesto. C’est là une lanterne trop réelle, espérer.
« L’espoir, c’est bon pour les cochons » (ma mère, dans sa
jeunesse). Vaincre est écœurant.
- Seul acteur et seul spectateur, donc.
- Dénoncer la corruption, corrompre la pureté. Entre les deux,
les yeux qui auraient pu voir.
- Les femmes, des miroirs ? Un écho ?
- Des passantes. Je leur ai parfois prêté de la gentillesse, et du
goût. On m’a rendu peu ou rien. Les individualistes qui
désirèrent forger une communauté, par horreur du magma, le
surent. Aimable ballet du peuple qui fut : ses membres étaient
doués d’une existence qui les dépassait.
- Les femmes, des romans ?
- Je plains qui perdit l’occasion d’en être un.
- Combien furent déchirantes ?
- « Les gens ont parfois l’air normaux. Au bout de cinq minutes,
on s’aperçoit que quelque chose cloche » (ma mère).
- Mieux les occasions perdues, ou saisies ?
- Le goût d’être nouveau, moi. L’extase de renaître. Les beaux
regrets. Ne pas croquer la pomme consent d’oublier qu’elle eût
été avariée.
- La liberté ?
- Pour qu’il y ait liberté, il faut qu’il y ait choix. Des masses
belles, naquirent les grands séducteurs. Le grand séducteur hait
tout ce qui est grégaire. Il pleure les papillons pas épinglés.
Mais s’il menace sa solitude, ne fût-ce que cinq minutes, déjà sa
liberté lui manque.
- Vivre, pour quoi ?
- J’ai 343 souvenirs sublimes, dont presque tous remontent à
mon enfance ; 49 douleurs ; et 7 instants de vie en beauté.
Voilà ce qui valut la peine. Les moments de mon cœur.
- Tu n’as pas tout dit, je suppose ?
- Je plains qui, en mourant, aura tout dit. Je n’ai mis en danger
que moi. Quand le docteur M. m’a chuchoté qu’il n’avait pas
beaucoup de visiteurs, ce fut un immense moment. Qui veut
sauver sa peau et préparer sa mort doit fuir et jouer. Il a fui et
il a joué, crois-moi. Moi aussi.
- La morale ?
- Si ce n’est mon éthique, qu’elle aille se faire mettre !
- Ta lanterne tremble. Tu sembles ivre.
- Mon héroïsme fut ma façon de penser, mon sentiment, mon
histoire, ma terre et mes Dieux d’Europe, mon sang. Destin
incarné, guerre perpétuelle, pureté, grandeur et continuation du
passé que j’avais élu, émotion, au centre de mes rites. La vie
comme totalité. La volonté guidée par l’intuition. Ma liberté est
hors d’atteinte. Dernier descendant des Vieux Grecs, je me fis
martyr et exilé. Dans un monde de mutants et dont je
n’admettais pas les protocoles, douceur amère que d’avoir été
le dernier Astre du Désastre. L’autel des Dieux fut renversé.
L’humanité paiera.
- Fou, Robert Pioche ?
- Fou, qui meurt maître de sa folie.
- Quoi valut la peine ?
- Ce qui fut de passage, voilà ce qui demeure. Immobile,
éternel, intangible. Les nuages. L’enchantement était dans les
interstices. Le Vingtième et le suivant, vains siècles.
- Les femmes ? Prétexte à la lâcheté de ne pas se suicider, ou
au courage de vivre ?
- Certitude ou illusion, quelqu’une se souviendra de ce qui fut –
ou de ce qui ne fut pas. Et nulle ne sera empêcheuse de mourir
en dernier carré. Souvent, plus quelqu’un me fut proche, et
moins il m’a connu.
- A qui adresser un salut ?
- Mélancolie du début de l’aprem. Mélancolie du plein milieu de
l’aprem. Mélancolie de la fin de l’aprem. Telles furent mes trois
mélancolies. Au revoir aux aprems d’enfance, quand les nuages
s’écartaient ou passaient devant le soleil, et que le vent brûlait
ou rafraîchissait ma peau. Au revoir aux reflets, sur le pavé des
rues, du ciel qui s’éclaircit après l’orage. Puisque ma dernière
heure est venue, je voudrais me lancer à la poursuite de la
lumière bleue. Pour la beauté du geste, toujours. Il faudra
trouver la force de partir. Combien sommes-nous encore ? Qui
sommes-nous ? Que transmettrons-nous ? Qui sera soucieux de
saisir le flambeau, de vérité ou d’ironie ou d’émotion, que nous
avons un instant tenu? Quand le moment sera venu : quel
moment, Grands Dieux ! Mourrons-nous sans héritiers ? Perdu
pour perdu, je serai seul à lancer ma dernière bataille, la der
des ders. J’ai fait ce que j’ai pu. Je me suis bien amusé.
D’accord et tant pis. J’aurais pu écrire et dire davantage. Mais
rien n’a plus d’importance. Tout est fini depuis longtemps. Les
Dieux savent.
Les rots des Blancs Ruts.
Les amis de Robert Pioche attendaient, dans le couloir,
l’instant fatal. L’un d’eux, dans quelques instants, serait chargé
de constater la mort. On recouvrirait Robert Pioche d’un linceul.
Xavier de Parouart, lui, s’était pourtant déjà éloigné de
l’hôpital. Il avait joué son rôle, voilà tout, un rôle qui - en vérité -
ne lui plaisait pas, celui de l’ami de Robert Pioche.
Xavier jeta un coup d’œil à sa montre. Il se pressait vers
quelque rendez-vous galant et, ce matin, décidément, il n’avait
que trop perdu son temps. Il était allé à l’hôpital, oui, parce qu’il
s’y était engagé. Mais, maintenant que tout était fini, il était
soulagé. Il se trouvait déjà sur le boulevard de Montparnasse. Il
était célèbre, parmi ses connaissances, pour ne jamais acheter
de journaux. Un peu cleptomane, il préférait les subtiliser.
Cependant, son attention fut alertée par les têtes
d’enterrement de plus en plus prononcées des gens. En son for
intérieur, il badina :
- Tant de tristesse, ce ne doit pas être pour la mort de
Robert Pioche, tout de même ?
Certes, c’eût été relativement étonnant.
Xavier héla un marchand de journaux :
- Hep ! Le Démon !
Le vendeur s’exécuta et lui tendit l’édition spéciale du
légendaire quotidien matinal, dont l’encre était encore fraîche.
Xavier de Parouart n’en crut pas ses yeux.
Maintenant, il courait, à perdre haleine, en secouant ce
journal comme s’il se fût agi d’un drapeau, vers l’hôpital. Il
n’avait pas même lu en détail les articles consacrés à
l’événement. Il lui avait suffi de lire le titre, à la une du Démon,
sur cinq colonnes.
Il s’égosillait :
- Bob ! Bob !
(Xavier avait été le seul à surnommer ainsi Robert Pioche).
Xavier de Parouart courait. C’était une course contre la
montre. Le Temps, impitoyable, fuyait. Chaque seconde pouvait
être celle de la mort de Robert Pioche. Et Xavier courait,
trottait, cavalait. Il bousculait les passants, les piétinait et
enjambait leurs corps.
- Bob ! Ne meurs pas ! Encore cette fois-ci, ne meurs pas !
Attends ! Encore un instant !
Il fallait qu’il parle, un instant encore, à Robert Pioche. Il le
fallait absolument.
Mais le malheureux Robert Pioche luttait, là-bas, dans la
solitude d’une chambre, arc-bouté à la frontière ultime d’entre
la vie et la mort.
Parvenu sous les fenêtres de l’hôpital, Xavier de Parouart
se mit à hurler de plus belle. Ses cris montaient dans l’air de
cette dramatique matinée de printemps. Robert Pioche avait
toujours pensé qu’au jour de sa mort, personne ne viendrait à
son enterrement, et que sa tombe serait vite oubliée.
Quiconque rendrait visite à sa sépulture la trouverait couverte
de crachats. Ou alors, cette tombe serait un véritable urinoir
public. Or, l’incroyable aveu que venait de faire Le Démon
changeait tout. Peut-être…
Ce soir, songeait Xavier, aux obsèques de Robert Pioche,
des dizaines de milliers d’inconnus se presseraient en pleurant,
et en recouvrant sa fosse de dizaines de milliers de roses. Des
jeunes filles hystériques se jetteraient par terre, suppliant
d’être ensevelies vives avec lui. Des ligues de vertu enverraient
des délégations officielles pour lui présenter, à titre posthume,
leurs excuses. Le Président allait décréter, peut-être, des
funérailles nationales pour Robert Pioche, une semaine de
deuil…
Enfin, Robert Pioche aurait tant d’amis !
La ville de Paris était immergée, depuis un instant, dans la
plus profonde et sincère consternation. Les citoyens étaient
plongés dans la lecture du Démon. Ils écarquillaient les yeux. Ils
lisaient, relisaient, répétaient, syllabe après syllabe, l’incroyable
information. Ils en étaient tantôt aphones, tantôt bègues
d’ébahissement. On dénombrait, et c’était dramatique, des
centaines de crises cardiaques simultanées, dans tous les
milieux, sans nulle discrimination : dans les milieux politiques
d’un bout à l’autre ; dans tous les lieux de culte des trois
grandes religions ; dans les milieux de la presse, du cinéma,
des chirurgiens, des avocats, des marchands de fripes, etc. ;
dans les milieux parlementaires, judiciaires, policiers ; et jusque
dans ceux de la chanson. Strictement personne n’était
épargné. C’était une hécatombe. Comme si un missile atomique
avait centré, en plein cœur, les fondements de la société
moderne et contemporaine. L’Occident venait de crouler,
exactement comme le ferait une basilique dont la clé de voûte
aurait été dynamitée ! C’était - comme le lecteur l’aura
aisément compris - une ahurissante catastrophe. Ils étaient tant
et tant à gémir amèrement, à s’arracher les cheveux, à se
mortifier. En effet, tout l’univers mental des masses, tout ce en
quoi elles avaient cru et voulu croire tout au long de leurs vies,
tout ce dont elles avaient été abreuvées dès le berceau, toutes
les convictions, toutes les croyances, toutes les superstitions
venaient de s’écrouler, en une seule et même seconde. Il n’y
avait plus de croyance, d’espoir, de morale, de révélation : et
même plus la rassurante certitude d’être bons.
Robert Pioche était-il mort ? s’interrogeait quant à lui
Xavier de Parouart.
La rumeur s’enflait.
On eût dit qu’il neigeait de l’incrédulité sur le monde. On
entendait des inconnus, le visage blême de stupeur, se héler.
Rue Blanche, deux passants descendirent de leurs vélos bleus.
Monsieur Blanchemorue apostropha Monsieur Régis
Blancheforge :
- Vous avez entendu ?
- Oui !
- Mais c’est vrai ? Bon sang, ce ne peut pas être vrai ?
On sentait, dans chacun de ses pleurnichements ivoirins,
le drame de Monsieur Blanchemorue. Ils étaient si
sympathiques, Monsieur Blanchemorue et Monsieur Régis
Blancheforge, et leurs vélos bleus. Leur dialogue ressemblait à
un rut : à un rut blanc,à un blanc rut !
- Hélas si, c’est officiel !
- Officiel !? répéta effaré Monsieur Blanchemorue.
- Officiel !
- Mais alors, le Bien… le Mal ? Et que deviendra donc notre
ami Manuel Dumieux, qui était si flatté d’avoir découvert
l’existence du Pire ? demanda Monsieur Blanchemorue dans un
nouveau blanc rut.
Le Sieur Régis Blancheforge se remit à pédaler sur son
vélo bleu, non sans avoir roté :
- Oh… Monsieur Blanchemorue, je ne sais que vous dire.
Vous en tirerez vous-même les conclusions, les blancs ruts qui
s’imposent… !
Monsieur Blanchemorue était opalin comme eût été
blafarde une morue incolore. Il s’efforçait, lui aussi, de refuser
l’évidence. Mais hélas, c’était cause perdue. A la lecture du
Démon, de toutes parts, ça hurlait de douleur. Tout s’emplissait
de rots et de ruts blancs, de blancs ruts et rots. C’était un
tsunami intellectuel, idéologique, historique sans précédent,
partout dans Paris. Mais il en allait rigoureusement de même
dans le monde entier. De Buenos Aires à Stockholm, de Pékin à
Tombouctou, de Trifouillis-les-Oies à New York, des
lamentations éperdues répandaient, sur l’univers entier, leurs
litanies. Cela brisait le cœur. La nouvelle, en caractères
énormes, remplissait toute la première page du Démon, de
L’Objectif, de La Vérité. Tous les organes de presse, sans
exception, préparaient des éditions spéciales, eux aussi. On
s’attendait à des tirages colossaux.
Une aveugle supplia Xavier de Parouart :
- Monsieur, je suis non voyante. Lisez-moi l’article du
Démon à voix haute, je vous supplie !
Xavier de Parouart s’empressa de lui obéir, et lut :
Ce matin, le Super-Gouvernement des Elus, réuni en
séance plénière du Parlement, toutes Chambres mêlées, a
convoqué trente mille journalistes du monde entier, ainsi que
plusieurs centaines de milliers d’autres journalistes en vidéo-
conférence, pour annoncer, en direct sur toutes les chaînes
mondiales de télévision, une nouvelle d’une portée colossale.
Avec des larmes dans la voix, le porte-parole chargé de lire
cette déclaration officielle, contresignée par tous les chefs
d’Etat du globe, s’est acquitté de sa tâche malgré six
évanouissements. Ont ainsi été expliquées, de façon définitive,
les raisons pour lesquelles, depuis tant et tant de décennies, il
avait été indispensable et nécessaire que la libre opinion
publique, d’un bout à l’autre de la planète, et cela grâce aux
œuvres conjointes des Ministères de l’Humour, de la Saine
Morale et du Bon Choix, soit convaincue de l’…
A l’improviste, Xavier se tut.
- Eh bien ? exigea l’aveugle. Continuez votre lecture ! Vous
alliez dire : soit convaincue de l’atroce décès de Robert
Pioche… N’est-ce pas ?
- Euh… Je voudrais tant poursuivre ma lecture, je vous le
jure, chère Madame ! Mais un mal entendant vient de
m’arracher le journal que j’étais en train de vous lire !
- Vous voulez dire un sourd ? interrogea la non voyante,
d’un ton acide.
- Se peut-il que Robert Pioche soit déjà mort ?
s’interrogeait Xavier.
Les radios ne parlaient pas d’autre chose, et les
automobilistes à l’écoute avaient été tellement estomaqués que
le trafic routier était interrompu, tous les dix mètres, par des
accidents mortels. Les télévisions, toutes chaînes confondues,
avaient elles aussi interrompu leurs émissions habituelles et
transmettaient en boucle, tandis que les journalistes, par
centaines, avaient déjà choisi la voie de la fuite, des démissions
mais, plus volontiers, du suicide collectif. Plusieurs ministres
avaient abandonné leurs ministères. A la vérité, tout le
gouvernement avait fui, disait-on, et, chose encore plus
étrange, il en allait de même dans tous les pays d’Europe, et du
monde. On craignait que des millions de gens, à Paris, et
même en province, ne descendent dans la rue en invoquant – à
titre posthume, toujours – Robert Pioche. Les écoliers déjà
brûlaient, dans leurs écoles et jusque dans les maternelles, des
monceaux de livres ; et les étudiants faisaient de même, dans
la Cour d’Honneur de la Sorbonne, aux cris de :
- Plus jamais ça !
Des écoliers, en route pour quelque important et
nécessaire pèlerinage culturel - ou bien, au contraire, ceux qui
en revenaient - avaient botté les fesses à leurs enseignants,
aux cris inexplicables de :
- Tiens !… Prends mon pied au cul, et surtout… n’oublie
pas !
C’était un indescriptible chaos. Le mécontentement
populaire était démesuré. Des gens de tous âges, de tous
sexes, de tous milieux, avaient amassé des bidons, qu’ils
cognaient furieusement les uns contre les autres afin
d’exprimer leur courroux démocratique. Les historiens, un jour,
appelleraient peut-être cela la révolution des bidons. Quant à
Xavier de Parouart, il tenait toujours des propos que, la veille
encore, on eût dénoncés comme incohérents:
- Bob ! Bob !… Edition spéciale !… Le Démon !…
On respirait la cruelle atmosphère d’une fin de siècle,
d’une fin de cycle ; et, dans une telle atmosphère d’adieux,
donner un peu de bonheur s’avérait indispensable. Ainsi, des
humoristes, des chansonniers, des rappers blacks et beurs de la
banlieue, sur le trottoir, sourirent à Xavier de Parouart et se
mirent à danser gaiement autour de lui. Naquit, spontanément,
un rap endiablé, d’une allégresse contagieuse.
Atroce nouvelle, excellente nouvelle ? C’était selon.
Et là-haut, dans la chambre d’hôpital, Robert Pioche,
ignare de ce qui était en train de se passer, ne cessait de
trépasser.
Là aussi, atroce nouvelle, excellente nouvelle ? C’était
selon.
Quelqu’un s’interposa :
- Non, M. de Parouart, vous ne pouvez pas entrer!
- Ca suffit, vos histoires ! rétorqua Xavier.
Et se frayant un passage à travers les journalistes de CNN,
il enfonça la porte de la chambre qui, au demeurant, était
depuis longtemps largement ouverte. Puis Xavier de Parouart
se précipita vers le lit de l’agonie et du glas de Robert Pioche.
Las. Il était trop tard.
Robert Pioche, une main posée sur le cœur, serein,
semblait déjà raidi par le grand froid de la mort. Le défunt avait
l’air d’un enfant innocent, on eût dit qu’il sommeillait. Sur ses
lèvres, flottait un sourire d’une ironie et d’une béatitude
infinies.
- Et dire, ô Robert Pioche, soupira Xavier de Parouart en
s’adressant à ce cadavre, que tu es mort sans avoir su !
Les sanglots de Xavier de Parouart jaillirent,
bouleversants, face à la pouilleuse dépouille de celui que, un
jour, on avait appelé Robert Pioche.
Le cri de Xavier de Parouart s’éleva, attendrissant :
- O Robert Pioche ! Et dire que tu allais devoir te contenter
que ta mort soit signalée, dans la rubrique nécrologique de
quelque feuille de chou, en deux lignes!
Trois fois, Xavier de Parouart, Evangéliste de la Bonne
Nouvelle, répéta son invocation, digne d’un chœur funèbre de
l’Antiquité :
- O Robert Pioche ! O Robert Pioche! O Robert Pioche!
Atroce nouvelle, excellente nouvelle, celle de la mort de
Robert Pioche? C’était selon.
VI
Le mot de la fin
- Et dire, ô Robert Pioche ! poursuivit Xavier, que tu auras
été le seul à ne pas savoir la surprenante et terrifiante nouvelle
qui vient d’ébranler et de bouleverser, aujourd’hui, le
monde entier !
Robert Pioche s’esclaffa.
Il se tenait le ventre.
- Je n’en peux plus ! confessa Robert Pioche. Je n’arrête
pas de mourir de rire ! Putain, mais qu’est-ce que c’est que ce
scénario à la mords-moi le nœud ?
Frédéric Virais, derrière sa caméra, ronchonna :
- Merde, alors ! Coupez !
Quelques semaines plus tôt, les amis avaient eu l’idée de
faire tourner par Frédéric Virais - le plus doué, le plus récent
représentant du néo-réalisme - un film surréaliste de pure
fiction, intitulé La chambre (d’hôpital): le trépas d’un homme
accompagné, jusqu’à l’heure de son dernier soupir, par ses
amis.
Frédéric Virais répéta, avec irritation :
- Coupez ! Jusque-là, c’était du tout bon ! Mais il faut
refaire la dernière scène! Sans éclater de rire, nom de Dieu !
Putain, on est au huitième et dernier jour du tournage ! Et, au
huitième et dernier jour, vous voulez quand même pas me
couper mon film ?
Pierre de la Taupe, lui, avait l’air littéralement consterné.
On s’inquiéta :
- Ce n’est pas si grave que ça, il faut juste tourner de
nouveau la dernière scène !
- Mais il ne s’agit pas de ça ! se fâcha Pierre de La Taupe.
- Et alors, de quoi s’agit-il ?
- C’est pas possible ! C’est enrageant ! Mon film est foutu !
Nous allons faire un navet. Ca va être un véritable four !
protesta amèrement Frédéric Virais.
- Comment ça, notre film est foutu ?
- Foutu ! Regardez-moi ça : la réalité dépasse la fiction !
- Comment ça ? Comment ça ?
- Regardez ! Je viens d’acheter le Démon !
Pierre de la Taupe était véritablement hors de lui. Il lança,
sur la table, l’édition du matin du Démon.
Pas celle du film de Frédéric Virais. Non. La vraie ! La vraie
de vraie édition du matin du Démon !
La vraie de vraie édition du Démon apportait, en effet,
précisément la même nouvelle que celle que s’apprêtait à
inventer le film de Frédéric Virais. Wall Street et toutes les
Bourses mondiales venaient, par malheur, de s’écrouler. Les
gouvernements d’Occident étaient renversés. Les citoyens
jetaient, par leurs fenêtres, un peu tout ce qui leur tombait sous
la main : leurs télévisions, pour commencer, qui implosaient en
se pulvérisant sur le goudron ; mais aussi des collections
entières de journaux ; et leurs bibliothèques entières, et leurs
vidéothèques avec ; et les livres d’histoire de leurs enfants ; et
des best seller absolument remarquables qui avaient été
vendus à des millions d’exemplaires, au XXe siècle ; et tant de
grands témoignages littéraires extraordinaires de ce qu’avait
été la fantaisie extrême de ce même siècle ; ils se
débarrassaient de leurs stylos à bille, de leurs réserves
d’insecticide, de tonnes de médicaments utiles à améliorer la
mémoire, ils jetaient absolument tout et n’importe quoi. Il était
très dangereux que des enfants se débarrassent de leurs
modèles réduits de trains, les grands-mères de leurs pyjamas et
de leurs produits anti-mites, les musiciens de leurs violoncelles,
les ménagères de leurs vieilles gazinières et de leurs modernes
fours à micro-ondes. Bref, des dizaines d’objets, en vrac, au
hasard – et qui n’avaient pas le moindre rapport les uns avec
les autres.
- Hélas ! s’exclama Robert Pioche littéralement accablé et
terrassé de douleur par un spectacle aussi curieux et
incompréhensible.
- En effet, confirma Frédéric Virais. Notre film n’existera
jamais ! Le public penserait qu’on le chambre ! Pas question de
se payer sa tête !
- Quelle poisse, punaise ! Il faut quand même qu’on trouve
une solution !
- Enfin, tu n’es pas mort, Robert Pioche ! Ca aussi, c’est
une bonne nouvelle ! Non ? demanda Xavier.
Robert Pioche se démaquillait et, peu à peu, de pouilleuse
dépouille qu’il était un instant encore auparavant, ressuscitait
comme par miracle.
C’est Xavier de Parouart qui eut, pour tous, un mot
d’encouragement final :
- Il va falloir écrire un nouveau scénario, voilà tout. Allons,
au boulot, les gars ! Et que ça gaze !
Olivier Mathieu
You might also like
- Le Colonel Chabert de Balzac (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreFrom EverandLe Colonel Chabert de Balzac (Fiche de lecture): Analyse complète de l'oeuvreNo ratings yet
- Nouvelle D'olivier Mathieu Un Mari de MerdeDocument8 pagesNouvelle D'olivier Mathieu Un Mari de Merdeoliviero44No ratings yet
- Les Jeunes Filles Ont L'âge de Mon Exil, Par Olivier Mathieu Dit Pioche, Livre Édité Par Jean-Pierre FleuryDocument1 pageLes Jeunes Filles Ont L'âge de Mon Exil, Par Olivier Mathieu Dit Pioche, Livre Édité Par Jean-Pierre Fleuryoliviero44No ratings yet
- 10 Petits Nègres-Sous-MarinDocument23 pages10 Petits Nègres-Sous-MarinAnne Sophie BuignetNo ratings yet
- Tableau NarrateurDocument2 pagesTableau Narrateurapi-166082671No ratings yet
- Tête de Pioche, Texte de Jean-Pierre FLEURY Sur Olivier MATHIEU Dit Robert PIOCHEDocument7 pagesTête de Pioche, Texte de Jean-Pierre FLEURY Sur Olivier MATHIEU Dit Robert PIOCHEoliviero44No ratings yet
- Cauchemar en Jaune Frédéric Brown, ÉvaluationDocument4 pagesCauchemar en Jaune Frédéric Brown, ÉvaluationNoémie Bailleux0% (1)
- Juste La Fin Du MondeDocument2 pagesJuste La Fin Du MondeThelma LouiseNo ratings yet
- Matin BrunDocument4 pagesMatin BrunYovanMenkevick100% (1)
- L.A 1 Incipit EtrangerDocument3 pagesL.A 1 Incipit EtrangerAhmed ElharrarNo ratings yet
- Albert Camus - La PesteDocument19 pagesAlbert Camus - La Pestechatagny.nathan1No ratings yet
- Vida Azimi, Octave Mirbeau Face Aux TénèbresDocument19 pagesVida Azimi, Octave Mirbeau Face Aux TénèbresAnonymous 5r2Qv8aonfNo ratings yet
- Colette Sequence ComplèteDocument23 pagesColette Sequence ComplèteniombeNo ratings yet
- Volpone FrancaisDocument606 pagesVolpone FrancaislidiavianuNo ratings yet
- La Nouvelle LittéraireDocument4 pagesLa Nouvelle Littérairemostabou100% (1)
- Fiches Roman Visions Du MondeDocument12 pagesFiches Roman Visions Du Mondeelisa.lalatina9669No ratings yet
- Octave Mirbeau, Un FouDocument5 pagesOctave Mirbeau, Un FouAnonymous 5r2Qv8aonfNo ratings yet
- Ruy Blas PDFDocument20 pagesRuy Blas PDFHadad Fatima ZahraNo ratings yet
- Fiche de Lecture Sophocle, Œdipe-RoiDocument3 pagesFiche de Lecture Sophocle, Œdipe-RoiClémentine BRUGUEROLLENo ratings yet
- Annie RIZK, Le Mariage, Prostitution Légale ? Mirbeau Lecteur de FlaubertDocument9 pagesAnnie RIZK, Le Mariage, Prostitution Légale ? Mirbeau Lecteur de FlaubertPierre MICHELNo ratings yet
- Dom Juan Acte 1 Scene 1 Tabac Plan DetailleDocument2 pagesDom Juan Acte 1 Scene 1 Tabac Plan Detailleayouzyouftn100% (1)
- Élise FONTVIEILLE, Mirbeau Et L'aliénation Dans "Le Calvaire", "L'Abbé Jules" Et "Sébastien Roch"Document5 pagesÉlise FONTVIEILLE, Mirbeau Et L'aliénation Dans "Le Calvaire", "L'Abbé Jules" Et "Sébastien Roch"Pierre MICHELNo ratings yet
- Séance 3 - Les Points de Vue Dans La NarrationDocument2 pagesSéance 3 - Les Points de Vue Dans La NarrationLuluNo ratings yet
- SQ 2 Invitation Au VoyageDocument15 pagesSQ 2 Invitation Au Voyagesakura.chan1327100% (1)
- Oscar Wilde Hhet Marcel ProustDocument11 pagesOscar Wilde Hhet Marcel ProustLisandro RelvaNo ratings yet
- 2 UE I, 2, 1èreDocument7 pages2 UE I, 2, 1èreSacha DivoNo ratings yet
- Yannick Lemarié, L'Abbé Jules: de La Révolte Des Fils Aux Zigzags de La FiliationDocument11 pagesYannick Lemarié, L'Abbé Jules: de La Révolte Des Fils Aux Zigzags de La FiliationAnonymous 5r2Qv8aonf0% (1)
- CANDIDE2 Nègre de SurinamDocument4 pagesCANDIDE2 Nègre de SurinamAyman BenkhdimNo ratings yet
- Isabelle Mellot, La Violence Du Rire Dans Le Conte Cruel Fin-De-Siècle, Chez Mirbeau Et Villiers de l'Isle-AdamDocument13 pagesIsabelle Mellot, La Violence Du Rire Dans Le Conte Cruel Fin-De-Siècle, Chez Mirbeau Et Villiers de l'Isle-AdamAnonymous 5r2Qv8aonfNo ratings yet
- La Condition Humaine Cours STMGDocument2 pagesLa Condition Humaine Cours STMGKUKINo ratings yet
- Adaptations D'orgueil Et Préjugés de Jane AustenDocument515 pagesAdaptations D'orgueil Et Préjugés de Jane AustenFrancoise HayartNo ratings yet
- Les Miserables HugoDocument74 pagesLes Miserables HugoCaouic GayaNo ratings yet
- Résumé Oedipe RoiDocument8 pagesRésumé Oedipe RoiAnna MNo ratings yet
- Arnaud Vareille, "Octave Mirbeau Et La Médecine"Document49 pagesArnaud Vareille, "Octave Mirbeau Et La Médecine"Anonymous 5r2Qv8aonfNo ratings yet
- Journal D'un Clone - Gudule - Texte IntégralDocument6 pagesJournal D'un Clone - Gudule - Texte Intégralnourdz4545100% (1)
- Reza Art CorrigéDocument2 pagesReza Art CorrigéMartin CallaisNo ratings yet
- Cours Classe AntoineDocument2 pagesCours Classe AntoinelyblancNo ratings yet
- Réflexions Sur Claude Lévi Strauss, À L'occasion de L'élection À L'académie Française Du 23 Juin 2011, Par Jean-Pierre FleuryDocument52 pagesRéflexions Sur Claude Lévi Strauss, À L'occasion de L'élection À L'académie Française Du 23 Juin 2011, Par Jean-Pierre Fleuryoliviero44No ratings yet
- Bac L 2017 Latin CorrigeDocument2 pagesBac L 2017 Latin CorrigeLETUDIANTNo ratings yet
- Commentaire Composé Littérature 1Document7 pagesCommentaire Composé Littérature 1Antônio MeurerNo ratings yet
- Analyse Linéaire Giton Et PhédonDocument6 pagesAnalyse Linéaire Giton Et Phédonmyriambengamra0110No ratings yet
- Carte Sur La NouvelleDocument1 pageCarte Sur La NouvelleAmel KhNo ratings yet
- L'ANALYSE-homme A La Cervelle D'orDocument3 pagesL'ANALYSE-homme A La Cervelle D'orMohamed FawouziNo ratings yet
- Marguerite DURAS, Un Barrage Contre Le Pacifique, Une Mère Exemplaire (Commentaire Composé)Document4 pagesMarguerite DURAS, Un Barrage Contre Le Pacifique, Une Mère Exemplaire (Commentaire Composé)Bra khalNo ratings yet
- Britannicus de Jean RACINEDocument6 pagesBritannicus de Jean RACINEsiyeon9242100% (1)
- Module II À Distance Fiche 2Document3 pagesModule II À Distance Fiche 2sorouri malakNo ratings yet
- Citations Pour La Dissertation Les CaractèresDocument6 pagesCitations Pour La Dissertation Les CaractèresHarmaneNo ratings yet
- Candide Surinam CCDocument5 pagesCandide Surinam CCterminalestiddsinNo ratings yet
- Bernanos - Un Itinéraire Spirituel 2Document20 pagesBernanos - Un Itinéraire Spirituel 2duckbannyNo ratings yet
- Récits EnchâssésDocument2 pagesRécits EnchâssésAs VejaNo ratings yet
- Il Était Une Fois Un Vieux Couple HeureuxDocument3 pagesIl Était Une Fois Un Vieux Couple Heureuxteffahi nabilNo ratings yet
- L'évasion D'arsène LupinDocument1 pageL'évasion D'arsène LupinsabinebatierNo ratings yet
- Pierre Michel, L'Autofiction Façon MirbeauDocument6 pagesPierre Michel, L'Autofiction Façon MirbeauAnonymous 5r2Qv8aonfNo ratings yet
- Devoir de Contrôle N°1 - Français - Bac Sciences Exp (2011-2012) Mme Ben Hammel HoudaDocument4 pagesDevoir de Contrôle N°1 - Français - Bac Sciences Exp (2011-2012) Mme Ben Hammel HoudaMadi Ha100% (1)
- Exemples de Sujets de Dissertation Olympe de Gouges Première GénéraleDocument8 pagesExemples de Sujets de Dissertation Olympe de Gouges Première Généraleaaliane77No ratings yet
- 1 Au Coeur Des TénébresDocument14 pages1 Au Coeur Des TénébresSuit SofNo ratings yet
- Oral Nana - OdtDocument3 pagesOral Nana - OdtFamille DesfreneNo ratings yet
- Correction EL5 La Rencontre Entre Manon Et Des GrieuxDocument2 pagesCorrection EL5 La Rencontre Entre Manon Et Des Grieuxtom.jenkins.proNo ratings yet
- De L'esclavage Des Nègres Montesquieu de L'esprit Des Lois Analyse Siècle Des LumièresDocument2 pagesDe L'esclavage Des Nègres Montesquieu de L'esprit Des Lois Analyse Siècle Des Lumièresfenelon06No ratings yet
- Extraits Du Roman Châteaux de Sable, Par L'homme Qui A Démodé Marc-Edouard NabeDocument22 pagesExtraits Du Roman Châteaux de Sable, Par L'homme Qui A Démodé Marc-Edouard Nabeoliviero44No ratings yet
- Réflexions Sur Claude Lévi Strauss, À L'occasion de L'élection À L'académie Française Du 23 Juin 2011, Par Jean-Pierre FleuryDocument52 pagesRéflexions Sur Claude Lévi Strauss, À L'occasion de L'élection À L'académie Française Du 23 Juin 2011, Par Jean-Pierre Fleuryoliviero44No ratings yet
- Je Ne Suis Pas Charlie, Par Olivier MathieuDocument6 pagesJe Ne Suis Pas Charlie, Par Olivier Mathieuoliviero44No ratings yet
- Olivier Mathieu Propose Une Dictée de Langue Française Aux Membres de L'académieDocument53 pagesOlivier Mathieu Propose Une Dictée de Langue Française Aux Membres de L'académieoliviero44No ratings yet
- Olivier Mathieu Propose Une Dictée de Langue Française Aux Membres de L'académieDocument53 pagesOlivier Mathieu Propose Une Dictée de Langue Française Aux Membres de L'académieoliviero44No ratings yet
- Olivier Mathieu Propose Une Dictée de Langue Française Aux Membres de L'académieDocument53 pagesOlivier Mathieu Propose Une Dictée de Langue Française Aux Membres de L'académieoliviero44No ratings yet
- Olivier Mathieu Propose Une Dictée de Langue Française Aux Membres de L'académieDocument53 pagesOlivier Mathieu Propose Une Dictée de Langue Française Aux Membres de L'académieoliviero44No ratings yet
- Tête de Pioche, Texte de Jean-Pierre FLEURY Sur Olivier MATHIEU Dit Robert PIOCHEDocument7 pagesTête de Pioche, Texte de Jean-Pierre FLEURY Sur Olivier MATHIEU Dit Robert PIOCHEoliviero44No ratings yet
- Olivier Mathieu (Dit ROBERT PIOCHE) Entre Ciel Mon Mardi Et L'académie Française, Par Jean-Pierre FleuryDocument8 pagesOlivier Mathieu (Dit ROBERT PIOCHE) Entre Ciel Mon Mardi Et L'académie Française, Par Jean-Pierre Fleuryoliviero44No ratings yet
- Vie de Maurice Druon Racontée, en Vers, Par Olivier MathieuDocument6 pagesVie de Maurice Druon Racontée, en Vers, Par Olivier Mathieuoliviero44No ratings yet
- Eloge Poétique de Maurice Druon (Élection À L'académie Française, 7 Avril 2011)Document4 pagesEloge Poétique de Maurice Druon (Élection À L'académie Française, 7 Avril 2011)oliviero44No ratings yet
- Chiens Et Chats Dans L'oeuvre D'andré Baillon Et Dans Celle de Marie de Vivier, Article D'olivier Mathieu (Dit Robert Pioche) Dans La Revue NOUVEAUX CAHIERS André BaillonDocument5 pagesChiens Et Chats Dans L'oeuvre D'andré Baillon Et Dans Celle de Marie de Vivier, Article D'olivier Mathieu (Dit Robert Pioche) Dans La Revue NOUVEAUX CAHIERS André Baillonoliviero44No ratings yet
- CENT PAGES D'AMOUR Par Marie de Vivier, Roman Sur Olivier Mathieu Dit Robert PiocheDocument40 pagesCENT PAGES D'AMOUR Par Marie de Vivier, Roman Sur Olivier Mathieu Dit Robert Piocheoliviero44No ratings yet
- Ange Lepaige, Roman Sur Carlo Gozzi, Le Vendéen de VeniseDocument68 pagesAnge Lepaige, Roman Sur Carlo Gozzi, Le Vendéen de Veniseoliviero44No ratings yet
- Olivier Mathieu, Le Passage À Niveau, RomanDocument22 pagesOlivier Mathieu, Le Passage À Niveau, Romanoliviero44No ratings yet
- Voyage en Arromanches, Olivier Mathieu, Préface de Jean-Pierre FleuryDocument24 pagesVoyage en Arromanches, Olivier Mathieu, Préface de Jean-Pierre Fleuryoliviero44No ratings yet
- Au Sujet D'olivier Mathieu, Dit Robert Pioche, Par Jean-Pierre FleuryDocument15 pagesAu Sujet D'olivier Mathieu, Dit Robert Pioche, Par Jean-Pierre Fleuryoliviero44No ratings yet
- Les Dames Tres Dignes Texte de 1969Document21 pagesLes Dames Tres Dignes Texte de 1969oliviero44No ratings yet
- Livre 3-Enseignements d'Enoch-Les Clefs Pour La Nouvelle Humanité PDFDocument96 pagesLivre 3-Enseignements d'Enoch-Les Clefs Pour La Nouvelle Humanité PDFprince romanel100% (3)
- Voltaire MondeDocument37 pagesVoltaire MondeAlima DoukoureNo ratings yet
- Dossier Gratuit Les Meilleurs Conseils Pour Reconquerir Son ExDocument44 pagesDossier Gratuit Les Meilleurs Conseils Pour Reconquerir Son ExMoussa BanaNo ratings yet
- Joseph Le Gras L Extravagante Personnalite de Jacques CasanovaDocument313 pagesJoseph Le Gras L Extravagante Personnalite de Jacques CasanovaHoly Santa100% (1)
- L'enfer ExisteDocument247 pagesL'enfer Existechretiencatholique100% (1)
- Manuel FMDocument265 pagesManuel FMMonte CristoNo ratings yet
- Les Clés de L'amour VéritableDocument47 pagesLes Clés de L'amour Véritablealibel09No ratings yet
- 1 Thessaloniciens 41-12 - La Sexualit Sanctifie T HarrisDocument10 pages1 Thessaloniciens 41-12 - La Sexualit Sanctifie T HarrisAvengNo ratings yet
- LES 42 Et Les 77 Commandements de Maat - 2 PDFDocument4 pagesLES 42 Et Les 77 Commandements de Maat - 2 PDFCollins A. NGUIMABOU T.No ratings yet
- RHR 7543 4 Dieu Est La Vraie Mesure de Toute ChoseDocument37 pagesRHR 7543 4 Dieu Est La Vraie Mesure de Toute ChoseSombre Arcane ZineNo ratings yet
- Comment Devenir Une Personne ExtraordinaireDocument2 pagesComment Devenir Une Personne ExtraordinaireYeshoua HoldingNo ratings yet
- Romeo & JulietteDocument32 pagesRomeo & Julietteparduc11No ratings yet
- DemarcheDocument3 pagesDemarcheAlain BarbierNo ratings yet
- Lesauteursgrecse 00 SommDocument644 pagesLesauteursgrecse 00 Sommmikab3100% (1)
- Tais-Toi Et Arrête de Te PlaindreDocument236 pagesTais-Toi Et Arrête de Te Plaindrepoussmouss59100% (1)
- Sainte Thérèse de Lisieux - PoésiesDocument80 pagesSainte Thérèse de Lisieux - PoésiesMarcos Paulo CruzNo ratings yet
- Chiromancie Nouvelle PDFDocument636 pagesChiromancie Nouvelle PDFTamar KalandadzeNo ratings yet
- Montaigne SéquenceDocument4 pagesMontaigne SéquencelyblancNo ratings yet
- Formation D'un Petit Groupe D'étude Spirite Médium MarcoDocument9 pagesFormation D'un Petit Groupe D'étude Spirite Médium MarcoledrogoNo ratings yet
- URANTIA - Tidings - 2007 - 07-08 - QC PDFDocument13 pagesURANTIA - Tidings - 2007 - 07-08 - QC PDFdroopy007No ratings yet
- L'enseignement de Ramakrishna-Francais PDFDocument584 pagesL'enseignement de Ramakrishna-Francais PDFkoffi serge pacome MBRANo ratings yet
- FadimanDocument33 pagesFadimantest1234No ratings yet
- Francois de Sales - Oeuvres Completes - Vol.10Document573 pagesFrancois de Sales - Oeuvres Completes - Vol.10librisNo ratings yet
- Svami PrajnanpadDocument2 pagesSvami PrajnanpadJulien111No ratings yet
- Blais Philo Du PouvoirDocument119 pagesBlais Philo Du PouvoirEmmanuel GleveauNo ratings yet
- ArDocument32 pagesArNeelKamal89No ratings yet
- Le Changement Des Valeurs Sociales PDFDocument13 pagesLe Changement Des Valeurs Sociales PDFLamyae BKHACHNo ratings yet
- Le Conscient Et L'inconscientDocument11 pagesLe Conscient Et L'inconscientJoop-le-philosopheNo ratings yet
- L'ideal ChevaleresqueDocument1 pageL'ideal ChevaleresqueOlguta IstratiNo ratings yet
- La PudeurDocument23 pagesLa PudeurAhmad MakkyNo ratings yet