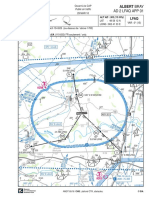Professional Documents
Culture Documents
Afric'+á Palabres 30
Uploaded by
routedesenfantsOriginal Title
Copyright
Available Formats
Share this document
Did you find this document useful?
Is this content inappropriate?
Report this DocumentCopyright:
Available Formats
Afric'+á Palabres 30
Uploaded by
routedesenfantsCopyright:
Available Formats
Afric’à L’Afrique : solidarité familiale à risque
Yves Mamou du Service Economique du Monde 14/06/08
Palabres Supprimer les exonérations de redevance télévisée et l'augmentation des
allocations familiales pour les enfants qui grandissent, freiner la mise en
place du revenu de solidarité active, préconisé par Martin Hirsch, haut-commissaire aux solidarités
actives, obliger les chômeurs à accepter le deuxième emploi proposé par l'ANPE..., ces mesures de
Nicolas Sarkozy reposent sur une hypothèse simple : les mécanismes de solidarité collective qui ont
prévalu engendrent l'inertie et freinent le développement économique. Si la société française veut
renouer avec la croissance et le plein-emploi, le curseur des dispositifs d'assurance collective -
assurance-maladie, assurance-chômage, aides sociales, etc. - doit être abaissé pour réinjecter une
dose plus élevée de risque. Combien ? Comment ? On tâtonne pour savoir.
Cette hypothèse, selon laquelle un juste équilibre entre assurance collective et risque individuel favorise
la croissance économique et la. Prospérité collective, n'est pas spécifique à la France. Elle concerne
tous les pays qui sortent de l'Etat providence, mais aussi et peut-être surtout les sociétés en
développement. Jean-Paul Azam, professeur d'économie à l'université Toulouse-1, estime ainsi que «
c'est l'absence de sécurité sociale qui pénalise le développement économique de bon nombre de
pays d'Afrique ». Dans les pays en développement, les risques santé, chômage, invalidité sont si élevés
qu'ils obligent la famille, le clan à consacrer leur énergie à bâtir des mécanismes d'assurance pour
assurer la subsistance des membres du groupe. Ainsi, l'un des principaux mécanismes assurantiels
développés par les sociétés africaines est l'émigration. « On trouve par exemple des Soninké aux Etats-
Unis et en Europe, note M. Azam. Ces migrants ont pour fonction de procurer au groupe des revenus
décorrélés des aléas climatiques. Si la moisson est frappée par la sécheresse ou les sauterelles, le
groupe sera nourri par les revenus des migrants. »
Qu'est-ce qui force les migrants à respecter leur
mission ? «La liaraka. » Si le patriarche, resté au
village, « refuse la baraka au migrant qui a failli, il en
résulte une forme d'excommunication. Même ses
enfants se détourneront de celui qui a perdu la
baraka », affirme M. Azam. Outre l'émigration, la
solidarité interpersonnelle joue aussi un grand rôle
dans la survie du groupe. Un père, une mère, un
oncle doit sacrifier son épargne... si les besoins de la
famille l'exigent. Et chacun sait qu'en Afrique les
besoins sont immenses et que la famille ne se réduit
pas aux parents et à deux enfants.
Paradoxalement, les sociétés africaines et la
société française, issue de l'Etat providence, ont deux points en commun : aucune personne
en position de « cotiser » n'échappe aux prélèvements sociaux du groupe ; et la demande de
sécurité des bénéficiaires des systèmes d'assurance sociale est abyssale, au point de pénaliser -
en Afrique comme en France - la croissance et la création de richesse. La question du poids
trop élevé de la solidarité collective est posée en Afrique par bon nombre d'Africains eux-mêmes. Les
migrants qui envoient de l'argent au pays finiraient par comprendre que ce flux d'argent régulier
engendre la « paresse » du groupe qui reçoit. « Rater chaque armée la récolte est un moyen de
pérenniser le flux financier en provenance du groupe des migrants », explique Emmanuelle Auriol,
professeur d'économie à l'université de Toulouse.
Des travaux menés par Jean-Marie Baland, Catherine Guirkinger et Charlotte Mali, pour le Centre de
recherche en économie du développement de l'université de Namur, montrent ainsi que, dans
certaines zones rurales du Cameroun des agriculteurs s'endettent volontairement auprès de
coopératives de crédit tontines) pour dissimuler à leur famille proche le montant de leurs économies. «
Quand j'emprunte, ma femme et mes enfants pensent que je n'ai pas d'argent. Je le fais exprès. Ainsi,
quand quelqu'un se plaint qu'il a un problème d'argent, j'explique que je ne peux lui venir en aide car
j'ai un emprunt à rembourser », déclare aux chercheurs un agriculteur camerounais. « Si j'emprunte pour
payer l'école, ajoute-t-il, mon fils ne viendra pas me voir pour me demander de lui acheter une paire de
chaussures. Mais si je paye l'école avec mes économies, il va me demander autre chose. » Le coût de
cette dissimulation est très élevé puisque les taux d'intérêt peuvent atteindre 13 %.
Poussés à la faillite
La pression exercée par le groupe pour le maintien de la redistribution de personne à personne est si
forte en Afrique que certains entrepreneurs sont parfois poussés à la faillite. M"" Auriol donne ainsi
l'exemple de ce Sénégalais créateur d'entreprise qui, pression familiale oblige, avait déjà dû
embaucher tous les membres de sa famille. Lorsqu'il s'est aperçu qu'un des cousins se servait dans la
caisse, il l'a licencié. Aussitôt, le clan s'est ligué contre l'entrepreneur. « Sa mère est venue le voir, elle l'a
maudit. Il a été obligé de réembaucher le voleur », raconte M"° Auriol. Pour éviter la ruine, certains
entrepreneurs très Imaginatifs multiplient la création d'entreprises de manière à brouiller les pistes. Ils
clament haut et fort que toutes leurs entreprises sont déficitaires et au bord de la faillite afin de mieux
protéger une ou deux structures qui gagnent de l'argent. Certains malins ont choisi d’investir dans
l’immobilier pour briser ce cycle de dépendance. Un Sénégalais qui a épargné assez d'argent pour
acheter un petit immeuble à la périphérie de Dakar à fait comprendre à sa famille qu'elle ne
bénéficierait des revenus locatifs qu'en participant à l'entretien de l'immeuble contre rémunération.
D'autres encore n'envoient pas d'argent directement à la famille mais passent commande à l'épicier
du village. « C'est une manière de flécher l'urgent qu'ils envoient. Ils savent comment il sera dépensé et,
surtout, l'épicier est témoin de la dépense », indique M"" Auriol.
La manière dont les Africains gèrent et vont faire évoluer leurs obligations en matière de solidarité est
cruciale pour l'avenir. Le leur surtout. Eliana La Ferrara, professeur à l'université Bocconi, à Milan, écrit
que « les sociologues et les anthropologues ont toujours placé les structures familiales au cœur de leur
investigation pour comprendre les structures sociales. Les économistes viennent seulement de
commencer d'en faire autant. Il est temps d'utiliser les concepts de l'économie pour comprendre
comment les personnes, les familles et les groupes prennent leurs décisions dans les pays en
développement ». Cette approche pourrait bien se révéler décisive dans la lutte contre la pauvreté.
la Chine à la conquête de l’Afrique
Si l'on demandait à un échantillon d'Européens et d'Américains de désigner une terre nouvelle, une
promesse de fortune, un Far West à conquérir, ils songeraient sans doute aux gratte-ciel de Shanghai.
Mais si l'on posait la même question à des Chinois, leur réponse aurait des chances de surprendre. Car
ils pourraient bien évoquer les embouteillages de Lagos ou les banlieues de Khartoum. Voire le Congo,
petite république de moins de quatre millions
d'habitants, à peine remise d'une guerre civile, où
les routes asphaltées sont rares et où les
réfrigérateurs marchent souvent sur groupe
électrogène. Les Chinois pourtant s'y précipitent
depuis quelques années, comme d'ailleurs vers
les cinquante-deux autres pays du continent noir.
Prenez Jessica Yé, par exemple. «Je suis arrivée à
Brazzaville les mains vides, en avril 2000», dit cette
jeune femme originaire de Wenzhou, au sud de
Shanghai. Après trois mois comme traductrice sur
un chantier où ses compatriotes construisaient le
nouveau ministère congolais des Affaires
étrangères, elle a ouvert un restaurant, puis deux,
une boutique, puis deux, alimentées par les
conteneurs de marchandises que son frère et ses
cousins envoyaient de Chine. Aujourd'hui, Jessica
a si bien travaillé qu'elle a fait venir quatre-vingts
membres de sa famille au Congo pour s'occuper
de ses affaires : une fabrique de fenêtres en
aluminium, une boîte de nuit, une dizaine de
boutiques et toujours plus de restaurants'. «J'ai
envie d'étendre mon business à l’Angola, ça
boume trop, là-bas !», dit-elle en français, avec
un accent à la fois asiatique et africain, au
restaurant Bel Air qu' elle vient d'acheter sur la
plage de Pointe-Noire. Puis, elle présente ses deux
plus proches collaborateurs : son frère, qui importe du ciment, et son mari, qui dirige une grosse
entreprise forestière.
En cinq ans, les échanges ont été multipliés par cinq
Une vraie ruée vers l'Afrique. Quelques Chinois avaient certes posé leurs premières valises au XIXe siècle
(en Afrique du Sud et à Madagascar). La coopération de l'époque Mao dans les années 1960 et 1970
amena ensuite quelques individus et quelques entreprises. Ils serviront d'ancrage pour les nouveaux
arrivants qui commencèrent à affluer au milieu des années 1990. Depuis, le flot s'est accéléré. Selon
l'association de l'Amitié des peuples chinois et africains, un des rares organismes à Pékin à citer un
chiffre, les Chinois seraient déjà 500000 en Afrique, à comparer aux 110000 Français environ. Mieux : la
Chine vient de prendre la place de la France comme second partenaire commercial de l'Afrique,
après les Etats-Unis. D'après le ministère chinois du Commerce, les échanges Chine-Afrique ont été
multipliés par cinq entre 2001 et 2006 pour atteindre 55,4 milliards de dollars. Ce chiffre s'élèvera -selon
nos propres calculs - à 70 milliards en 2007 (contre 56 pour la France).
Quel est le secret des Chinois pour faire fortune en Afrique, là où les Occidentaux ne voient souvent qu'
une terre juste bonne à recueillir de l'aide humanitaire ? Il y a bien sûr le soutien explicite de leur
gouvernement, qui cherche à garantir l'accès de la Chine aux matières premières dont l'Afrique
regorge : pétrole, cuivre, uranium, bois... Il finance pour cela des centaines de projets d'infrastructures.
En mai 2007,l’Exim Bank, principal levier du gouvernement chinois pour les opérations à l'étranger,
indiquait qu'elle s'apprêtait à investir vingt milliards de dollars en Afrique ces trois prochaines années.
Mais il n'y a pas que les milliards de l'Etat. Le courage et la détermination de milliers d'individus, qui n'ont
rien à perdre, compte aussi. Les paysans du Sichuan ou du Yunnan,
qui trouvent moins facilement du boulot sur les chantiers de
Shanghai ou Canton, et qui veulent gagner plus que les 60 à 100
euros mensuels offerts là-bas, se lancent dans l'aventure africaine.
Le plus souvent, ils débutent comme marchands de pacotille
chinoise dans les rues brûlantes des métropoles. Ils économisent
chaque franc CFA pour investir ensuite dans des affaires plus
établies. D'autres préfèrent partir avec la garantie des agences
d'exportation de main-d'œuvre, qui ont fleuri dans tout le pays.
Huang Yiming qui en a ouvert une à Chongqing, dans le centre de
la Chine, raconte : «En 2008, je suis chargé de trouver mille ouvriers
spécialisés pour M. Li, un entrepreneur chinois qui possède
quarante usines au Nigeria.» Huang Yiming fournit aussi bien les
restes chinois de Paris que les chantiers africains. «Il faut signer pour
deux ans minimum, ajoute-t-il, et les salaires sont de cinq cents
dollars par mois, nourri logé.»
«Afropessimisme» n'a pas sa traduction en mandarin
A Lagos au Nigeria, son client M. Li est une célébrité. Ses usines
produisent notamment les sandales en plastique qui chaussent
quatre personnes sur dix en Afrique de l'Ouest. Mais il n'est pas le
seul. Il y a aussi son compatriote Jacob Wood, qui possède quinze
usines, deux hôtels et un restaurant de cinq étages, le Golden
Gâte, où il reçoit. Ce petit homme à lunettes se veut le symbole des
entrepreneurs chinois au Nigeria, à la fois généreux (il a offert à la
ville de Lagos une école pour 4000 élèves, ce qui lui a valu le titre
de chef africain) et débrouillard (il paie par un banquet annuel à
l'association des femmes d'officiers le privilège d'avoir pu passer
toute sa flotte de 4x4 en immatriculation de police). Ce n'est pas là
sa seule concession aux mœurs locales : Jacob Wood est aussi devenu bigame. Sa première femme
n'ayant pas pu avoir d'enfant, il en a épousé une seconde, plus jeune, chinoise elle aussi, qui lui a
donné un garçon aujourd'hui âgé de 7 ans. Une situation qui convient parfaitement à la structure de
ses affaires : la première épouse s'occupe de son hôtel à Lagos, le cœur économique du pays, alors
que la seconde tient l'établissement d'Abuja, la capitale politique.
Jacob Wood emploie 1500 Nigérians encadrés par plus de 300 Chinois et il s’apprête à recruter des
dizaines d'autres compatriotes cette année. «Les Chinois commencent tous par importer des
marchandises en Afrique, dit-il, mais ce qu'il faut, c'est produire sur place. Il y a tant à faire !» Lui-même
a d'abord tenu un restaurant, avant de se diversifier dans le bâtiment et les travaux publics, les
matériaux de construction et l'assemblage de machines de chantier. Ses projets vont de la fabrication
de climatiseurs géants au montage de téléviseurs.
En bons stratèges, les Chinois multiplient aussi les initiatives diplomatiques et
culturelles
A Lagos, à Luanda, à Alger, on dirait que l'«afropessimisme», un mot si prisé chez nous, n'a pas de
traduction en chinois. L'enthousiasme et le rythme effréné des affaires dont s'occupent les Chinois
offrent un contraste saisissant avec l'attitude négative des Occidentaux et celle des populations locales
résignées au chômage et aux activités de survie. Les infrastructures que l'Afrique réclame depuis
quarante ans à ses anciens maîtres coloniaux, les Chinois sont en train de les réaliser à toute vitesse. Le
barrage de Bui au Ghana, celui d'Imboulou, au Congo, les 1 315 km de chemin de fer au Nigeria entre
Kano et Lagos ou les 800 km d'autoroute entre Khartoum et Port-Soudan, prévus depuis les années 1960,
sont passés du papier au béton, grâce aux crédits et aux constructeurs chinois.
La nuit, le chantier fonctionne à la lueur des projecteurs
A la tombée de la nuit, à Brazzaville, il faut enjamber des dizaines d'ouvriers qui gisent par terre, épuisés,
pour accéder au palais en construction de Claude Alphonse N’Silou, ministre congolais de la
Construction, de l'Urbanisme et de l'Habitat. «On est là depuis 7 heures du matin», gémit l'un. «On
construit la maison d'un ministre, mais c'est pour les Chinois qu'on travaille», ajoute un autre. Ces
manœuvres sont payés 1800 francs CFA (2,70 euros) par jour et n'ont pas de contrat. Ils se plaignent de
se faire insulter à la moindre maladresse, frapper de temps en temps.
Dans l'enceinte du chantier, les Chinois ont allumé les projecteurs pour continuer de tourner du béton,
clouer des coffrages et monter des briques. Le maître des lieux nous attend au sommet d'un escalier
qui, on le devine déjà, sera monumental et surmonté d'un frontispice triangulaire. Claude Alphonse
NSilou s'excuse du désordre et nous conduit dans la partie déjà habitable, et même luxueuse, avec
salon de cuir, sol de marbre, écran plat géant, lumière tamisée et une domestique qui sert de l'eau
pétillante française.
«Les Chinois sont fantastiques, lance le ministre, jovial, les bras posés sur les accoudoirs de son fauteuil.
Vous avez vu comme ils travaillent? Ils nous ont fait le stade Alphonse Massamba-Débat, le ministère
des Affaires étrangères, le siège de la télévision, le barrage d'Imboulou. Ils vont refaire tout le réseau
d'eau à Brazzaville. L'aérogare. L'autoroute Pointe-Noire - Brazzaville. Des logements. Un parc
d'attractions. Tout ça, décidé, conclu ! Du gagnant-gagnant ! Dommage pour les Français, mais les
Chinois sont fantastiques.» Interrogé sur les conditions de travail de ses compatriotes sur son propre
chantier, le ministre se fait philosophe. «Nous sommes trois millions, eux ils sont un milliard. Donc, la
relation au travail n'est pas la même. Chez eux, c'est une question de survie. Chez nous aussi... mais pas
au même niveau. Ici, certains jeunes n'ont pas encore compris l'importance du travail. Cela agace les
Chinois. Je les comprends. Il faut avouer que nous sommes un peu flegmatiques.»
Evidemment, il serait indélicat de demander si le flegme en question ne concerne que les ouvriers qui se
reposent aux abords de sa propriété ou s'il inclut certaines élites africaines. Pendant les 40 ans qui ont
suivi l'indépendance, les gouvernants du continent se sont le plus souvent contentés d'assister,
nonchalants et cyniques, à la déliquescence des infrastructures de l'époque coloniale. La plupart des
experts estiment que, durant la période 1960-2003, l'Afrique a reçu 400 milliards de dollars d'aide
occidentale. L'économiste William Easterly, directeur de 1 ' Institut de développement de l'université de
New York annonce même 568 milliards. Peu
importe. L'ironie des chiffres veut que cette
somme corresponde aussi, selon l’ONU, à la
totalité des capitaux qui ont quitté l'Afrique en
douce pour se cacher dans les banques
occidentales.
L’arrivée des Chinois n'a pas rendu les élites
africaines plus vertueuses, mais comme ils
prêtent à la fois l'argent et construisent les
infrastructures, cela aboutit au moins à ce que
les stades, les barrages, les routes, les chemins
de fer, les hôpitaux et les écoles soient
achevés. Une fois les travaux terminés, les
gouvernants africains tirent la couverture à
eux. Comme par hasard, beaucoup de
chantiers chinois sont calculés pour se terminer
au moment des élections... Exemple ? Le
barrage d'Imboulou au Congo (en 2009) ou
l'autoroute est-ouest en Algérie (idem). Si les
délais sont tenus, cette dernière détiendra un
record mondial de vitesse d'exécution : 927
km, 11 tunnels et 25 viaducs construits en
quarante mois (à signature du contrat, le 18
septembre 2006).
Deux cultures antagonistes se rencontrent
Le consortium chinois CITIC-CRCC a obtenu les deux tiers de ce «chantier du siècle». «Pour respecter le
calendrier, nous travaillons jour et nuit, sept jours sur sept», explique Wang, un ingénieur qui ne donne
que son nom de famille. Autour de lui, la base de vie numéro 2 de Khemis el-Khechna, au cœur de la
plaine de la Mitidja, au sud-est d'Alger, ressemble à la fois à un camp de vacances et à une caserne.
L'accès est protégé par des hommes armés et des barbelés. Les allées sont plantées de haut-parleurs
qui diffusent à heure fixe des exhortations au travail et de la musique martiale. «Les Chinois ont l'air
misérable. Ils n'ont que leurs mains et leur force à offrir», regrette Omar Oukil, conseiller du ministre des
Travaux publics, en sirotant un thé dans les canapés de son bureau. «Mais pour que nos Algériens se
frottent à leur culture du travail assez rigoureuse, nous avons obligé les Chinois à utiliser 70 % de main-
d'œuvre locale», ajoute-t-il en conclusion de sa journée de travail au ministère... déjà désert sur les
coups de 16 heures. Les Chinois de CITIC-CRCC ont fait valoir que la présence d'Algériens sur les
chantiers risquait de ralentir les travaux et ont négocié la venue de 12 878 expatriés chinois. Soit la
moitié des effectifs.
Au bas de l'échelle, à vrai dire, il y a peu d'amour entre Chinois et Africains, issus de deux cultures
diamétralement opposées. Excepté à Madagascar, où les Chinois sont établis depuis plus d'un siècle,
les mariages mixtes se comptent sur les doigts de la main, les rapports humains sur les chantiers sont
souvent tendus et dans les discussions avec les uns et les autres surgissent tous les clichés racistes que
l'Occident, par correction politique, s'interdit désormais de prononcer : les Africains sont «paresseux»
alors que les Chinois sont des «petits robots privés de sensibilité, qui mangent les chats et les chiens».
Mais, là encore, pour les dirigeants africains, peu importe. La venue des Chinois est la meilleure affaire
depuis longtemps.
«Ils nous offrent du concret, alors que l'Occident
propose des valeurs intangibles. Ça sert à quoi, la
transparence, la gouvernance, si les gens n'ont pas
d'électricité, pas de travail ? La démocratie, ça ne se
mange pas», affirme Serge Mombouli, conseiller de la
présidence à Brazzaville.
Voilà l'équation crûment posée : voter ou manger, il
faudrait choisir. Et c'est au titre de ce pragmatisme que
la Chine soutient -entre autres- des régimes dictatoriaux
comme celui de Robert Mugabe au Zimbabwe ou celui
d'Omar al-Bachir au Soudan, accusé de crimes contre
l'humanité au Darfour. La possible complicité de la
Chine dans le massacre de 200000 civils au Darfour a
conduit le réalisateur américain Steven Spielberg à
renoncer à mettre en scène l'ouverture des Jeux
olympiques de Pékin en août 2008. Mais ce type de
posture exaspère les Africains. «L'Occident passe son
temps à nous faire la morale, lance Paulo Diarra, jeune
homme d'affaires angolais qui fournit des accès à
Internet et importe de Canton des téléphones
portables. Les Chinois, eux, viennent et agissent. Bien sûr
qu'ils sont au Soudan ou en Angola pour le pétrole, mais vous êtes là pour quoi, vous, les Américains, les
Français ? Vous prétendez nous donner des leçons de moralité et de transparence, mais vous avez sucé
notre pétrole depuis quarante ans, vous nous avez laissés pauvres, vous avez corrompu tout le monde,
vous avez prolongé notre guerre civile et vous avez soutenu les pires dictateurs africains !»
Pékin présente la démocratie comme un fléau
La «non-ingérence dans les affaires intérieures» est le maître mot du discours idéologique qui
accompagne la présence chinoise en Afrique. Au sommet de Pékin de novembre 2006, qui a
rassemblé 48 Etats africains sur 53, les organisateurs distribuaient un petit ouvrage de l'historien Yuan Wu,
«La Chine et l'Afrique, 1956-2006», qui présente la démocratie comme un fléau, cause de
«l'exacerbation» des tensions à l'intérieur des pays africains. Heureusement, conclut-il, après 1995, «les
vagues de démocratisation sur le continent ont tendu à s'apaiser» (sic).
Les entreprises sont dans le collimateur des écologistes
L'écologie est l’autre sujet d'inquiétude des experts occidentaux. Ils constatent que les entreprises
chinoises ne s'embarrassent pas, dans le domaine de l'environnement, de codes de conduite. Les ONG
occidentales, même les plus puissantes comme le WWF, n' ont aucun moyen de pression. Au Congo,
Philippe Zhang, le mari de Jessica, gère les cinq concessions forestières de son entreprise, Sino-Congo-
Forêt (Sicofor), dont 93 000 hectares en plein parc national de Conkouati, un trésor de biodiversité. Le
bassin du Congo détient la seconde plus grande forêt tropicale au monde après l'Amazonie, mais le
WWF estime que deux tiers pourraient disparaître en cinquante ans si l'exploitation forestière se poursuit
au rythme actuel. Les comptages de la SGS, la société suisse de contrôle de quantité et de qualité,
indiquent que six arbres africains coupés sur dix partent directement pour la Chine et principalement le
port de Zhangjiagang, près de Shanghai, la plus grosse plate-forme mondiale pour le commerce de
bois tropical.
Sicofor a été créée fin 2006 sur les ruines d'une autre société chinoise, Man Fai Tai, en faillite pour
mauvaise gestion et viol systématique du code forestier congolais. Philippe Zhang déploie aujourd'hui
tous les efforts pour revenir au quota de production négocié à l'époque par Man Fai Tai, à savoir 919
troncs par jour, dont 189 dans le parc de Conkouati. L'ONG américaine Wildiife Conservation Society
(WCS), elle, finance un programme de surveillance du parc et a placé là une experte belge, Hilde
Vanleeuwe, qui s'arrache les cheveux au fur et à mesure que Sicofor s'approche de son quota. «Pour
prendre les arbres qui les intéressent, les bûcherons dépassent souvent les limites de leur concession,
accuse-t-elle. Par ailleurs, ils ne nourrissent pas leurs ouvriers. Du coup, ces derniers partent toutes les
nuits chasser dans la forêt.» En février 2007, les écogardes de Hilde Vanleeuwe ont intercepté un pick-
up sur la route de Pointe-Noire. Le véhicule était chargé de 86 dépouilles animales, dont plusieurs
gorilles et chimpanzés, à peine décongelés. Et le seul congélateur de toute la forêt appartient à
Sicofor...
S'il n'y a pas grand monde en Afrique pour pleurer la disparition d'espèces protégées, il en va
autrement lorsque les Chinois s'en prennent aux hommes. En Zambie, en avril 2005, un accident dans la
mine de cuivre chinoise de Chambishi a fait 45 morts parmi les employés locaux, en raison du non-
respect des normes de sécurité. Les mineurs ont alors manifesté contre leur employeur, et ont trouvé un
écho à Lusaka, la capitale, où le leader de l'opposition, Michael Sata, a utilisé les sentiments antichinois
de ses compatriotes pour sa campagne présidentielle en septembre 2006. Il a perdu de peu et a
accusé l'ambassade de Chine d'avoir soutenu le président sortant. Du coup, le président chinois Hu
Jintao, qui visitait le pays en février 2007, a dû renoncer à se rendre dans les mines de Chambishi, par
peur de provoquer la révolte des ouvriers.
Les travaux continuent... même en terrains minés
Même pour les Chinois, l'Afrique n'est pas une sinécure. De tous les projets annoncés, certains ne se
feront peut-être jamais. Ainsi, en Angola, le pays africain où la Chine a le plus investi
après le Soudan, la corruption au plus haut niveau aurait fait s'évaporer deux milliards de dollars de
fonds chinois et bloqué la reconstruction des chemins de fer. Cela ne manque pas de réjouir les
diplomates occidentaux sur place, qui détaillent par câbles cryptés à leurs ministères respectifs les
indices d'une crise diplomatique entre Pékin et Luanda. «Les Chinois n' ont pas assez d'expérience en
Afrique, ils ne vont pas tarder à décevoir les Angolais, dit l'un d'eux, sous couvert de l'anonymat.
D'ailleurs, ils commencent à être déçus : ils ne pensaient pas que les pots-de-vin étaient si chers, en
Angola !» Un autre enfonce le clou : «A nos amis angolais, on dit: "C'est super, votre petite promenade
avec les Chinois. Amusez-vous bien. Mais quand vous voudrez jouer dans la cour des grands, payez vos
dettes et revenez nous voir."»
Les Chinois offrent du concret, pas des leçons de morale
Ce diplomate déchanterait sans doute s'il allait faire un tour à Lobito, dans le sud du pays. Bien sûr, la
ville désespère que soit un jour réparée la ligne de train qui la reliait autrefois aux mines de cuivre de
Zambie et de l'ex-Zaïre. Ce contrat d'Etat semble patiner. Mais les entreprises privées chinoises, elles,
font fortune. «En cinq ans d'Afrique, je n'ai jamais vu ça, souffle l'ingénieur Zhou Zhenhong, originaire de
Shanghai, qui ne s'arrête de courir que le temps d'une cigarette. Je n' ai pas une seconde pour
chercher un logement pour mes trente contremaîtres chinois. On campe sur les chantiers.» En 2007,
pour la première année de son existence, Kaituo, sa petite entreprise, a fait dix millions de dollars de
chiffre d'affaires en bâtissant deux écoles, un hôpital, une caserne de pompiers et plusieurs immeubles
résidentiels dans les environs de Lobito. «Les autorités, dit-il, insistent tellement pour que tout soit fait du
jour au lendemain -et paient cher pour ça.»
Il n'y a vraiment que les Chinois, leur incroyable détermination et leur âpreté au gain pour affronter, en
Angola, la corruption, le manque de matériaux de construction ou... les mines antipersonnel. Il subsiste
dans le pays 3 266 zones minées, près desquelles vivent 2,3 millions d'Angolais. Les démineurs du
gouvernement sont encore peu organisés et les ONG internationales comme Halo Trust, qui fournit ces
statistiques, sont obligées de réduire leurs opérations. Cela n'effraie pas Zhou Zhenhong : «On n ' a pas le
temps d'attendre les équipes de déminage sur nos sites, sourit-il. On le fait nous-mêmes, au bulldozer.
On enfonce le chargeur et on pousse fort. Cela nous a coûté quelques bulldozers, mais c'est plus
rentable que de retarder le chantier.»
Serge Michel Géo avril 2008
L'Africain qui se joue des frontières
Dans les rues de Paris, avec son képi couvert de médailles et son
visage charbon, Romuald Hazoumé ne passe pas inaperçu. Alors
qu'il s'est lancé dans un grand discours sur l'art, deux clochards
particulièrement avinés se précipitent sur lui pour prendre son
couvre-chef. Mais Hazoumé reste imperturbable. Comme si tout
était écrit, comme si rien ne devait jamais le surprendre.
S'il est reçu dans les plus grands musées, de Londres à Rio en
passant par New York, Hazoumé reste un "homme de la rue" de
toutes les rues du monde qu'il sillonne sans fin pour y puiser
l'inspiration. Les "agités du bocal" ne lui font pas peur, il se sent
même une étrange parenté avec eux. Au Bénin, son pays d'origine,
il a longtemps fait figure d'illuminé. "Mes parents, surtout, me
prenaient pour un malade, ils ne comprenaient pas pourquoi je
voulais me lancer dans l'art." Artiste contemporain, plasticien,
c'était un métier qui n'existait pas au Bénin, avant que Romuald Hazoumé ne "l'invente" à la fin
des années 80. "Cela faisait quatre ans que je sillonnais l'Afrique de l'Ouest à vélo avec deux
Allemandes, une mère et sa fille. Je venais d'arrêter mes études de médecine en première
année pour me lancer dans cette aventure. Nous prenions des pistes loin des grandes routes et
ainsi nous découvrions les villages les plus intéressants, ceux qui sont cachés. Ces quatre
années m'ont permis de réfléchir. Tous les soirs, mon amie allemande me demandait ce que
j'allais faire de ma vie. Franchement, je n'en avais aucune idée. Et puis un jour, j'ai décidé de
me lancer dans l'art. Une idée qui ne m'avait jamais traversé l'esprit auparavant, même si
j'avais toujours fait de la sculpture."
Du jour au lendemain, il se met à travailler les métaux et à peindre. Mais à Cotonou, la capitale
économique du Bénin, pendant des années, nul ne le prend au sérieux. D'ailleurs, à cette
époque, personne ne s'intéresse à l'art contemporain. "Les artistes béninois faisaient des
"copies" de l'art occidental. Il y avait bien quelques riches Béninois et Occidentaux pour
acheter leurs imitations des oeuvres impressionnistes, mais franchement, je ne voyais pas
l'intérêt de me lancer dans cette voie. Notre culture est très riche. Pourquoi ne pas s'en inspirer
pour réaliser des œuvres originales ?"
Porto Novo, la ville natale de Romuald Hazoumé, est la capitale du trafic d'essence. 90 % du
carburant consommé au Bénin vient illégalement du Nigeria. Il est transporté en pirogue, en
tricycle, en camion par des trafiquants. Alors, en s'inspirant de son quotidien, Romuald a une
idée. Avec les bidons d'essence utilisés pour le "kpayo" la contrebande, il façonne des
masques africains. Une référence au passé de l'Afrique et à son présent. Le succès est
immédiat. Dès 1989, ses œuvres sont exposées au Brésil. David Bowie achète trois "masques
bidons" 2000 dollars pièce. À l'époque, c'est une petite révolution pour un artiste contemporain
africain. Depuis lors, dans le monde de l'art, la cote d'Hazoumé n'a cessé de monter. À
l'ouverture du musée du quai Branly, en 2006, une de ses installations
a fait sensation, La bouche du roi, une exposition de masques bidons
au milieu de bateaux qui participent à la traite négrière. Cette
installation a été achetée par le British Muséum. "La bouche du roi,
c'est l'estuaire du fleuve Mono. Là où les Portugais venaient acheter
leurs esclaves. Si j'utilise des éléments modernes pour parler du thème
de l'esclavage, c'est parce que je pense que cela reste un problème
très actuel. Aujourd’hui il y a des esclaves modernes avec la
mondialisation sauvage. Pas simplement en Afrique. Quand je vais à
Londres, je vois tous ces Polonais paumés qui ont dû quitter leur pays
pour des raisons économiques',' se désole Hazoumé.
Hazoumé prépare une nouvelle "installation" autour d'un concept qui
lui tient très à cœur : des stars béninoises, je vais récolter de l'argent
en Afrique pour l'envoyer aux Occidentaux en difficulté. Nous allons
remettre l'argent aux ambassadeurs de France et des Etats-
Unis','propose-t-il, un sourire aux lèvres. Au-delà de la plaisanterie, son idée exprime un vrai ras-
le-bol : "L'aide occidentale est souvent l'expression d'une forme d'arrogance vis-à-vis de
l’Afrique. Comme si nous étions les seuls à avoir des pauvres. Les événements de la Nouvelle-
Orléans ont montré au monde entier que la pauvreté pouvait être terrible aux États-Unis alors
qu'en Afrique, hors les situations de guerre, on ne vit pas si mal. L'Africain a toujours un toit et
une famille." Hazoumé veut rompre avec l'"afropessimisme": "J'essaie de faire entendre ce
message : si on reste chez nous, on peut réussir. J'y crois, mais je le fais aussi parce que je suis
bien obligé de dire ça pour calmer la frustration des jeunes qui n'ont plus le droit de quitter le
continent. Aujourd'hui, si tu n'es pas un artiste ou un sportif célèbre, tu ne peux plus sortir de ce
continent."
Hazoumé veut se battre pour changer la donne. Il ne peut Conseils aux voyageurs
s'empêcher de penser que sa trajectoire peut servir • Pour découvrir un pays il convient
d'exemple. "Je n'ai jamais voulu faire comme tout le d'éviter les grands axes : lorsque j'ai
monde. Au lycée, j'ai choisi d'apprendre l'allemand par traversé l'Afrique de l'Ouest à vélo, j'ai
pur esprit de contradiction... Comme tout le monde jouait passé beaucoup de temps dans les villages
éloignés des routes, ceux qui se cachent
au foot, je me suis orienté vers le judo ", avoue celui qui a dans la brousse. L'accueil y est
été sélectionné dans cette discipline pour les Jeux merveilleux. C'est la meilleure façon de
Olympiques de Séoul. Finalement, son goût pour la découvrir la vraie culture, la plus
contradiction s'épanouira dans l'art. "Je n'ai jamais voulu authentique.
• Lorsque l'on voyage dans des régions où
étudier aux beaux-arts, je considère que c'est une perte il y a des problèmes d'insécurité, il ne
de temps. Je ne veux pas apprendre à faire de l'art faut jamais montrer sa peur, sous peine
comme les Occidentaux, explique-t-il. J'ai préféré de susciter des agressions. A l'heure
voyager. Grâce à mes périples, je parle couramment une actuelle, mieux vaut éviter de traverser la
frontière terrestre entre le Bénin et le
dizaine de langues africaines. J'ai fait une cinquantaine Nigeria. Il y a trop d'insécurité dans cette
de voyages en Allemagne, c'est là-bas que j'ai vraiment zone.
appris cette langue, pas sur les bancs du lycée où j'étais
vraiment nul." Autre sujet d'agacement pour Hazoumé : la prétention des Occidentaux à
vouloir enseigner l'art aux Africains. "Ils pensent avoir tout inventé. Mais sur ce continent, nous
faisons de l'art depuis des milliers d'années. Simplement, nos œuvres sont au service de la
communauté. J'ai d'ailleurs envie de servir les miens. Faire de l'art, c'est mieux que faire de la
politique. On peut tenir un discours honnête, sans mentir."
Malgré son succès international, Hazoumé refuse de quitter le
Bénin. "Il faut reconstruire l'Afrique, chacun à son petit niveau.
Montrer que les Africains peuvent réussir, mener des actions
collectives sans se déchirer." Passionné de sport, il finance
avec ses économies une équipe cycliste, le "Zoumzoum vélo
club "qui participe aux plus grandes courses africaines, du
Cameroun au Burkina Faso en passant par le Togo. Son amie
Agnès B lui a donné un coup de main financier pour acheter
quelques vélos. L'année dernière, l'artiste a pris la tête de la
Fédération béninoise de cyclisme. Touche-à-tout, il vient aussi
d'ouvrir un restaurant à Cotonou. Si l'on prononce devant lui le
mot autodidacte, il esquisse une grimace : "C'est un terme qui
ne convient pas à l'Afrique. Ici, personne n'est autodidacte.
Dès notre plus jeune âge à Porto Novo, nous sommes initiés.
Nous rentrons dans des sociétés secrètes où l'on nous apprend
à faire des masques. Ce qui compte au Bénin, c'est d'avoir été
choisi par le "fa " (l'oracle). Si le fa a jeté son dévolu sur vous, on
vous fera accéder à certaines connaissances, c'est plus important que les années
d'apprentissage" explique Hazoumé, dont l'aïeul était un"babalao'; un "prêtre du fa','venu du
Nigeria. "Je suis ce que l'on appelle un "haré" un itinérant, qui possède une connaissance
léguée : elle permet d'être au-dessus des autres et de savoir mieux faire que ceux qui ont reçu
un long apprentissage. Si le fa (l'oracle) décide que c'est toi qui auras ce don !" affirme
Hazoumé sans broncher.
Inutile de lui demander de préciser sa pensée, Hazoumé répond par une autre énigme : "Celui
qui sait ne dit pas qu'il sait .'"et "Celui qui est de l'autre côté de la ligne ne dit pas qu'il est de
l'autre côté de la ligne." Avec ce voyageur africain d'un nouveau genre, les douaniers risquent
de perdre leur latin.
Les parents d'Hazoumé rêvaient que leur fils soit douanier, comme son père. Mais le fils de Porto
Novo a trouvé un autre moyen de se jouer des "interdits" Avec le "masque bidon';il a inventé
le"gri-gri passe-frontière"
Pierre Cherruau (Ulysse n°124)
Gaston-Paul Effa : romancier ou anthropologue
Nous, enfants de la tradition, son septième roman, est à la fois
élégiaque et critique. L’auteur camerounais y incrimine la société
africaine engluée dans des traditions millénaires qui empêchent
l’individu de s’épanouir.
Pourquoi faut-il lire Gaston-Paul Effa ? Pour la grâce et la splendeur de
sa langue. C’est en véritable styliste du français qu’écrit ce
Camerounais talentueux qui explique volontiers comment il est
devenu « esclave » de cette langue bien que celle-ci soit arrivée au
Cameroun dans la valise du colonisateur. « J’entretiens une relation à
la fois de fascination et d’ambiguïté avec le français », aime-t-il
répéter. Et de raconter : « Dans mon village, l’école était dirigée par
des religieuses françaises. Chaque vendredi nous avions droit à une
dictée. Et nous recevions autant de coups de bâton que nous avions
fait de fautes.
J’aurais eu toutes les raisons de détester cette langue. Pourtant, je l’ai désirée ! Comme on
désire ce qui nous échappe. Je voulais tellement la dominer, la maîtriser que je suis devenu son
esclave. J’étais prêt à tout pour la posséder. »
Son esclave mais aussi son maître, comme le prouve encore son nouveau roman. Nous,
enfants de la tradition est un hommage de l’auteur à son Afrique natale (« le pays où l’air a la
couleur de l’amande, où les féticheurs marchent sur les pierres chaudes comme des chèvres
sauvages ») malgré la critique cinglante qu’il fait dans ce livre de la société africaine engluée
dans ses traditions si meurtrières pour l’épanouissement de l’individu.
Accablé par le poids de la tradition
Au cœur du récit, Osele. L’aîné de trente-trois enfants, cet élève brillant est envoyé en France
par sa communauté pour qu’il puisse parachever avec succès ses études d’ingénierie. Une fois
les études terminées, celui-ci s’installe dans son pays d’adoption. Marié à une Française, père
de deux enfants, il expédie tout son salaire aux siens, au grand désespoir de son épouse qui a
du mal à joindre les deux bouts avec son seul salaire d’enseignante. Exaspéré par la tradition
qui veut que l’Africain qui réussit doit porter à bout de bras toute sa communauté pendant le
reste de sa vie sous prétexte que la communauté a financé ses études, Hélène met son mari à
la porte. A la faveur de cette rupture conjugale, livré à lui-même dans un foyer Sonacotra où il
vit désormais, Osele réfléchit au poids de la tradition qui a empoisonné son existence et l’a
éloigné de ceux qui lui sont chers.
Dans la solitude de son exil intérieur et extérieur, il se remémore le passé, les liens solides qui le
rattachent à sa terre natale. Mais il en veut à sa famille de ne pas tenir compte de ses besoins
d’épanouissement personnel, de ses responsabilités de père de famille. A travers les pages qui
sont autant d’hymnes à la beauté, à la nuit et aux mystères d’une Afrique peut-être perdue à
tout jamais, jaillit le cri de cœur du jeune narrateur accablé par le poids de la tradition.
Il y a de la nostalgie, mais aussi beaucoup d’amertume et d’ironie. « A tous les coups, s’écrie
Osele, on dira que j’ai tort face à la tradition. On a toujours tort face à elle. Il faut lui obéir, se
soumettre à elle, paraît-il. Mais moi, j’ai envie de lui commander, je serai plus fort qu’elle.
Vraiment j’aurais aimé rire de cette légende : Job se promenait au pied du mont Cameroun
avec dans ses bras une calebasse pleine de traditions. En grimpant, il avait trébuché et le vase
de traditions s’était répandu à travers toute l’Afrique, qui devint ainsi le continent le plus poreux
aux us et coutumes…
Un conte contemporain plutôt qu’un roman
Malgré l’érudition et les éclats d’une langue souvent lyrique, on est un peu frustré par la
simplicité de l’intrigue de ce roman. Il manque la complexité des êtres et de la narration qui est
le véritable ressort de la bonne fiction. Mais en fin de compte,
il ne s’agit peut-être pas ici d’un roman dans le sens classique BIBLIOGRAPHIE
Tout ce bleu, roman, Grasset,
du terme, mais plutôt d’un récit anthropologique sur le thème 1996 ;
du don, sur le conflit des générations au sein d’une Afrique Mâ, roman, Grasset, 1998
(sélectionné pour le prix Renaudot), Prix
millénaire. En somme, un conte contemporain sur la guerre Erckmann-Chatrian 1998 et Grand prix
des anciens et des modernes, avec pour cadre la France- littéraire de l’Afrique Noire 1998 ;
Le cri que tu pousses ne
Afrique qui est moins une géographie qu’un territoire du vécu réveillera personne, roman, Gallimard,
et de l’esprit. collection Continents noirs, 2000.
Aux éditions Pierron, il a publié
Couleurs des temps en collaboration
avec Isabelle Lebrat et Daniel Manzi,
1999 ;
Nous, enfants de la tradition, par Gaston-Paul Effa. Icône, sanctuaire de la présence
Editions Anne Carrière, 166 pages, 17 euros. en collaboration avec Geneviève
Gouverneur en 2000.
Cheval-Roi est publié en
septembre 2001 au Rocher.
Tous les enfants du monde, en
collaboration avec Isabelle Lebrat,
poète et Clément Jung, photographe,
mai 2003, Pierron.
Le Juif et l’ Africain, double
offrande, essai, en collaboration avec
Gabriel Attias, Rocher, 2003.
Le livre de l’Alliance , dialogue
avec André Chouraqui, aux éditions
Bibliophane , Daniel Radford Editeur,
2003.
La salle des professeurs, roman,
Editions du Rocher, 2004.
Cette langue est bien ce feu, en
collaboration avec Isabelle Lebrat,
poète et Lassaâd Metoui, calligraphe,
éditions du Laquet, 2004.
Sons en forêt camerounaise : l’Orchestre Baka Gbiné
Douala 13/04/2006 - RFI
Le premier disque d’un groupe de musiciens pygmées de l’Est du Cameroun, Baka Gbiné, enregistré par un
guitariste britannique, sort le 24 avril prochain en Grande-Bretagne. Une belle réussite pour un projet atypique.
"Ce n’est pas de la musique pour les anthropologues, mais bien de la
musique moderne", prévient Martin Cradick. Le disque produit par ce
musicien britannique sort cependant de l’ordinaire. Première particularité
de Gati Bongo : il a été enregistré dans une région reculée de l’Est du
Cameroun, au cœur de la zone forestière tropicale du Bassin du Congo.
Seconde spécificité, il met en scène l’Orchestre Baka Gbiné, un groupe
de musiciens pygmées, ce qui est plutôt rare : généralement, les
pygmées, peuples nomades des forêts, sont très peu pris en compte par
le reste de la société camerounaise. Ils n’ont guère le droit à la parole et
donc encore moins la possibilité de s’exprimer devant un micro. Enfin,
l’histoire même de la création de Gati Bongo est originale.
Elle a commencé en 1988. Martin Cradick, alors guitariste du groupe
anglais Outback, tombe par hasard sur une émission télévisée consacrée à la musique des pygmées baka du
Cameroun. Il est fasciné par les rythmes et les sons qu’il entend. Avec sa guitare, il tente de les reproduire.
Finalement, de ces essais, il tire un morceau qui donne son nom à un album d’Outback, Baka. "Je m’étais dit
devant cette émission : il faut que j’aille au Cameroun, se souvient Martin. Mais c’était un rêve…" Su Hart, sa
femme et par ailleurs chanteuse d’Outback, trouve pourtant les moyens de le concrétiser auprès d’une petite
Fondation qui s’intéresse aux peuples dits "autochtones".
Rythmes doux et syncopés
En 1992, ils se rendent tous les deux dans l’Est du Cameroun, à Banana, un
village de pygmées devenus en partie sédentaires. Ils y découvrent que
certains de leurs hôtes, Mbeh et Pelembir, jouent de la guitare. Grâce à
eux, ils apprennent notamment à reconnaître le yelli, un chant
qu’entonnent les femmes, juste avant le lever du jour, pour ensorceler les
animaux et faciliter ainsi la tâche de leurs maris chasseurs. Pendant ces
quelques semaines, tous passent beaucoup de temps à faire de la
musique ensemble. Martin se rend compte que "les rythmes de la
musique baka, à la fois doux et syncopés, constituent le joint parfait pour
réunir des éléments musicaux de différentes origines". Il prend l’habitude
d’enregistrer avec un petit magnétophone leurs créations communes,
pour, pourquoi pas, y puiser plus tard des idées.
Quelques mois après, il sort un disque, Spirit of the forest, largement inspiré de ses découvertes de Banana. "L’idée,
c’était de recréer l’ambiance des séances de musique qui se tiennent souvent l’après midi et presque chaque
soir en forêt", explique-t-il. Séduite, sa maison de disques produit un second album, Heart of the forest. En 1995,
Martin et Su vont plus loin dans leur entreprise : ils créent Global Music Exchange, une ONG chargée de
redistribuer aux Baka une partie des fonds rapportés par ces deux premières productions. Avec un impératif : les
habitants de Banana doivent décider seuls de leur utilisation. Un petit dispensaire, une "maison de la musique" font
ainsi partie de leurs premières réalisations. Une association de développement local, Gbiné, voit le jour, l’Orchestre
Baka Gbiné aussi. Pendant ce temps, Martin, avec Baka Beyond, son nouveau groupe, composé d’artistes
européens et africains, continue de créer, à Bath, en Grande-Bretagne, une musique qui mélange diverses
influences, celtiques et baka notamment. Le guitariste anglais se rend également régulièrement à Banana.
Première pour Baka Gbiné
En 2004, il y enregistre, avec du matériel de plus en plus sophistiqué,
alimenté par l’énergie solaire, de nouvelles productions. Il en retravaille une
partie avec Baka Beyond qui en fait un nouvel album, Rhythm Tree. Gati
Bongo est sa suite logique : cette fois, il s’agit uniquement des
enregistrements, réalisés dans la chaleur de Banana, de morceaux créés et
interprétés par le Baka Gbiné, soit une vingtaine de musiciens et chanteurs.
Basse, guitares, percussions et mandoline à l’appui, le résultat est bluffant,
aussi bien sur le plan de la qualité sonore que celui de la musique, à la fois
festive et soignée. "Cet album parle de la vie de tous les jours, commente
Martin. Il y a plusieurs textes sur les relations hommes-femmes, par exemple.
Comme chez nous, d’ailleurs. Que ce soit en Occident ou dans la forêt
tropicale, nous vivons tous les mêmes choses, nous sommes tous pareils". A leur
tour, les pygmées de Banana vont pouvoir s’en rendre compte puisque,
grande première, l’Orchestre Baka Gbiné se produira en Grande-Bretagne au cours du mois de mai.
Gati Bongo Orchestre Baka Gbiné (March Hare Music) 2006
Discographie BAKA BEYOND
* Spirit of the Forest (1993, Hannibal/Rykodisc)
* The Meeting Pool (1995, Hannibal/Rykodisc)
Ça date de
* Live and Pedal-Powered (1996, March Hare Music) 2006 mais
* Journey Between (1998, Hannibal/Rykodisc)
* Unplugged (1999, March Hare Music) vraiment ça
* Sogo (2000, Hannibal/Rykodisc)
* Official Bootleg Series (2000)
vaut le
* East to West (2002, March Hare Music)
* The Rythm Tree (2005, March Hare Music)
détour !!!
Beaucoup d’autres renseignements sur cette incroyable métissage musical
http://rythmes-croises.org/ethnotempos/articles/baka_beyond.htm
Regards…
You might also like
- Pronom Coi Ou Pronom ToniqueDocument3 pagesPronom Coi Ou Pronom ToniqueJohn Boumtche0% (1)
- Billet ÉlectroniqueDocument2 pagesBillet ÉlectroniqueAyoub EnergieNo ratings yet
- CTM PrésentationDocument22 pagesCTM PrésentationOmar Afra100% (1)
- Gisti - Le Guide Des Etrangers Face A L'administrationDocument281 pagesGisti - Le Guide Des Etrangers Face A L'administrationdanyNo ratings yet
- Arbre À Palabres N°33Document28 pagesArbre À Palabres N°33routedesenfantsNo ratings yet
- Sida Sa Palabres 30Document4 pagesSida Sa Palabres 30routedesenfantsNo ratings yet
- Kouamb'a Palabres 30Document7 pagesKouamb'a Palabres 30routedesenfantsNo ratings yet
- Burkin'+á Palabres 30Document7 pagesBurkin'+á Palabres 30gilquentinNo ratings yet
- Kouamb'a Palabres 29Document7 pagesKouamb'a Palabres 29gilquentinNo ratings yet
- Kouamb'a Palabres 29Document7 pagesKouamb'a Palabres 29gilquentinNo ratings yet
- Sida Sa Palabres 29Document1 pageSida Sa Palabres 29gilquentinNo ratings yet
- Afric'+á Palabres 29Document10 pagesAfric'+á Palabres 29gilquentinNo ratings yet
- Etudiant Request AgadirDocument1 pageEtudiant Request AgadirYouness0% (1)
- Corrigés DELF B1Document2 pagesCorrigés DELF B1ChristineNo ratings yet
- Formation Académique: Gestion Logistique Et TransportDocument1 pageFormation Académique: Gestion Logistique Et TransportVidal SokamteNo ratings yet
- Guideaustralie2021vf CompressedDocument96 pagesGuideaustralie2021vf CompressedAxel ADDESSONo ratings yet
- Contrat TravailDocument4 pagesContrat Travailcare upNo ratings yet
- Syllabus B1.1 Version Finale OkDocument5 pagesSyllabus B1.1 Version Finale OkDamarisNo ratings yet
- mc9 Test Vers A Un1Document6 pagesmc9 Test Vers A Un1Mike MicasNo ratings yet
- L'impact Du COVID-19 Sur Le E-Tourisme: Travaillé ParDocument11 pagesL'impact Du COVID-19 Sur Le E-Tourisme: Travaillé ParMariem JtNo ratings yet
- Ad-2 Lfaq PDFDocument6 pagesAd-2 Lfaq PDFNicolas GiorgisNo ratings yet
- 2009 Cas Club MedDocument4 pages2009 Cas Club MedMohamed LaqrifiNo ratings yet
- Sujet - Principal - ATC - 2015Document13 pagesSujet - Principal - ATC - 2015Louis BmNo ratings yet
- Pouczenie Dla Cudzoziemca FRDocument111 pagesPouczenie Dla Cudzoziemca FRanna czereszkoNo ratings yet
- GLT S2 M8.3 TSP Voy Messagerie CRS ARIF PDFDocument45 pagesGLT S2 M8.3 TSP Voy Messagerie CRS ARIF PDFAbderrazzaq AbderrazzaqNo ratings yet
- Randonnee Le Fort de La Gavaresse Depuis La PlageDocument4 pagesRandonnee Le Fort de La Gavaresse Depuis La PlageAnto OrsiniNo ratings yet
- Oncf-Voyages-Yassine Chaachoue Yassine ChaachoueDocument1 pageOncf-Voyages-Yassine Chaachoue Yassine ChaachoueYassine ChaachoueNo ratings yet
- DVD 0000000020Document2 pagesDVD 0000000020Odilon Formadjo ChoforNo ratings yet
- PARIS NORD-LILLE FLANDRES 24-09-22 IMOUNGA DIENE LOIC ARMEL TTSFES ECRQnIT9E1Lm4dpduMDGDocument1 pagePARIS NORD-LILLE FLANDRES 24-09-22 IMOUNGA DIENE LOIC ARMEL TTSFES ECRQnIT9E1Lm4dpduMDGLoïc ImoungaNo ratings yet
- Tunisie Routes Non Revetues ZaidiMosbah PDFDocument68 pagesTunisie Routes Non Revetues ZaidiMosbah PDFMohamed Boudabbous100% (2)
- Chapitre 6Document55 pagesChapitre 6Mohamed El Meftahy100% (1)
- Regina THE Pearl: Boutique-Hôtel de Luxe À AnehoDocument12 pagesRegina THE Pearl: Boutique-Hôtel de Luxe À AnehoCarlitos DOE-BRUCENo ratings yet
- Lexique Des Voyages Activites Ludiques Feuille Dexercices Mots Croises 84876Document2 pagesLexique Des Voyages Activites Ludiques Feuille Dexercices Mots Croises 84876Amel Manai100% (1)
- Code Maritime 1967Document83 pagesCode Maritime 1967dadabenoelyNo ratings yet
- Dark Heresy Apocrypha Vehicules Et Montures Secteur Calixisfr PDFDocument20 pagesDark Heresy Apocrypha Vehicules Et Montures Secteur Calixisfr PDFTeddy PietteNo ratings yet
- Bedzed Part2 PDFDocument10 pagesBedzed Part2 PDFBenamar MohamedNo ratings yet
- 0520 s06 QP 1Document12 pages0520 s06 QP 1mstudy123456No ratings yet
- Cours Technique de TransportDocument45 pagesCours Technique de Transportyannick koffi93% (14)